Union Des Comores
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
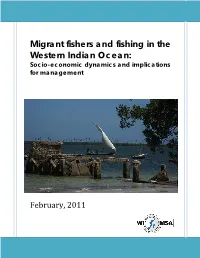
Ing in N the E
Migrant fishers and fishing in the Western Indian Ocean: Socio-economic dynamics and implications for management Februaryr , 2011 PIs: Innocent Wanyonyi (CORDIO E.A, Kenya / Linnaeus University, Sweden) Dr Beatrice Crona (Stockholm Resilience Center, University of Stockholm, Sweden) Dr Sérgio Rosendo (FCSH, Universidade Nova de Lisboa, Portugal / UEA, UK) Country Co‐Investigators: Dr Simeon Mesaki (University of Dar es Salaam)‐ Tanzania Dr Almeida Guissamulo (University of Eduardo Mondlane)‐ Mozambique Jacob Ochiewo (Kenya Marine and Fisheries Research Institute)‐ Kenya Chris Poonian (Community Centred Conservation)‐ Comoros Garth Cripps (Blue Ventures) funded by ReCoMaP ‐Madagascar Research Team members: Steven Ndegwa and John Muturi (Fisheries Department)‐ Kenya Tim Daw (University of East Anglia, UK)‐ Responsible for Database The material in this report is based upon work supported by MASMA, WIOMSA under Grant No. MASMA/CR/2008/02 Any opinions, findings and conclusions or recommendation expressed in this material are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the WIOMSA. Copyright in this publication and in all text, data and images contained herein, except as otherwise indicated, rests with the authors and WIOMSA. Keywords: Fishers, migration, Western Indian Ocean. Page | 1 Recommended citation: WIOMSA (2011). Migrant fishers and fishing in the Western Indian Ocean: Socio‐economic dynamics and implications for management. Final Report of Commissioned Research Project MASMA/CR/2008/02. Page | 2 Table of Contents -

Centre Souscentreserie Numéro Nom Et Prenom
Centre SousCentreSerie Numéro Nom et Prenom MORONI Chezani A1 2292 SAID SAMIR BEN YOUSSOUF MORONI Chezani A1 2293 ADJIDINE ALI ABDOU MORONI Chezani A1 2297 FAHADI RADJABOU MORONI Chezani A4 2321 AMINA ASSOUMANI MORONI Chezani A4 2333 BAHADJATI MAOULIDA MORONI Chezani A4 2334 BAIHAKIYI ALI ACHIRAFI MORONI Chezani A4 2349 EL-ANZIZE BACAR MORONI Chezani A4 2352 FAOUDIA ALI MORONI Chezani A4 2358 FATOUMA MAOULIDA MORONI Chezani A4 2415 NAIMA SOILIHI HAMADI MORONI Chezani A4 2445 ABDALLAH SAID MMADINA NABHANI MORONI Chezani A4 2449 ABOUHARIA AHAMADA MORONI Chezani A4 2450 ABOURATA ABDEREMANE MORONI Chezani A4 2451 AHAMADA BACAR MOUKLATI MORONI Chezani A4 2457 ANRAFA ISSIHAKA MORONI Chezani A4 2458 ANSOIR SAID AHAMADA MORONI Chezani A4 2459 ANTOISSI AHAMADA SOILIHI MORONI Chezani D 2509 NADJATE HACHIM MORONI Chezani D 2513 BABY BEN ALI MSA MORONI Dembeni A1 427 FAZLAT IBRAHIM MORONI Dembeni A1 464 KASSIM YOUSSOUF MORONI Dembeni A1 471 MOZDATI MMADI ADAM MORONI Dembeni A1 475 SALAMA MMADI ALI MORONI Dembeni A4 559 FOUAD BACAR SOILIHI ABDOU MORONI Dembeni A4 561 HAMIDA IBRAHIM MORONI Dembeni A4 562 HAMIDOU BACAR MORONI Dembeni D 588 ABDOURAHAMANE YOUSSOUF MORONI Dembeni D 605 SOIDROUDINE IBRAHIMA MORONI FoumboudzivouniA1 640 ABDOU YOUSSOUF MORONI FoumboudzivouniA1 642 ACHRAFI MMADI DJAE MORONI FoumboudzivouniA1 643 AHAMADA MOUIGNI MORONI FoumboudzivouniA1 654 FAIDATIE ABDALLAH MHADJOU MORONI FoumbouniA4 766 ABDOUCHAKOUR ZAINOUDINE MORONI FoumbouniA4 771 ALI KARIHILA RABOUANTI MORONI FoumbouniA4 800 KARI BEN CHAFION BENJI MORONI FoumbouniA4 840 -

World Bank Document
The World Bank COMOROS SOLAR ENERGY DEVELOPMENT PLATFORM (P162783) Note to Task Teams: The following sections are system generated and can only be edited online in the Portal. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Project Information Document/ Integrated Safeguards Data Sheet (PID/ISDS) Concept Stage | Date Prepared/Updated: 03-Feb-2020 | Report No: PIDISDSC21054 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Jan 12, 2017 Page 1 of 12 The World Bank COMOROS SOLAR ENERGY DEVELOPMENT PLATFORM (P162783) BASIC INFORMATION A. Basic Project Data OPS TABLE Country Project ID Parent Project ID (if any) Project Name Comoros P162783 Comoros Solar Energy Integration Platform (P162783) Region Estimated Appraisal Date Estimated Board Date Practice Area (Lead) AFRICA Mar 12, 2020 May 11, 2020 Energy & Extractives Financing Instrument Borrower(s) Implementing Agency Investment Project Financing Government of the Union of SONELEC Comoros Proposed Development Objective(s) Improve the commercial performance of SONELEC and its capacity to dispatch variable renewable energy. PROJECT FINANCING DATA (US$, Millions) SUMMARY-NewFin1 Total Project Cost 40.00 Total Financing 40.00 of which IBRD/IDA 40.00 Financing Gap 0.00 DETAILS-NewFinEnh1 World Bank Group Financing International Development Association (IDA) 40.00 IDA Grant 40.00 Environmental Assessment Category Concept Review Decision B - Partial Assessment Track II-The review did authorize the preparation to continue Jan 12, 2017 Page 2 of 12 The World Bank COMOROS SOLAR ENERGY DEVELOPMENT PLATFORM (P162783) Note to Task Teams: End of system generated content, document is editable from here. Other Decision (as needed) B. Introduction and Context Country Context Comoros is a fragile and conflict-affected country with considerable development challenges. -

Comoro Archipelago
GROUP STRUCTURE AND ACTIVITY RHYTHM IN LEMUR MONGOZ (PRIMATES, LEMURIFORMES) ON ANJOUAN AND MOHELI ISLANDS, COMORO ARCHIPELAGO IAN TATTERSALL VOLUME 53: PART 4 ANTHROPOLOGICAL PAPERS OF THE AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY NEW YORK :1976 4 .4.4.4.4 .4.4 4.4.4 .4.4 4.4 - . ..4 ..4.4.4 o -Q ¼' 11 I, -_7 Tf., GROUP STRUCTURE AND ACTIVITY RHYTHM IN LEMUR MONGOZ (PRIMATES, LEMURIFORMES) ON ANJOUAN AND MOHELI ISLANDS, COMORO ARCHIPELAGO IAN TATTERSALL Associate Curator, Department ofAnthropology TheAmerncan Museum ofNatural History VOLUME 53: PART 4 ANTHROPOLOGICAL PAPERS OF THE AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY NEW YORK: 1976 ANTHROPOLOGICAL PAPERS OF THE AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY Volume 53, Part 4, pages 367-380, figures 1-6, tables 1, 2 Issued December 30, 1976 Price. $1.1 5 ISSN 0065-9452 This Part completes Volume 53. Copyright i The American Museum of Natural History 1976 ABSTRACT A previous study in Madagascar revealed the day. This difference appears to be environ- Lemur mongoz to be nocturnal and to exhibit mentally linked. Further, on Anjouan L. mongoz pair-bonding. Subsequent work in the Comoro Is- exhibits pair-bonding and the formation of lands has shown that, whereas in the warm, "family" groups, but on Moheli there is variation seasonal lowland areas of Moheli and Anjouan L. in group structure. It is possible that group com- mongoz is likewise nocturnal, in the humid high- position of L. mongoz on Moheli undergoes lands of Anjouan these animals are active during seasonal change. RItSUMI! Une premiere etude de Lemur mongoz de jour. -

UNION DES COMORES Unité – Solidarité – Développement
UNION DES COMORES Unité – Solidarité – Développement --------- ! DIRECTION GENERALE DE L’ANACEP ---------- _________________________________________________ PROJET DE FILETS SOCIAUX DE SECURITES Accord de Financement N° D0320 -KM RAPPORT SEMESTRIEL D’ACTIVITES N° 05 Période du 1 er juillet au 31 décembre 2017 Février 2018 1 SIGLES ET ABREVIATIONS ACTP : Argent Contre Travail Productif ACTC : Argent Contre Travail en réponses aux Catastrophes AG : Assemblée Générale AGEX : Agence d’Exécution ANACEP : Agence Nationale de Conception et d’Exécution des Projets AGP : Agence de Paiement ANO: Avis de Non Objection AVD : Agent Villageois de Développement ANJE : Amélioration du Nourrisson et du Jeune Enfant BE : Bureau d’Etudes BM : Banque Mondiale CCC : Comité Central de Coordination CG : Comité de Gestion CGES : Cadre de Gestion Environnementale et Sociale CGSP : Cellule de Gestion de Sous Projet CI : Consultant Individuel CP : Comité de Pilotage CPR : Cadre de politique de Réinstallation CPS Comité de Protection Sociale CR : Comité Régional DAO : Dossier d’appel d’offre DEN : Directeur Exécutif National DGSC : Direction Générale de la Sécurité Civile DP : Demande de Proposition DER : Directeur Exécutif Régional DNO : Demande de Non Objection DSP : Dossier de sous- projet FFSE : Facilitateur chargé du Suivi Evaluation HIMO : Haute Intensité de Main d’Œuvres IDB : Infrastructure de Bases IDB C : Infrastructure De Base en réponse aux Catastrophes IEC : Information Education et Communication MDP : Mémoire Descriptif du Projet MWL : île de Mohéli -
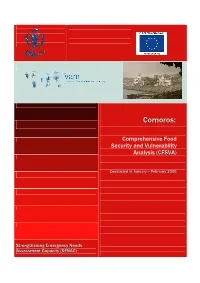
Comoros: Comprehensive Food Security and Vulnerability Analysis (CFSVA)
CCoommoorrooss:: Comprehensive Food Security and Vulnerability Analysis (CFSVA) Conducted in January – February 2006 Strengthening Emergency Needs Assessment Capacity (SENAC) 2 Comoros: Comprehensive Food Security and Vulnerability Analysis (CFSVA) Prepared by Tango International March, 2006 © World Food Programme, Vulnerability Analysis and Mapping Branch (ODAV) This study was prepared under the umbrella of the “Strengthening Emergency Needs Assessment Capacity” (SENAC) project. The SENAC project aims to reinforce WFP’s capacity to assess humanitarian needs in the food sector during emergencies and the immediate aftermath through accurate and impartial needs assessments. For any queries on this document or the SENAC project, please contact [email protected] or Krystyna Bednarska, Country Director Madagascar: [email protected] Eric Kenefick Regional VAM Officer Johannesburg: [email protected] For information on the VAM unit, please visit us at http://vam.wfp.org/ United Nations World Food Programme Headquarters: Via C.G. Viola 68, Parco de’ Medici, 00148, Rome, Italy This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union. 3 4 Comoros: Comprehensive Food Security and Vulnerability Analysis (CFSVA) Conducted January-February 2006 5 6 Acknowledgements The authors of this report would like to thank the United Nations-Comoros staff in Moroni for their assistance and support throughout the mission. Particular appreciation is due to Ms. Guiseppina Mazza, the UNDP Resident Representative, who assured our logistic and material support. In addition, we would like to acknowledge the efforts of the UN staff on Anjouan (Houmadi Abdallah) and on Mohéli (Nafion Mohammed). -

Projet De Collecte Et De Commercialisation De Cafe : Cas De Barakani, Region De Ouani, Anjouan Comores »
UNIVERSITE D’ANTANANARIVO Faculté de Droit, d’Economie, de Gestion et de Sociologie (DEGS) DEPARTEMENT ECONOMIE 3em cycle MEMOIRE DE FIN D’ETUDES EN VUE DE L’OBTENTION DU DIPLOME D’ETUDES SUPERIEURES SPECIALISEES (DESS) Option : Entreprise-Coopérative-Association (ECA) Thème « PROJET DE COLLECTE ET DE COMMERCIALISATION DE CAFE : CAS DE BARAKANI, REGION DE OUANI, ANJOUAN COMORES » Présenté par : Monsieur MIFTAHOU Bacar Encadreur Pédagogique: Monsieur LAZAMANA Pierre André, Maitre de conférences à l’Université d’Antananarivo Encadreur Professionnel : Monsieur RANDRIANARIJAONA Luis Jensen, Enseignant à l’Institut Privé des Novateurs de Madagascar Année Universitaire 2012-2013 Date de soutenance : 05 Octobre 2015 UNIVERSITE D’ANTANANARIVO Faculté de Droit, d’Economie, de Gestion et de Sociologie (DEGS) DEPARTEMENT ECONOMIE 3em cycle MEMOIRE DE FIN D’ETUDES EN VUE DE L’OBTENTION DU DIPLOME D’ETUDES SUPERIEURES SPECIALISEES (DESS) Option : Entreprise-Coopérative-Association (ECA) Thème « PROJET DE COLLECTE ET DE COMMERCIALISATION DE CAFE : CAS DE BARAKANI, REGION DE OUANI, ANJOUAN COMORES » Présenté par : Monsieur MIFTAHOU Bacar Encadreur Pédagogique: Monsieur LAZAMANA Pierre André, Maitre de conférences à l’Université d’Antananarivo Encadreur Professionnel : Monsieur RANDRIANARIJAONA Luis Jensen, Enseignant à l’Institut Privé des Novateurs de Madagascar Année Universitaire 2012-2013 REMERCIEMENTS Nous tenons d’ abord à remercier le seigneur Dieu, le Tout puissant, qui nous a donné la santé, le courage et la force de réaliser ce présent ouvrage. -

Schéma Directeur A.E.P. Mbadjini Est
Schéma Directeur A.E.P. Mbadjini Est Consultante : Marie-Pierre Lalaude-Labayle (MP2L) ONG : 2 Mains Bailleurs de fond : Agence de l’Eau Rhône - Méditerranée -Corse, Conseil Régional PACA Diaspora Mbadjini Est Date : Mars 2015 Version Finale 2 Mains - Schéma Directeur AEP Mbadjini Est Mars 2015 Acronymes AEP: Adduction d’Eau Potable AERMC: Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse A.T.: Assistant Technique ATPC: Assainissement Total Piloté par la Communauté B.F.: Borne-Fontaine (accès libre) B.I.: Branchement Individuel D.G.: Directeur Général DGEME: Direction Générale de l’Énergie des Mines et de l’Eau EHA: Eau Hygiène Assainissement HMT: Hauteur Manométrique Totale H.S. : Hors-Service KFM: Francs Comoriens PACA: Provence-Alpes-Côte d’Azur PEHD: Poly-Éthylène Haute-Densité PVC: PolyChlorure de Vinyle Q: Débit S.A.E.P.: Système d’Adduction en Eau Potable T.E.D. Traitement de l’Eau à Domicile 2 Mains - Schéma Directeur AEP Mbadjini Est Mars 2015 Bibliographie Analyse de la demande des usagers du services Eau et Assainissement, Guide Méthodologique #3, AFD-pS-Eau; Rapport sur le contexte social et politique Mbadjini Est, Adjmaël HALIDI, 2014; Fiche Coliformes totaux, Groupe scientifique sur l’eau Institut national de santé publique du Québec, Mai 2003; Fiche Contamination Fécale, Groupe scientifique sur l’eau Institut national de santé publique du Québec, Mai 2003; Caractérisation de l’origine de la salinité des eaux de la nappe côtière d’Agadir (Maroc), Y. HSISSOU, L. BOUCHAOU, M. KRIMISSA, J. MUDRY, 2001; Modalités de captage des eaux souterraines à la Réunion. Analyse critique de l’existant (tech- niques, coûts, opérateurs) BRGM/RP-56787-Fr, Novembre 2008; Programme d’Action National d’Adaptation aux changements climatiques (PANA), 2006; Résultats et Interprétations d’une campagne de pompages d’essai sur des puits dans les aqui- fères de base, Grande-Comore, D. -

21 3 223 225 Golovatch Comores.P65
Arthropoda Selecta 21(3): 223225 © ARTHROPODA SELECTA, 2012 New records of millipedes from the Comoro Islands (Diplopoda) Íîâûå íàõîäêè ìíîãîíîæåê-äèïëîïîä ñ Êîìîðñêèõ îñòðîâîâ (Diplopoda) C. Rollard1 & S.I. Golovatch2 Ê. Ðîëëàð1, Ñ.È. Ãîëîâà÷2 1 Muséum national dHistoire naturelle, Département Systématique & Evolution, UMR 7205 OSEB, Section Arthropodes, 57 rue Cuvier, CP 53, 75005 Paris, France. 2 Institute for Problems of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, Leninsky pr. 33, Moscow 119071, Russia. 2 Èíñòèòóò ïðîáëåì ýêîëîãèè è ýâîëþöèè ÐÀÍ, Ëåíèíñêèé ïð. 33, Ìîñêâà 119071 Ðîññèÿ. KEY WORDS: Diplopoda, fauna, Comoros. ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÑËÎÂÀ: Diplopoda, ôàóíà, Êîìîðñêèå îñòðîâà. ABSTRACT. A small collection of diplopods from MW05, Lake Dziani Boundouni, degraded dry forest (60 m), the Comoros contains nine species, two of which repre- 31.10.2008.; 1 juv.: Mohéli, MW16, Chalet St Antoine, natural sent new island records. The fauna (16 species) is forest on crest (700 m), 4.11.2008. confirmed to be depauperate and dominated by anthro- REMARKS. This pantropical species is quite com- pochore species, but several seem to be local endemics mon on all of the islands of the Comoro Archipelago (4) or subendemics (3). [VandenSpiegel & Golovatch, 2007]. ÐÅÇÞÌÅ. Íåáîëüøîé ìàòåðèàë äèïëîïîä ñ Êî- ìîðñêèõ îñòðîâîâ ñîäåðæèò äåâÿòü âèäîâ, äâà èç Family Pachybolidae êîòîðûõ âïåðâûå óêàçàíû äëÿ îäíîãî èç îñòðîâîâ. Ïîäòâåðæäàåòñÿ, ÷òî ôàóíà (16 âèäîâ) îáåäíåíà è â íåé äîìèíèðóþò àíòðîïîõîðíûå âèäû, íî â åå ñî- Leptogoniulus sorornus (Butler, 1876) ñòàâå, î÷åâèäíî, åñòü è ìåñòíûå ýíäåìèêè (4) è ñóáýíäåìèêè (3). MATERIAL. 1 juv.: Anjouan, ND16, Hajoho Bay, back beach, degraded forest (2 m), 16.11.2010; 1 $: Grande Comore, NG01, Mt Dima Kora, Lake Hantsangoma, banana plants (1000 m), Introduction 19.10.2008. -

Arret N°16-016 Primaire Ngazidja
H h ~I'-I courcon5t~liorwr~ UNION DES COMORES Olll\;I\IHliWif,!' Unité - Solidarité - Développement ARRET N° 16-016/E/P/CC PORTANT PROCLAMATION DES RESULTATS DEFINITIFS DE L'ELECTION PRIMAIRE DE L'ILE DE NGAZIDJA La Cour constitutionnelle, VU la Constitution du 23 décembre 200 l, telle que révisée; VU la loi organique n° 04-001/ AU du 30 juin 2004 relative à l'organisation et aux compétences de la Cour constitutionnelle; VU la loi organique n° 05-014/AU du 03 octobre 2005 sur les autres attributions de la Cour constitutionnelle modifiée par la loi organique n° 14-016/AU du 26juin 2014; VU la loi organique n° 05-009/AU du 04 juin 2005 fixant les conditions d'éligibilité du Président de l'Union et les modalités d'application de l'article 13 de la Constitution, modifiée par la loi organ ique n? 10-019/ AU du 06 septembre 2010 ; VU la loi n° 14-004/AU du 12 avril 2014 relative au code électoral; VU le décret n° 15- 184/PR du 23 novembre 2015 portant convocation du corps électoral pour l'élection du Président de l'Union et celles des Gouverneurs des Iles autonomes; VU l'arrêt n? 16-001 /E/CC du 02 janvier 2016 portant liste définitive des candidats à l'élection du Président de l'Union de 2016; VU l'arrêté n° 15- 130/MIIDIICAB du 01 décembre 2015 relatif aux horaires d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote pour l'élection du Président de l'Union et celles des Gouverneurs des Iles Autonomes; VU le circulaire n? 16-037/MIIDIICAB du 19 février 2016 relatifau vote par procuration; VU la note circulaire n° 16-038/MIIDIICAB du 19 février -

Priorities for Sustainable and Equitable Development of the Tourism Sector on Mohéli, Union of the Comoros
ISSN 1754-5188 C3 TECHNICAL REPORT SERIES NO. 5 PRIORITIES FOR SUSTAINABLE AND EQUITABLE DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR ON MOHÉLI, UNION OF THE COMOROS Community Centred Conservation C3-Comores 2008 Community Centred Conservation (C3) Sustainable Tourism on Mohéli © C3-Comores 2008 C3-Comores is a collaborative initiative between Community Centred Conservation (C3), a non- profit company registered in England and Wales no. 5606924 and Comorian partner organizations. The research described in this report is part of the project: Operation Mohéli: Linking Conservation of Marine Flagship Species with Sustainable Development, supported by a Future Conservationist Award from the BP Conservation Leadership Programme. Suggested citation: C3-Comores (2008) PRIORITIES FOR SUSTAINABLE AND EQUITABLE DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR ON MOHÉLI, UNION OF THE COMOROS. C3 Technical Report Series No. 5. ISSN 1754-5188. Community Centred Conservation (C3), London, UK. 38pp Bungalows at Hoani FOR MORE INFORMATION Community Centred Conservation (C3) Mohéli Marine Park (PMM) www.c-3.org.uk Nioumachoua, Mohéli [email protected] [email protected] C3-Comores Association d’Intervention pour le Développement et l’Environnement (AIDE) BP 8310, Iconi, Grande Comore tel. +269 73 75 04 B.P. 1292 Moroni, Grand Comore GSM +269 36 75 06 www.aide.africa-web.org The BP Conservation Leadership Maison de l’écotourisme de Mohéli Programme Bandar es Salam, Mohéli http://conservation.bp.com/ www.mohéli-tourisme.com http://www.conservationleadershipprogramme.org Community Centred Conservation (C3) Sustainable Tourism on Mohéli PRIORITIES FOR SUSTAINABLE AND EQUITABLE DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR ON MOHÉLI, UNION OF THE COMOROS PRIORITES POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE ET EQUITABLE DU SECTEUR TOURISTIQUE DE MOHÉLI, UNION DES COMORES P.Z.R. -

World Bank Document
Public Disclosure Authorized UNION DES COMORES Unité-Solidarité-Développement ************** MINISTÈRE DE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE ET DE L’ENVIRONNEMENT ------------------------------- Direction Générale des Ressources Halieutiques (DGRH) -------------------- Premier Projet de Gouvernance des Pêches et Croissance Partagée du Sud-Ouest de l’Océan Indien (SWIOFISH1) P132123/P132029 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL RELATIF A L’EXTENSION DU MAGASIN DE STOCKAGE DES EQUIPEMENTS ET MATERIELS DE PECHE A NDRONDRONI Public Disclosure Authorized PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE Consultant : ISSOUF INRFANE Initiateur du projet : Projet SWIOFish1 Titulaire du sous-projet : Association des pêcheurs de Ndrondroni (Manyunyi) Intitulé du sous-projet : Extension du magasin de stockage des équipements et matériels de pêche. Réf contrat: CONTRAT N°19- 06 /MEAPE/SWIOFish1 Commune de : Mlédjélé Village de : Ndrondroni Localisation du Site : Le site de construction de l’infrastructure se trouve dans le village de Miremani/Ndrondroni dans la commune de Mlédjélé. Il se trouve précisément au bord de la plage de Miremani. On accède au site en empruntant une piste non revêtue d’environ 500 m à partir du village de Ndrondroni ou 1km à partir de Ouallah II. Il se situe au bord de la plage à environ 80m de la mer. Hoani Dom oni Mbatse Mtak oudja NDRONDRONI Ham ba Fomboni Barakani Bangom a Bandaressalam Miringoni Djoy ezi Ouallah Ziroudani Hagnam ouada Ouanani Kangani Ndrondroni Ndremeani Mouahani Itsam ia Nioum ac houa Sam bia Ham avouna Le sous projet consiste à faire une extension du magasin de stockage d’équipement et matériels de pêche existant. C’est une grande salle de 40m2 qui sera construit avec une fondation en maçonnerie de moellon et des murs en agglo de 15x50x20 et couvert par un plancher en béton armé muni d’acrotère et des colonnes de descente d’eau.