2 Presenta Tion Generale Des Comores
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
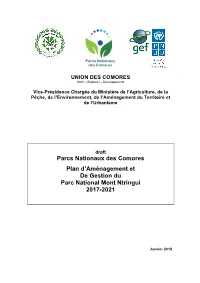
Parc National Mont Ntringui 2017-2021
Parcs Nationaux RNAPdes Comores UNION DES COMORES Unité – Solidarité – Développement Vice-Présidence Chargée du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche, de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme draft Parcs Nationaux des Comores Plan d’Aménagement et De Gestion du Parc National Mont Ntringui 2017-2021 Janvier 2018 Les avis et opinions exprimés dans ce document sont celles des auteurs, et ne reflètent pas forcément les vues de la Vice-Présidence - Ministère de l’Agriculture, de la Pêche, de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme, ni du PNUD, ni du FEM (UNDP et GEF) Mandaté Par L’Union des Comores, Vice-Présidence Chargée du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche, de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme, Parcs nationaux des Comores Et le Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD Fonds Mondial pour l’Environnement, FEM Maison du PNUD, Hamramba BP. 648, Moroni, Union des Comores T +269 7731558/9, F +269 7731577 www.undp.org Titre du Projet d’appui RNAP Développement d’un réseau national d’aires protégées terrestres et marines représentatives du patrimoine naturel unique des Comores et cogérées par les communautés villageoises locales. PIMS : 4950, ID ATLAS : 00090485 Citation : Parcs nationaux des Comores (2017). Plan d’Aménagement et de Gestion du Parc national Mont Ntringui. 2017-2021. 94 p + annexes 84 p. Pour tous renseignements ou corrections : Lacroix Eric, Consultant international UNDP [email protected] Fouad Abdou Rabi, Coordinateur RNAP [email protected] Plan d’aménagement et de gestion du Parc national Ntringui – 2018 2 Avant-propos Depuis 1994 le souhait des Comoriennes et Comoriens et de leurs amis du monde entier est de mettre en place un Système pour la protection et le développement des aires protégées des Comores. -
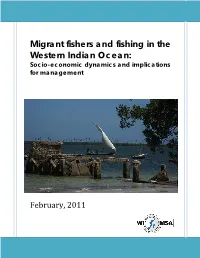
Ing in N the E
Migrant fishers and fishing in the Western Indian Ocean: Socio-economic dynamics and implications for management Februaryr , 2011 PIs: Innocent Wanyonyi (CORDIO E.A, Kenya / Linnaeus University, Sweden) Dr Beatrice Crona (Stockholm Resilience Center, University of Stockholm, Sweden) Dr Sérgio Rosendo (FCSH, Universidade Nova de Lisboa, Portugal / UEA, UK) Country Co‐Investigators: Dr Simeon Mesaki (University of Dar es Salaam)‐ Tanzania Dr Almeida Guissamulo (University of Eduardo Mondlane)‐ Mozambique Jacob Ochiewo (Kenya Marine and Fisheries Research Institute)‐ Kenya Chris Poonian (Community Centred Conservation)‐ Comoros Garth Cripps (Blue Ventures) funded by ReCoMaP ‐Madagascar Research Team members: Steven Ndegwa and John Muturi (Fisheries Department)‐ Kenya Tim Daw (University of East Anglia, UK)‐ Responsible for Database The material in this report is based upon work supported by MASMA, WIOMSA under Grant No. MASMA/CR/2008/02 Any opinions, findings and conclusions or recommendation expressed in this material are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the WIOMSA. Copyright in this publication and in all text, data and images contained herein, except as otherwise indicated, rests with the authors and WIOMSA. Keywords: Fishers, migration, Western Indian Ocean. Page | 1 Recommended citation: WIOMSA (2011). Migrant fishers and fishing in the Western Indian Ocean: Socio‐economic dynamics and implications for management. Final Report of Commissioned Research Project MASMA/CR/2008/02. Page | 2 Table of Contents -

Centre Souscentreserie Numéro Nom Et Prenom
Centre SousCentreSerie Numéro Nom et Prenom MORONI Chezani A1 2292 SAID SAMIR BEN YOUSSOUF MORONI Chezani A1 2293 ADJIDINE ALI ABDOU MORONI Chezani A1 2297 FAHADI RADJABOU MORONI Chezani A4 2321 AMINA ASSOUMANI MORONI Chezani A4 2333 BAHADJATI MAOULIDA MORONI Chezani A4 2334 BAIHAKIYI ALI ACHIRAFI MORONI Chezani A4 2349 EL-ANZIZE BACAR MORONI Chezani A4 2352 FAOUDIA ALI MORONI Chezani A4 2358 FATOUMA MAOULIDA MORONI Chezani A4 2415 NAIMA SOILIHI HAMADI MORONI Chezani A4 2445 ABDALLAH SAID MMADINA NABHANI MORONI Chezani A4 2449 ABOUHARIA AHAMADA MORONI Chezani A4 2450 ABOURATA ABDEREMANE MORONI Chezani A4 2451 AHAMADA BACAR MOUKLATI MORONI Chezani A4 2457 ANRAFA ISSIHAKA MORONI Chezani A4 2458 ANSOIR SAID AHAMADA MORONI Chezani A4 2459 ANTOISSI AHAMADA SOILIHI MORONI Chezani D 2509 NADJATE HACHIM MORONI Chezani D 2513 BABY BEN ALI MSA MORONI Dembeni A1 427 FAZLAT IBRAHIM MORONI Dembeni A1 464 KASSIM YOUSSOUF MORONI Dembeni A1 471 MOZDATI MMADI ADAM MORONI Dembeni A1 475 SALAMA MMADI ALI MORONI Dembeni A4 559 FOUAD BACAR SOILIHI ABDOU MORONI Dembeni A4 561 HAMIDA IBRAHIM MORONI Dembeni A4 562 HAMIDOU BACAR MORONI Dembeni D 588 ABDOURAHAMANE YOUSSOUF MORONI Dembeni D 605 SOIDROUDINE IBRAHIMA MORONI FoumboudzivouniA1 640 ABDOU YOUSSOUF MORONI FoumboudzivouniA1 642 ACHRAFI MMADI DJAE MORONI FoumboudzivouniA1 643 AHAMADA MOUIGNI MORONI FoumboudzivouniA1 654 FAIDATIE ABDALLAH MHADJOU MORONI FoumbouniA4 766 ABDOUCHAKOUR ZAINOUDINE MORONI FoumbouniA4 771 ALI KARIHILA RABOUANTI MORONI FoumbouniA4 800 KARI BEN CHAFION BENJI MORONI FoumbouniA4 840 -

Comoros Business Profile
COMOROS BUSINESS PROFILE Country official Name Union of the COMOROS Area 1 861 km² Population 0.851 Million Inhabitants Time UTC+3 Capital Moroni Comoros Franc (KMF) Currency 1 KMF = 0,0024 USD, 1 USD = 417,5767 KMF Language Arabic, French Major cities Moutsamoudou, Fomboni, Domoni, Tsimbeo, Adda-Douéni, Sima, Ouani, Mirontsi Member since 1976 OIC Member State Date Bilateral Investment Treaties Within OIC United Arab Emirates, Burkina Faso, Egypt Member States TPSOIC and protocols (PRETAS and Rules of Signed, not Ratified Origin) WTO Observer Regional and bilateral trade Agreements Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) GDP growth (annual %) 2.50 % in 2019 The country mainly exports cloves (45%), vanilla (32.3%), essential oils (12.3%), machines for cleaning or Economic sectors grading seeds (2%), and motor vehicles (1.7%). Its main imports include motor vehicles (11.9%), electric sound or visual signalling apparatus (11.6%), rice (9.3%), cement (7.1%), and meat (5%). 2019 World Exports USD 49 Millions World Imports USD 204 Millions Market Size USD 253 Millions Intra-OIC Exports USD 3.7 Millions Intra-OIC Exports share 7.43% UAE, Pakistan, Benin, Sudan, Oman, Turkey, Malaysia, Uganda, Saudi Arabia, Indonesia, Morocco, Egypt, Top OIC Customers Mozambique, Tunisia, Bangladesh Cloves, whole fruit, cloves and stems, Vanilla, Motor vehicles for the transport of goods, incl. chassis with engine and cab, Containers, incl. containers for the transport of fluids, specially designed and equipped for . Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of >= 600 mm, cold-rolled "cold- reduced", Trunks, suitcases, vanity cases, executive-cases, briefcases, school satchels, spectacle Major Intra-OIC exported products cases, Fuel wood, in logs, billets, twigs, faggots or similar forms; wood in chips or particles; sawdust . -
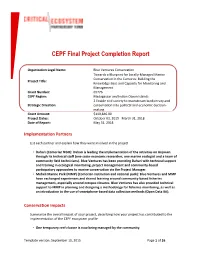
CEPF Final Project Completion Report
CEPF Final Project Completion Report Organization Legal Name: Blue Ventures Conservation Towards a Blueprint for Locally-Managed Marine Conservation in the Comoros: Building the Project Title: Knowledge Base and Capacity for Monitoring and Management Grant Number: 65776 CEPF Region: Madagascar and Indian Ocean Islands 2 Enable civil society to mainstream biodiversity and Strategic Direction: conservation into political and economic decision- making. Grant Amount: $149,846.00 Project Dates: October 01, 2015 - March 31, 2018 Date of Report: May 31, 2018 Implementation Partners List each partner and explain how they were involved in the project • Dahari (Comorian NGO): Dahari is leading the implementation of the activities on Anjouan through its technical staff (one socio-economic researcher, one marine ecologist and a team of community field technicians). Blue Ventures has been providing Dahari with technical support and training in ecological monitoring, project management and community-based participatory approaches to marine conservation via the Project Manager. • Moheli Marine Park (MMP) (Comorian institution and national park): Blue Ventures and MMP have exchanged experiences and shared learning around community-based fisheries management, especially around octopus closures. Blue Ventures has also provided technical support to MMP in planning and designing a methodology for fisheries monitoring, as well as an introduction to the use of smartphone-based data collection methods (Open Data Kit). Conservation Impacts Summarize the overall impact of your project, describing how your project has contributed to the implementation of the CEPF ecosystem profile • One temporary reef closure is now being managed by the community. Template version: September 10, 2015 Page 1 of 16 • The creation of a fisherwomen’s association is filling the previous lack of representation of reef gleaning fisheries. -

Indian Ocean Islands Comoros & Mayotte
Indian Ocean Islands Comoros & Mayotte 26th September to 4th October 2020 (9 days) Mayotte Scops Owl by Daniel Keith Danckwerts Sprinkled through the tropical seas off East Africa are a series of volcanic and coralline islands where paradise is defined in a most exquisite beauty! On our exploration of these idyllic isles, we will search for birds in the most spectacular scenery; be it rugged forest-clad volcanic peaks, verdant forest patches or white, shell-laden beaches fringed by warm water and teeming marine life. Island wildlife is generally susceptible to extinction, however, and the islands of this area are no exception with birds like the unfortunate Dodo serving as stark reminders of Mans’ heavy hand. The Comoros Archipelago, in particular, consists of a series of volcanic islands off the central-east African coast. They are divided between the Union of the Comoros – a sovereign nation formed by the three islands of Grande Comoro, Anjouan & Mohéli – and the French overseas department of Mayotte. The vast evergreen forests that once dominated these islands have largely been removed, leaving only a few remaining pockets of RBL Indian Ocean Islands – Comoros Itinerary 2 pristine habitat. Collectively, the four islands boast roughly 24 endemic species but this will likely reach a staggering 40 with further research. The addition of incredible scenery, a series of easily approachable active volcanoes and particularly friendly locals have made these islands an enticing and rewarding experience. We welcome you to join us as we island-hop with binoculars in hand on our quest to find the birds of these heavenly Indian Ocean isles. -

Mission 1 Cadre Institutionnel
UNION DES COMORES --------------------- VICE –PRESIDENCE EN CHARGE DU MINISTERE DE LA PRODUCTION, DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ENERGIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT ------------------- DIRECTION GENERALE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DE L’EAU (DGEME) UNITE DE GESTION DU PROJET ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT --------------------- PROJET D ’A LIMENTATION EN EAU POTABLE ET D SSAINISSEMENT DANS LES ILES DE ’A (AEPA) 3 L’U NION DES COMORES (F INANCEMENT BAD) ETUDES TECHNIQUES, DU CADRE INSTITUTIONNEL ET DU PROGRAMME NATIONAL D’AEPA Mission 1 : Elab oration du cadre institutionnel, o rganisationnel et financier du s ecteur d’AEPA Edition définitive JUIN 2013 71, Avenue Alain Savary Bloc D – 2ème étage - App 23 ENTREPRISE D’ETUDES DE DEVELOPPEMENT RURAL 1003 Cité El Khadra - Tunis EEDR MAMOKATRA S.A. Tél : (216) 71 809 686 Société Anonyme au capital de 20.000.000 d’Ariary Fax : (216) 71 806 313 Siège social : Villa Mamokatra Nanisana E-mail : [email protected] 101 ANTANANARIVO Site web : www.hydroplante.com …: (261.20) 22 402-14 ; 22 403-78 * 961 E-mail : [email protected] 1 Elaboration du cadre institutionnel, organisationnel et financier du secteur de l’AEPA des Comores PAEPA PREFACE L’élaboration du cadre institutionnel, organisationnel et financier du secteur d’eau potable et d’Assainissement s’inscrit dans le cadre de la composante 1 du Projet d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement (PAEPA – Comores – projet n : P-KM-EA0-001) financé par un don de la Banque Africaine de Développement. Tel que défini par le rapport d’évaluation du projet, le PAEPA comprend quatre (4) composantes: (i) l’Etude du Cadre institutionnel, organisationnel et financier ainsi que l’élaboration d’un plan stratégique à l’horizon 2030; (ii) le développement et la réhabilitation des infrastructures d’alimentation en eau potable et d’assainissement (AEPA) de plusieurs localités dont Moroni, Ouani, Mutsamudu, Fomboni et Mbéni; (iii) l’Appui Institutionnel et (iv) la Gestion du Projet. -

Socmon Comoros NOAA
© C3 Madagascar and Indian Ocean Islands Programme 2010 C3 Madagascar and Indian Ocean Islands Programme is a collaborative initiative between Community Centred Conservation (C3), a non-profit company registered in England no. 5606924 and local partner organizations. The study described in this report was funded by the NOAA Coral Reef Conservation Program. Suggested citation: C3 Madagascar and Indian Ocean Islands Programme (2010) SOCIO- ECONOMIC ASSESSMENT AND IDENTIFICATION OF POTENTIAL SITES FOR COMMUNITY-BASED CORAL REEF MANAGEMENT IN THE COMOROS. A Report Submitted to the NOAA Coral Reef Conservation Program, USA 22pp FOR MORE INFORMATION C3 Madagascar and Indian Ocean NOAA Coral Reef Conservation Program Islands Programme (Comoros) Office of Response and Restoration BP8310 Moroni NOAA National Ocean Service Iconi 1305 East-West Highway Union of Comoros Silver Spring, MD 20910 T. +269 773 75 04 USA CORDIO East Africa Community Centred Conservation #9 Kibaki Flats, Kenyatta Beach, (C3) Bamburi Beach www.c-3.org.uk PO BOX 10135 Mombasa 80101, Kenya [email protected] [email protected] Cover photo: Lobster fishers in northern Grande Comore SOCIO-ECONOMIC ASSESSMENT AND IDENTIFICATION OF POTENTIAL SITES FOR COMMUNITY-BASED CORAL REEF MANAGEMENT IN THE COMOROS Edited by Chris Poonian Community Centred Conservation (C3) Moroni 2010 ACKNOWLEDGEMENTS This report is the culmination of the advice, cooperation, hard work and expertise of many people. In particular, acknowledgments are due to the following for their contributions: COMMUNITY CENTRED -

Niveaux D'anticorps Contre La Protéine Circumsporozoïtique De
Ann. Parasitol. Hum. Comp., Mots-clés : Épidémiologie du paludisme. Anticorps anti-CS pro 1991, 66 : n° 4, 179-184. téine de Plasmodium falciparum. Anopheles gambiae. Anopheles funestus. Comores. Mémoire. Key-words: Malaria epidemiology. Plasmodium falciparum CS- protein antibodies. Anopheles gambiae. Anopheles funestus. Comoros. NIVEAUX D’ANTICORPS CONTRE LA PROTÉINE CIRCUMSPOROZOÏTIQUE DE PLASMODIUM FALCIPARUM ET LEUR UTILISATION EN TANT QU’INDICATEURS ÉPIDÉMIOLOGIQUES DE LA TRANSMISSION DU PALUDISME EN RFI DES COMORES G. SABATINELLI*, R. ROMI*, S. BLANCHY** R ésumé -------------------------------------------------------------------------------------- Une enquête épidémiologique pour déterminer les niveaux d’anti Les prévalences d’Ac-CS dans l’échantillon de population examinée corps contre la protéine circumsporozoïtique de Plasmodium fal passe de 5,5 % chez les enfants de 3-4 ans à 40 % chez ceux ciparum (Ac-CS) a été menée au début de la saison des pluies de 5 ans. Dès 6-7 ans, on enregistre une augmentation progressive 1988, dans 21 villages de la RFI des Comores, conjointement à de la prévalence qui atteint un plateau après 30 ans. La détermi une évaluation des densités résiduelles anophéliennes. Des préva nation des niveaux d’Ac-CS se révèle une méthode très utile pour lences d’Ac-CS très différentes ont été relevées dans la population évaluer les niveaux de transmission du paludisme, particulièrement des villages choisis, comme l’ont été les densités moyennes d’Ano dans les situations épidémiologiques où une évaluation entomolo- pheles gambiae et d’Anopheles funestus par chambre. Les diffé gique fiable est difficile à effectuer. rences sont conditionnées par les situations écologiques locales. Summary: Antibodies levels to Plasmodium falciparum circumsporozoitic protein as epidemiological indicators of malaria transmission in the FIR of Comoros. -

Fonds Africain De Developpement Union Des
FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT Publication autorisée UNION DES COMORES REHABILITATION DU RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTS PICU/PGCL Publication autorisée Publication autorisée Janvier 2017 TABLE DES MATIERES I. ORIENTATIONS STRATEGIQUES & JUSTIFICATION DU PROJET…………………………………………… 1 1.1. Liens du projet avec la stratégie et les objectifs des Comores ...................................................................................... 1 1.2. Justification de l’intervention de la Banque .................................................................................................................. 1 1.3. Coordination des partenaires techniques et financiers .................................................................................................. 2 II. DESCRIPTION DU PROJET………………………………………………………………………………………………………….3 2.1. Objectifs et composantes du projet ............................................................................................................................... 3 2.2. Solutions techniques retenues et alternatives étudiées .................................................................................................. 4 2.3. Type de projet ............................................................................................................................................................... 5 2.4. Coûts estimatifs et dispositif de financement du projet ................................................................................................. 5 2.5. Zone et bénéficiaires visés par le projet ....................................................................................................................... -

UNION DES COMORES Unité – Solidarité – Développement
UNION DES COMORES Unité – Solidarité – Développement --------- ! DIRECTION GENERALE DE L’ANACEP ---------- _________________________________________________ PROJET DE FILETS SOCIAUX DE SECURITES Accord de Financement N° D0320 -KM RAPPORT SEMESTRIEL D’ACTIVITES N° 05 Période du 1 er juillet au 31 décembre 2017 Février 2018 1 SIGLES ET ABREVIATIONS ACTP : Argent Contre Travail Productif ACTC : Argent Contre Travail en réponses aux Catastrophes AG : Assemblée Générale AGEX : Agence d’Exécution ANACEP : Agence Nationale de Conception et d’Exécution des Projets AGP : Agence de Paiement ANO: Avis de Non Objection AVD : Agent Villageois de Développement ANJE : Amélioration du Nourrisson et du Jeune Enfant BE : Bureau d’Etudes BM : Banque Mondiale CCC : Comité Central de Coordination CG : Comité de Gestion CGES : Cadre de Gestion Environnementale et Sociale CGSP : Cellule de Gestion de Sous Projet CI : Consultant Individuel CP : Comité de Pilotage CPR : Cadre de politique de Réinstallation CPS Comité de Protection Sociale CR : Comité Régional DAO : Dossier d’appel d’offre DEN : Directeur Exécutif National DGSC : Direction Générale de la Sécurité Civile DP : Demande de Proposition DER : Directeur Exécutif Régional DNO : Demande de Non Objection DSP : Dossier de sous- projet FFSE : Facilitateur chargé du Suivi Evaluation HIMO : Haute Intensité de Main d’Œuvres IDB : Infrastructure de Bases IDB C : Infrastructure De Base en réponse aux Catastrophes IEC : Information Education et Communication MDP : Mémoire Descriptif du Projet MWL : île de Mohéli -

Annotated UNDP-GEF Project Document Template
United Nations Development Programme Project Document Least Developed Country Fund (LDCF) Project title: Strengthening Comoros resilience against climate change and variability related disaster. Country: Implementing Partner: Management Arrangements: National Implementation Modality Union of Comoros UNDP (NIM) UNDAF/Country Programme Outcome: Outcome 4 – By 2019, the most vulnerable populations ensure their resilience to climate change and crises. UNDP Strategic Plan Output: insert either 1.3, 1.4, 1.5 or 2.5 see item 5 under further information in the opening section of the annotated template UNDP Social and Environmental Screening Category: UNDP Gender Marker: 2. Low Atlas Project ID/Award ID number: 00103394 Atlas Output ID/Project ID number: 00105390 UNDP-GEF PIMS ID number: 5445 GEF ID number: 6912 Planned start date: this is defined as the expected Planned end date: 60 months project document signature date LPAC date: Brief project description: The Union of Comoros (Comoros) is comprised of four islands, namely Ngazidja (or Grande Comore), Mwali (Mohéli), Ndzuani (Anjouan) and Maoré (Mayotte). However, the project will only focus on three of the four islands, excluding Maoré from the project area. Comoros is a small island developing state (SIDS) with a population of ~8000 and is one of the most densely populated countries in Africa. Being a SIDS, the Comoros is characterised by limited resources and poor economic resilience. The Comorian population is predominantly dependent upon subsistence livelihoods based on traditional crops and reliant upon natural resources. Existing land use practices connected to natural resource management are poorly managed resulting in food and water insecurity. Furthermore, because of its geographical position and climatic factors, the Comoros is vulnerable to natural disasters such as tropical storms, floods, rising sea level, volcanic eruptions, earthquakes and landslides.