Voir Un Extrait En
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

THE LIFE and WORK of WILLY ACHIM FIEDLER, 1. Germany
THE LIFE AND WORK OF WILLY ACHIM FIEDLER, Designer, test pilot, aeronautical and missile engineer 1908-1998 by Rit Staalman and Monica Wagner-Staalman 1. Germany PERSONAL RESUMÉ source: Biographical Data Form ‘Who’s Who in Science and Engineering’, First Ed. 1992-1993 see also: http://de.wikipedia.org/wiki/Willy_A._Fiedler Personal data Fiedler, Willy Achim, Designer, Test Pilot, Aeronautical and Missile Engineer, Consultant born: Freudenstadt, Würtemberg, Black Forest, Germany, 23 January 1908; father: Carl Fiedler (photographer); mother: Caroline Kurz Married to: Greta E. Lange (born 16/06/1914) from 1937 until her death in 1993. they have four children: Petra, Monika, Achim and Karen. Achim dies at an early age. Willy remarries with Monica Wagner (born 16/01/1940) in 1996. He dies on 17 January 1998 in Los Altos Hills CA, USA. Willy on his way to school (ca. 1916) 1 Willy Fiedler, cont’d Professional Education: Dipl.Ing. Technische Universität Stuttgart D 1928-1933 Flugbaumeister DVL (Prof. Hoff) Berlin D 1937 Career History designer British Aircraft Ltd Feltham GB 1936 a/c study + piloting DVL Berlin-Adlershof D 1937 a/c assessment + piloting G-Fieseler Werke Kassel D 1938 Test Direction G-Fieseler Werke “V1” Peenemünde D 1942-1944 Co-owner, Techn. Director Bachem Co. (“Natter”) Waldsee D 1944? Civil Service 9 – 4514 US-Navy, NAMTC Point Mugu CA USA 1948-1956 Manager Scientific Staff Lockheed Missile & Space Sunnyvale CA USA 1956 Chief Scientist ditto ditto USA 1958-1974 Career-Related Activities Advisor to Pacific Missile Range Comm. -

Messerschmitt Bf 109 H/F Scale 1:12, Wingspan 1032Mm (40.6In) / 890Mm (35.0In)
... print your plane | www.3DLabPrint.com User Guide rev. 2016/08 Fully 3d printable Messerschmitt Bf 109 H/F scale 1:12, wingspan 1032mm (40.6in) / 890mm (35.0in) page 1 ... print your plane | www.3DLabPrint.com 3D Lab Print Messerschmitt Bf 109H/F – fully printable R/C plane for your home 3Dprinter Future of flying - Print your own plane We still trying move things further, so this project is again full of other improvements for better durability , easier assembly , better geometry solution and so on..., we hope you enjoy it, although this print may test your competencies to and quality of your printer (wel- come to the thin wall printing) The first fully printable airplanes with suitable files prepared for your 3Dprinter. Flight charecteristics are comparable or even better than classic build model airplane. Simply download and then print it anytime you need only for $10 (filament cost). This is not a dream, now you can print this HI-TECH …. at home, print spar parts, and so on... Extensive hi-tech 3d structural reinforcement which makes the model very rigid while still maintaining lightweight airframe and exact airfoil even when it is made only from plastic. This perfect and exact 3d structure is possible only due to aditive 3dprinting technology. So welcome to the 21th century of model flying. Be The first at your airfield. Easy to assembly, you do not need any extra tool or hardware, you only need to glue printed parts together and make pushrods for control. The rest of the assembly is very easy.Simply add brushless motor, ESC, servos and radio system. -

Jb-2: America's First Cruise Missile
JB-2: AMERICA’S FIRST CRUISE MISSILE Gary Francis Quigg Submitted to the faculty of the University Graduate School in partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Arts in the Department of History, Indiana University May 2014 Accepted by the Graduate Faculty, Indiana University, in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts. Master’s Thesis Committee ______________________________ Philip V. Scarpino, Ph.D., Chair ______________________________ Kevin C. Cramer, Ph.D. ______________________________ Elizabeth Brand Monroe, Ph.D., J.D. ii ACKNOWLEDGEMENTS I am grateful to the staff of each of the following institutions for their patience and dedication: National Archives and Records Administration II (College Park, Maryland, facility), Library of Congress, National Air and Space Museum, National Museum of the United States Air Force, and the history offices at three United States Air Force bases, Eglin, Maxwell, and Wright-Patterson. Two professionals from among these repositories deserve special recognition: Margaret Clifton, Research Specialist at the Library of Congress, and Major General Clay T. McCutchan (USAF Ret.), Historian in the Office of History at Eglin AFB. I am indebted to the Public History Program, especially my thesis committee. First, to Dr. Kevin C. Kramer, who was particularly helpful in suggesting the following publications: Dawning of the Cold War: The United States Quest for Order by Randall B. Woods and Howard Jones, The Cold War: A New History by John Lewis Gaddis, Homeward Bound: American Families in the Cold War Era by Elaine Tyler May, The Culture of the Cold War by Stephen J. Whitfield, and Parting the Curtain: Propaganda, Culture and the Cold War, 1945-1961 by Walter L. -

2. the United States
THE LIFE AND WORK OF WILLY ACHIM FIEDLER, Designer, test pilot, aeronautical and missile engineer 1908-1998 by Rit Staalman and Monica Wagner-Staalman 2. The United States In 1948 Willy Fiedler and his family moved to California. He went to work for the US Navy Missile Test Center at Point Mugu, on the Pacific coast, not far from Los Angeles. Point Mugu is to this day a Navy facility. Near the entry of the camp an open air exhibit gives an overview of the development of various weaponry of the missile kind between the end of the Second World War and 1960. The last missile shown is the Polaris, which was the first missile that could be launched vertically from a sub- merged submarine. At the entrance of the so-called “Missile Park” a real life F-4 Phantom jet fighter functions as a gate keeper. This airplane played a role in following and observing the flight path of the missiles. According to Willie Fiedler he flew on occasion the mighty machine himself. Instrumental in the move from Germany had been Dr. Herbert Wagner, leading German scientist on the devel- opment of guided missiles, who himself was employed at the Naval test facility. Wagner and Fiedler had known each other in Germany during the war at the test center in Peenemünde where Fiedler had been chief of the test program of the V1. Wagner had been director of missile development at Henschel. Noticing the troubles of the Loon testing program, which were very similar to the tribulations in Peenemúnde, he had rec- ommended calling in Willie Fiedler. -

O Messerschmitt Me 262 Um Novo Paradigma Na Guerra Aérea
UNIVERSIDADE DE LISBOA FACULDADE DE LETRAS O MESSERSCHMITT ME 262 UM NOVO PARADIGMA NA GUERRA AÉREA (1944-1945) NORBERTO ANTÓNIO BIGARES DE MELO ALVES MARTINS Tese orientada pelo Professor Doutor António Ventura e co-orientada pelo Professor Doutor José Varandas, especialmente elaborada para a obtenção do grau de Mestre em HISTÓRIA MILITAR. 2016 «Le vent se lève!...il faut tenter de vivre!» Paul Valéry, Le cimetière marin, 1920. ÍNDICE RESUMO/ABSTRACT 3 PALAVRAS-CHAVE/KEYWORDS 5 AGRADECIMENTOS 6 ABREVIATURAS 7 O SISTEMA DE DESIGNAÇÃO DO RLM 8 A ESTRUTURA OPERACIONAL DA LUFTWAFFE 11 INTRODUÇÃO 12 1. O estado da arte 22 CAPÍTULO I Conceito, forma e produção 27 1. Criação do Me 262 27 2. Interferência de Hitler no desenvolvimento do Me 262 38 3. Produção do Me 262 42 4. Variantes do Me 262 45 CAPÍTULO II A guerra aérea: novas possibilidades 61 1. O Me 262 como caça intercetor 61 2. O Me 262 como caça-bombardeiro 75 3. O Me 262 como caça noturno 83 4. O Me 262 como avião de reconhecimento 85 5. O Me 262 no РОА/ROA (Exército Russo de Libertação) 89 6. Novas táticas 91 1 7. Novo armamento 96 8. O fator humano 100 CAPÍTULO III O legado do Me 262 104 1. Influência na aerodinâmica 104 2. Inovações 107 3. Variantes estrangeiras do Me 262 109 4. Influência do Me 262 em aviões estrangeiros 119 CONCLUSÃO 130 O Me 262 no espaço aéreo: um novo paradigma 132 BIBLIOGRAFIA 136 ANEXOS 144 2 RESUMO A Segunda Guerra Mundial foi, para além de um evento decisivo na transformação do Mundo, palco de imensos desenvolvimentos técnologicos cuja influência se estende até hoje, fazendo parte, inclusive, do dia a dia de milhões de pessoas. -

User Guide Rev. 2021/4
... print your plane | www.3DLabPrint.com User Guide rev. 2021/4 Fully 3d printable Messerschmitt BF 109F-3 1:6.6 ~ wingspan1.53m/60in page 1 ... print your plane | www.3DLabPrint.com Messerschmitt BF 109F-3– fully printable R/C plane for your desktop 3Dprinter Future of flying - Print your own plane.flight video Another 3d printable warbird in 1:6.6 scale as a worthy adversary to our very successful Spitfire Mk.IXc, again with some new revolutionary features. For the first time, a new joining method has been used for all the parts - stronger, easier to assemble and more precise. This plane is recommended for medium skilled pilots. We hope you enjoy printing, building and flying it, although this build will truly test your abilities and quality of your printer. Welcome to the thin wall printing! The first fully printable airplanes with files prepared for your 3Dprinter, with flight characteristics, comparable or even superior to classic build model airplane. This is not a dream, now you can print this HI-TECH at home. Simply download and print the whole plane or spare parts anytime you need just for a cost of filament. Extensive hi-tech 3d structural reinforcement making the model very rigid while maintaining a lightweight air frame and exact airfoil even it’s just a plastic. This perfect and exact 3d structure is possible only thanks to additive 3d printing technology. So welcome to the 21st century of model flying and be the first at your airfield. Easy to assemble, you don’t need any extra tools or hardware. -
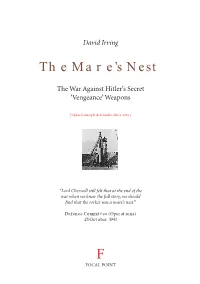
Maresnest Minion
David Irving The Mare’s Nest The War Against Hitler’s Secret ‘Vengeance’ Weapons [Updated and uploaded Sunday, May 6, 2001 ] “Lord Cherwell still felt that at the end of the war when we knew the full story, we should find that the rocket was a mare’s nest.” Defence Committee (Operations) 25 October 1943 F FOCAL POINT Panther Books Granada Publishing Ltd. Grafton Street, London WX LA This revised edition published by Panther Books First published in Great Britain by William Kimber and Co. Limited Copyright © William Kimber and Co. Limited Copyright © David Irving , Electronic edition © Focal Point Publications ISBN --- All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form, or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publishers. This book is sold subject to the conditions that it shall not, by way of trade or otherwise, be lent, re-sold, hired out or otherwise circulated without the publisher’s prior consent in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser. David Irving is a military historian who has written a number of highly original books about the Second World War, including the controversial Hitler’s War and The Destruction of Dresden and The Destruction of Con- voy PQ. This revised edition of The Mare’s Nest includes a hitherto un- published chapter. “David Irving is the forensic pathologist of modern military history. -

De Havilland Mosquito
DE HAVILLAND MOSQUITO The Mosquito was a British twin-engine, two-seater fighter and bomber aircraft that served during the Second World War, The plane was unusual because its frame was constructed mostly of wood. It was nicknamed the ‘Wooden Wonder’, or ‘Mossie’. It saw service with the Royal Air Force as well as other air forces around the world. The Mosquito was 12.5 metres long and had a wingspan of 16.5 metres. It weighed 7,200 kilograms and was armed with four Browning machine guns and four Hispano cannons, all firing from the nose. It had a range of 1,400 miles and a ceiling of 8,500 metres. When the Mosquito entered service in 1941, it was faster than the Spitfire used at the time with a top speed of 400 miles per hour. The Mosquito’s famous raids was code-named Operation Jericho. This involved the bombing of a prison in Amiens, France, which held captured British and French soldiers. The destruction of the walls allowed 225 prisoners to escape. About 8,000 of this beautiful aircraft, designed by Sir Geoffrey de Havilland, were built. HAWKER HURRICANE The Hawker Hurricane was a British single-seat fighter aircraft that was designed and built by Hawker Aircraft Ltd for the Royal Air Force, entering service in 1937. Along with the Supermarine Spitfire, the aircraft became renowned during the Battle of Britain. At the end of June 1940, the majority of the RAF's 36 fighter squadrons were equipped with Hurricanes. There were 14,500 built in total. -
![DCS Bf 109 K-4 Kurfürst Flight Manual DCS [Bf 109 K-4]](https://docslib.b-cdn.net/cover/3759/dcs-bf-109-k-4-kurf%C3%BCrst-flight-manual-dcs-bf-109-k-4-8833759.webp)
DCS Bf 109 K-4 Kurfürst Flight Manual DCS [Bf 109 K-4]
DCS Bf 109 K-4 Kurfürst Flight Manual DCS [Bf 109 K-4] Dear User, Thank you for your purchase of DCS: Bf 109 K-4. DCS: Bf 109 K-4 is a simulation of a legendary German World War II fighter, and is the fifth installment in the Digital Combat Simulator (DCS) series of PC combat simulations. Like previous DCS titles, DCS: Bf 109 K-4 features a painstakingly reproduced model of the aircraft, including the external model and cockpit, as well as all of the mechanical systems and aerodynamic properties. Along the lines of our flagship P-51D Mustang title, DCS: Bf 109 K-4 places you behind the controls of a powerful, propeller-driven, piston engine combat aircraft. Designed long before “fly- by-wire” technology was available to assist the pilot in flight control or smart bombs and beyond visual range missiles were developed to engage targets with precision from afar, the Kurfürst is a personal and exhilarating challenge to master. Powerful and deadly, the aircraft nicknamed the "Kurfürst" provides an exhilarating combat experience to its drivers, and a worthy challenge to all fans of DCS P-51D Mustang. As operators of one of the largest collections of restored World War II aircraft, we at The Fighter Collection and the development team at Eagle Dynamics were fortunate to be able to take advantage of our intimate knowledge of WWII aviation to ensure the DCS model is one of the most accurate virtual reproductions of this aircraft ever made. Combined with volumes of outside research and documentation, the field trips to the TFC hangar and countless consultations and tests by TFC pilots were invaluable in the creation of this simulation. -
![Walter and Reimar Horten Interviews [Myhra]](https://docslib.b-cdn.net/cover/3760/walter-and-reimar-horten-interviews-myhra-9003760.webp)
Walter and Reimar Horten Interviews [Myhra]
Walter and Reimar Horten Interviews [Myhra] M. Beth Lee 2002 National Air and Space Museum Archives 14390 Air & Space Museum Parkway Chantilly, VA 20151 [email protected] https://airandspace.si.edu/archives Table of Contents Collection Overview ........................................................................................................ 1 Administrative Information .............................................................................................. 1 Biographical / Historical.................................................................................................... 2 Scope and Contents........................................................................................................ 2 Arrangement..................................................................................................................... 2 Names and Subjects ...................................................................................................... 2 Container Listing ............................................................................................................. 4 Series 1: Original Cassettes.................................................................................... 4 Series 2: Master Reel-to-Reels................................................................................ 7 Series 3: User CD-Rs............................................................................................ 10 Walter and Reimar Horten Interviews [Myhra] NASM.1999.0065 Collection Overview Repository: National Air -

Alexander Lippisch, Die Me 163 Und Der Deltaflügel
92 THEMENHEFT FORSCHUNG FLYING Alexander Lippisch, die Me 163 und der Deltaflügel Flugzeuge mit Deltaflügeln kennt man zum Beispiel von 1. Einleitung der inzwischen außer Dienst gestellten Concorde und Die Unternehmer-Persönlichkeiten wie vom Eurofighter. Diese Konfiguration ist eine bedeutende Willy Messerschmitt, Ernst Heinkel, Alternative zu den am meisten verbreiteten Flugzeugen Claudius Dornier, Hugo Junkers und Kurt Tank sind wahrscheinlich viel bekannter mit einer Rumpfröhre, daran angebrachten ge raden oder als Alexander Lippisch, denn jedermann gepfeilten Flügeln und dem Höhen- und Seitenleitwerk am verbindet mit ihnen große Flugzeug- Heck. In diesem Artikel wird den Ursprüngen der Delta- Firmen und berühmte Flugzeug-Typen. Es gab jedoch hinter diesen Männern eine Konfiguration nachgegangen. Sie liegen in Deutschland andere Gruppe von Leuten, die mit ihren bei den Konstruktionen, Entwürfen und Ideen von Alexan- Ideen, Konzepten und Entwürfen den Flugzeugbau maßgeblich mitgestaltet ha- der Lippisch (1894–1976) sowie in den USA bei den ben. Wenige Beispiele erläutern diese Aus- frühen Deltaflüglern der Firmen Convair und Douglas. Die sage: Ernst Heinkel gebührt das Verdienst, Beiträge von Alexander Lippisch stehen im Vordergrund, zur richtigen Zeit von seinen Mitarbeitern den großen Schritt zu Stromlinienflugzeu- obwohl seine fortschrittlichsten Entwürfe am Ende des gen wie He 70 und He 111 verlangt und die zweiten Weltkrieges nicht mehr realisiert werden konnten. Verantwortung für das unternehmerische DELTAFLÜGEL 93 ABSTRACT Risiko übernommen zu haben. Entworfen During the years 1937 to 1943 Alexander Lippisch designed and developed the rocket haben diese Flugzeuge aber die Brüder fighter/interceptor Messerschmitt Me 163, first at the Deutsche Forschungsanstalt für Siegfried und Walter Günter. Messer- Segelflug DFS, from 1939 onwards at the Messerschmitt works, department L. -

Deák Tamás a V-1 És V-2 Megtorlófegyverek És Ezek Hatásai
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR A V-1 és V-2 megtorlófegyverek és ezek hatásai a későbbi hadiipari fejlesztésekre Deák Tamás honvéd tisztjelölt Konzulens: Dr. Szilvássy László alezredes – Szolnok 2016 – TARTALOM BEVEZETÉS ............................................................................................................................ 3 1. VERGELTUNGSWAFFE-1 ............................................................................................ 5 1.1 A „szárnyas bomba” rövid története ................................................................................. 5 1.2 V-1 elleni védekezés ......................................................................................................... 7 1.3 A Fieseler Fi-103 felépítése .............................................................................................. 9 1.3.1 Irányítási rendszere .................................................................................................. 10 1.3.2 Megsemmisülése ...................................................................................................... 11 1.3.3 Lüktető sugárhajtómű (Argus As 109-114) ............................................................. 12 1.4 Reichenberg, a „német kamikaze” .................................................................................. 15 1.5 Későbbi fejlesztések ....................................................................................................... 16 1.5.1 Egyesült Államok ....................................................................................................