Ensemble Intercontemporain, Bruno Mantovani
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

LE MONDE Mort De Christophe Desjardins, Un Alto Pour La Musique De Tous Les Temps
LE MONDE Mort de Christophe Desjardins, un alto pour la musique de tous les temps L’instrumentiste français, soliste à l’Ensemble intercontemporain durant deux décennies et interprète privilégié des plus grands compositeurs, est mort jeudi à 57 ans. Par Marie-Aude Roux Publié le 15 février 2020 Il avait su faire de son instrument une arme de création massive : l’altiste Christophe Desjardins, bien connu des mélomanes amis de la musique contemporaine, est mort à Paris jeudi 13 février des suites d’un cancer. Il avait 57 ans. L’un de ses enregistrements maîtres restera le somptueux récital réalisé pour Aeon, Alto/Multiples, en 2010, dix-sept pièces en 2 CD, dont le premier rassemble des grands solos (d’Hindemith à Elliott Carter) qui ont jalonné le XXe siècle, le second regroupant des œuvres en lien avec un répertoire plus ancien ou réclamant le procédé du re-recording afin de démultiplier son instrument – ainsi, le trio Ockeghem-Maderna, le quatuor de Wolfgang Rihm ou le septuor Messagesquisse de Boulez, dont il a créé en 2000 la version pour sept altos. Christophe Desjardins naît à Caen (Calvados) le 24 avril 1962. Il commence la musique très jeune et étudie d’abord le piano, avant de découvrir l’alto à 10 ans, dont le côté mystérieux le séduit. Il entre au Conservatoire national supérieur de musique de Paris en 1982 dans les classes de Serge Collot pour l’alto, de Geneviève Joy (femme d’Henri Dutilleux) pour la musique de chambre. Muni d’un Premier Prix à l’unanimité l’année suivante (1983), il se perfectionne à la Hochschule der Künste (actuelle Universität der Künste) de Berlin auprès de Bruno Giuranna. -

Jeudi 28 Avril Solistes De L'ensemble
Roch-Olivier Maistre, Président du Conseil d’administration Laurent Bayle, Directeur général Jeudi 28 avril Solistes de l’ensemble intercontemporain Jeudi 28 avril 28 Jeudi | Dans le cadre du cycle L’œuvre ouverte Du mardi 19 au samedi 30 avril Vous avez la possibilité de consulter les notes de programme en ligne, 2 jours avant chaque concert, à l’adresse suivante : www.citedelamusique.fr Solistes de l’ensemble intercontemporain intercontemporain Solistes de l’ensemble Cycle L’œuvre ouverte Libres explorateurs de tous les possibles, laissant venir ce qui doit venir : de Cage au free-jazz en passant par la caméra ixe d’Andy Warhol, bien des artistes ont tenté de saisir l’ouvert. C’est justement Andy Warhol qui est au centre du premier concert de ce cycle. L’artiste expérimental Scanner, alias Robin Rimbaud, travaille sur la voix de Warhol issue de ses interviews. Il fait émerger des espaces vides, des hésitations et des respirations nécessaires à la construction – parfois à partir d’un simple « euh » – d’un univers sonore. Des images projetées accompagnent cette performance, donnant à voir l’expression warholienne de l’ennui et sa fascination du détail. Quant à Dean & Britta, issus du groupe de rock indépendant Luna, ils inventent une bande-son pour les screen tests auxquels Warhol soumettait ses visiteurs, connus ou anonymes : le résultat de deux minutes quarante était ensuite projeté au ralenti ain d’en obtenir quatre. Le pianiste Cecil Taylor a révolutionné le jazz en libérant l’improvisation des conventions en vigueur : il est, avec Ornette Coleman, l’un des créateurs du free-jazz. -

Dossier De Presse Luigi Nono
FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS 4 septembre – 31 décembre | 43 e édition DOSSIER DE PRESSE LUIGI NONO Service de presse : Christine Delterme, Carole Willemot Assistant : Maxime Cheung Tél : 01 53 45 17 13 | Fax : 01 53 45 17 01 [email protected] [email protected] [email protected] Festival d’Automne à Paris | 156, rue de Rivoli – 75001 Paris Renseignements et réservations : 01 53 45 17 17 | www.festival-automne.com DOSSIER DE PRESSE MUSIQUE – FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS 2014 – PAGE 2 EDITORIAL Un “portrait” consacré au compositeur vénitien Luigi Nono (1924-1990) Il est temps de revenir sur la musique de Luigi Nono. Depuis plus de dix ans, ses grandes œuvres n’ont pas été jouées à Paris. Développé au cours des automnes 2014 et 2015, ce “portrait” de Luigi Nono permettra d’écouter des œuvres d’orchestre et de musique de chambre (avec l’ajout de live-electronics pour celles de la dernière période), rares au concert, et dont certaines en création française. L’attention portée à la voix, en soliste ou en chœur, et la manifes - tation de son engagement politique dans ses œuvres constituent les deux axes sur lesquels se déploie ce cycle. Dans les années 1960 et 1970, Luigi Nono, membre du Parti communiste italien, organise en effet des concerts dans les usines et rencontre, au cours de nombreux voyages, les militants des mouvements révolutionnaires apparaissant en Algérie, à Cuba, au Pérou, au Chili, au Vietnam et ailleurs. Ces rencontres fournissent la matière aux deux opéras de cette période, Intolleranza 1960 et Al gran carico d’amore – ce dernier, créé avec le metteur en scène Youri Liou - bimov. -

Dossier De Presse
DOSSIER DE PRESSE 1 SOMMAIRE Edito ............................................................................................ p.3 Calendrier ..................................................................................... p.4 Prélude au festival ........................................................................... p.5 Résidence Oscar Bianchi 2015 .............................................................. p.5 Installation «le son installé» ............................................................... p.6 Installation «72 Impulse» .................................................................. p.7 Installation «Fantômes» ..................................................................... p.8 Installation «D’ore et d’espace» ........................................................... p.10 Installation «Un orchestre de papier» .................................................... p.11 Installation «Apertures» ................................................................... p.12 Entre chou et loup ........................................................................... p.14 Visages ......................................................................................... p.15 Un temps fort autour de l’orgue contemporain ......................................... p.17 Kevin Bowyer (Ecosse), 6 novembre ....................................................... p.17 Kevin Bowyer (Ecosse), 7 novembre ....................................................... p.20 Incline ......................................................................................... -
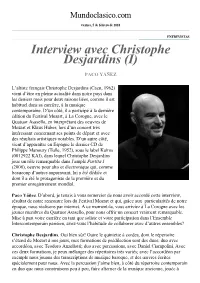
Interview Avec Christophe Desjardins (I)
Mundoclasico.com viernes, 5 de febrero de 2010 ENTREVISTAS Interview avec Christophe Desjardins (I) PACO YÁÑEZ L’altiste français Christophe Desjardins (Caen, 1962) vient d’être en pleine actualité dans notre pays dans les deniers mois pour deux raisons liées, comme il est habituel dans sa carrière, à la musique contemporaine. D’un côté, il a participé à la dernière édition du Festival Mozart, à La Corogne, avec le Quatuor Asasello, en interprétant des oeuvres de Mozart et Klaus Huber, lors d’un concert très intéressant concernant ses points de départ et avec des résultats artistiques notables. D’un autre côté, vient d’apparaître en Espagne le dernier CD de Philippe Manoury (Tulle, 1952), sous le label Kairos (0012922 KAI), dans lequel Christophe Desjardins joue un rôle remarquable dans l’ample Partita I (2006), oeuvre pour alto et électronique qui, comme beaucoup d’autres auparavant, lui a été dédiée et dont il a été le protagoniste de la première et du premier enregistrement mondial. Paco Yáñez. D’abord, je tenais à vous remercier de nous avoir accordé cette interview, résultat de notre rencontre lors du Festival Mozart et qui, grâce aux particularités de notre époque, nous réalisons par internet. A ce moment-la, vous arriviez à La Corogne avec les jeunes membres du Quatuor Asasello, pour nous offrir un concert vraiment remarquable. Mise à part votre carrière en tant que soliste et votre participation dans l’Ensemble Intercontemporain parisien, avez-vous l’habitude de collaborer avec d’autres ensembles? Christophe Desjardins. Oui bien sûr! Outre le quintette à cordes, dont le répertoire s’étend de Mozart à nos jours, mes formations de prédilection sont des duos: duo avec accordéon, avec Teodoro Anzellotti; duo avec percussions, avec Daniel Ciampolini. -

Jeudi 9 Octobre Hommage À Elliott Carter H Ommage À E Llio Tt C a Rter
Roch-Olivier Maistre, Président du Conseil d’administration Laurent Bayle, Directeur général Jeudi 9 octobre Hommage à Elliott Carter | Jeudi 9 octobre Vous avez la possibilité de consulter les notes de programme en ligne, 2 jours avant chaque concert, à l’adresse suivante : www.citedelamusique.fr Hommage à Elliott Carter JEUDI 9 OCTOBRE –18H Amphithéâtre 18h : Projection Elliott Carter – A labyrinth of Time Documentaire de Franck Schefer, Pays-Bas, 2003, 90 minutes pause 20h : Concert Elliott Carter Riconoscenza « per Gofredo Petrassi » A 6 Letter Letter Figment II – remembering Mr. Ives Gra Figment III – Création européenne Scrivo in vento Figment IV Mosaic Solistes de l’Ensemble intercontemporain : Hae-Sun Kang, violon Didier Pateau, cor anglais Pierre Strauch, violoncelle Alain Billard, clarinette Frédéric Stochl, contrebasse Sophie Cherrier, lûte Christophe Desjardins, alto Frédérique Cambreling, harpe Coproduction Cité de la musique, Ensemble intercontemporain. Ce concert est enregistré par France Musique, partenaire de la Cité de la musique et de l’Ensemble intercontemporain. Fin du concert vers 21h. 2 Elliott Carter (1908) Riconoscenza « per Gofredo Petrassi », pour violon Composition : 1984. Création : 15 juin 1984, Abbaye de Fossanova, Priverno (Italie), par Georg Mönch. Commande : Festival Pontino 1984, à l’occasion du 80e anniversaire de Gofredo Petrassi. Dédicace : « per Gofredo Petrassi ». Efectif : violon. Éditeur : Boosey & Hawkes. Durée : environ 6 minutes. Riconoscenza « per Gofredo Petrassi » a été composé en hommage au compositeur italien pour son quatre-vingtième anniversaire. La musique présente trois caractères diférents, chacun avec sa propre technique de jeu, son comportement rythmique et son répertoire d’intervalles : une ligne mélodique luide et continue (« dolce, legatissimo, scorrevole »), des groupes de notes énergiques jouées staccato (« giocosamente furioso ») et de longues tenues souvent en doubles- cordes (« tranquillo, ben legato »). -

Centre Pompidou | Exposition DADA Aux Concerts Et De Soutenir NOVEMBRE | KYBURZ La Création À L’Ircam
l’iRCAM lance une nouvelle saison contemporaine à paris et sa carte d’abonnement OCTOBRE | CURSUS LA CARTE iRCAM 13, 14 Ircam | Présentations 1 et 2 permet d’assister A PARTIR DU 5 Centre Pompidou | Exposition DADA aux concerts et de soutenir NOVEMBRE | KYBURZ la création à l’Ircam. 9, 10, 11 Centre Pompidou | H. Kyburz & E. Greco PRix DE LA CARTE | 30 € DÉCEMBRE | L’ÉTiNCELLE PLACES | 5 € 12 Ircam | K. Huber, Les Jeunes Solistes 16 Centre Pompidou | M. Lindberg, Ensemble intercontemporain SES AVANTAGES 17 Centre Pompidou | G. Benjamin, Ensemble Modern accès libre à trois concerts au choix JANViER | MATiÈRE-SON - 12 Centre Pompidou | Do it yourself, Benjamin de la Fuente dès le quatrième concert 13 Maison de la radio | G. Benjamin, G. Ligeti, O. Messiaen prix des places 5 € 18 Centre Pompidou | Atelier-répertoire G. Grisey, Prologue - 20 Centre Pompidou | B. Furrer, S. Gervasoni, A. Cattaneo dès le premier concert, possibilité d’inviter une autre FÉVRiER | DOUBLE ENTENTE personne au même prix 22 Centre Pompidou | Atelier-répertoire F. Bedrossian, Transmission - 28 Ircam | F. Bedrossian & W. Rihm accès gratuit aux Ateliers-répertoire Ircam MARS | PRÉLUDES À L’OPÉRA 22 Centre Pompidou | Atelier-répertoire K. Saariaho, Près HORS CARTE iRCAM Ircam - Centre25 Centre PompidouPompidou | J. Harvey, E. Nunes 12 JANViER 27 Opéra Bastille | K. Saariaho, Ensemble L’Itinéraire Centre Pompidou 29 Ircam | M. Jarrell & E. Nunes Do it Yourself 30 Opéra Bastille | K. Saariaho, E.P. Salonen, P. Sellars, Adriana Mater 13 JANViER AVRiL | ON-iRON Maison de la Radio 3, 7, 10, 12, 15 et 18 Opéra Bastille | K. Saariaho, E.P. -
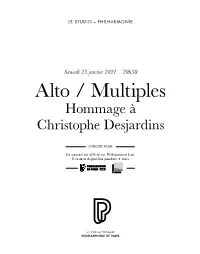
Alto / Multiples Hommage À Christophe Desjardins
LE STUDIO – PHILHARMONIE Samedi 23 janvier 2021 – 20h30 Alto / Multiples Hommage à Christophe Desjardins CONCERT FILMÉ Ce concert est diffusé sur Philharmonie Live. Il restera disponible pendant 4 mois. Programme Céline Steiner Apories pour alto et électronique Commande de la Philharmonie de Paris – création Patrick Marcland Alto-Solo I pour alto seul Nouvelle version augmentée – création Pierre Boulez Messagesquisse Nouvelle version pour alto et bande – création française Philippe Manoury Partita I pour alto et électronique en temps réel GRAME, dispositif électronique Serge Lemouton, réalisateur informatique musicale Louise Desjardins, alto (pièce de C. Steiner) Laurent Camatte, alto (pièce de P. Marcland) Adrien La Marca, alto (pièce de P. Boulez) Carole Dauphin-Roth, alto (pièce de P. Manoury) En partenariat avec GRAME, Centre national de création musicale Extraits radiophoniques réalisés par Claire Lagarde et issus des émissions Le Portrait contemporain et Magazine de la contemporaine (Arnaud Merlin – France Musique). DURÉE DU CONCERT : ENVIRON 1H25. Concert diffusé le 14 avril 2021 à 20h sur France Musique Éric Besnier Christophe Desjardins, © Hommage à Christophe Desjardins, 1962-2020 J’ai rencontré pour la première fois Christophe alors qu’il venait de rejoindre l’Ensemble intercontemporain. Il était curieux, intéressé, engagé et généreux de son temps. Il avait également le désir de faire avancer son instrument, de créer un nouveau répertoire pour ce magnifique instrument qu’est l’alto. Parmi mes nombreux souvenirs, je retiens celui d’une exécution phénoménale d’Ein- spielung III d’Emmanuel Nunes à Strasbourg. Lorsque j’ai appris sa disparition, le titre d’une pièce de Frédéric Durieux m’est tout de suite venu à l’esprit, So schnell, zu früh, qui doit son titre à une cantate de Bach. -

11 Desjardins
N° 11 Dimanche 25 septembre 2011 à 11h Salle de la Bourse Christophe Desjardins, alto Avec le soutien de la Sacem Alto, Christophe Desjardins Projection sonore, Philippe Manoury (Partita I) Réalisation informatique musicale Grame, Christophe Lebreton (Partita I) Réalisation informatique musicale Ircam, Serge Lemouton (Partita I) ---- Johann Sebastian Bach Partita II BWV 1004 (1720) / 25 min. transcription de la Partita II en ré mineur pour violon I. Allemande II. Courante III. Sarabande IV. Gigue V. Chaconne Philippe Manoury Partita I (2006) / 42 min. alto et électronique en temps réel fin du concert : 12h30 À propos du concert De l'alto, instrument toujours un peu secret et méconnu, Christophe Desjardins a fait une référence. Philippe Manoury a composé pour lui son immense Partita dans laquelle le geste instrumental est prolongé par l'électronique. Partita : ce mot – pourtant d'apparence si banal – suffit à évoquer Johann Sebastian Bach, sa musique insurpassable, son absolu. Cet accomplissement intellectuel et sensible est la synthèse parfaite des deux cerveaux à laquelle aspirent musiciens et mélomanes. Saisissant ce mot, Philippe Manoury situe à la fois son ambition et sa déférence pour Bach. Neuf parties composent cette Partita pour alto et électronique en temps réel, composée de juillet à décembre 2006, qui inaugure un cycle consacré aux instruments à cordes avec électronique. Fixé au doigt du soliste, un capteur permet d'analyser les accélérations et pressions de l'archet sur les cordes. Ces informations pilotent – sans affecter le jeu – un dispositif électro-acoustique : un rapport intime entre les infimes variations du musicien et le contrôle des sons de synthèse est ainsi nouvellement créé. -

4E Biennale D'art Vocal
Roch-Olivier Maistre, Président du Conseil d’administration Laurent Bayle, Directeur général Mardi 9 et samedi 13 juin Dans le cadre de la 4e Biennale d’Art Vocal de la Cité de la musique et du festival Agora de l’Ircam. Mardi 9 et samedi 13 juin 13 9 et samedi Mardi | festival Agora Agora festival | Vous avez la possibilité de consulter les notes de programme en ligne, 2 jours avant chaque concert, à l’adresse suivante : www.citedelamusique.fr ÊTRE FIDÈLE À LA MUSIQUE Biennale d’Art Vocal Vocal Biennale d’Art e 4 4e Biennale d’Art Vocal DIMANCHE 31 MAI, 15H MARDI 2 JUIN, 20H30 JEUDI 4 JUIN, 20H30 Œuvres de John Rutter, George Emils Darzins Antonio Caldara Gershwin, Annie Cordie, Hector Sapnu taluma Symphonie en la mineur Berlioz… Cianas berni Biagio Marini Naru dziesma Passacaglio in sol Chœur d’Enfants Sotto Voce Lautzas priedes Claudio Monteverdi Scott Alan Prouty, direction Gustav Mahler/Clytus Gottwald Pianto della Madonna sur le Lamento Richard Davis, piano Scheiden und meiden d’Arianna Die zwei blauen Augen Antonio Vivaldi Entrée libre Ich bin der Welt abhanden gekommenn Concerto madrigalesco Richard Strauss en ré mineur RV 129 Zwei Gesänge op. 34 / Der Abend - Hymne Sonate en mi bémol majeur RV 130 DIMANCHE 31 MAI, 16H30 Traumlicht « Al Santo Sepolcro » Deutsche Motette op. 62 Francesco Conti Joseph Haydn Sento già mancar la vita Symphonie n° 104 « Londres » Accentus Johann Georg Pisendel Harmoniemesse Latvijas Radio Koris Sonate en do mineur Laurence Equilbey, direction Sigmund Leopold Weiss Orchestre Philharmonique Prélude et -

Récital Alto Solo Christophe Desjardins
Vendredi 8 décembre 2017 19h Palais Lascaris, Nice Récital alto solo Christophe Desjardins Edith Canat de Chizy "Lament" Pour alto seul (2015) 8' Alberto Posadas "Tombeau et Double" Pour alto seul (2014) 30' Patrick Marcland "Alto solo II" Pour alto et électronique (2007) 5' Katherine Balch "Off Hesperus" CREATION Pour alto scordatura, électronique et lumières - 10' Monica Gil Giraldo, Réalisatrice informatique musicale COMMANDE & PRODUCTION CIRM 2017 Pierre Boulez "Messagesquisse" Pour alto et bande (1976 / 2000) 8' Technique CIRM, Monica Gil Giraldo ingénieur du son Concert enregistré par France Musique Fin du concert : 20h15 Passeur infatigable, Christophe Desjardins nous fait partager avec ce récital quelques-unes de ses toutes dernières créations. Pour alto seul tout d’abord, avec "Lament" d’Edith Canat de Chizy, qui s’inscrit dans la grande tradition des Lamenti de Monteverdi ou Purcell. Pour alto préparé ensuite avec le monumental "Tombeau et Double" d’Alberto Posadas, où le timbre si particulier de l’alto gagne encore de nouveaux territoires. Dans la deuxième partie du programme l’électronique vient multiplier et diffracter le son de l’instrument, avec les pièces de Patrick Marcland et Pierre Boulez, deux compagnons de route de longue date de l'altiste. Commande du CIRM et donnée en création mondiale, la nouvelle œuvre de l'américaine Katherine Balch est une féérie secrète, tant pour les oreilles que pour les yeux. Un joyau de musique dans l’écrin du Palais Lascaris. Les œuvres "Lament" d’Edith Canat de Chizy Pour alto seul (2015) 8' Cette pièce se situe dans la grande tradition des lamenti de Monteverdi, Purcell, Britten (Lacrimae), ou encore plus récemment le Concerto lugubre de Tadeusz Baird. -

Pierre Jodlowski (*1971)
© Jean Radel PIERRE JODLOWSKI (*1971) 1 Drones 16:21 Pour ensemble de 15 instruments 2 Barbarismes 24:41 Pour ensemble et électronique 3 Dialog/No Dialog 14:45 Pour flûte et électronique TT: 55:49 Sophie Cherrier flute Susanna Mälkki conductor Ensemble intercontemporain IRCAM-Centre Pompidou Recording venues: 1 Paris, Cité de la musique, Salle des concerts 2 , 3 Paris, IRCAM, Espace de projection Recording dates: 1 1.10.2007, 2 9/10.11.2009, 3 21.09.2009 Recording supervisor: Vincent Villetard Recording engineers: 1 Franck Rossi-Maxime Le Saux, 2 Jérémie Henrot-Sylvain Cadars, 3 Sylvain Cadars Editing: 1 Joachim Olaya, 2 - 3 Sylvain Cadars Post production and mixing: 1 Joachim Olaya, 2 Jérémie Henrot, 3 Sylvain Cadars Co-production of IRCAM-Centre Pompidou Ensemble intercontemporain KAIROS 2 Ensemble intercontemporain Alain Billard bass clarinet Arnaud Boukhitine tuba Sophie Cherrier flute Jeanne-Marie Conquer violin Eric-Maria Couturier cello Antoine Curé trumpet Alain Damiens clarinet Christophe Desjardins viola Gilles Durot percussion Samuel Favre percussion Jean-Jacques Gaudon trumpet Philippe Grauvogel oboe Hae-Sun Kang violin Hidéki Nagano piano Jérôme Naulais trombone Emmanuelle Ophèle flute Paul Riveaux bassoon Benny Sluchin trombone Frédéric Stochl double bass Pierre Strauch cello Diégo Tosi violin Jean-Christophe Vervoitte horn 3 Jodlowski en quatre points Du geste, essentiellement, il y a variante ou répétition Martin Kaltenecker graduée. Toute la première partie de Drones est un tissage d’éléments répétés produisant un ostinato Geste général ; toute la fin construite sur la répétition, par exemple, de rythmes à 5/8 dans le piano que Pierre Jodlowski reprend à son compte, pleinement, Stravinsky aurait nargués, dérangés, fait trébucher ; tout un discours du geste devenu central depuis une ici, c’est une pulsation empruntée au jazz qui fait quinzaine d’années dans le domaine de la musique naître les découpages : « des énergies devenant ryth- contemporaine et de l’interprétation musicale, celle- mes1 », et non l’inverse.