Le Secteur Fiherenana Dans Un Contexte
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ecosystem Profile Madagascar and Indian
ECOSYSTEM PROFILE MADAGASCAR AND INDIAN OCEAN ISLANDS FINAL VERSION DECEMBER 2014 This version of the Ecosystem Profile, based on the draft approved by the Donor Council of CEPF was finalized in December 2014 to include clearer maps and correct minor errors in Chapter 12 and Annexes Page i Prepared by: Conservation International - Madagascar Under the supervision of: Pierre Carret (CEPF) With technical support from: Moore Center for Science and Oceans - Conservation International Missouri Botanical Garden And support from the Regional Advisory Committee Léon Rajaobelina, Conservation International - Madagascar Richard Hughes, WWF – Western Indian Ocean Edmond Roger, Université d‘Antananarivo, Département de Biologie et Ecologie Végétales Christopher Holmes, WCS – Wildlife Conservation Society Steve Goodman, Vahatra Will Turner, Moore Center for Science and Oceans, Conservation International Ali Mohamed Soilihi, Point focal du FEM, Comores Xavier Luc Duval, Point focal du FEM, Maurice Maurice Loustau-Lalanne, Point focal du FEM, Seychelles Edmée Ralalaharisoa, Point focal du FEM, Madagascar Vikash Tatayah, Mauritian Wildlife Foundation Nirmal Jivan Shah, Nature Seychelles Andry Ralamboson Andriamanga, Alliance Voahary Gasy Idaroussi Hamadi, CNDD- Comores Luc Gigord - Conservatoire botanique du Mascarin, Réunion Claude-Anne Gauthier, Muséum National d‘Histoire Naturelle, Paris Jean-Paul Gaudechoux, Commission de l‘Océan Indien Drafted by the Ecosystem Profiling Team: Pierre Carret (CEPF) Harison Rabarison, Nirhy Rabibisoa, Setra Andriamanaitra, -

A Taxonomic Revision of Melanoxerus (Rubiaceae), with Descriptions of Three New Species of Trees from Madagascar
A taxonomic revision of Melanoxerus (Rubiaceae), with descriptions of three new species of trees from Madagascar Kent Kainulainen Abstract KAINULAINEN, K. (2021). A taxonomic revision of Melanoxerus (Rubiaceae), with descriptions of three new species of trees from Madagascar. Candollea 76: 105 – 116. In English, English and French abstracts. DOI: http://dx.doi.org/10.15553/c2021v761a11 This paper provides a taxonomic revision of Melanoxerus Kainul. & Bremer (Rubiaceae) – a genus of deciduous trees with eye-catching flowers and fruits that is endemic to Madagascar. Descriptions of three new species, Melanoxerus antsirananensis Kainul., Melanoxerus atropurpureus Kainul., and Melanoxerus maritimus Kainul. are presented along with distribution maps and a species identification key. The species distributions generally reflect the ecoregions of Madagascar, with Melanoxerus antsirananensis being found in the dry deciduous forests of the north; Melanoxerus atropurpureus in the inland dry deciduous forests of the west; Melanoxerus maritimus in dry deciduous forest on coastal sands; and Melanoxerus suavissimus (Homolle ex Cavaco) Kainul. & B. Bremer in the dry spiny thicket and succulent woodlands of the southwest. Résumé KAINULAINEN, K. (2021). Révision taxonomique du genre Melanoxerus (Rubiaceae), avec la description de trois nouvelles espèces d’arbres de Madagascar. Candollea 76: 105 – 116. En anglais, résumés anglais et français. DOI: http://dx.doi.org/10.15553/c2021v761a11 Cet article propose une révision taxonomique de Melanoxerus Kainul. & Bremer (Rubiaceae), un genre d’arbres à feuilles caduques avec des fleurs et des fruits attrayants qui est endémique de Madagascar. La description de trois nouvelles espèces, Melanoxerus antsirananensis Kainul., Melanoxerus atropurpureus Kainul. et Melanoxerus maritimus Kainul. est présentée accompagné de cartes de répartition et d’une clé d’identification des espèces. -

Résultats Détaillés Toliary
RESULTATS SENATORIALES DU 29/12/2015 FARITANY: 6 TOLIARY BV reçus: 304 sur 304 HVM IND OBAMA FITIBA AVOTS AREMA MAPAR IND IND TIM IND IND MONIM AJFO E OMBILA MIARA- MASOA TSIMAN A TANIND HY DIA NDRO AVAKE N°BV Emplacement AP AT Inscrits Votants B N S E RAZA MAHER Y REGION 61 ANDROY BV reçus 58 sur 58 DISTRICT: 6101 AMBOVOMBE ANDROY BV reçus21 sur 21 01 AMBANISARIKA 0 0 8 8 0 8 5 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 02 AMBAZOA 0 0 8 7 1 6 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 03 AMBOHIMALAZA 0 0 8 8 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 04 AMBONAIVO 0 0 8 8 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 05 AMBONDRO 0 0 8 7 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 AMBOVOMBE ANDRO 1 0 12 12 2 10 7 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 07 AMPAMATA 1 0 8 8 1 7 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 08 ANALAMARY 0 0 6 6 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 09 ANDALATANOSY 0 0 8 7 0 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 ANDOHARANO 1 0 6 5 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 ANDRAGNANIVO 0 0 6 6 0 6 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 12 ANJEKY ANKILIKIRA 1 0 8 8 1 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 ANTANIMORA SUD 0 0 8 8 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 14 ERADA 0 0 8 8 1 7 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 15 IMANOMBO 0 0 8 8 0 8 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 16 JAFARO 0 0 8 8 0 8 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 17 MAROALOMAINTE 1 0 8 8 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 18 MAROALOPOTY 0 7 8 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 MAROVATO BEFENO 0 0 8 7 0 7 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 20 SIHANAMARO 0 0 8 8 0 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 21 TSIMANANADA 0 0 8 8 0 8 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 TOTAL DISTRICT 5 7 166 160 18 142 91 1 0 0 2 1 3 7 9 0 0 0 28 DISTRICT: 6102 BEKILY BV reçus20 sur -

Evaluation Des Impacts Du Cyclone Haruna Sur Les Moyens De Subsistance
1 EVALUATION DES IMPACTS DU CYCLONE HARUNA SUR LES MOYENS DE SUBSISTANCE, ET SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE ET LA VULNERABILITE DES POPULATONS AFFECTEES commune rurale de Sokobory, Tuléar Tuléar I Photo crédit : ACF Cluster Sécurité Alimentaire et Moyens de Subsistance Avril 2013 2 TABLE DES MATIERES LISTE DES CARTES..................................................................................................................................... 3 LISTE DES GRAPHIQUES ..................................................................................................................................... 3 LISTE DES TABLEAUX ........................................................................................................................................... 4 ACRONYMES ............................................................................................................................................................ 5 RESUME ........................................................................................................................................................ 6 1. CONTEXTE ............................................................................................................................................ 8 2. OBJECTIFS ET METHODES ............................................................................................................. 11 2.1 OBJECTIFS ........................................................................................................................................... 11 2.2 METHODOLOGIE -
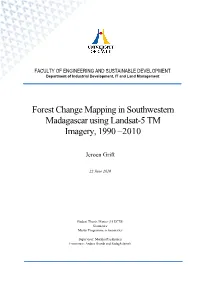
Forest Change Mapping in Southwestern Madagascar Using Landsat-5 TM Imagery, 1990 –2010
FACULTY OF ENGINEERING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT Department of Industrial Development, IT and Land Management Forest Change Mapping in Southwestern Madagascar using Landsat-5 TM Imagery, 1990 –2010 Jeroen Grift 22 June 2016 Student Thesis, Master (15 ECTS) Geomatics Master Programme in Geomatics Supervisor: Markku Pyykkönen Examiners: Anders Brandt and Sadegh Jamali Abstract The main goal of this study was to map and measure forest change in the southwestern part of Madagascar near the city of Toliara in the period 1990-2010. Recent studies show that forest change in Madagascar on a regional scale does not only deal with forest loss, but also with forest growth However, it is unclear how the study area is dealing with these patterns. In order to select the right classification method, pixel-based classification was compared with object-based classification. The results of this study shows that the object-based classification method was the most suitable method for this landscape. However, the pixel-based approaches also resulted in accurate results. Furthermore, the study shows that in the period 1990–2010, 42% of the forest cover disappeared and was converted into bare soil and savannahs. Next to the change in forest, stable forest regions were fragmented. This has negative effects on the amount of suitable habitats for Malagasy fauna. Finally, the scaling structure in landscape patches was investigated. The study shows that the patch size distribution has long-tail properties and that these properties do not change in periods of deforestation. Keywords: Deforestation, pixel-based classification, object-based classification, landscape metrics, scaling structure II Table of Contents Abstract ................................................................................................................................................. -

Evolution De La Couverture De Forets Naturelles a Madagascar
EVOLUTION DE LA COUVERTURE DE FORETS NATURELLES A MADAGASCAR 1990-2000-2005 mars 2009 La publication de ce document a été rendue possible grâce à un support financier du Peuple Americain à travers l’USAID (United States Agency for International Development). L’analyse de la déforestation pour les années 1990 et 2000 a été fournie par Conservation International. MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DES FORETS ET DU TOURISME Le présent document est un rapport du Ministère de l’Environnement, des Forêts et du Tourisme (MEFT) sur l’état de de l’évolution de la couverture forestière naturelle à Madagascar entre 1990, 2000, et 2005. Ce rapport a été préparé par Conservation International. Par ailleurs, les personnes suivantes (par ordre alphabétique) ont apporté leur aimable contribution pour sa rédaction: Andrew Keck, James MacKinnon, Norotiana Mananjean, Sahondra Rajoelina, Pierrot Rakotoniaina, Solofo Ralaimihoatra, Bruno Ramamonjisoa, Balisama Ramaroson, Andoniaina Rambeloson, Rija Ranaivosoa, Pierre Randriamantsoa, Andriambolantsoa Rasolohery, Minoniaina L. Razafindramanga et Marc Steininger. Le traitement des imageries satellitaires a été réalisé par Balisama Ramaroson, Minoniaina L. Razafindramanga, Pierre Randriamantsoa et Rija Ranaivosoa et les cartes ont été réalisées par Andriambolantsoa Rasolohery. La réalisation de ce travail a été rendu possible grâce a une aide financière de l’United States Agency for International Development (USAID) et mobilisé à travers le projet JariAla. En effet, ce projet géré par International Resources Group (IRG) fournit des appuis stratégiques et techniques au MEFT dans la gestion du secteur forestier. Ce rapport devra être cité comme : MEFT, USAID et CI, 2009. Evolution de la couverture de forêts naturelles à Madagascar, 1990- 2000-2005. -

EITI-Madagascar
Rapport de réconciliation 2018 – EITI-Madagascar EITI-Madagascar Rapport de réconciliation 2018 Annexes Version finale Novembre 2019 Confidentiel – Tous droits réservés - Ernst & Young Madagascar Rapport final | 1 Rapport de réconciliation 2018 – EITI-Madagascar Sommaire ANNEXES .......................................................................................................................................................... 3 Annexe 1 : Points de décision en matière de divulgation de la propriété réelle ........................................ 4 Annexe 2 : Tableau de correspondance entre flux de paiements et entités réceptrices ............................ 9 Annexe 3 : Données brutes pour sélectionner les compagnies ............................................................... 11 Annexe 4 : Identification des sociétés ..................................................................................................... 12 Annexe 5 : Arbres capitalistiques des sociétés ........................................................................................ 26 Annexe 6 : Présentation des flux de paiement ........................................................................................ 31 Annexe 7 : Matérialité des régies et des flux concernés par les taxes et revenus pour 2015 et 2016 (#4.1) 35 Annexe 8 : Cas Mpumalanga – Lettre du Ministre ................................................................................... 36 Annexe 9 : Cas Mpumalanga – Acte de rejet du BCMM ......................................................................... -

Liste Candidatures Maires Atsimo Andrefana
NOMBRE DISTRICT COMMUNE ENTITE NOM ET PRENOM(S) CANDIDATS CANDIDATS ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA AMPANIHY OUEST AMBOROPOTSY 1 VAKISOA (ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA) AMPANIHY OUEST AMBOROPOTSY 1 INDEPENDANT SOLO (INDEPENDANT SOLO) BESADA AMPANIHY OUEST AMBOROPOTSY 1 AVI (ASA VITA NO IFAMPITSARANA) TOVONDRAOKE AMPANIHY OUEST AMBOROPOTSY 1 TIM (TIAKO I MADAGASIKARA) REMAMORITSY AMPANIHY OUEST AMBOROPOTSY 1 HIARAKA ISIKA (HIARAKA ISIKA) SORODO INDEPENDANT MOSA Jean Baptiste (INDEPENDANT AMPANIHY OUEST AMPANIHY CENTRE 1 FOTOTSANAKE MOSA Jean Baptiste) ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA AMPANIHY OUEST AMPANIHY CENTRE 1 TOVONASY (ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA) ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA AMPANIHY OUEST ANDROKA 1 ESOLONDRAY Raymond (ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA) AMPANIHY OUEST ANDROKA 1 TIM (TIAKO I MADAGASIKARA) LAHIVANOSON Jacques AMPANIHY OUEST ANDROKA 1 MMM (MALAGASY MIARA MIAINGA) KOLOAVISOA René INDEPENDANT TSY MIHAMBO RIE (INDEPENDANT AMPANIHY OUEST ANDROKA 1 EMANINTSINDRAZA TSY MIHAMBO RIE) INDEPENDANT ESOATEHY Victor (INDEPENDANT AMPANIHY OUEST ANDROKA 1 EFANOMBO ESOATEHY Victor) ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA AMPANIHY OUEST ANKILIABO 1 ZOENDRAZA Fanilina (ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA) INDEPENDANT TAHIENANDRO (INDEPENDANT AMPANIHY OUEST ANKILIABO 1 EMAZINY Mana TAHIENANDRO) AMPANIHY OUEST ANKILIABO 1 TIM (TIAKO I MADAGASIKARA) RASOBY AMPANIHY OUEST ANKILIABO 1 HIARAKA ISIKA (HIARAKA ISIKA) MAHATALAKE ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA AMPANIHY OUEST -

Bulletin D'information Du Cluster Nutrition Resultats De La Surveillance
© UNICEF/UNI209764/Ralaivita BULLETIN D’INFORMATION DU CLUSTER NUTRITION RESULTATS DE LA SURVEILLANCE NUTRITIONNELLE DANS DIX DISTRICTS DU SUD DE MADAGASCAR TROISIEME TRIMESTRE 2020 © UNICEF/UN0280943/Rakotobe BULLETIN D’INFORMATION DU CLUSTER NUTRITION RESULTATS DE LA SURVEILLANCE NUTRITIONNELLE DANS HUIT DISTRICTTS DU SUD DE MADAGASCAR | PAGE 2 I. APERÇU DE LA SITUATION NUTRITIONNELLE Au cours du troisième trimestre 2020, dix districts du sud de Madagascar ont bénéficié des dépistages exhaustifs de la malnutrition aiguë. Cette activité a été mise en œuvre par les services déconcentrés du Gouvernement de Madagascar (Office National de Nutrition et Ministère de la Santé Publique) avec l’appui technique et financier de l’UNICEF. Sur l’ensemble des dix districts, 436.388 enfants ont été dépistés sur un total de 447.178 enfants âgés de 6 à 59 mois attendus (soit 98%). L’analyse des résultats révèle une : • Urgence nutritionnelle dans 13% des communes (26 communes sur 202) • Alerte nutritionnelle dans 14% des communes (29 communes sur 202) • Situation nutritionnelle « sous contrôle » dans 73% des communes (147 communes sur 202) © UNICEF/UNI209771/Ralaivita En 2018 et 2019, les districts de Tuléar 2 et Betroka ne faisaient pas partie des zones couvertes par le Système de Surveillance Nutritionnelle (SSN). Ainsi, en excluant ces deux districts (afin de rendre la comparaison avec ces périodes possible), les résultats du dépistage du T3 2020 montrent que la situation nutritionnelle dans les communes des huit districts n’a pas vraiment changé par rapport à T3-2019 (14% en Urgence, 15% en Alerte et 71% « sous contrôle » dans 154 communes). Il en est de même par rapport à la situation du T3 2018. -

Stakeholder Engagement
RANOBE MINE PROJECT, SOUTHWEST REGION, MADAGASCAR VOLUME 21: STAKEHOLDER ENGAGEMENT Prepared for: Prepared by: World Titanium Resources Ltd Coastal & Environmental Services 15 Lovegrove Close, P.O. Box 934, Mount Claremont Grahamstown, 6140 Western Australia South Africa 6010 Also in East London January 2013 Stakeholder Engagement – January 2013 COPYRIGHT INFORMATION This document contains intellectual property and propriety information that is protected by copyright in favour of Coastal & Environmental Services and the specialist consultants. The document may therefore not be reproduced, used or distributed to any third party without the prior written consent of Coastal & Environmental Services. This document is prepared exclusively for submission to Toliara Sands Ltd., and is subject to all confidentiality, copyright and trade secrets, rules intellectual property law and practices of Madagascar. Coastal & Environmental Services i Ranobe Mine Project Stakeholder Engagement – January 2013 TABLE OF CONTENTS 1. STAKEHOLDER ENGAGEMENT ACTIVITIES ...................................................................... 1 1.1 Stakeholder Engagement during the Original ESIA ............................................................. 1 1.2 Stakeholder Engagement during the Scoping Phase of the present ESIA .......................... 3 1.3 Stakeholder Engagement during the ESIA Phase of the present ESIA ............................. 78 LIST OF TABLES Table 1.1: Stakeholder Analysis ..................................................................................................... -

Reglementation De La Filiere Bois Energie Dans La Region
EN PARTENARIAT AVEC : SEPTEMBRE REGLEMENTATION DE LA FILIERE BOIS ENERGIE DANS LA REGION ATSIMO ANDREFANA Acquis et leçons apprises • 2008 à 2011 Programme WWF à Madagascar et dans l’Océan Indien Occidental RÉSUMÉ Le bois est la principale source d’énergie utilisée par les ménages malgaches. Il représente 92% de l’offre énergétique à Madagascar. Le bois énergie, notamment le bois de chauffe et le charbon de bois, a l’avantage d’être disponible, facile à stocker et à utiliser, à faible coût par rapport à d’autres sources d’énergie de cuisson comme le gaz ou l’électricité. Les récentes analyses1 menées au niveau national prévoient une pénurie dans les années à venir si aucune mesure n’est prise, du fait d’une offre en bois énergie qui n’arrivera pas à satisfaire la demande. Par ailleurs, la répartition des ressources forestières disponibles n’est pas équilibrée. Les zones forestières à proximité des grandes villes sont sous forte pression pour satisfaire les besoins urbains en charbon de bois. La mise en place d’outils de régulation pour garantir l’approvisionnement durable en charbon de bois des milieux urbains s’avère ainsi nécessaire. Une proposition de réforme de textes législatifs régissant les activités de la filière a été proposée en 2009 à l’administration forestière, mais reste sans suite à ce jour. Ce projet de réforme avait fait Depuis 2008, le Programme du WWF à Madagascar et dans l’Océan Indien Occidental œuvre avec les différents acteurs de l’objet de différentes consultations, notamment au niveau des différentes directions interrégionales des forêts, pour la filière Bois Energie pour l’instauration d’une réglementation de la filière dans la région Atsimo Andrefana. -

Maîtrise Géographie Miary Tena
UNIVERSITE DE TOLIARA -------------------- FACULTE DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES ---------------------- DEPARTEMENT DE GEOGRAPHIE ---------------------- LES STRATEGIES PAYSANNES DE DEVELOPPEMENT DANS LA COMMUNE RURALE DE MMIARYIARY Mémoire de Maîtrise Présenté par ANTUFA ALLAOUI Sous la direction de : Mr Marcel NAPETOKE Maître de Conférences à l’Université de Tuléar Date de soutenance : 03 Mai 2011 Année universitaire : 2010-2011 REMERCIEMENTS Ce travail d’études et de recherches ne saurait voir le jour sans l’appui actif et judicieux de ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce document. Pour cela, notre gratitude va en premier lieu à : - Docteur Marcel NAPETOKE, Maître de conférences à l’Université de Toliara pour avoir accepté de diriger ce travail d’études et de recherches malgré ses lourdes préoccupations. - Monsieur SOLO Jean Robert, Assistant de Recherches et Directeur du Département de Géographie, il nous a permis l’autorisation d’enquête auprès de différents acteurs dans la commune rurale de Miary. - Monsieur JAOVOLA Tombo, Assisant de Recherches pour ses conseils précieux dans l’analyse des données et la planification de ce travail. Nos reconnaissances vont droit à tous les enseignants du Département de Géographie pour la formation et l’enseignement qu’ils nous ont dispensés depuis notre première année d’études à l’Université de Toliara jusqu’à ce jour. Nous tenons également à remercier : - Monsieur FINDRAMAHOLA Elson, Maire de la Commune rurale de Miary qui nous a permis d’effectuer facilement des enquêtes auprès des différents acteurs du développement de sa circonscription. - Monsieur RAFIDSON Rebakely, Troisième Adjoint au Maire qui nous a accueilli aussi à bras ouvert pour le complément d’informations nécessaires qu’il a apporté.