Liste Rouge Champignons Supérieurs
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Rote Liste Der Gefährdeten Arten Der Schweiz Ausgabe 2007
> Umwelt-Vollzug > Rote Listen / Artenmanagement 18 > Rote Liste 07 Grosspilze Rote Liste der gefährdeten Arten der Schweiz Ausgabe 2007 > Umwelt-Vollzug > Rote Listen / Artenmanagement > Rote Liste Grosspilze Rote Liste der gefährdeten Arten der Schweiz Ausgabe 2007 Autoren: Beatrice Senn-Irlet, Guido Bieri, Simon Egli Herausgegeben vom Bundesamt für Umwelt BAFU und der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL Bern, 2007 Rechtlicher Stellenwert dieser Publikation Impressum Rote Liste des BAFU im Sinne von Artikel 14 Absatz 3 der Verordnung Herausgeber vom 16. Januar 1991 über den Natur- und Heimatschutz (SR 451.1) Bundesamt für Umwelt (BAFU), Bern www.admin.ch/ch/d/sr/45.html. Eidgenössische Anstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL), Birmensdorf ZH Diese Publikation ist eine Vollzugshilfe des BAFU als Aufsichtsbehörde und richtet sich primär an die Vollzugsbehörden. Sie konkretisiert Autoren unbestimmte Rechtsbegriffe von Gesetzen und Verordnungen und soll Beatrice Senn-Irlet, Biodiversität und Naturschutzbiologie WSL, eine einheitliche Vollzugspraxis fördern. Berücksichtigen die Guido Bieri, wildbild Vollzugsbehörden diese Vollzugshilfen, so können sie davon Simon Egli, Walddynamik WSL ausgehen, dass sie das Bundesrecht rechtskonform vollziehen; andere Lösungen sind aber auch zulässig, sofern sie rechtskonform Begleitung sind. Das BAFU veröffentlicht solche Vollzugshilfen (bisher oft auch als Francis Cordillot, Stephan Lussi, Abteilung Artenmanagement, BAFU Richtlinien, Wegleitungen, Empfehlungen, Handbücher, Praxishilfen Schweizerische Kommission für die Erhaltung der Pilze SKEP/CSSC u.ä. bezeichnet) in seiner Reihe «Umwelt-Vollzug». Zitiervorschlag Senn-Irlet B., Bieri G., Egli S. 2007: Rote Liste der gefährdeten Grosspilze der Schweiz. Umwelt-Vollzug Nr. 0718. Hrsg. Bundesamt für Umwelt, Bern, und WSL, Birmensdorf. 92 S. Gestaltung Ursula Nöthiger-Koch, Uerkheim Titelfoto Oudemansiella mucida (Schrad.:Fr.) Hoehn. -

Liste Rouge Des Espèces Menacées En Suisse: Champignons Supérieurs
> L’environnement pratique > Listes rouges / Gestion des espèces 18 > Liste rouge 07 Champignons supérieurs Liste rouge des espèces menacées en Suisse Édition 2007 > L’environnement pratique > Listes rouges / Gestion des espèces > Liste rouge Champignons supérieurs Liste rouge des espèces menacées en Suisse Édition 2007 Auteurs: Beatrice Senn-Irlet, Guido Bieri, Simon Egli Publié par l’Office fédéral de l’environnement OFEV et par l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL Berne, 2007 Valeur juridique de cette publication Impressum Liste rouge de l’OFEV au sens de l’article 14, 3e alinéa de Éditeur l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du Office fédéral de l’environnement (OFEV), Berne paysage (RS 451.1) www.admin.ch/ch/f/sr/45.html Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL), Birmensdorf ZH La présente publication est une aide à l’exécution élaborée par l’OFEV en tant qu’autorité de surveillance. Destinée en premier lieu Auteurs aux autorités d’exécution, elle concrétise des notions juridiques Beatrice Senn-Irlet, biodiversité et conservation biologique, WSL indéterminées provenant de lois et d’ordonnances et favorise ainsi Guido Bieri, wildbild une application uniforme de la législation. Si les autorités d’exécution Simon Egli, dynamique forestière, WSL en tiennent compte, elles peuvent partir du principe que leurs décisions seront conformes au droit fédéral. D’autres solutions sont Responsables aussi licites dans la mesure où elles sont conformes au droit en Francis Cordillot et Stephan Lussi, Division Gestion des espèces OFEV vigueur. -

I Funghi Della Zona Subalpina E Alpina Dello Sciliar – Raccolta Dei Dati E Considerazioni Al “Progetto Sciliar”
Gredleriana Vol. 8 / 2008 pp. 47 - 74 I funghi della zona subalpina e alpina dello Sciliar – Raccolta dei dati e considerazioni al “Progetto Sciliar” Claudio Rossi & Francesco Bellù A cura del comitato scientifico della Associazione Micologica Bresadola Gruppo di Bolzano Abstract The fungi of the subalpine and alpine zone of the Sciliar massif – checklist and conclusions of the "Sciliar project" The author describes the methods of the search for fungi and of the mycological work adopted by the Gruppo Micologico Bresadola of Bolzano within the "Nature Project Schlern" during the research years 2006 and 2007. Results and scientific conclusions include a checklist (578 taxa) with descriptions and illustrations of rare and/or peculiar fungi, as well as ecological considerations based on the recorded fungal community patterns. Keywods: Checklist, Fungi, Basidiomycota, Ascomycota, Myxomycetes, Sciliar, South Tyrol, Italy. 1. Introduzione Quando, nella primavera del 2006, la nostra Associazione micologica fu contattata dall’Ufficio Provinciale “Bacini Montani” e dal Museo di Scienze Naturali di Bolzano per aderire ad un progetto di ricerca sulla biodiversità nella zona dello Sciliar-Schlern, iniziò per noi un'affascinante ed interessante esperienza, che mise alla prova il nostro apparato organizzativo e scientifico. Non era sicuramente la prima esperienza per noi, infatti da molti anni collaboriamo con vari uffici della Provincia Autonoma di Bolzano ad alcuni progetti come il controllo della radioattività ed il monitoraggio ambientale. L’area dello Sciliar-Schlern, non era per noi certo una zona di studio nuova, visto che studiamo intensamente questa zona da oltre 30 anni, assieme a tutta la Provincia di Bolzano, di cui abbiamo intenzione di pubblicare, con il tempo, una completa micoflora. -

Liite 1. Explanations to the Distribution and Ecology Tables of Agarics and Boletes in Finland
Liite 1/1 Liite 1. Explanations to the distribution and ecology tables of agarics and boletes in Finland Distribution table Laji = species, taxon IUCN-luokka = IUCN category Uusi luokka = new category Omaa luontoarvoa = shows /has value as an indicator Ruotsi = IUCN category in Sweden Elinympäristöt = habitats M = Forests Mk = heath forests Mkk = — dry heath forests Mkt = — mesic heath forests Ml = herb-rich forests Mlt = — dry and mesic herb-rich forests Mlk = — moist herb-rich forests Additional elements to all forest types: v = old-growth forests h = esker forests p = burnt forest areas and other young stages of natural succession S = Mires Sl = rich fens Sla = — open rich fens Slr = — type of wooded rich fen (usually pine dominated) Slk = — type of wooded rich fen (usually spruce dominated) Sn = fens Snk = — ombro- and oligotrofic fens Snr = — mesotrofic fens Sr = pine mires Srk = — ombro- and oligotrofic pine mires Srr = — mesotrophic pine mires Sk = spruce mires Skk = — oligotrophic spruce mires Skr = — eutrophic and mesotrophic spruce mires V = Aquatic habitats Vi = Baltic Sea Vs = lakes and ponds Vsk = — oligotrophic lakes and ponds Vsr = — eutrophic lakes and ponds Va = small ponds (in the mires etc.) Vj = rivers Vp = brooks and small rivers Vk = rapids Vl = springs and spring fens Suomen ympäristö 769 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 427 Liite 1/2 R = Shores Ri = shores of the Baltic Sea Rih = — Baltic sandy shores Rin = — Baltic coastal meadows Rik = — Baltic rocky shores Ris = — Baltic stony shores Rit = — Baltic -

Extinct Species and Potentially Threatened Species
PERSOONIA Published by the Rijksherbarium, Leiden Volume 14, Part 1, pp. 77-125 (1989) A preliminary Red Data List of Macrofungi in the Netherlands Eef Arnolds Biological Station, Wijster (Drente), Netherlands An enumeration is presented of species of macrofungi considered to be threatened in the Netherlands. The list comprises 944 species, including 91 (presumably) extinct species and 182 species which are directly threatened with extinction. In addition for each species is if the associated information given on preferential habitat, substrate, possible organ- of habitat estimated before 1950 and after 1970 and isms, way exploitation, frequency in Red Data Lists of other countries. The criteria used for presence European placing a species on the Red Data List are briefly discussed. Some statistical data are presented on contribution of various taxonomic and the list. The the proportional ecological groups to most important causes for the decrease ofthreatened macrofungi are concisely discussed and some measures for conservation of macrofungiare recommended. 1. Introduction In the framework of an expected revision of the national law on nature conservation, the Nature Conservation Council in the Netherlandsintended to make an inventory ofproblems concerning conservation oflower plants (bryophytes, lichens and algae) and fungi. Lists of threatened species will possibly be includedin the new law. For the preparation of these lists ad hoc of and accompanying texts an working group experts was appointed in 1985, in which the and the present author participated proposed text on fungi. The results were published as proposals to the Ministerof Agriculture in 1986 (Natuurbeschermingsraad, 1986) and includ- ed a list of 406 selected threatened fungi (see also Kuyper, 1987). -
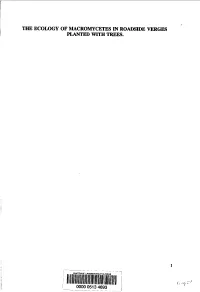
The Ecology of Macromycetes in Roadside Verges Planted with Trees
THE ECOLOGY OF MACROMYCETES IN ROADSIDE VERGES PLANTED WITHTREES . <,,<•,;-' 0000 0513 4693 Promotor: Dr. Ir. R.A.A. Oldeman, hoogleraar in de Bosteelt en Bosoecologie. Co-promotor: Dr. E.J.M. Arnolds, universitair hoofddocent, Biologisch Station, Wijster. II ; tivo$?&(( /( '^£ Peter-Jan Keizer THE ECOLOGY OF MACROMYCETES IN ROADSIDE VERGES PLANTED WITH TREES Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de landbouw- en milieuwetenschappen, op gezag van de rector magnificus, Dr. H.C. van der Plas, in het openbaar te verdedigen op woensdag 19 mei 1993 des namiddags te half twee in de aula van de Landbouwuniversiteit te Wageningen. Ill àOSfflTO "De hedendaagse architectuur, in stedebouw zowel als in de weg- en waterbouw, heeft de aansluiting op de menselijke maat en op de polsslag van culturele ontwikkelingen verlaten. Alles wat er nu gebeurt bestaat uit een meer dan honderdvoudige vergroting van een ontwerp op schaal. De ware grootte van de ontwerpen is onafzienbaar geworden. Niemand is in staat om deze megalomanie te beheersen, want al zou er een planoloog bestaan die zijn vak verstaat en die zijn verantwoordelijkheid beseft, dan mist hij nog de historische distantie die nodig is om deze buitenmaatse ontwikkelingen te overzien, laat staan te beoordelen. De ontwerpers volstaan met een verwijzing naar hun deskundigheid die uit een papieren bevoegdheid bestaat die lang geleden, ver weg van de werkelijkheid, op grond van een schoolwerkstuk verleend is." Gerrit Noordzij, 1990. Woorden aan de dijk. In: Attila op de bulldozer - Rijkswaterstaat en het rivierengebied. G.A. van Oorschot, Amsterdam. BIBLIOIHU^K LANDBOUWUNlVERSnmi JKAGENINGEM CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Keizer, Peter-Jan The ecology of macromycetes in roadside verges planted with trees / Peter-Jan Keizer. -

Atlante Illustrato Dei Funghi Del Parco
ATLANTE ILLUSTRATO DEI FUNGHI DEL PARCO 845 specie di funghi nel Parco Nazionale Atlante della biodiversità del Parco delle Foreste Casentinesi Amanita muscaria Geastrum triplex Calocera viscosa Crepidotus cesatii Boletus aestivalis Atlante della Biodiversità del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna “Atlante illustrato dei funghi del Parco. 845 specie di funghi nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi”. ATLANTE A cura di Fabio Padovan ILLUSTRATO Testi Fabio Padovan, Davide Ubaldi (L’ambiente dei funghi) DEI FUNGHI Fabio Padovan DEL PARCO Micologo, laureato in Scienze Biologiche e specializzato in Fitopatologia Agraria presso l’Università di Bolo- gna. Presidente dell’Associazione Micologica Bresadola - Gruppo di Belluno. [email protected] Davide Ubaldi Dipartimento di Biologia evoluzionistica sperimentale dell’Università di Bologna. Indice Professore associato di “Geobotanica” e di “Ecologia della vegetazione italiana” Presentazione Coordinamento ........................................................................................................p. 4 Nevio Agostini Introduzione .........................................................................................................p. 5 Servizio Promozione, Conservazione, Ricerca e Divulgazione della Natura del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. [email protected] L’ambiente dei funghi .........................................................................................p. 11 Fotografie Check List dei funghi del Parco -

Rote Liste Grosspilze
> Umwelt-Vollzug > Rote Listen / Artenmanagement 18 > Rote Liste 07 Grosspilze Rote Liste der gefährdeten Arten der Schweiz Ausgabe 2007 @@@%@&@&&@000&??&&??00/&?0/?&00&@%0%0%/%0%???@?@0&?%&@0/&0&0?0?%0?&?&000&?&%%0%@%@@@@@@@@›;,;;,,;;^?^^^^^%%^^/@^???&/&0/›0/^?^›^^/^^/?0^^ @@@%@&%000&00?&0?0%??0??00&/0&0&%@/&0&/&0%?@0&0%%0/&@&/00?????&0?00&0?&0?0%&0&&&&%@%@%@@@@›;›,;,;,&^^^?&^^^^/00^^/00&%0^^›;^^›/^^^›;^??0/ @@&%@&&&&&/&&0?00?0&/?&/?&%//&&?&%/00&/0%%/%%&?&@?/?@0/&?&?/0?&?/0?0?&0?0%&0&&0&&&&%%%@@@@@^›,;,;;›/0^^^^@%%&0&0???&@&^›/^;0?^^;?&/00??/^ @&%@?&&&?&0?0&?/??/00/?&/0&&??0??&??&&/?&0/&@&?&&??&%??000//?&?/0?&?00?0&0??&0?0%0%@&@@@@@@@;,;,,;//@^^^^^&0&&00?//&/^//&/^^^›^›^^^›?/?// %&%0&0?&&?0&/0&&/00/0?/0&/000?0&/0&/&&??%0/0@@?00&0@0/&?0?/0&?//?0??0?0&0?&&??0&0&%0&@@%@@@@?›,;›&/?/^^^^^00&000&/@/^^^^^/^››0/^›^^^^&^&› @%&?&00/?0&?00000/?0/?/?0&?0%/?0??&/00??&%?0@%?0&?&%?/?&??/00?/?0??0??&0?&000&00&0?&%&@%@@@@@›,?///^??/^@&%0000///0//^^^/^›^^›^›^^^/›^00/ &?&&%?0&0??&??00&?//?/?/?00/??/?0?0/?&0/0@0?@&?@?/&0?/&0?/00?/00??/?&0???0?000?0??&0?&%&@@@@@@›?/^@›%^/^0^//?%??^^?0??^^›^^›^^››^›^/0^›^^ &&%0?0?/0&??0??0/?//?0///?0//?//?/???&&/?%0/@&?@?/@0/00?//0?/00??/?00??/0?&0?0??00?0%00%@&@@@@@/;,^^//^^?/0@/@@^^^/??^//^^/^^^^›??/&/›0›› 0&??00/0/?0&???/0/?///0///?0?/?//0?0??0??&?/%&0@??%?/%0?/&0?/00?/??&??/??0???/?&??00?&%0%@%%@@@/,;//›^/›?^^^&0/^^0//^^^^^^^///›^?/%&&››^^ 00&&&/?0/?/??0??/?//^//0?^/?0/?//?0?//?&/0?/%&&%/%&?0&?//0?/&??//00?//??0???/0??/0??&0&%&%%@%@@@;;//^0^›^//^@&???^^^^^^^//^^//^@&&^^/›››› &&&??0&//???//?00/???^//?0//?0/?//?00//0?0@/&0&&/@0/00?/&0?0?//?00?//???/???0?/0??00?&0%%&&%@%@@0;^?/›^&^^0&/&@%0/^^^^^^^^^@&&@@@@%@^0›^› -

Natural and Historical Values of the Olkusz Ore-Bearing Region Przyrodnicza I Historyczna Wartość Olkuskiego Okręgu Rudnego
Natural and historical values of the Olkusz Ore-bearing Region Przyrodnicza i historyczna wartość Olkuskiego Okręgu Rudnego This publication was supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the European Economic Area Financial Mechanism Niniejsza publikacja powstała dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Natural and historical values of the Olkusz Ore-bearing Region Przyrodnicza i historyczna wartość Olkuskiego Okręgu Rudnego Editor • Redakcja Barbara Godzik Kraków 2015 Editor • Redakcja Barbara Godzik Reviewers • Recenzenci Ludwik Frey, Krystyna Grodzińska, Agnieszka Klimkowicz-Pawlas, Ireneusz Malik, Anna Ronikier, Lucyna Śliwa Line editing • Redakcja językowa Michael Jacobs Make-up Editor • Skład komputerowy Marian Wysocki Cover design • Projekt okładki Barbara Godzik, Marian Wysocki Cover photograph • Fotografia na okładce Grażyna Szarek-Łukaszewska Editorial office • Adres Redakcji W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Lubicz 46, 31-512 Kraków Tel. (48) 12 4241737, e-mail: [email protected] Copyright © W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences Published and distributed by • Publikacja i dystrybucja W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Lubicz 46, 31-512 Kraków Tel./fax (48) 12 4241731; e-mail: [email protected] ISBN: 978-83-62975-25-9 Printed by • Druk Drukarnia Kolejowa Kraków Sp. z o.o. Forteczna 20A, 32-086 Węgrzce, Poland -

Mykologické Listy 93
MYKOLOGICKE LISTY 93 Caso pis C:eske vedecke spolecnosti pro mykologii Praha 2005 . ISSN 1213-5887 Mykologické Listy, Praha, no. 93, 2005. OBSAH Pouzar Z.: Klíč k určování našich trepkovitek (Crepidotus) a poznámky k nim ... 1 Holec J.: Klíč k určování druhů rodu Gymnopilus známých z České republiky s poznámkami k jednotlivým druhům ....................................................... 10 Zíta V.: Nová lokalita vzácné břichatky Geastrum berkeleyi v České republice .. 16 Pouzar Z. a Vampola P.: Příspěvek k poznání vzácné parazitické rosolovky chorošové – Tremella polyporina ............................................................ 17 Šilhánová M.: Nové poznatky o některých chorobách révy vinné (Vitis vinifera L.) ........................................................................................................... 20 Kotlaba F.: K devadesátým narozeninám MUDr. Jana Z. Cvrčka ...................... 28 Úmrtí .............................................................................................................. 29 Recenze: M. Gryndler a kolektiv - Mykorhizní symbióza. O soužití hub s kořeny rostlin (M. Tomšovský) ........................................................................... 30 Holec J.: Dilema profesionálního mykologa ..................................................... 31 Antonín V.: Mykologie makromycetů v Korejské republice .............................. 32 Zprávy z výboru ČVSM (A. Kubátová) ............................................................ 34 Informace o akcích (seminář Mykologický průzkum v chráněných -

Macrofungos Em Mudas Cítricas Carlos Ivan Aguil
Universidade de São Paulo Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Macrofungos em mudas cítricas Carlos Ivan Aguilar Vildoso Tese apresentada para obtenção do título de Doutor em Ciências. Área de Concentração: Genética e Melhoramento de Plantas Piracicaba 2009 Carlos Ivan Aguilar Vildoso Engenheiro Agrônomo Macrofungos em mudas cítricas Orientadora: Profa. Dra. ALINE APARECIDA PIZZIRANI-KLEINER Tese apresentada para obtenção do título de Doutor em Ciências. Área de Concentração: Genética e Melhoramento de Plantas Piracicaba 2009 Dados Internacionais de Catalogação na Publicação DIVISÃO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO - ESALQ/USP Aguilar-Vildoso, Carlos Ivan Macrofungos em mudas cítricas / Carlos Ivan Aguilar Vildoso. - - Piracicaba, 2009. 182 p. : il. Tese (Doutorado) - - Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, 2009. Bibliografia. 1. Basidiomycota 2. Biodiversidade 3. Citricultura 4. Controle biológico 5. Controle químic 6. Fungos 7. Mudas 8. Viveiros I. Título CDD 634.3 A283m “Permitida a cópia total ou parcial deste documento, desde que citada a fonte – O autor” 3 Aos meus amigos e minha família DEDICO À citricultura OFEREÇO 4 5 AGRADECIMENTOS Este é um momento de reflexão que fazemos e sempre acabamos fazendo injustiças, por não conseguir descrever o real apoio das pessoas nesta fase da nossa vida, ou mesmo não fazendo menção nestas poucas linhas, mas estando nas nossas lembranças. À Profa. Dra. Aline Pizzirani-Kleiner pela compreensão e confiança durante todo este trabalho. Ao Núcleo de Apoio à Pesquisa em Microscopia Eletrônica na Pesquisa Agropecuária - NAP/MEPA, ESALQ/USP e ao Prof. Dr. Elliot Watanabe Kitajima pela disponibilidade de uso dos equipamentos em especial do microscópio eletrônico de varredura. -

Beiträge Zur Naturkunde Niedersachsens
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens Jahr/Year: 2014 Band/Volume: 67 Autor(en)/Author(s): Wöldecke Knut Artikel/Article: Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Großpilze 41-116 Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens 67. Jahrgang - Heft 2 / 2014 Beitr. Naturk. Niedersachsens 67 (2014): 41-116 Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Großpilze 3. Fassung vom 1.1.2014 von KNUT WÖLDECKE Hannover Karte 1: Regionale Differenzierung in der Roten Liste Aurantioporus croceus - Orangefarbener Saftporling. Hasbruch, ca. 2008. Photo: Wolfgang Pankalla. Boletus regius - Königsröhrling.Klingenberg, 30.7.1988. Photo: Günter Kleinert. Summary: Red data list of threatened Macrofungi in the federal states of Lower Saxony and Bremen. 3rd report. Status on 01/01/2014. Intentions o f these lists stress the necessity o f actual public informations regarding the present status of Macrofun gi and thus help for their protection and special habitats. Offices in nature conservation and protection, in forestry and agriculture, botanical and private specialists (mushroom hobbyists), the news media shall be informed and inspired. The 3rd Macrofungi data presentation is continuing previous documentations (WÖLDECKE 1987, 1995; 1998) and is supplementing similar lists in neighbouring federal states and bordering national states. Numerous volun tary activists have contributed data for the revised checklist (see text). The present red data list comprehends 1455 species compared to 1189 species in the 2nd list (WÖLDECKE 1995). The total number o f Macrofungi comes up to 3.300; 44.1 % of them listed in Red data connection.