Le Havre, La Ville Reconstruite Par Auguste Perret
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
![Architecture of Museums : [Exhibition], Museum of Modern Art, New York, September 24-November 11, 1968](https://docslib.b-cdn.net/cover/7940/architecture-of-museums-exhibition-museum-of-modern-art-new-york-september-24-november-11-1968-627940.webp)
Architecture of Museums : [Exhibition], Museum of Modern Art, New York, September 24-November 11, 1968
Architecture of museums : [exhibition], Museum of Modern Art, New York, September 24-November 11, 1968 Date 1968 Publisher The Museum of Modern Art Exhibition URL www.moma.org/calendar/exhibitions/2612 The Museum of Modern Art's exhibition history— from our founding in 1929 to the present—is available online. It includes exhibition catalogues, primary documents, installation views, and an index of participating artists. MoMA © 2017 The Museum of Modern Art Architecture of Museums The Museum of Modern Art, New York. September 24 —November 11, 1968 LIBRARY Museumof ModernArt ^9 Architecture of Museums The "musee imaginaire" assembled by Andre Malraux from mankind's universal reservoir of art has an architectural complement. It is the imaginary museum that has existed in the ideas and designs of architects for two centuries, ever since the museum's inception as a public institution. A giftto modern democracies, museums have remained, through the vicissitudes of their history, one of the few unanimously accepted inventions of the age of enlightenment. The revolutionary minds of the eighteenth century saw in the idea of the museum a worthy successor to the churches they sought to abolish. The museum the French architect Etienne Boullee projected in 1783, with a "temple of fame for statues of great men" at its center, is in idea and form a secular pantheon. Indeed, that Roman monument became as much the prototype for the interiors of classicists' museums as did Greek temple fronts for their otherwise plain exteriors. During the nineteenth century, while the domed halls still symbolized the universal patrimony of art, the accumulation of treasure within became a matter of patriotic pride. -

BRASILIA – CHANDIGARH – LE HAVRE PORTRAITS DE VILLES Du 2 Juin Au 16 Septembre 2007
MUSÉE MALRAUX LE HAVRE BRASILIA – CHANDIGARH – LE HAVRE PORTRAITS DE VILLES du 2 juin au 16 septembre 2007 ATTACHÉE DE PRESSE Catherine Bertrand Tél. 02 35 19 44 21 Fax 02 35 19 47 41 [email protected] SOMMAIRE Communiqué de l’exposition ....................................................... pages 2-5 Colloque international en septembre 2007 au Havre .................................. page 6 Brasilia (histoire et construction) ................................................... pages 7-8 Chandigarh (histoire et construction) ............................................. pages 9-10 Le Havre (histoire et construction) ............................................... pages 11-12 Liste des œuvres exposées ........................................................ pages 13-16 Renseignements pratiques ........................................................... page 17 Catalogue de l’exposition ............................................................ page 17 BRASILIA – CHANDIGARH – LE HAVRE / PORTRAITS DE VILLES 1 MUSÉE MALRAUX – LE HAVRE BRASILIA – CHANDIGARH – LE HAVRE PORTRAITS DE VILLES du 2 juin au 16 septembre 2007 Exposition d’œuvres Le 15 juillet 2005, le bureau du Patrimoine de l’UNESCO décidait à l’unanimité l’inscrip- photographiques et vidéos tion, au Patrimoine mondial de l’Humanité, du centre-ville du Havre reconstruit par au musée Malraux, Le Havre, Auguste Perret. du 2 juin au 16 septembre 2007. Depuis lors, la Ville du Havre a engagé un programme d’actions visant à valoriser ce label. Un colloque international sera organisé dans ce cadre les jeudi 13 et vendredi 14 sep- LUCIEN HERVÉ tembre 2007, autour du thème « Brasilia – Chandigarh – Le Havre – Tel Aviv. Quatre villes LOUIDGI BELTRAME symboles du XXe siècle ». EMMANUELLE BLANC JORDI COLOMER Parallèlement, et en amont de cette manifestation, le musée Malraux présentera à partir STÉPHANE COUTURIER du samedi 2 juin prochain une exposition de photos : « Brasilia – Chandigarh – Le Havre. GEORGE DUPIN VÉRONIQUE ELLÉNA Portraits de villes ». -

LH Groupe Scolaire Paul Bert
Fichier international de DoCoMoMo _________________________________________________________________ 1. IDENTITÉ DU BÂTIMENT OU DU GROUPE DE BÂTIMENTS nom usuel du bâtiment : Groupe scolaire Paul Bert variante : numéro et nom de la rue : 65 avenue Paul Bert (école maternelle), 49-51 rue des Iris (école élémentaire), Aplemont ville : Le Havre pays : France ................................................................................................................................... PROPRIÉTAIRE ACTUEL nom : Ville du Havre adresse : téléphone : 02 35 47 12 62 (école maternelle) et 02 35 47 24 23 (école élémentaire) fax : ................................................................................................................................... ÉTAT DE LA PROTECTION type : date : ................................................................................................................................... ORGANISME RESPONSABLE DE LA PROTECTION nom : adresse : téléphone : fax : ................................................................................................................................... 2. HISTOIRE DU BATIMENT commande : Vingt-cinq écoles de l’agglomération havraise ont été détruites par les bombardements de septembre 1944, dont l’ancien groupe Paul Bert. Construit dans les années 1930 au sein d’une cité- jardins, il comprenait une école de garçons de douze classes, une de filles de douze classes et un jardin d’enfants de cinq classes. D’architecture moderne, son ossature était en béton et son habillage en -

Conclusiones Y Sugerencias Italiano.Indd
CONCURSO INTERNACIONAL DE IDEAS maspalomas COSTA CANARIA EL PAISAJE COMO ARGUMENTO, LO NATURAL COMO BASE PAISAJES E.N.S.B.A. ATEA+SETAP CONCURSO 1961 Concurso Internacional de Ideas Maspalomas i Costa Canaria 1961 El paisaje como argumento, lo natural como base Paisajes, ENSBA, ATEA+SETAP, Concurso Tesis Doctoral Doctorando: Iván Álvarez León Director: Ricard Pié Ninot Co-director: Manuel Gausa Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori Universitat Politècnica de Catalunya Barcelona, 2013 IIIConclusiones y consideraciones fi nales. Bibliografía. III CONCLUSIONES Conclusiones y consideraciones fi nales. CONCLUZIONE Il seguente lavoro di ricerca rivela il carattere singolare e avanzato del piano vincitore del concorso internazionale di idee Maspalomas Costa Canaria (1961). Alcune delle caratteristiche del piano elaborato 50 anni fa dall’atelier francese AS, si trasformano oggi in principi di pianifi cazione per gli sviluppi turistici nella costa. Aprire il dibattito e consolidare, se fosse necesario, alcuni dei parametri di pianifi cazione che le città turistiche presentano in esperienze prodigiose come quella di Maspalomas, serve per continuare a rifl ettere sulla chiave del successo dello spazio turistico. Maspalomas, pioniera tra gli sviluppi turistici costieri in Europa, contribuisce attraverso il primo piano regolatore (non realizzato) al passato e al futuro dei centri turistici. La ricerca fa riferimento ai valori che lo stesso studio di architettura annunciò quell’anno, quali il paesaggio e il rispetto per il “naturale”. Il progetto disegnato dall’atelier francese AS ATEA+SETAP, oggetto del concorso, presentò qualità e caratteristiche all’avanguardia rispetto all’epoca in cui si situa. Oggi, 50 anni dopo, diventa uno dei piani di spicco rispetto al resto degli interventi turistici progettati durante gli anni ’60 nel litorale spagnolo e francese. -

De “Geografische Blik” Van Architectuurtijdschriften De Presentatie Van Afrika En Latijns-Amerika in L’Architecture D’Aujourd’Hui (1945-1975)
De “geografische blik” van architectuurtijdschriften De presentatie van Afrika en Latijns-Amerika in L’Architecture d’Aujourd’hui (1945-1975) Annelies Cornelis Promotor: prof. dr. ir.-arch. Johan Lagae Begeleiders: dr. Rika Devos, dr. ir.-arch. Fredie Floré Masterproef ingediend tot het behalen van de academische graad van Master in de ingenieurswetenschappen: architectuur Vakgroep Architectuur en stedenbouw Voorzitter: prof. dr. Bart Verschaffel Faculteit Ingenieurswetenschappen Academiejaar 2008-2009 De “geografische blik” van architectuurtijdschriften De presentatie van Afrika en Latijns-Amerika in L’Architecture d’Aujourd’hui (1945-1975) Annelies Cornelis Promotor: prof. dr. ir.-arch. Johan Lagae Begeleiders: dr. Rika Devos, dr. ir.-arch. Fredie Floré Masterproef ingediend tot het behalen van de academische graad van Master in de ingenieurswetenschappen: architectuur Vakgroep Architectuur en stedenbouw Voorzitter: prof. dr. Bart Verschaffel Faculteit Ingenieurswetenschappen Academiejaar 2008-2009 Voorwoord Dit onderzoek bouwt voort op een Bijzonder Vraagstuk uit het academiejaar 2007-2008, dat mijn interesse in architectuurtijdschriften aanwakkerde. Ik dank in eerste instantie mijn promotor Johan Lagae voor de vele begeleidingsmomenten, evenals mijn begeleidsters Rika Devos en Fredie Floré. Ik dank ook mijn medestudenten voor het beschikbaar stellen van hun materiaal uit het Bijzonder Vraagstuk. Tot slot dank ik mijn familie voor hun steun en het nalezen van de teksten. De auteur geeft de toelating deze masterproef voor consultatie beschikbaar te stellen en delen van de masterproef te kopiëren voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen van resultaten uit deze masterproef. Overzicht De “geografische blik” van architectuurtijdschriften De presentatie van Afrika en Latijns-Amerika in L’Architecture d’Aujourd’hui (1945- 1975) Annelies Cornelis Promotor: prof. -

Robert Joly (1928-2012) : Urbaniste, Moderne, Intellectuel : Les Nouvelles Figures De L’Architecture Alexandra Schlicklin
Robert Joly (1928-2012) : urbaniste, moderne, intellectuel : les nouvelles figures de l’architecture Alexandra Schlicklin To cite this version: Alexandra Schlicklin. Robert Joly (1928-2012) : urbaniste, moderne, intellectuel : les nouvelles figures de l’architecture. Architecture, aménagement de l’espace. Université de Lorraine, 2014. Français. NNT : 2014LORR0342. tel-01751655 HAL Id: tel-01751655 https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01751655 Submitted on 29 Mar 2018 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. AVERTISSEMENT Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la communauté universitaire élargie. Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci implique une obligation de citation et de référencement lors de l’utilisation de ce document. D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction illicite encourt une poursuite pénale. Contact : [email protected] LIENS Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4 Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10 http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm UNIVERSITE DE LORRAINE, METZ. -
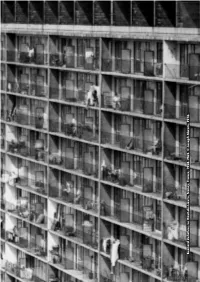
B E Rn a Rd Z E H Rfu Ss, Le H a U T-D U -Liè V Re , N a N Cy , Fra N Ce , 1 9 5
Bernard Zehrfuss, Le Haut-du-Lièvre, Nancy, France, 1958-1962. © Joseph Abram, 1976. ESSAYS Modernity and housing production in France after WWII BY JOSEPH ABRAM After the collapse of 1940 and Occupation (1940-1944), France experienced a remarkable renewal after Liberation in 1944. Through reconstruction and intensive efforts to bring the country out of the housing crisis, the State set up a powerful production system, which based the expansion of the building sector on the con- centration of investment in large companies. It was the era of the grands ensembles, of heavy prefabrication and giant construction sites. Initially well received by their inhabitants, these large housing complexes rapidly deteriorated and became ghettos. Despite the social difficulties that beset these neighborhoods, how can this important heritage of modernity be preserved today? An Industrial housing policy with the companies Boussiron and Froment-Clavier. The France was confronted, during the 1950s, with a serious second prize was awarded to Bernard Zehrfuss (1911-1996), housing crisis. Since 1945, the State had dealt with this emer- the third went to Jean-Louis Fayeton (1908-1968), and the gency. Reconstruction, despite its exceptional dynamism, was fourth to Le Corbusier (1887-1965), who responded to the unable to stem the mechanisms of a chronic shortage, which, program by dividing the 800 housing units into two unités already worrying during the 1930s, had been amplified by d’habitation comparable to the one in Marseille (1947-1952, the destruction caused by WWII and the demographic surge and so then still under construction) and a 50 meter (m) high 65 — 2021/2 of Liberation. -

Journal of Architectural Education Fall Editorial Board Meeting Portland
Journal of Architectural Education Fall Editorial Board Meeting Portland State University Portland, OR 02-04 October 2015 Table of Contents General Information . 1 Meeting Schedule . 2 Meeting Agenda . 3 Reports Executive Editor . .. 4 Associate Editor, Design . 5 Associate Editor, Reviews . 6 Art Director . 8 Additional Material Spring 2015 Board Meeting Minutes Theme Issue Proposals Essays to be considered for the JAE Awards General Information Welcome to the Journal of Architectural Education 2015 Fall Editorial Board Meeting. All of our meetings will occur at Portland State University (1825 SW Broadway, Portland, OR 97201) If you are unable to attend the meeting, a skype connection can be provided. Please email Marc Neveu ([email protected]) if you wish to participate via skype. While in Portland, Marc Neveu may be reached by phone at: 617-899-6965. Barton Residence: (1920 SW River Drive, E101) 1 Meeting Schedule Friday, 02 October 4.00 pm Clive Knights to introduce Editorial Board to students Shattuck Hall, 1914 SW Broadway 4.15 pm Tour, School of Architecture 5.00 pm Happy Hour at Professor Emeritus Rudy Barton's house 1920 SW River Drive, E101 Saturday, 03 October 9.00 – 12.30 Design Committee Meeting Shattuck Hall, 1914 SW Broadway: Room 250 Kulper, Fujita, Jackson, La, Sprecher, Stuth, Squire, Theodore 9.00 – 12.30 Reviews Committee Meeting Shattuck Hall, 1914 SW Broadway: Room 235 Rupnik, Contandriopoulos, Mumford, Nawre, Trubiano, Wendl 9.00 – 12.30 70:1 Shattuck Hall, 1914 SW Broadway: Office pod Neveu, Brennan, Weddle 1.30 – 5.00 Editorial Board Meeting Shattuck Hall, 1914 SW Broadway: Room 210 Full Editorial Board, Monti, Reimers, Vonier 7.00 Andina 1314 NW Glisan St. -
Museo De Bellas Artes André Malraux
museo de bellas artes André Malraux Laurent Beaudouin, Emanuelle Beaudouin, Sandra Barclay, Jean Pierre Crousse latitud: por Inés Moisset 49°49'N longitud: 00°04'E ubicación: Le Havre, Francia superficie: 5.721 m² año: 1999 16 12 5 6 11 11 15 10 7 8 4 32 1 17 8 18 12 9 4 13 01 pasarela de entrada 07 entrada a sala de museo 13 terraza planta baja 02 ingreso 08 rampa planta alta 14 escultura de Adam 03 hall de entrada 09 arte moderno 15 colección Baudin 14 04 vacío sobre biblioteca 10 impresionista 16 panel suspendido 05 mostrador 11 montacargas 17 pintura antigua (s XVI - s XVII) 0 1 2 3 4 5 10 06 librería 12 exposiciones temporales 18 cafetería renovación del museo de bellas artes la 2º Guerra Mundial, fue inaugurado en 1961 con la inten - André Malraux ción de ser un signo de que la cultura es el principio del renacimiento de un pueblo. El museo André Malraux se encuentra en Le Havre, ciudad- puerto destruida para facilitar el desembarco de los aliados El edificio original, considerado uno de los museos más en Normandía. La reconstrucción de la ciudad, hoy inscrip - importantes del siglo XX, tiene una respuesta sintética: una ta en la lista del patrimonio de la Humanidad 1, fue llevada gran caja industrial de cristal protegida por una parrilla de a cabo por August Perret y su equipo en su totalidad. El parasoles instalada frente al mar y una terraza donde se 66 > museo, el primero en ser realizado en Francia después de encuentra la gran escultura hormigón de Henri-Georges colaboradores: A.Creusot, A.Purpuri, C.Presle, > Proyecto seleccionado para el premio Equerre d'Argent, Paris 1999. -
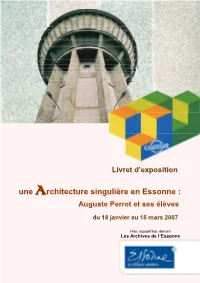
Une Architecture Singulière En Essonne : Auguste Perret Et Ses Élèves
Livret d’exposition une Architecture singulière en Essonne : Auguste Perret et ses élèves du 18 janvier au 15 mars 2007 Hier, aujourd’hui, demain Les Archives de l’Essonne une Architecture singulière en Essonne : Auguste Perret et ses élèves Auguste Perret, figure de l’architecture contemporaine, a choisi d’utiliser le béton et ses nouvelles opportunités techniques pour mieux révéler la structure des bâtiments. Sa renommée lui a valu d’enseigner. Ses élèves, qui ont travaillé avec lui au Havre, ont laissé en Essonne quelques réalisations. Auguste Perret ou le mariage original entre cabinet d’architecture et entreprise de béton armé Auguste Perret (1874-1954) est né dans une famille d’entrepreneurs en bâtiment. Il participe très tôt à l’entreprise paternelle avec ses frères. Les ouvrages d’architecture d’Eugène Viollet-le-Duc et de Choisy jouent une grande place dans sa formation. En effet, entré dans l’atelier de Julien Guadet, il le quitte sans diplôme pour travailler dans l’entreprise familiale qui devient « Perret Frères » en 1905 après le décès de son père. L’entreprise se spécialise dans le béton armé et acquiert un savoir tech- nique dans les arcs et voûtes en béton qu’elle utilise pour l’église du Raincy (Seine-Saint-Denis), surnommée la « Sainte Chapelle du bé- ton ». Durant l’entre-deux-guerres, Auguste Perret construit des mai- sons-ateliers en béton armé pour des artistes comme Orloff ou Braque. Il participe au concours de l’église Sainte Jeanne d’Arc à Paris et obtient ses premières commandes publiques : le service technique des cons- tructions navales (Paris 15e), le garde meuble du mobilier national (Paris 13e), le musée des travaux publics sur la colline de Chaillot (Paris 16e). -
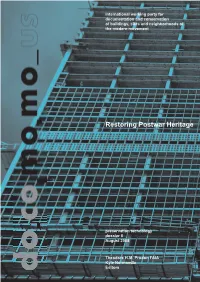
Dossier 8 (PDF Full File)
international working party for documentation and conservation of buildings, sites and neighborhoods of the modern movement Restoring Postwar Heritage preservation technology dossier 8 August 2008 Theodore H.M. Prudon FAIA Kyle Normandin Editors Cover Design Technology Seminar Sponsors Unjoo Noh The original seminars were supported by ISBN 978-0-9820365-0-1 many fi rms, companies and individuals. DO- COMOMO US acknowledges gratefully their © 2008 DOCOMOMO US support. PO Box 230977 New York, NY 10023 This publication has been made possible Email- [email protected] through a grant from the Getty Foundation, the www.docomomo-us.org Conproco Corporation and the generous sup- port of Brent Harris. Cover Photographs View of the United Nations Campus, c. 1953. Photo courtesy of the United Nations Archive. www.conproco.com The editors have exercised their best efforts to identify the source of all illustrations and obtain permission for publication. Any discrepancies should be brought to our attention. Technology Seminars: Restoring Postwar Buildings was offered by DOCOMOMO US in conjunction with the VIIIth International DOCOMOMO Conference: Import/Export: Postwar Modernism in an Expanding World, 1945-1975 September 30 to October 2, 2004, New York City international working party for documentation and conservation of buildings, sites and neighborhoods of the modern movement Restoring Postwar Heritage View of United Nations, c. 1952. Courtesy United Nations Photo Archives preservation technology dossier 8 August 2008 Theodore H.M. Prudon FAIA Kyle Normandin Editors DOSSIER 8 CONTENT Restoring Postwar Heritage: Selections from the 2004 DOCOMOMO US Technology Seminars (New York) 1 Introduction Theodore Prudon, Kyle Normandin, Editors Plenary Stone and Technology in the Modern Movement 5 University of Chicago Preservation Guidelines for 93 Experiencing Stone, Structure and Cladding Contemporary Architecture Ola Wedebrunn Harry J. -

Fria New Town Fria
174 Fria New Town Fria (GN) Michel Écochard; Guy Lagneau, Michel Weill & Jean Dimitrijevic; Michel Kalt, Daniel Pouradier-Duteil & Pierre Vignal Fria New Town: Fria, ten zuiden & Pierre Vignal (rijwoningen voor Plangebied/Area: 275 ha Bronnen/Sources: Africa’, ABE Journal, nr./no. 4 van de N21 ter hoogte van Tabossi, Afrikaanse arbeiders/row houses Bewonersdichtheid/Inhabitant ‘Sabendé: Ville Nouvelle en Guinee’, (2013) (geraadpleegd 1 mei 2015/ Guinee/south of the N21 near for African workers) density: 72/ha L’Architecture d’Aujourd’hui, accessed 1 May 2015) Tabossi, Guinee/Guinea Opdrachtgever/Client: Péchiney Voorzieningen/Amenities: winkels, nr./no. 88 (1960), 96-101 Ontwerp/Design: Michel Écochard (alumiumfabriek/aluminium factory) bioscoop, school, stadion, hotel/ ‘Guinée, Cité de Sabendé’, Archi- (stedenbouwkundig plan/urban Ontwerp-oplevering/Design shops, cinema, school, stadium, tecture d’Aujourd’hui, nr./no. 80 plan), Guy Lagneau, Michel Weill & completion: 1956-1964 hotel (1958), 102-103 Jean Dimitrijevic (hoogbouwflats/ Aantal bewoners/Number of Kim de Raedt, ‘Shifting Conditions, high-rise apartment buildings), inhabitants: 19.682 Frameworks and Approaches: Michel Kalt, Daniel Pouradier-Duteil (ontwerp)/19,682 (design) The Work of KPDV in Postcolonial Binnenplaats in buurt II Global Housing Courtyard in Neighbourhood II Woningbouw wereldwijd DASH Dash12-13 binnenwerk.indd 174 15/12/15 10:45 Fria in Guinee is een goed voorbeeld van Franse, laat- Fria, in Guinea, is a prime example of French late-colonial DASH koloniale industriële New Town-planning. Fria werd industrial New Town planning. It was designed and built tussen 1956 en 1964 vanuit het niets ontworpen en from scratch between 1956 and 1964 to house both the gebouwd om zowel het hogere personeel als de arbei- senior staff and workers of a new bauxite extraction and ders van de nieuwe bauxiet- en aluminiumfabriek van aluminium production plant owned by the French company de Franse firma Péchiney te huisvesten.