Rapport Final Lasdel Aguégués Avril 2007
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

B E N I N Benin
Birnin o Kebbi !( !( Kardi KANTCHARIKantchari !( !( Pékinga Niger Jega !( Diapaga FADA N'GOUMA o !( (! Fada Ngourma Gaya !( o TENKODOGO !( Guéné !( Madécali Tenkodogo !( Burkina Faso Tou l ou a (! Kende !( Founogo !( Alibori Gogue Kpara !( Bahindi !( TUGA Suroko o AIRSTRIP !( !( !( Yaobérégou Banikoara KANDI o o Koabagou !( PORGA !( Firou Boukoubrou !(Séozanbiani Batia !( !( Loaka !( Nansougou !( !( Simpassou !( Kankohoum-Dassari Tian Wassaka !( Kérou Hirou !( !( Nassoukou Diadia (! Tel e !( !( Tankonga Bin Kébérou !( Yauri Atakora !( Kpan Tanguiéta !( !( Daro-Tempobré Dammbouti !( !( !( Koyadi Guilmaro !( Gambaga Outianhou !( !( !( Borogou !( Tounkountouna Cabare Kountouri Datori !( !( Sécougourou Manta !( !( NATITINGOU o !( BEMBEREKE !( !( Kouandé o Sagbiabou Natitingou Kotoponga !(Makrou Gurai !( Bérasson !( !( Boukombé Niaro Naboulgou !( !( !( Nasso !( !( Kounounko Gbangbanrou !( Baré Borgou !( Nikki Wawa Nambiri Biro !( !( !( !( o !( !( Daroukparou KAINJI Copargo Péréré !( Chin NIAMTOUGOU(!o !( DJOUGOUo Djougou Benin !( Guerin-Kouka !( Babiré !( Afekaul Miassi !( !( !( !( Kounakouro Sheshe !( !( !( Partago Alafiarou Lama-Kara Sece Demon !( !( o Yendi (! Dabogou !( PARAKOU YENDI o !( Donga Aledjo-Koura !( Salamanga Yérémarou Bassari !( !( Jebba Tindou Kishi !( !( !( Sokodé Bassila !( Igbéré Ghana (! !( Tchaourou !( !(Olougbé Shaki Togo !( Nigeria !( !( Dadjo Kilibo Ilorin Ouessé Kalande !( !( !( Diagbalo Banté !( ILORIN (!o !( Kaboua Ajasse Akalanpa !( !( !( Ogbomosho Collines !( Offa !( SAVE Savé !( Koutago o !( Okio Ila Doumé !( -

Projet De Vulgarisation De L'aquaculture Continentale En République Du Bénin Quatrième Session Ordinaire Du Comité De Suiv
Projet de Vulgarisation de l’Aquaculture Continentale en République du Bénin Bureau du Projet / Direction des Pêches Tel: 21 37 73 47 No 004 Le 22 Juillet 2011 Email: [email protected] Un an après son démarrage en juin 2011, le Projet de Vulgarisation de l’Aquaculture Continentale en République du Bénin (PROVAC), a connu un bilan positif meublé d’activités diverses mais essentiellement axées sur les formations de pisciculteurs ordinaires par l’approche « fermier à fermier »démarré au début du mois de juin 2010, poursuit ses activités et vient d’amor‐ cer le neuvième mois de sa mise en œuvre. Quatrième session ordinaire du Comité de Suivi Le Mercredi 18 Mai 2011 s’est tenue, dans la salle de formation de la Direction des Pêches à Cotonou, la quatrième session ordinaire du Comité de Suivi du Projet de Vulgarisation de l’Aqua‐ culture Continentale en République du Bénin (PROVAC). Cette rencontre a connu la participation des membres du Comité de Suivi désignés par les quatre Centres Régionaux pour la Promotion Agricole (CeRPA) impliqués dans le Projet sur le terrain et a été rehaussée par la présence de la Représentante Résidente de la JICA au Bénin. A cette session, les CeRPA Ouémé/Plateau, Atlantique/Littoral, Zou/Collines et Mono/Couffo ont fait le point des activités du Projet sur le terrain, d’une part, et le Plan de Travail Annuel (PTA) 4e session ordinaire approuvé à Tokyo par la JICA au titre de l’année japonaise 2011 a été exposé, d’autre part, par le du Comité du Suivi Chef d’équipe des experts. -

Online Appendix to “Can Informed Public Deliberation Overcome Clientelism? Experimental Evidence from Benin”
Online Appendix to “Can Informed Public Deliberation Overcome Clientelism? Experimental Evidence from Benin” by Thomas Fujiwara and Leonard Wantchekon 1. List of Sample Villages Table A1 provides a list of sample villages, with their experimental and dominant can- didates. 2. Results by Commune/Stratum Table A2.1-A2.3 presents the results by individual commune/stratum. 3. Survey Questions and the Clientelism Index Table A3.1 provides the estimates for each individual component of the clientelism index, while Table A3.2 details the questions used in the index. 4. Treatment Effects on Candidate Vote Shares Table A4 provides the treatment effect on each individual candidate vote share. 5. Estimates Excluding Communes where Yayi is the EC Table A5 reports results from estimations that drop the six communes where Yayi is the EC. Panel A provides estimates analogous from those of Table 2, while Panels B and C report estimates that are similar to those of Table 3. The point estimates are remarkably similar to the original ones, even though half the sample has been dropped (which explains why some have a slight reduction in significance). 1 6. Estimates Including the Commune of Toffo Due to missing survey data, all the estimates presented in the main paper exclude the commune of Toffo, the only one where Amoussou is the EC. However, electoral data for this commune is available. This allows us to re-estimate the electoral data-based treatment effects including the commune. Table A6.1 re-estimates the results presented on Panel B of Table 2. The qualitative results remain the same. -

The Geography of Welfare in Benin, Burkina Faso, Côte D'ivoire, and Togo
Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized The Geography of Welfare in Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, and Togo Public Disclosure Authorized Nga Thi Viet Nguyen and Felipe F. Dizon Public Disclosure Authorized 00000_CVR_English.indd 1 12/6/17 2:29 PM November 2017 The Geography of Welfare in Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, and Togo Nga Thi Viet Nguyen and Felipe F. Dizon 00000_Geography_Welfare-English.indd 1 11/29/17 3:34 PM Photo Credits Cover page (top): © Georges Tadonki Cover page (center): © Curt Carnemark/World Bank Cover page (bottom): © Curt Carnemark/World Bank Page 1: © Adrian Turner/Flickr Page 7: © Arne Hoel/World Bank Page 15: © Adrian Turner/Flickr Page 32: © Dominic Chavez/World Bank Page 48: © Arne Hoel/World Bank Page 56: © Ami Vitale/World Bank 00000_Geography_Welfare-English.indd 2 12/6/17 3:27 PM Acknowledgments This study was prepared by Nga Thi Viet Nguyen The team greatly benefited from the valuable and Felipe F. Dizon. Additional contributions were support and feedback of Félicien Accrombessy, made by Brian Blankespoor, Michael Norton, and Prosper R. Backiny-Yetna, Roy Katayama, Rose Irvin Rojas. Marina Tolchinsky provided valuable Mungai, and Kané Youssouf. The team also thanks research assistance. Administrative support by Erick Herman Abiassi, Kathleen Beegle, Benjamin Siele Shifferaw Ketema is gratefully acknowledged. Billard, Luc Christiaensen, Quy-Toan Do, Kristen Himelein, Johannes Hoogeveen, Aparajita Goyal, Overall guidance for this report was received from Jacques Morisset, Elisée Ouedraogo, and Ashesh Andrew L. Dabalen. Prasann for their discussion and comments. Joanne Gaskell, Ayah Mahgoub, and Aly Sanoh pro- vided detailed and careful peer review comments. -

Emergency Plan of Action (Epoa) Benin: Ebola Virus Disease Preparedness
Emergency Plan of Action (EPoA) Benin: Ebola Virus Disease Preparedness DREF operation Operation n° MDRBJ014; Date of Issue: 27 August 2014 Glide ° Date of disaster: 20 July 2014 Operation start date: 25 August 2014 Operation end date: 27 November ( 3 months) Host National Society(ies): Benin Red Cross Society Operation budget: CHF 50,204 Number of people affected: 14 Zones at risk Number of people assisted: One Million (indirect) 141,299 (direct) N° of National Societies involved in the operation: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Luxembourg Red Cross and Netherlands Red Cross N° of other partner organizations involved in the operation: Ministry of Health, Ministry of the Interior (through the ANPC), Plan Benin and United Nations Children’s Fund A. Situation analysis Description of the disaster In February 2014, there was an outbreak of the Ebola Virus Disease (EVD) in Guinea, which has spread to Liberia, Mali, Nigeria, Senegal and Sierra Leone causing untold hardship and hundreds of deaths in these countries. As of 27 February 2015, a total of 23,694 cases, and 9,589 deaths, which were attributed to the EVD, had been recorded across the most affected countries of Guinea, Liberia and Sierra Leone. In the Democratic Republic of Congo (DRC), an outbreak of the EVD was also reported, but is considered of a different origin than that which has affected West Africa. Benin, with a population of 10,051,000 (UNCDP 2014) shares a border with Nigeria, which has been affected by the EVD, and therefore the risks presented by the epidemic to the country are high. -

Spatial Distribution and Risks Factors of Porcine Cysticercosis in Southern Benin Based Meat Inspection Records
International Research Journal of Microbiology (IRJM) (ISSN: 2141-5463) Vol. 4(8) pp. 188-196, September, 2013 DOI: http:/dx.doi.org/10.14303/irjm.2013.043 Available online http://www.interesjournals.org/IRJM Copyright © 2013 International Research Journals Full Length Research Paper Spatial distribution and risks factors of porcine cysticercosis in southern Benin based meat inspection records Judicaël S. E. Goussanou ab* , T. Marc Kpodekon ab , Claude Saegerman c, Eric Azagoun a, A. K. Issaka Youssao a, Souaïbou Farougou a, Nicolas Praet d, Sarah Gabriël d., Pierre Dorny d, Nicolas Korsak e aDepartment of animal Production and Heath, Ecole Polytechnique of Abomey-Calavi, University of Abomey-Calavi, Benin bLaboratory of Applied Biology, University of Abomey-Calavi, Benin cDepartment of Infectious and Parasitic Diseases, Research Unit of Epidemiology and Risk Analysis Applied to Veterinary Sciences (UREAR-ULg), Faculty of Veterinary Medicine, University of Liège, Liège, Belgium dDepartment of Biomedical Sciences, Institute of Tropical Medicine, Antwerp, Belgium eFood Sciences Department, Faculty of veterinary Medicine, University of Liège, Liège, Belgium *Corresponding author e-mail: [email protected] : Tel: 0022995700449/ 0022997168992 Abstract Porcine cysticercosis, which is widely distributed in Africa, causes financial losses and diseases among humans. To control the disease in an area, it is important to know the geographical distribution. In this study, spatial distribution of porcine cysticercosis in southern Benin was performed. By using the number of partial organ seizures at meat inspection, the study has revealed high risks of porcine cysticercosis in administrative districts of Aplahoue, Dogbo, Klouekanme and Lokossa. The proportion of seizures ranged from 0.06% for neck muscles to 0.69% for tongues. -

Monographie De La Commune De Adjarra
REPUBLIQUE DU BENIN MISSION DEDEDE DECENTRALISATION ------- PPPROGRAMME D ’A’A’A PPUI AU DDDEMARRAGE DES CCCOMMUNES MONOGRAPHIE DE LA COMMUNE D’ADJARRA Consultant GANDONOU Basile Marius Ingénieur Agro-économiste Sous la supervision de M. Emmanuel GUIDIBIGUIDIBI, Directeur Général du Cabinet « Afrique Conseil » Mars 2006 Monographie de Adjarra, AFRIQUE CONSEIL, Mars 2006 SOMMAIRE SIGLES ET ABREVIATIOABREVIATIONSNSNSNS................................................................................... ................................................................................................ ................... 444 CARTESCARTES................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................ ....................... 666 GRAPHESGRAPHES................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................... .................. 666 TABLEAUX ................................................................................... ................................................................................................ ........................................................................................... -

Benin• Floods Rapport De Situation #13 13 Au 30 Décembre 2010
Benin• Floods Rapport de Situation #13 13 au 30 décembre 2010 Ce rapport a été publié par UNOCHA Bénin. Il couvre la période du 13 au 30 Décembre. I. Evénements clés Le PDNA Team a organisé un atelier de consolidation et de finalisation des rapports sectoriels Le Gouvernement de la République d’Israël a fait don d’un lot de médicaments aux sinistrés des inondations La révision des fiches de projets du EHAP a démarré dans tous les clusters L’Organisation Ouest Africaine de la Santé à fait don d’un chèque de 25 millions de Francs CFA pour venir en aide aux sinistrés des inondations au Bénin L’ONG béninoise ALCRER a fait don de 500.000 F CFA pour venir en aide aux sinistrés des inondations 4 nouveaux cas de choléra ont été détectés à Cotonou II. Contexte Les eaux se retirent de plus en plus et les populations sinistrés manifestent de moins en moins le besoin d’installation sur les sites de déplacés. Ceux qui retournent dans leurs maisons expriment des besoins de tentes individuelles à installer près de leurs habitations ; une demande appuyée par les autorités locales. La veille sanitaire post inondation se poursuit, mais elle est handicapée par la grève du personnel de santé et les lots de médicaments pré positionnés par le cluster Santé n’arrivent pas à atteindre les bénéficiaires. Des brigades sanitaires sont provisoirement mises en place pour faire face à cette situation. La révision des projets de l’EHAP est en cours dans les 8 clusters et le Post Disaster Needs Assessment Team est en train de finaliser les rapports sectoriels des missions d’évaluation sur le terrain dans le cadre de l’élaboration du plan de relèvement. -

Partner Country Coverage
IMaD’s Lessons Learned Luis Benavente MD, MS CORE’s webinar August 29, 2012 Insert title here Country Number of health Health workers trained in topics related to malaria diagnosis as of June 2012 total N facility visits trained Baseline Outreach How to TOT and On-the- job Database National External Malaria all assesmt. of training & perform supervi- training data entry, Malaria competency micros- Diagnostic support laboratory sors during mainte- Slide sets, assess- copy and capabilities supervision assessments OTSS OTSS nance NAMS ments RDTs Angola 5 6 2 18 12 0 0 12 26 70 Benin 11 409 2 30 1671 9 0 0 40 1,752 Burundi 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DR Congo 0 0 0 23 0 0 0 0 74 97 Ethiopia 4 0 4 0 0 0 13 17 0 34 Ghana 37 1109 37 46 3704 10 10 6 40 3,853 Guinea Con. 11 0 11 0 0 0 0 0 20 31 Kenya 1192 52 1192 66 312 0 0 37 67 1,674 Liberia 8 200 8 35 975 11 0 7 141 1,177 Madagascar 50 31 50 18 18 0 0 0 23 109 Malawi 14 521 14 75 1132 3 0 0 64 1,288 Mali 5 172 5 24 1188 4 0 0 40 1,261 Nigeria 40 0 0 0 0 0 0 26 0 26 Zambia 6 278 6 12 1733 5 0 9 92 1,857 Total 1,401 2,778 1,331 347 10,745 42 23 114 627 13,229 Proportion of febrile episodes caused by Plasmodium falciparum Source: d’Acremont V, Malaria Journal, 2010 Better testing is needed to assess the impact of malaria control interventions Parasitemia prevalence after IRS, countries with at least biennial monitoring 80% Namibia-C Zimbabwe Moz-Maputo 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 CORE’s Surviving Malaria Pathway ITNs - Bednet use Caretaker recognizes -

A Comparative Analysis of Land Use Systems in Benin Jean Adanguidi
Tropentag, October 9-11, 2007, Witzenhausen “Utilisation of diversity in land use systems: Sustainable and organic approaches to meet human needs” A Comparative Analysis of Land Use Systems in Benin Jean Adanguidi Faculty of Economics and Management, University of Abomey-calavi, Benin, Economics, Benin Abstract Last year, a small farmer survey was carried out in Benin for deep understanding of the land use system in twelve villages. These villages were chosen in different districts according to specific criteria (Banikoara, Bassila, Dangbo, Djougou, K´etou,Klou´ekanm`e, Matr´eri, Nikki, Ouess`e,Parakou, Toffo, Zagnanado). A questioner was administrated to twenty farmers in each village. Different data related to land use system were collected: composition of land, land prices, land use changes, cropping system, labour force, income and food security strategies. The aim of this paper is to give a global view of the land use systems in the study area. More specifically, we will discuss in a comparative basis: • The composition of land use and land price in each region; • The yield of the major food crops and its development during the last years; • The relationship between the yield and other variables such as fallow period. • The yield development after fallow period; • The farmer’s food production strategy ; • The importance of price in farmer’s production strategy. The data were process by the means of descriptive statistic tools mainly. The results show that: • The role fallow period in the yield development vary from region to region and inside the same region from crop to crop. • Prices (buying or selling price) play a major role in the farmer’s production strategy. -

Nigeria Benin Togo Burkina Faso Niger Ghana
! 1°E 2°E 3°E 4°E 5°E 6°E! ! ! ! MA-024 !Boulgou !Kantchari Gwadu Birnin-Kebbi ! Tambawel Matiacoali ! ! Pekinga Aliero ! ! ! A f r i c a Jega Niger ! Gunmi ! Anka Diapaga Koulou Birnin Tudu B! enin ! Karimam!a Bunza ! ! ! N N ° ° 2 Zugu 2 1 ! 1 Gaya Kamba ! Karimama Malanville ! ! Atlantic Burkina Faso Guéné ! Ocean Kombongou ! Dakingari Fokku ! Malanville ! ! Aljenaari ! Arli Mahuta ! ! Founougo ! Zuru Angaradébou ! ! Wasagu Kérémou Koko ! ! Banikoara ! Bagudo Banikoara ! ! ! Kaoje ! Duku Kandi ! Kandi ! Batia Rijau ! ! Porga N ! N ° Tanguieta ° 1 1 1 Ségbana 1 Kerou ! Yelwa Mandouri Segbana ! ! Konkwesso Ukata ! ! Kérou Gogounou Gouandé ! ! Bin-Yauri ! Materi ! ! Agwarra Materi Gogounou ! Kouté Tanguieta ! ! Anaba Gbéroubouè ! ! Ibeto Udara Toukountouna ! ! Cobly !Toukountouna Babana Kouande ! Kontagora Sinendé Kainji Reservoir ! ! Dounkassa Natitingou Kouandé ! Kalale ! ! Kalalé ! ! Bouka Bembereke ! Boukoumbe Natitingou Pehunko Sinende ! Kagara Bembèrèkè Auna ! ! Boukoumbé ! Tegina ! N N ° ° 0 Kandé 0 ! Birni ! 1 ! 1 ! Wawa Ndali Nikki ! ! New Bussa ! Kopargo Zungeru !Kopargo ! Kizhi Niamtougou Ndali ! Pizhi ! Djougou Yashikera ! ! Ouaké ! ! Pagoud!a Pya ! Eban ! Djougou Kaiama ! Guinagourou Kosubosu ! Kara ! ! ! Ouake Benin Perere Kutiwengi ! Kabou ! Bafilo Alédjo Parakou ! ! ! Okuta Parakou ! Mokwa Bassar ! Kudu ! ! Pénessoulou Jebba Reservoir ! Bétérou Kutigi ! ! ! Tchaourou Bida Kishi ! ! ! Tchamba ! Dassa ! Bassila Sinou 2°E ! ! Nigeria ! N N Sokodé ° ° ! Save 9 9 Bassila Savalou Bode-Sadu !Paouignan Tchaourou Ilesha Ibariba -
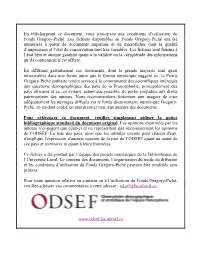
C-Doc 126 Odsef.Pdf
En téléchargeant ce document, vous souscrivez aux conditions d’utilisation du Fonds Gregory-Piché. Les fichiers disponibles au Fonds Gregory-Piché ont été numérisés à partir de documents imprimés et de microfiches dont la qualité d’impression et l’état de conservation sont très variables. Les fichiers sont fournis à l’état brut et aucune garantie quant à la validité ou la complétude des informations qu’ils contiennent n’est offerte. En diffusant gratuitement ces documents, dont la grande majorité sont quasi introuvables dans une forme autre que le format numérique suggéré ici, le Fonds Gregory-Piché souhaite rendre service à la communauté des scientifiques intéressés aux questions démographiques des pays de la Francophonie, principalement des pays africains et ce, en évitant, autant que possible, de porter préjudice aux droits patrimoniaux des auteurs. Nous recommandons fortement aux usagers de citer adéquatement les ouvrages diffusés via le fonds documentaire numérique Gregory- Piché, en rendant crédit, en tout premier lieu, aux auteurs des documents. Pour référencer ce document, veuillez simplement utiliser la notice bibliographique standard du document original. Les opinions exprimées par les auteurs n’engagent que ceux-ci et ne représentent pas nécessairement les opinions de l’ODSEF. La liste des pays, ainsi que les intitulés retenus pour chacun d'eux, n'implique l'expression d'aucune opinion de la part de l’ODSEF quant au statut de ces pays et territoires ni quant à leurs frontières. Ce fichier a été produit par l’équipe des projets numériques de la Bibliothèque de l’Université Laval. Le contenu des documents, l’organisation du mode de diffusion et les conditions d’utilisation du Fonds Gregory-Piché peuvent être modifiés sans préavis.