Presentation Des Regions De Developpement
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
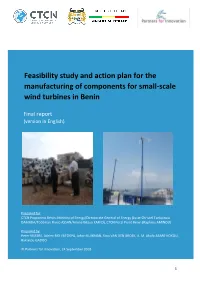
Feasibility Study and Action Plan for Small Wind Turbines in Benin
Feasibility study and action plan for the manufacturing of components for small-scale wind turbines in Benin Final report (version in English) Prepared for: CTCN Proponent Benin: Ministry of Energy/Directorate General of Energy (Juste Christel Tankpinou DAMADA/Todéman Flinso ASSAN/Amine Bitayo KAFFO), CTCN Focal Point Benin (Raphiou AMINOU) Prepared by: Peter VISSERS, Adrien BIO YATOKPA, Johan KUIKMAN, Stan VAN DEN BROEK, A. M. Akofa ASARE-KOKOU, Rakiatou GAZIBO © Partners for Innovation, 24 September 2018 1 List of acronyms ABERME Agence Béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie AfDB African Development Bank ANADER Agence Nationale de Développement des Energies Renouvelables ARE Autorité de Régulation de l'Electricité CEB Communauté Electrique du Bénin CENER Centro Nacional de Energías Renovables (National Centre of Renewable Energy, Spain) CONTRELEC L’Agence de Contrôle des Installations Electriques Intérieures CTCN Climate Technology Centre and Network DGRE Direction Générale des Ressources Énergétiques, Ministère de l’Energie DGEC Direction Générale de l’Environnement et du Climat, Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable DTU Danmarks Tekniske Universitet (Danish University of Technology) ECOWAS Economic Community of West African States ECREEE ECOWAS Centre for Renewable Energy and Energy Efficiency EEEOA Le système d’Échanges d’Énergie Électrique Ouest Africain EnDev Energising Development EPC Engineering, Procurement and Construction FCFA West African CFA franc (XOF), 1 EUR = 656 FCFA, 1 USD = 558 -

Programmation Hebdomadaire Des Marchés
Cellule Technique de Suivi et d’Appui à la Gestion de la Sécurité Alimentaire (CT-SAGSA) Programmation Hebdomadaire des marchés Semaine du lundi 15 au dimanche 21 mars 2021 Jour/Département Marchés lundi 15 mars 2021 Atacora Tokotoko, Tchabikouma, Tanéka-Koko, Kouaba, Tanguiéta, Manta Donga Djougou Alibori Banikoara, Goumori Borgou Gamia, Sinendé-Centre, Guéssou-Bani, Sèkèrè, Tchaourou, [Bétail] Tchaourou, Biro Collines [Bétail] Savalou (Tchetti), Tchetti, Savalou, Savè Zou Abomey (Houndjro), Djidja, Dovi-Dovè, Za-Hla, Houandougon, Domè, Setto, Oumbèga, Covè, Dan Couffo Tchito, Klouékanmè Mono Honhoué, Lokossa, Kpinnou, Akodéha Plateau [Bétail] Kétou (Iwoyé), Ikpinlè, Kétou, Yoko, Pobè Ouémé Affamè, [Bétail] Sèmè-Podji, Hozin, Adjarra, Azowlissè Atlantique Toffo, Kpassè, Hadjanaho, Zè, Godonoutin, Sey (dans Toffo), Tori-Gare, Ahihohomey (dans Abomey- Calavi), Sékou mardi 16 mars 2021 Atacora Toucountouna, Boukoumbé, Kouandé Donga Bariyénou, [Bétail] Djougou (Kolokondé), Kolokondé, Kikélé, Kassoua-Allah Alibori Sori, Sompérékou, Kandi Borgou Tchikandou, Fo-Bouré, [Bétail] Parakou (ASELCOP) Collines Sowigandji, Lahotan, Dassa-Zoumè, Aklankpa, Bantè Zou Agouna, Kpokissa, Ouinhi Couffo Djékpétimey, Dogbo Mono Danhoué Plateau Toubè, [Bétail] Kétou (Iwoyé), Aba, Adigun, Ifangni, Akitigbo, Efêoutê Ouémé Kouti, [Bétail] Sèmè-Podji, Ahidahomè (Porto-Novo), Gbagla-Ganfan, Ouando, Gbangnito, Vakon- Attinsa Atlantique Tori-Bossito, Déssa, Zinvié, Tokpadomè, Hêvié-Djêganto, Saint Michel d’Allada, Agbata mercredi 17 mars 2021 Atacora Natitingou, Tobré, -

Evaluation of Agricultural Land Resources in Benin By
Evaluation of agricultural land resources in Benin by regionalisation of the marginality index using satellite data Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades (Dr. rer. nat.) der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn vorgelegt von Julia Röhrig aus Waiblingen Bonn, April 2008 Angefertigt mit der Genehmigung der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. 1. Referent: Prof. Dr. G. Menz 2. Referent: Prof. Dr. M. Janssens Tag der Promotion: 15.07.2008 Diese Dissertation ist auf dem Hochschulschriftenserver der ULB Bonn http://hss.ulb.uni-bonn.de/diss_online elektronisch publiziert. Erscheinungsjahr: 2008 Contents 1 Introduction.................................................................................................1 1.1 Problem ................................................................................................1 1.2 Objective...............................................................................................1 1.3 Project framework of the study: the IMPETUS project...............................5 1.4 Structural composition of this study.........................................................6 2 Framework for agricultural land use in Benin ..................................................8 2.1 Location................................................................................................8 2.2 Biophysical conditions for agricultural land use .........................................8 2.2.1 -

Conservation Des Produits Agricoles Et Accumulation Des Métaux Lourds Dans Les Produits Vivriers Dans Le Département Du Couffo (Benin)
Fangnon et al . .… J. Appl. Biosci. 2012. Conservation et accumulation des métaux lourds dans les produits agricoles Journal of Applied Biosciences 57: 4168– 4176 ISSN 1997–5902 Conservation des produits agricoles et accumulation des métaux lourds dans les produits vivriers dans le département du Couffo (Benin) Fangnon Bernard *1 Tohozin Antoine Yves 1 Guedenon Patient 2 And Edorh A. Patrick 2, 3 1Laboratory of Urban and Regional Dynamics Studies 2 Laboratory of Toxicology and Environmental Health / Interfaculty Centre of Training and Research in Environment for Sustainable Development ( CIFRED), UAC, 03 BP on 1463, Jericho, Cotonou, Benin. 3Département of Biochemistry and cellular Biology, Faculty of Science and Techniques, University of Abomey-Calavi, 1BP 526 Cotonou, Benin. Correspondance : 1 [email protected] ,2 [email protected] ; [email protected] 3 [email protected] Original submitted in on 26 th June 2012. Published online at www.m.elewa.org on 30 th September 2012. RESUME Objectif : Cette étude est réalisée pour évaluer le taux des métaux lourds (plomb, cuivre, arsenic et cadmium) dans les cultures vivrières (maïs et niébé) de grande consommation dans le département du Couffo. Méthodologie et résultats : La méthode de spectrophotométrie d’absorption atomique a permis de détecter les métaux lourds dans les produits vivriers et les éléments entrant dans le processus de conservation des produits agricoles. Les échantillons de maïs et de niébé ont été minéralisés avant l’analyse par spectrophotométrie. Les résultats ont révélé que les concentrations moyennes des métaux lourds dans le maïs et le niébé évoluent respectivement de 0,05 à 6,50 mg/Kg et 0,26 à 0,70 mg/Kg pour le plomb, de 2,74 à 12,90 et 3,25 à 7,09 mg/Kg pour le cuivre, et de 8,48 à 20,90 mg/Kg et 10,43 à 29,72 mg/Kg pour l’arsenic. -

Cahier Des Villages Et Quartiers De Ville Du Mono.Pdf
REPUBLIQUE DU BENIN &&&&&&&&&& MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT &&&&&&&&&& INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE L’ANALYSE ECONOMIQUE (INSAE) &&&&&&&&&& CAHIER DES VILLAGES ET QUARTIERS DE VILLE DU DEPARTEMENT DU MONO (RGPH-4, 2013) Août 2016 REPUBLIQUE DU BENIN &&&&&&&&&& MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE L’ANALYSE ECONOMIQUE (INSAE) &&&&&&&&&& CAHIER DES VILLAGES ET QUARTIERS DE VILLE DU DEPARTEMENT DU MONO Août 2016 Prescrit par relevé N°09/PR/SGG/REL du 17 mars 2011, la quatrième édition du Recensement Général de la Population et de l’Habitation du Bénin s’est déroulée sur toute l’étendue du territoire national en mai 2013. Plusieurs activités ont concouru à sa réalisation, parmi lesquelles la cartographie censitaire. En effet, la cartographie censitaire à l’appui du recensement a consisté à découper tout le territoire national en de petites portions appelées Zones de Dénombrement (ZD). Au cours de la cartographie, des informations ont été collectées sur la disponibilité ou non des infrastructures de santé, d’éducation, d’adduction d’eau etc…dans les villages/quartiers de ville. Le présent document donne des informations détaillées jusqu’au niveau des villages et quartiers de ville, par arrondissement et commune. Il renseigne sur les effectifs de population, le nombre de ménage, la taille moyenne des ménages, la population agricole, les effectifs de population de certains âges spécifiques et des informations sur la disponibilité des infrastructures communautaires. Il convient de souligner que le point fait sur les centres de santé et les écoles n’intègre pas les centres de santé privés, et les confessionnels, ainsi que les écoles privées ou de type confessionnel. -

Zou Couffo Atlantique Mono
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1°40'E 1°50'E 2°0'E 2°10'E MA-009 Boudiavi ! Atri ! Ametchonoui ! Dagu!i ! ! Zinkame ! Honvi ! Aobe!gon ! Passagon Mono Bodolo Agbotavou Sakpeta ! ! Konfokpa Honve Agonme Ouko ! ! ! ! ! ! Benin Hogbahie Oukpa Hontonou Dra Assankanme Paoulakpa Bohe Mougnon ! ! ! Ag!behe ! ! ! Honhoun Bavou Pakpakan Honve Amou Ahihome Houo Sovi Ahevi Avocanzou Savakon Departement du Zou ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Onhoun 0 0 Vome-Vegame Agban Volli-Latadji Agougan Djaho Zakanme 0 Kodji Gnassata Tindji Assanline Zouto 0 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0 Benin: Flooding – Atlantic 8 Vivime Oki Kalachi Ouriagbi Diagbeto Baffan Detohou Sotta Hizan Ko g e Odecean ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Couffo Departement Atome-Ahevi Atome-Avegame Kogbitokoe Levourhoe Bagborhoe Sodjagotoe Lagborche Dra Gome Allomakanme Sonou Djime Bohicon Lisse-Sokodome orientation map ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Oky Tafan Houo Ketekpa Ketekpa Abomey ! ! ! ! ! ! ! N ' 0 Azime Anfin Poludji Ouakpe Adjahakpa ! ! ! ! ! Bekonkoli Davougon Lokokanme Ouahoue Bohicon Allahe 1 ! ! ! ! ! ! ° 7 Fagigarhoe Dolome Sinlito Dotota 0 SUMMARY: Orientation map ! ! ! Tohoueta Hodja Agnangnan ! ! ! ! ! ! ! ! 0 0 Legbaholli 0 displaying departements Maougberhoe 9 Donoume Lonkly Oui Globoui Rhomte Agougan Sahoua Adjahakpa Dekanme Tanve 7 boundaries, settlements and russian ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! topographic background. Delli Zou Esuime Klikoue Zame Dagoudikoe Afanai Akonhoum Akpeto Gboli Lissazoume ! ! ! ! ! ! ! ! ! Haou!la ! Badjame Aboukoue Togba Kologbe Djohoue Lanta-Kechikoe -

Diversity of the Neglected and Underutilized Crop Species of Importance in Benin
The Scientific World Journal Volume 2012, Article ID 932947, 19 pages The cientificWorldJOURNAL doi:10.1100/2012/932947 Research Article Diversity of the Neglected and Underutilized Crop Species of Importance in Benin A. Dansi,1, 2 R. Vodouhe,` 3 P. Azokpota,4 H. Yedomonhan,5 P. Assogba,2 A. Adjatin,1 Y. L. Loko,2 I. Dossou-Aminon,2 and K. Akpagana6 1 Laboratory of Agricultural Biodiversity and Tropical Plant breeding (LAAPT), Faculty of Sciences and Technology (FAST), University of Abomey-Calavi, BP 526, Cotonou, Benin 2 Crop, Aromatic and Medicinal Plant Biodiversity Research and Development Institute (IRDCAM), 071BP28, Cotonou, Benin 3 Bioversity International, Office of West and Central Africa, 08 BP 0931, Cotonou, Benin 4 Department of Nutrition and Food Technology, Faculty of Agriculture (FSA), University of Abomey-Calavi, BP 526, Cotonou, Benin 5 National Herbarium, Department of Botany and Plant Biology, Faculty of Sciences and Technology (FAST), University of Abomey- Calavi (UAC), BP 526, Cotonou, Benin 6 Laboratoire de Botanique, Facult´e des sciences (FS), Universit´edeLom´e, BP 1515, Lom´e, Togo Correspondence should be addressed to A. Dansi, [email protected] Received 25 October 2011; Accepted 11 January 2012 Academic Editor: Mehmet Yakup Arica Copyright © 2012 A. Dansi et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Many of the plant species that are cultivated for food across the world are neglected and underutilized. To assess their diversity in Benin and identify the priority species and establish their research needs, a survey was conducted in 50 villages distributed throughout the country. -

Caractéristiques Générales De La Population
République du Bénin ~~~~~ Ministère Chargé du Plan, de La Prospective et du développement ~~~~~~ Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique Résultats définitifs Caractéristiques Générales de la Population DDC COOPERATION SUISSE AU BENIN Direction des Etudes démographiques Cotonou, Octobre 2003 1 LISTE DES TABLEAUX Tableau 1: Population recensée au Bénin selon le sexe, les départements, les communes et les arrondissements............................................................................................................ 3 Tableau G02A&B : Population Résidente recensée dans la commune de KANDI selon le sexe et par année d’âge ......................................................................... 25 Tableau G02A&B : Population Résidente recensée dans la commune de NATITINGOU selon le sexe et par année d’âge......................................................................................... 28 Tableau G02A&B : Population Résidente recensée dans la commune de OUIDAH selon le sexe et par année d’âge............................................................................................................ 31 Tableau G02A&B :Population Résidente recensée dans la commune de PARAKOU selon le sexe et par année d’âge (Commune à statut particulier).................................................... 35 Tableau G02A&B : Population Résidente recensée dans la commune de DJOUGOU selon le sexe et par année d’âge .................................................................................................... 40 Tableau -

En Téléchargeant Ce Document, Vous Souscrivez Aux Conditions D’Utilisation Du Fonds Gregory-Piché
En téléchargeant ce document, vous souscrivez aux conditions d’utilisation du Fonds Gregory-Piché. Les fichiers disponibles au Fonds Gregory-Piché ont été numérisés à partir de documents imprimés et de microfiches dont la qualité d’impression et l’état de conservation sont très variables. Les fichiers sont fournis à l’état brut et aucune garantie quant à la validité ou la complétude des informations qu’ils contiennent n’est offerte. En diffusant gratuitement ces documents, dont la grande majorité sont quasi introuvables dans une forme autre que le format numérique suggéré ici, le Fonds Gregory-Piché souhaite rendre service à la communauté des scientifiques intéressés aux questions démographiques des pays de la Francophonie, principalement des pays africains et ce, en évitant, autant que possible, de porter préjudice aux droits patrimoniaux des auteurs. Nous recommandons fortement aux usagers de citer adéquatement les ouvrages diffusés via le fonds documentaire numérique Gregory- Piché, en rendant crédit, en tout premier lieu, aux auteurs des documents. Pour référencer ce document, veuillez simplement utiliser la notice bibliographique standard du document original. Les opinions exprimées par les auteurs n’engagent que ceux-ci et ne représentent pas nécessairement les opinions de l’ODSEF. La liste des pays, ainsi que les intitulés retenus pour chacun d'eux, n'implique l'expression d'aucune opinion de la part de l’ODSEF quant au statut de ces pays et territoires ni quant à leurs frontières. Ce fichier a été produit par l’équipe des projets numériques de la Bibliothèque de l’Université Laval. Le contenu des documents, l’organisation du mode de diffusion et les conditions d’utilisation du Fonds Gregory-Piché peuvent être modifiés sans préavis. -

Departement : Plateau Commune : Adja-Ouere Arrondissement : Adja-Ouere
CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SUPERVISION (COS LEPI) DEPARTEMENT : PLATEAU COMMUNE : ADJA-OUERE ARRONDISSEMENT : ADJA-OUERE FICHE DES DELEGUES D'ARRONDISSEMENT A L'ACTUALISATION (DAA) RETENUS N° NOM ET PRENOMS DATENAIS. VIL./QTIER DIPLOME RENA/LEPI EXPERIEN. TEL OBS. 1 HOUNGBEDJI GASTON 2 OLAWOLE ACHILLE LAKANMI 11/05/1975 OKE- ODAN BAC D OUI RENA 97130708/95148515 3 OROBI ISAAC 01/01/1986 ADJA-OUERE BAC DRA 96 17 68 97 CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SUPERVISION (COS LEPI) DEPARTEMENT : PLATEAU COMMUNE : ADJA-OUERE ARRONDISSEMENT : IKPINLE FICHE DES DELEGUES D'ARRONDISSEMENT A L'ACTUALISATION (DAA) RETENUS N° NOM ET PRENOMS DATENAIS. VIL./QTIER DIPLOME RENA/LEPI EXPERIEN. TEL OBS. 1 BISSIRIOU B. SAID 27/02/1985 IKPINLE LICENCE 97933728 2 DOITCHAMOU SAMSON 3 OGOUBEYI SOUROU 01/01/1985 MAITRISE OUI MIRENA 97296506/64768686 4 OLADJEHOU BARNABE 01/01/1982 MAITRISE NON 97041461/64439679 CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SUPERVISION (COS LEPI) DEPARTEMENT : PLATEAU COMMUNE : ADJA-OUERE ARRONDISSEMENT : KPOULOU FICHE DES DELEGUES D'ARRONDISSEMENT A L'ACTUALISATION (DAA) RETENUS N° NOM ET PRENOMS DATENAIS. VIL./QTIER DIPLOME RENA/LEPI EXPERIEN. TEL OBS. 1 ARONI OLAMIDE RAOUL 06/07/1988 MAITRISE CNT 98471077/97840377 2 HOUNKPATIN S. A. PAULIN 26/12/1988 KPOULOU BAC 96 28 35 42 3 SAWE GABRIEL CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SUPERVISION (COS LEPI) DEPARTEMENT : PLATEAU COMMUNE : ADJA-OUERE ARRONDISSEMENT : MASSE FICHE DES DELEGUES D'ARRONDISSEMENT A L'ACTUALISATION (DAA) RETENUS N° NOM ET PRENOMS DATENAIS. VIL./QTIER DIPLOME RENA/LEPI EXPERIEN. TEL OBS. 1 AGOSSOU Simon J. 20/06/1986 MASSE MAITRISE OUI MIRENA 95948391 2 DAH AMIDOU 20/12/1970 MASSE BAC DRA 97 17 43 48 3 KOUKPOLYI FERDINAND CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SUPERVISION (COS LEPI) DEPARTEMENT : PLATEAU COMMUNE : ADJA-OUERE ARRONDISSEMENT : OKO-AKARE FICHE DES DELEGUES D'ARRONDISSEMENT A L'ACTUALISATION (DAA) RETENUS N° NOM ET PRENOMS DATENAIS. -

Plan Directeur D'electrification Hors Réseau
Plan Directeur d’Electrification Hors Réseau Prévision de la demande - 2018 Annexe 3 Etude pour la mise en place d’un environnement propice à l’électrification hors-réseau Présenté par : Projet : Accès à l’Électricité Hors Réseau Activité : Etude pour la mise en place d’un environnement propice à l’électrification hors-réseau Contrat n° : PP1-CIF-OGEAP-01 Client : Millennium Challenge Account-Bénin II (MCA-Bénin II) Financement : Millennium Challenge Corporation (MCC) Gabriel DEGBEGNI - Coordonnateur National (CN) Dossier suivi par : Joel AKOWANOU - Directeur des Opérations (DO) Marcel FLAN - Chef du Projet Energie Décentralisée (CPED) Groupement : IED - Innovation Energie Développement (Fr) PAC - Practical Action Consulting Ltd (U.K) 2 chemin de la Chauderaie, 69340 Francheville, France Consultant : Tel: +33 (0)4 72 59 13 20 / Fax: +33 (0)4 72 59 13 39 E-mail : [email protected] / [email protected] Site web: www.ied-sa.fr Référence IED : 2016/019/Off Grid Bénin MCC Date de démarrage : 21 nov. 2016 Durée : 18 mois Rédaction du document : Version Note de cadrage Version 1 Version 2 FINAL Date 26 juin 2017 14 juillet 2017 07 septembre 2017 17 juin 2017 Rédaction Jean-Paul LAUDE, Romain FRANDJI, Ranie RAMBAUD Jean-Paul LAUDE - Chef de projet résident Relecture et validation Denis RAMBAUD-MEASSON - Directeur de projet Off-grid 2017 Bénin IED Prévision de la Demande Localités non électrifiées Scenario 24h Première année Moyen-terme Horizon Population Conso. Pointe Part do- Conso. (kWh) Pointe Part do- Conso. Pointe Part do- Code Localité -

Monographie Des Communes Des Départements Du Mono Et Du Couffo
Spatialisation des cibles prioritaires des ODD au Bénin : Monographie des communes des départements du Mono et du Couffo Note synthèse sur l’actualisation du diagnostic et la priorisation des cibles des communes Une initiative de : Direction Générale de la Coordination et du Suivi des Objectifs de Développement Durable (DGCS-ODD) Avec l’appui financier de : Programme d’appui à la Décentralisation et Projet d’Appui aux Stratégies de Développement au Développement Communal (PDDC / GIZ) (PASD / PNUD) Fonds des Nations unies pour l'enfance Fonds des Nations unies pour la population (UNICEF) (UNFPA) Et l’appui technique du Cabinet Cosinus Conseils Note synthèse réalisée dans le cadre de la mission mise en œuvre par le cabinet Cosinus Conseils Sarl Tables des matières Sigles et abréviations ............................................................................................................................................ 3 1.1. BREF APERÇU SUR LE DEPARTEMENT ....................................................................................................... 4 1.1.1. INFORMATIONS SUR LES DEPARTEMENTS MONO-COUFFO .................................................................................... 4 1.1.1.1. Aperçu du département du Mono ........................................................................................................... 4 1.1.1.1.2. Aperçu du département du Couffo ................................................................................................. 5 1.1.2. RESUME DES INFORMATIONS SUR LE DIAGNOSTIC