Sujet Les Facteurs Explicatifs De La
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Aplahoué Audit Fadec 2016
REPUBLIQUE DU BENIN FRATERNITE- JUSTICE-TRAVAIL MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA MINISTERE DE L’ECONOMIE GOUVERNANCE LOCALE ET DES FINANCES INSPECTION GENERALE DES FINANCES INSPECTION GENERALE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES AUDIT DE LA GESTION DES RESSOURCES DU FONDS D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DES COMMUNES (FADeC) AU TITRE DE L’EXERCICE 2016 COMMUNE D’APLAHOUE Etabli par : - Monsieur Benjamin Fagninou KEMAVO, Inspecteur Général des finances (MEF) - Madame Elie Justine TCHOKPON, Administrateur en planification (MDGL) Octobre 2017 Audit de la gestion des ressources du FADeC au titre de l’exercice 2016 TABLE DES MATIERES : INTRODUCTION ..................................................................................................................................................... 1 1. ETAT DES TRANSFERTS FADEC, GESTION ET NIVEAU DE CONSOMMATION DES CREDITS .............................. 5 1.1 SITUATION D’EXECUTION DES TRANSFERTS FADEC ..................................................................................... 5 1.1.1 Les crédits de transfert mobilisés par la commune au titre de la gestion ............................................... 5 1.1.2 Situation de l’emploi des crédits disponibles ........................................................................................... 8 1.1.3 Niveau d’exécution financière des ressources de transfert ................................................................... 13 1.1.4 Marchés non soldés au 31 Décembre 2016 .......................................................................................... -

Conservation Des Produits Agricoles Et Accumulation Des Métaux Lourds Dans Les Produits Vivriers Dans Le Département Du Couffo (Benin)
Fangnon et al . .… J. Appl. Biosci. 2012. Conservation et accumulation des métaux lourds dans les produits agricoles Journal of Applied Biosciences 57: 4168– 4176 ISSN 1997–5902 Conservation des produits agricoles et accumulation des métaux lourds dans les produits vivriers dans le département du Couffo (Benin) Fangnon Bernard *1 Tohozin Antoine Yves 1 Guedenon Patient 2 And Edorh A. Patrick 2, 3 1Laboratory of Urban and Regional Dynamics Studies 2 Laboratory of Toxicology and Environmental Health / Interfaculty Centre of Training and Research in Environment for Sustainable Development ( CIFRED), UAC, 03 BP on 1463, Jericho, Cotonou, Benin. 3Département of Biochemistry and cellular Biology, Faculty of Science and Techniques, University of Abomey-Calavi, 1BP 526 Cotonou, Benin. Correspondance : 1 [email protected] ,2 [email protected] ; [email protected] 3 [email protected] Original submitted in on 26 th June 2012. Published online at www.m.elewa.org on 30 th September 2012. RESUME Objectif : Cette étude est réalisée pour évaluer le taux des métaux lourds (plomb, cuivre, arsenic et cadmium) dans les cultures vivrières (maïs et niébé) de grande consommation dans le département du Couffo. Méthodologie et résultats : La méthode de spectrophotométrie d’absorption atomique a permis de détecter les métaux lourds dans les produits vivriers et les éléments entrant dans le processus de conservation des produits agricoles. Les échantillons de maïs et de niébé ont été minéralisés avant l’analyse par spectrophotométrie. Les résultats ont révélé que les concentrations moyennes des métaux lourds dans le maïs et le niébé évoluent respectivement de 0,05 à 6,50 mg/Kg et 0,26 à 0,70 mg/Kg pour le plomb, de 2,74 à 12,90 et 3,25 à 7,09 mg/Kg pour le cuivre, et de 8,48 à 20,90 mg/Kg et 10,43 à 29,72 mg/Kg pour l’arsenic. -

Cahier Des Villages Et Quartiers De Ville Du Mono.Pdf
REPUBLIQUE DU BENIN &&&&&&&&&& MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT &&&&&&&&&& INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE L’ANALYSE ECONOMIQUE (INSAE) &&&&&&&&&& CAHIER DES VILLAGES ET QUARTIERS DE VILLE DU DEPARTEMENT DU MONO (RGPH-4, 2013) Août 2016 REPUBLIQUE DU BENIN &&&&&&&&&& MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE L’ANALYSE ECONOMIQUE (INSAE) &&&&&&&&&& CAHIER DES VILLAGES ET QUARTIERS DE VILLE DU DEPARTEMENT DU MONO Août 2016 Prescrit par relevé N°09/PR/SGG/REL du 17 mars 2011, la quatrième édition du Recensement Général de la Population et de l’Habitation du Bénin s’est déroulée sur toute l’étendue du territoire national en mai 2013. Plusieurs activités ont concouru à sa réalisation, parmi lesquelles la cartographie censitaire. En effet, la cartographie censitaire à l’appui du recensement a consisté à découper tout le territoire national en de petites portions appelées Zones de Dénombrement (ZD). Au cours de la cartographie, des informations ont été collectées sur la disponibilité ou non des infrastructures de santé, d’éducation, d’adduction d’eau etc…dans les villages/quartiers de ville. Le présent document donne des informations détaillées jusqu’au niveau des villages et quartiers de ville, par arrondissement et commune. Il renseigne sur les effectifs de population, le nombre de ménage, la taille moyenne des ménages, la population agricole, les effectifs de population de certains âges spécifiques et des informations sur la disponibilité des infrastructures communautaires. Il convient de souligner que le point fait sur les centres de santé et les écoles n’intègre pas les centres de santé privés, et les confessionnels, ainsi que les écoles privées ou de type confessionnel. -

Zou Couffo Atlantique Mono
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1°40'E 1°50'E 2°0'E 2°10'E MA-009 Boudiavi ! Atri ! Ametchonoui ! Dagu!i ! ! Zinkame ! Honvi ! Aobe!gon ! Passagon Mono Bodolo Agbotavou Sakpeta ! ! Konfokpa Honve Agonme Ouko ! ! ! ! ! ! Benin Hogbahie Oukpa Hontonou Dra Assankanme Paoulakpa Bohe Mougnon ! ! ! Ag!behe ! ! ! Honhoun Bavou Pakpakan Honve Amou Ahihome Houo Sovi Ahevi Avocanzou Savakon Departement du Zou ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Onhoun 0 0 Vome-Vegame Agban Volli-Latadji Agougan Djaho Zakanme 0 Kodji Gnassata Tindji Assanline Zouto 0 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0 Benin: Flooding – Atlantic 8 Vivime Oki Kalachi Ouriagbi Diagbeto Baffan Detohou Sotta Hizan Ko g e Odecean ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Couffo Departement Atome-Ahevi Atome-Avegame Kogbitokoe Levourhoe Bagborhoe Sodjagotoe Lagborche Dra Gome Allomakanme Sonou Djime Bohicon Lisse-Sokodome orientation map ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Oky Tafan Houo Ketekpa Ketekpa Abomey ! ! ! ! ! ! ! N ' 0 Azime Anfin Poludji Ouakpe Adjahakpa ! ! ! ! ! Bekonkoli Davougon Lokokanme Ouahoue Bohicon Allahe 1 ! ! ! ! ! ! ° 7 Fagigarhoe Dolome Sinlito Dotota 0 SUMMARY: Orientation map ! ! ! Tohoueta Hodja Agnangnan ! ! ! ! ! ! ! ! 0 0 Legbaholli 0 displaying departements Maougberhoe 9 Donoume Lonkly Oui Globoui Rhomte Agougan Sahoua Adjahakpa Dekanme Tanve 7 boundaries, settlements and russian ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! topographic background. Delli Zou Esuime Klikoue Zame Dagoudikoe Afanai Akonhoum Akpeto Gboli Lissazoume ! ! ! ! ! ! ! ! ! Haou!la ! Badjame Aboukoue Togba Kologbe Djohoue Lanta-Kechikoe -

Costing Analysis and Anthropological Assessment of The
Vaccine 35 (2017) 2183–2188 Contents lists available at ScienceDirect Vaccine journal homepage: www.elsevier.com/locate/vaccine Costing analysis and anthropological assessment of the vaccine supply chain system redesign in the Comé District (Benin) q ⇑ Xiao Xian Huang a, , Elise Guillermet a, Jean-Bernard Le Gargasson a, Daleb Abdoulaye Alfa b, Romule Gbodja b, Adanmavokin Justin Sossou c, Phillippe Jaillard a a Agence de Médecine Préventive, France b University of Abomey-Calavi, Benin c Benin’s Ministry of Health, Benin article info abstract Keywords: Objective: At the end of 2013, a pilot experiment was carried out in Comé health zone (HZ) in an attempt Supply chain to optimize the vaccine supply chain. Four commune vaccine storage facilities were replaced by one cen- Health logistics tral HZ facility. This study evaluated the incremental financial needs for the establishment of the new sys- Logistics cost tem; compared the economic cost of the supply chain in the Comé HZ before and after the system HERMES redesign; and analyzed the changes induced by the pilot project in immunization logistics management. Vaccination programs EPI Method: The purposive sampling method was used to draw a sample from 37 health facilities in the zone Health workforce for costing evaluation. Data on inputs and prices were collected retrospectively for 2013 and 2014. The Low- and middle-income countries analysis used an ingredient-based approach. In addition, 44 semi-structured interviews with health Benin workers for anthropological analysis were completed in 2014. Results: The incremental financial costs amounted to US$55,148, including US$50,605 for upfront capital investment and US$4543 for ongoing recurrent costs. -

Caractéristiques Générales De La Population
République du Bénin ~~~~~ Ministère Chargé du Plan, de La Prospective et du développement ~~~~~~ Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique Résultats définitifs Caractéristiques Générales de la Population DDC COOPERATION SUISSE AU BENIN Direction des Etudes démographiques Cotonou, Octobre 2003 1 LISTE DES TABLEAUX Tableau 1: Population recensée au Bénin selon le sexe, les départements, les communes et les arrondissements............................................................................................................ 3 Tableau G02A&B : Population Résidente recensée dans la commune de KANDI selon le sexe et par année d’âge ......................................................................... 25 Tableau G02A&B : Population Résidente recensée dans la commune de NATITINGOU selon le sexe et par année d’âge......................................................................................... 28 Tableau G02A&B : Population Résidente recensée dans la commune de OUIDAH selon le sexe et par année d’âge............................................................................................................ 31 Tableau G02A&B :Population Résidente recensée dans la commune de PARAKOU selon le sexe et par année d’âge (Commune à statut particulier).................................................... 35 Tableau G02A&B : Population Résidente recensée dans la commune de DJOUGOU selon le sexe et par année d’âge .................................................................................................... 40 Tableau -
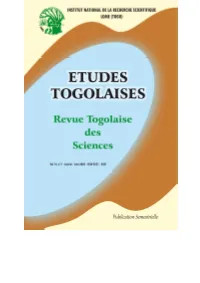
4D27f28896c1ac27954cc8cfaa4
0 ETUDES TOGOLAISES Revue Togolaise des Sciences Vol 14, n°1 – Janvier – Juin 2020 - ISSN 0531 - 2051 Publication semestrielle Institut National de la Recherche Scientifique (INRS) BP 2240 LOME – TOGO Tél (228) 22 21 01 39 / (228) 22 21 39 94 Email: [email protected] 1 ETUDES TOGOLAISES Revue publiée sous le haut patronage du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Directeur de Publication : Prof. Kouami KOKOU Rédacteur en chef : Dr. Sénamé Dodzi KOSSI Responsables Administratifs et Financiers : M. Frédéric Adjagnon NADOR / M. Wakilou BONFOH Comité scientifique de lecture - Pr. Messanvi GBEASSOR, Lomé – Togo - Pr. Kouami KOKOU, Lomé – Togo - Pr. Fidèle Messan NUBUKPO, Lomé – Togo - Pr. Mireille PRINCE-DAVID, Lomé – Togo - Pr. Kossi KOUMAGLO, Lomé – Togo - Pr. Moustapha KASSE, Dakar – Sénégal - Pr. Adolé GLITHO, Lomé –Togo - Pr. Serge GLITHO, Lomé - Togo - Pr. Kossi NAPO, Lomé – Togo - Pr. Comla de SOUZA, Lomé – Togo - Pr. Akuetey SANTOS, Lomé – Togo - Pr. Nandedjo BIGOU-LARE, Lomé – Togo - Pr. Taladidia THIOMBIANO, Ouagadougou – Burkina Faso - Pr. Koffisa BEDJA, Lomé - Togo - Pr. Mawuena GUMEDZOE, Lomé – Togo - Pr. Koffi NDAKENA, Lomé – Togo - Pr. Koffi AKPAGANA, Lomé – Togo - Pr. Komla SANDA, Lomé – Togo - Pr. Komi TCHAKPELE, Lomé – Togo - Pr. Maurille AGBOBLI, Lomé –Togo - Pr. Aimé GOGUE, Lomé –Togo - Pr. Egnonto M. KOFFI-TESSIO, Lomé – Togo - Pr. Gauthier BIAOU, Cotonou – Bénin - Pr. Koffi AHADZI-NONOU, Lomé – Togo - Pr. Badjow TCHAM, Lomé – Togo - Pr. Edinam KOLA, Lomé – Togo - Pr. Kokou Folly Lolowou HETCHELI, Lomé – Togo - Pr. Pépévi KPAKPO (MC), Lomé – Togo - Pr. Adzo Dzifa KOKOUTSÈ, Lomé – Togo - Pr Adou YAO, Abidjan – Côte d’Ivoire - Pr. Gbati NAPO (MC), Lomé – Togo - Prix du numéro : 2 500 Fcfa - Abonnement : 4 500 Fcfa / An Toute correspondance concernant la revue doit être adressée à : Etudes Togolaise « Revue Togolaise des Sciences »,BP 2240 LOME – TOGO ; Tél. -

Rapport Final De L'enquete Steps Au Benin
REPUBLIQUE DU BENIN MINISTERE DE LA SANTE Direction Nationale de la Protection Sanitaire Programme National de Lutte contre les Maladies Non Transmissibles RAPPORT FINAL DE L’ENQUETE STEPS AU BENIN Juin 2008 EQUIPE DE REDACTION Pr. HOUINATO Dismand Coordonnateur National / PNLMNT Dr SEGNON AGUEH Judith A. Médecin Epidémiologiste / PNLMNT Pr. DJROLO François Point focal diabète /PNLMNT Dr DJIGBENNOUDE Oscar Médecin Santé Publique/ PNLMNT i Sommaire RESUME ...........................................................................................................1 1 INTRODUCTION....................................................................................... 2 2 OBJECTIFS ................................................................................................ 5 3 CADRE DE L’ETUDE: (étendue géographique).........................................7 4 METHODE ............................................................................................... 16 5 RESULTATS ............................................................................................ 23 6 Références bibliographiques...................................................................... 83 7 Annexes ii Liste des tableaux Tableau I: Caractéristiques sociodémographiques des sujets enquêtés au Bénin en 2008..... 23 Tableau II: Répartition des sujets enquêtés en fonction de leur niveau d’instruction, activité professionnelle et département au Bénin en 2008. ................................................................ 24 Tableau III : Répartition des consommateurs -

Plan Directeur D'electrification Hors Réseau
Plan Directeur d’Electrification Hors Réseau Prévision de la demande - 2018 Annexe 3 Etude pour la mise en place d’un environnement propice à l’électrification hors-réseau Présenté par : Projet : Accès à l’Électricité Hors Réseau Activité : Etude pour la mise en place d’un environnement propice à l’électrification hors-réseau Contrat n° : PP1-CIF-OGEAP-01 Client : Millennium Challenge Account-Bénin II (MCA-Bénin II) Financement : Millennium Challenge Corporation (MCC) Gabriel DEGBEGNI - Coordonnateur National (CN) Dossier suivi par : Joel AKOWANOU - Directeur des Opérations (DO) Marcel FLAN - Chef du Projet Energie Décentralisée (CPED) Groupement : IED - Innovation Energie Développement (Fr) PAC - Practical Action Consulting Ltd (U.K) 2 chemin de la Chauderaie, 69340 Francheville, France Consultant : Tel: +33 (0)4 72 59 13 20 / Fax: +33 (0)4 72 59 13 39 E-mail : [email protected] / [email protected] Site web: www.ied-sa.fr Référence IED : 2016/019/Off Grid Bénin MCC Date de démarrage : 21 nov. 2016 Durée : 18 mois Rédaction du document : Version Note de cadrage Version 1 Version 2 FINAL Date 26 juin 2017 14 juillet 2017 07 septembre 2017 17 juin 2017 Rédaction Jean-Paul LAUDE, Romain FRANDJI, Ranie RAMBAUD Jean-Paul LAUDE - Chef de projet résident Relecture et validation Denis RAMBAUD-MEASSON - Directeur de projet Off-grid 2017 Bénin IED Prévision de la Demande Localités non électrifiées Scenario 24h Première année Moyen-terme Horizon Population Conso. Pointe Part do- Conso. (kWh) Pointe Part do- Conso. Pointe Part do- Code Localité -

Monographie Des Communes Des Départements Du Mono Et Du Couffo
Spatialisation des cibles prioritaires des ODD au Bénin : Monographie des communes des départements du Mono et du Couffo Note synthèse sur l’actualisation du diagnostic et la priorisation des cibles des communes Une initiative de : Direction Générale de la Coordination et du Suivi des Objectifs de Développement Durable (DGCS-ODD) Avec l’appui financier de : Programme d’appui à la Décentralisation et Projet d’Appui aux Stratégies de Développement au Développement Communal (PDDC / GIZ) (PASD / PNUD) Fonds des Nations unies pour l'enfance Fonds des Nations unies pour la population (UNICEF) (UNFPA) Et l’appui technique du Cabinet Cosinus Conseils Note synthèse réalisée dans le cadre de la mission mise en œuvre par le cabinet Cosinus Conseils Sarl Tables des matières Sigles et abréviations ............................................................................................................................................ 3 1.1. BREF APERÇU SUR LE DEPARTEMENT ....................................................................................................... 4 1.1.1. INFORMATIONS SUR LES DEPARTEMENTS MONO-COUFFO .................................................................................... 4 1.1.1.1. Aperçu du département du Mono ........................................................................................................... 4 1.1.1.1.2. Aperçu du département du Couffo ................................................................................................. 5 1.1.2. RESUME DES INFORMATIONS SUR LE DIAGNOSTIC -

Programme D'actions Du Gouvernement 2016-2021
PROGRAMME D’ACTIONS DU GOUVERNEMENT 2016-2021 ÉTAT DE MISE EN œuvre AU 31 MARS 2019 INNOVATION ET SAVOIR : DÉVELOPPER UNE ÉCONOMIE DE L’INNOVATION ET DU SAVOIR, SOURCE D’EMPLOIS ET DE CROISSANCE – © BAI-AVRIL 2019 A PROGRAMME D’ACTIONS DU GOUVERNEMENT 2016-2021 ÉTAT DE MISE EN œuvre AU 31 MARS 2019 2 Sommaire 1. Avant-propos p. 4 2. Le PAG en bref p. 8 3. État d’avancement des réformes p. 14 4. Mise en œuvre des projets p. 26 TOURISME p. 30 AGRICULTURE p. 44 INFRASTRUCTURES p. 58 NUMÉRIQUE p. 74 ÉLECTRICITÉ p. 92 CADRE DE VIE p. 110 EAU POtaBLE p. 134 PROTECTION SOCIALE p. 166 CITÉ INTERNatIONALE DE L’INNOVatION ET DU SaVoir – SÈMÈ CITY p. 170 ÉDUCatION p. 178 SPORT ET CULTURE p. 188 SaNTÉ p. 194 5. Mobilisation des ressources p. 204 6. Annexes p. 206 Annexe 1 : ÉLECTRICITÉ p. 210 Annexe 2 : CADRE DE VIE p. 226 Annexe 3 : EAU POTABLE p. 230 SOMMAIRE – © BAI-AVRIL 2019 3 1 4 RÉCAPITULATIF DES RÉFORMES MENÉES – © BAI-AVRIL 2019 Avant-propos RÉCAPITULATIF DES RÉFORMES MENÉES – © BAI-AVRIL 2019 5 Avant-propos Les équipes du Président Patrice TALON poursuivent du PAG. Il convient de souligner que ces fonds ont été résolument la mise en œuvre des projets inscrits dans affectés essentiellement au financement des infrastruc- le Programme d’Actions du Gouvernement PAG 2016– tures nécessaires pour impulser l’investissement privé 2021. Dans le présent document, l’état d’avancement (énergie, routes, internet haut débit, attractions, amé- de chacun des projets phares est fourni dans des fiches nagement des plages,…). -

Cahier Des Villages Et Quartiers De Ville
République du Bénin ~~~~~ Ministère Chargé du Plan, de La Prospective et du Développement ~~~~~~ Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique Cahier des villages et quartiers de ville Département du MONO DDC COOPERATION SUISSE AU BENIN Direction des Etudes Démographiques Cotonou, Mai 2004 2 DEPARTEMENT DU MONO CARTE N Dép. Couffo LOKOSSA BOPA ATHIEME HOUEYOG BE COME Dép. Atlantique GRAND-POPO Rép. Togo du Océan Atlantique 0510Kilometers E = 1/350000 Mai 2004 3 DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DU DEPARTEMENT DU MONO Présentation du département Situé au sud-ouest de la République du Bénin, le département du Mono couvre une superficie de 1 605 km². Six communes composent ce département. Il s’agit de: Athiémé, Bopa, Comè, Grand-Popo, Houéyogbé et Lokossa. On y dénombre 276 villages regroupés en 35 Arrondissements. Occupant la zone sud de l’ex-département du Mono, l’actuel département du Mono se trouve limité comme suit : - Au Nord par le département du Couffo, - Au Sud par l’Océan Atlantique, - A l’Est par le département de l’Atlantique, - A l’Ouest par la République du Togo. Milieu naturel Le département du Mono jouit d’un climat de type sub-équatorial avec une succession de quatre saisons, une pluviosité variant entre 850 mm et 1 160 mm, une température pouvant atteindre 27,9°C, une humidité relative variant entre 55% et 95% et une insolation annuelle moyenne de 2 024 h/an. Le département est traversé par deux zones agro écologiques. La zone agro écologique qui traverse la commune de Houéyogbé est constituée de terre de barre tandis que l’autre zone est faite de basse vallée et de formations alluviales et couvre les communes de Athiémé, Bopa, Comé, Grand-Popo, Lokossa.