I Casi Di Lucky Luciano E Pablo Escobar
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Società E Cultura 65
Società e Cultura Collana promossa dalla Fondazione di studi storici “Filippo Turati” diretta da Maurizio Degl’Innocenti 65 1 Manica.indd 1 19-11-2010 12:16:48 2 Manica.indd 2 19-11-2010 12:16:48 Giustina Manica 3 Manica.indd 3 19-11-2010 12:16:53 Questo volume è stato pubblicato grazie al contributo di fondi di ricerca del Dipartimento di studi sullo stato dell’Università de- gli Studi di Firenze. © Piero Lacaita Editore - Manduria-Bari-Roma - 2010 Sede legale: Manduria - Vico degli Albanesi, 4 - Tel.-Fax 099/9711124 www.lacaita.com - [email protected] 4 Manica.indd 4 19-11-2010 12:16:54 La mafia non è affatto invincibile; è un fatto uma- no e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto, bisogna rendersi conto che è un fe- nomeno terribilmente serio e molto grave; e che si può vincere non pretendendo l’eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze mi- gliori delle istituzioni. Giovanni Falcone La lotta alla mafia deve essere innanzitutto un mo- vimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità… Paolo Borsellino 5 Manica.indd 5 19-11-2010 12:16:54 6 Manica.indd 6 19-11-2010 12:16:54 Alla mia famiglia 7 Manica.indd 7 19-11-2010 12:16:54 Leggenda Archivio centrale dello stato: Acs Archivio di stato di Palermo: Asp Public record office, Foreign office: Pro, Fo Gabinetto prefettura: Gab. -

Online Instructor's Manual with Testbank
Online Instructor’s Manual with Testbank for Organized Crime Seventh Edition Michael D. Lyman Columbia College of Missouri Test Bank Chapter 1 Understanding Organized Crime 1.1 Multiple Choice Questions 1) In many ways the image and impression we have of organized crime, whether accurate or not, have been shaped by American “________” culture. A) bebop B) rap C) pop D) country Answer: C Page Ref: 2 Objective: Understand the numerous definitions of organized crime. Level: Basic 2) The 1972 movie ________, starring Marlon Brando, depicted organized crime. A) The Underworld B) The Black Dahlia C) The Choir Boys D) The Godfather Answer: D Page Ref: 3 Objective: Understand the numerous definitions of organized crime. Level: Intermediate 3) Donald Liddick (2004) suggests that organized crime is “the provision of illegal goods and services, various forms of theft and fraud, and the restraint of trade in both licit and illicit market sectors, perpetuated by informal and changing networks of ‘upper-world’ and ‘under-world’ societal participants who are bound together in complex webs of ________ relationships.” A) seller-user B) boss-subordinate C) patron-client D) power-patron Answer: C Page Ref: 8-9 Objective: Understand the numerous definitions of organized crime. Level: Intermediate 126 Copyright © 2019 Pearson Education, Inc. 4) The National Criminal Intelligence Service (2005) describes organized crime as having four salient attributes, which include all of the following EXCEPT ________. A) an organized crime group contains at least three people B) the group, or at least one member, commits murder or aggravated assault C) the group is motivated by a desire for profit or power D) the group commits serious criminal offenses Answer: B Page Ref: 12 Objective: Understand the numerous definitions of organized crime. -

La Mafia Siciliana, Cosa Nostra Uno Studio Sulle Origini, La Storia, L’Attualità
Hugvísindasvið La mafia siciliana, Cosa Nostra Uno studio sulle origini, la storia, l’attualità Ritgerð til BA-prófs í ítölsku Kristín Sveina Bjarnadóttir Júní 2013 Háskóli Íslands Hugvísindasvið Ítalska La mafia siciliana, Cosa Nostra Uno studio sulle origini, la storia, l’attualità Ritgerð til BA-prófs í ítölsku Kristín Sveina Bjarnadóttir Kt.: 240388-3249 Leiðbeinandi: Stefano Rosatti Júní 2013 Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA-gráðu í ítölsku og er óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. © Kristín Sveina Bjarnadóttir 2013 Reykjavík, Ísland 2013 Ágrip Uppruna mafíunnar má rekja til Sikileyjar. Á Sikiley notar mafían heitið Cosa Nostra sem merkir „okkar mál“. Sikileyska mafían hefur haft ítök í efnahag og stjórnmálum eyjarinnar í hundruði ára en hún hefur einnig haslað sér völl á meginlandi Ítalíu og erlendis. Í lok 19. aldar var mikil kreppa á Ítalíu og fluttust margir íbúar Sikileyjar til Bandaríkjanna í leit að betra lífi og í kjölfarið mynduðust þar mafíuklíkur. Mafía er skipulögð glæpastarfsemi og stunda meðlimir hennar meðal annars fjárkúgun, peningaþvætti og eiturlyfja- og vopnasmygl. Á 10. áratug síðustu aldar náði baráttan gegn mafíunni hápunkti og voru dómararnir Giovanni Falcone og Paolo Borsellino þar fremstir í flokki. Giovanni og Borsellino helguðu lífi sínu baráttunni gegn mafíunni og urði þeir heimsfrægir fyrir harðfylgni sína gegn henni. Baráttan skilaði töluverðum árangri en nokkrir af helstu mafíuforingjum Sikileyjar voru handsamaðir. Tilgangur þessarar rigerðar er að greina frá megin einkennum sikileysku mafíunnar, sögu hennar og vinnubrögðum. Í fyrri hluta ritgerðarinnar er greint frá uppruna mafíunnar og þróun hennar í tímanna rás. Einnig er fjallað um hugtakið mafía og merkingu þess. -

Influenced Transplantation: a Study Into Emerging Mafia Groups in The
Influenced Transplantation: A Study into Emerging Mafia Groups in the United States pre-1920 Simon May Submitted version deposited in Coventry University’s Institutional Repository Original citation: May, S. (2017) Influenced Transplantation: A Study into Emerging Mafia Groups in the United States pre-1920 . Unpublished PhD Thesis. Coventry: Coventry University. Copyright © and Moral Rights are retained by the author. A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, without prior permission or charge. This item cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the copyright holder(s). The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the copyright holders. Some materials have been removed from this thesis due to Third Party Copyright. Pages where material has been removed are clearly marked in the electronic version. The unabridged version of the thesis can be viewed at the Lanchester Library, Coventry University. Influenced Transplantation: A Study into Emerging Mafia Groups in the United States pre-1920 By Simon May May 2017 A thesis submitted in partial fulfilment of the University’s requirements for the Degree of Doctor of Philosophy 1 2 REGISTRY RESEARCH UNIT ETHICS REVIEW FEEDBACK FORM (Review feedback should be completed within 10 working days) Name of applicant: Simon May ...................................... Faculty/School/Department: [Business, Environment and Society] International Studies and Social Science .................................................................. Research project title: PHD on Organised Crime: Links between pre-prohibition mafias in the US and Sicily Comments by the reviewer 1. Evaluation of the ethics of the proposal: 2. -
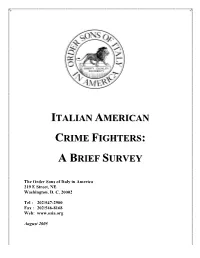
Italian American Crime Fighters a Brief Survey
IITTAALLIIAANN AAMMEERRIICCAANN CCRRIIMMEE FFIIGGHHTTEERRSS:: AA BBRRIIEEFF SSUURRVVEEYY The Order Sons of Italy in America 219 E Street, NE Washington, D. C. 20002 Tel : 202/547-2900 Fax : 202/546-8168 Web: www.osia.org August 2005 ITALIAN AMERICAN CRIME FIGHTERS: A Brief Survey Table of Contents Executive Summary…………………............ P. 3 Part I: A Century of Law Enforcement………….…. P. 6 Part II: Fighting Organized Crime…..….….……..… P. 13 Appendix I: The Detective in the Derby: Joseph Petrosino By Ercole Gaudioso……………………………….. P. 21 Appendix II: Sources……………….. ………………..…............. P. 28 Appendix III: Future Research…. …………….………………… P. 29 2 ITALIAN AMERICAN CRIME FIGHTERS: A BRIEF SURVEY EXECUTIVE SUMMARY: This report was inspired by three recent events in the U.S. entertainment industry: • The popularity of the HBO television mafia soap opera, The Sopranos • The PBS public television documentary and Website, The Medicis: Godfathers of the Renaissance • Steven Spielberg's children's gangster film Shark Tale These and countless other films and television shows for decades, all portray characters of Italian heritage as criminals. The result of such stereotyping is the belief strongly imbedded in the public's mind that Italian Americans are criminally inclined. In a poll of American adults, conducted by the Princeton-based Response Analysis, Inc. several years ago, 74% said they believed most Italian Americans have some association with organized crime. This perception is at odds with the facts: • The U. S. Department of Justice estimates that 5,000 people of all races and ethnic backgrounds are in organized crime today. Even if all 5,000 were Italian American, that would constitute .0025 or one- quarter of one percent of today's 16 million Italian Americans, the nation's fifth largest ethnic group.* *In the U.S. -

Tenebroso Sodalizio.Pdf
cose nostre collana diretta da Salvatore Lupo Comitato scientifico internazionale Presieduto da: Salvatore Lupo (Università di Palermo) Comprende: Jean Louis Briquet (Cnrs Paris), John Dickie (University College of London), Marcella Marmo (Università Federico II di Napoli), Nelson Moe (Columbia University of New York), Salvatore Nicosia (Università di Palermo e Direttore Istituto Gramsci Sicilia), Rocco Sciarrone (Università di Torino), Claudio Torrisi (Direttore Archivio di Stato di Palermo) © 2010 XL edizioni XL edizioni Sas di Stefania Bonura Sede legale e redazione via Urbana 100 - 00184 Roma [email protected] www.xledizioni.com Magazzino Via Pascoli 32 - 47853 Cerasolo Ausa di Coriano (RN) tel +39 0541682186 fax +39 0541683556 Per ordini: [email protected] Pubblicazione realizzata con il contributo dell’Istituto Gramsci Siciliano onlus Traduzione dall’inglese del saggio di John Dickie, Ritratto di questore con mafia, a cura di Manoela Patti Immagine di copertina per gentile concessione di Letterio Pomara © ISBN 978-88-6083-040-1 Salvatore Lupo il tenebroso sodalizio La mafia nel rapporto Sangiorgi Il primo quadro completo della mafia siciliana che sia mai stato delineato nella storia Con una postfazione di John Dickie Xedizioni L Indice Salvatore Lupo - Le carte del questore. La mafia palermitana di fine Ottocento Un Lapsus di Sciascia 5 «Ciò turba la mente della scienza» 13 La mafia e la Sicilia nuova 18 Sostiene Sangiorgi 25 Che cosa (non) è la mafia 33 P.S. 44 Il rapporto Sangiorgi 47 Nota al rapporto Sangiorgi 49 John Dickie - Ritratto di questore con mafia Il «carattere avventato» 163 A sud 166 Fratellanze e fratricidi 168 Sangiorgi questore 173 Indice dei nomi 181 Le carte del questore. -

Mob Rule Vs. Progressive Reform
Bard College Bard Digital Commons Senior Projects Spring 2016 Bard Undergraduate Senior Projects Spring 2016 Mob Rule vs. Progressive Reform Ethan Moon Barness Bard College, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.bard.edu/senproj_s2016 Part of the Political History Commons This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 License. Recommended Citation Barness, Ethan Moon, "Mob Rule vs. Progressive Reform" (2016). Senior Projects Spring 2016. 185. https://digitalcommons.bard.edu/senproj_s2016/185 This Open Access work is protected by copyright and/or related rights. It has been provided to you by Bard College's Stevenson Library with permission from the rights-holder(s). You are free to use this work in any way that is permitted by the copyright and related rights. For other uses you need to obtain permission from the rights- holder(s) directly, unless additional rights are indicated by a Creative Commons license in the record and/or on the work itself. For more information, please contact [email protected]. Mob Rule vs. Progressive Reform The struggle between organized crime, machine politics and the Progressive Reform Movement for control over New York City municipal politics from 19001935 Senior Project submitted to The Division of Social Studies Bard College by Ethan Barness 1 Acknowledgements I would like to thank my Project Advisor Myra Armstead for guiding me through the research process in my senior year at Bard. I would like to thank my mother, my father and my sister as well as all my closest friends and relatives, whose support I greatly appreciate. -

E Tutti Scrissero Sulla Riolenza Tre Temi in Bilico Tra Retorica E Buone Letture Piano Mutui Prima-Casa
MARTEDÌ 6 l'Unità - VITA ITALIANA 18 GIUGNO 1985 Sorpresa all'apertura delle buste delle prove: manca il titolo più atteso Consiglio amministrazione l'Unità convocato per venerdì a Roma Il Consiglio di amministrazione della Editrice l'Unità è convo cato nella sede del giornale — in via dei Taurini, 19 a Roma — per venerdì prossimo, 21 giugno, alle 9.30, per approvare il bilancio 1984. Il Consiglio dovrà inoltre esaminare l'aggiornamento delle previsioni del 1985; gli andamenti economici e diffusionali dei primi cinque mesi dell'anno; valutare le iniziative editoriali in corso; esaminare il prezzo domenicale del quotidiano e decidere Manzoni sulla costituzione della Cooperativa Soci de l'Unità. Rimpatriate dall'Ungheria le TEMI COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI: 1) La violento •• salme di 22 militari italiani ...e tutti scrissero sulla riolenza lacera quotidianamente la società, circonda la nostra vita, coin volge la nostra coscienza, sollecita la nostra riflessione morale, ROMA — Le salme di 22 militari italiani caduti durante la secon culturale, politica. Nella tua esperienza giovanile non avrai da guerra mondiale in Ungheria sono state rimpatriate ieri a Roma Macchinosa e con toni grotteschi la «difesa» del segreto dei temi: presidi pendolari tra questure e scuole - La traccia mancato di interrogarti su questo aspetto drammatico della dal Ministero della Difesa. Questi i loro nomi: aviere Mario Cai via, società del nostro tempo e di maturare personali considerazioni. sottotenente Gaetano Cnnciullo, sottotenente Salvatore Civcllo, sulle figure femminili: preferite le «manzoniane» Ermengarda, Lucia e Gertrude - Oggi il momento della verità sottotenente Giuseppe Corvo, tenente Fedele Covello, soldato 2) Figure femminili nella letteratura italiana dell'età romanti Nello Della Felice, soldato Umberto Delpiano, soldato Antonio Di ca. -

Criminals, Crimes and Cruelty
Contents Contents .....................................................................2 The Undead................................................................20 CHAPTER 1: Introduction.........................................5 Supernatural Creatures ..............................................21 The Forces of Darkness................................................. 5 The Religious Right ....................................................21 The Benefits of Being Evil ............................................ 5 CHAPTER 4: Super Villain Organizations............ 22 Choosing an Evil Name................................................ 5 Locations for your Lair ................................................22 Motives......................................................................... 6 Medieval Castle ..........................................................22 How to do an Evil Laugh............................................... 6 Giant Corporate Tower ...............................................22 Good times to use your evil laugh: ............................... 6 Underground Secret Headquarters of Doom ..............22 CHAPTER 2: Playing Super Villains .......................7 Abandoned Church.....................................................22 Careers for the Evil Doer ............................................... 7 Fake Mountain............................................................22 Criminal Mastermind .................................................... 7 Desert Island ..............................................................22 -

1 the Detective in the Derby by Ercole Joseph Gaudioso She Was
The Detective In The Derby by Ercole Joseph Gaudioso She was the editor of a Virginia magazine. Her phone voice, intelligent and full of Dixie, conjured a vision of Scarlet O’Hara. We finished discussing an article I’d written about two NYPD undercover cops and the conversation turned to my job at the New York State Organized Crime Task Force. Then we spoke about Virginia. “Any jobs for me down there?” I asked, not real seriously, “Any organized crime in your beautiful state that needs investigating?” Quickly, she said, “Oh, I bet. We even have pizza parlors down here now.” No insult intended. Her thoughts had rambled to a place where too many American thoughts ramble. Lots of documented reasons for it – TV and Hollywood, politicians and news media – careless disseminators of information, who fail to inform Scarlet and the rest of us that Italians hold no monopoly on organized crime, or that when Italian organized crime takes a hit, many of the guys with the sleepy eyes, battering rams and handcuffs have names that end in vowels. Off the top of my head: Maddalone, Poccia, Perrotta. DiMarco, Natale, Pizzo, Palmieri. Galasso and Cipullo, the undercovers in that article. And my hero, Lieutenant Giuseppe Petrosino. * Before 1880, the population of Italian immigrants in the United States counted 25,000, according to the U.S. Census Bureau. The area that would become New York City’s biggest Little Italy with 500,000 first and second generation Italians was then populated by an almost unnoticeable number of Italians, nearly all from the north-central area of Italy. -

Contre La Mafia En Sicile : Images Pieuses Médiatiques, Et Réalités
"Révoltes populaires" contre la mafia en Sicile : images pieuses médiatiques, et réalités Fabrice Rizzoli – mai 2008 – [email protected] Toute la presse, unanime a porté aux nues Addiopizzo à Palerme, et fait des courageux com- merçants et industriels locaux des héros. Cependant, la presse non italienne n’évoque jamais les affaires de dirigeants de Confindustria liés à la mafia, ni des policiers ou magistrats condamnés pour activités pro-mafia. La presse, italienne comprise, n’a aucune notion historique de l’Antimafia. L’Antimafia en Sicile est parfois comme le scotch, à double face ! La Sicile est une terre complexe. Il existe des conflits ouverts avec la mafia et des situations plus nuancées1. Contrairement à une idée reçue, Cosa nostra fait traditionnellement de l’Antimafia pour mieux la noyauter. La stratégie des mafieux et de leur complice est caractérisée par la duplicité. A la fin du dix neuvième siècle, le parrain Vito Cascio Ferro appuyait les fasci siciliens, des organisations syndicales luttant contre l’exploitation féodale des terres2. Pendant le fascisme, de nombreux mafieux mais surtout les grands propriétaires se placèrent du côté du régime et dénoncèrent la mafia3. Un politicien peut prendre des positions contre la mafia en public et nous serrer la main le lendemain4. Au début années 2000, Bernardo Provenzano fut interrogé par un de ses lieute- nants sur l’opportunité qu’un chef d’entreprise adhère à une association antimafia. La réponse du « chef des chefs » fut favorable. Plus récemment, le collaborateur de justice Francesco Campanella, a dévoilé « l’antimafia mafieuse ». Il s’agissait de faire croire que la commune de Villabate, dans l’arrière-pays de Palerme, avait déclaré la guerre contre l’illégalité5. -

Sicilian Mafia, Patron Saints, and Religious Processions: the Consistent Face of an Ever-Changing Criminal Organization
Sicilian Mafia, Patron Saints, and Religious Processions: The Consistent Face of an Ever-Changing Criminal Organization Rossella Merlino Ma una festa religiosa, che cosa è una festa religiosa in Sicilia? Sarebbe facile rispondere che è tutto, tranne che una festa religiosa. È, innanzitutto, una esplosione esistenziale. Poiché è soltanto nella festa che il siciliano esce dalla sua condizione di uomo solo. A religious festival, what is a religious festival in Sicily? An easy answer would be that it is everything but a religious festival. It is, above all, an existential explosion, as it is only during religious festivals that Sicilians abandon their state of loneliness. —Leonardo Sciascia1 The altars frequently found in the hideouts of mafiosi and the overt religiosity displayed by mafia bosses in both private and public occasions are but a few of the numerous examples of a relationship between the mafia and religion. These instances represent different aspects of the religious dimension of the Sicilian mafia, Cosa Nostra, facets that are as inextricably related to each other as they are profoundly diverse, thereby making it impossible for this complex phenomenon to be analyzed as one homogeneous whole or through a single disciplinary means. Relying chiefly on socio-anthropological theories of religious rituals and performance, this article adopts an interdisciplinary approach to look at the noticeable role that the mafia plays in local religious festivals. Evidence suggests that the practice of financing, organizing and performing a central role in religious processions in honor of local patron saints has occurred throughout the history of the organization. In this study, a set of instances from different periods and geographical areas of Sicily will be taken into account.