Jean Racine (1639-1699)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Women Characters of Corneille and Racine
MERRILLS THE WOMEN CHARACTERS DF CdRNEILLE AND RACINE FRENCH — B. A. — 19 I 9 THE UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY 191 ^ M 55 The person charging this material is re- sponsible for its return to the library from which it was withdrawn on or before the Latest Date stamped below. Theft, mutilation, and underlining of books are reasons for disciplinary action and may result in dismissal from the University. UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY AT URBANA-CHAMPAIGN BUILDING LSE ONLY BUILDING I SE'ONCV BUILD!! L161 — O-1096 THE WOMEN CHARACTERS OF CORNEILLE AND RACINE BY VIRGINIA MERRILLS THESIS FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN FRENCH COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES UNIVERSITY OF ILLINOIS 1919 M55 UNIVERSITY OF ILLINOIS *SS*...7 191.9... THIS IS TO CERTIFY THAT THE THESIS PREPARED UNDER MY SUPERVISION BY VIRGINIA MERRILLS ENTITLED !™...!!9™! CHARACTERS OF CORNEILLE AND RAOIHE IS APPROVED BY ME AS FULFILLING THIS PART OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF B*™5P.R. 0F..AK?g.. Instructor in Charge Approved : \AdJt-&Jid<^~ a Sc 4«rrV© OF DEPARTMENT ()F/\..^^. ^ .Z~±?^^.f$Z<. * 443959 i CONTENTS Page Introduction ii Chapter I. The Women Characters of Corneille 1 II. The Y/omen Characters of Racine 7 III. Contrasts Between Corneille and Racine 12 Digitized by the Internet Archive in 2014 http://archive.org/details/womencharactersoOOmerr ii INTRODUCTION The purpose of this essay is to discuss briefly the women characters of Corneille and Racine, showing their resemblances and differences. It is beyond the scope of the subject to analyze the plots and purposes of the plays of Corneille and Racine, and hence the reader is expected to be somewhat familiar with the plays which are used as the back- ground of this essay. -

Marins Sous La Coupole
Marins sous la Coupole Le 22 juin 1989 dans son discours d’accueil de Jacques-Yves COUSTEAU à l’Académie française l’académicien Bertrand Poirot-Delpech déclarait : "Vous voilà le septième officier de la Royale à prendre le Quai Conti à l’abordage, après l’amiral d’Estrées en 1715, l’amiral de la Gravière en 1888, Pierre Loti en 1891, Maurice de Broglie en 1934, Claude Farrère en 1935, et, en 1936, l’amiral Lacaze, ministre de la Marine pendant la Grande Guerre, cet amiral un peu coléreux, à qui Henri Mondor, en bon médecin, lança un jour, pour prévenir un coup de sang : « Amiral, attention à vos vaisseaux ! » Il avait omis l’amiral Jean-Baptiste-Henri de VALINCOUR élu en 1699 et il faut rajouter Michel Serres élu académicien en 1990 ce qui porte à neuf le nombre d’officiers de marine "Immortels". http://www.academie-francaise.fr 1699 Jean-Baptiste-Henri de VALINCOUR (1653-1730) Historiographe, amiral Élu en 1699 au fauteuil 13 Prédécesseur : Jean RACINE Successeur : Jean-François LERIGET de LA FAYE Né à Paris, le 1er mars 1653. Secrétaire des commandements du comte de Toulouse, prince du sang et grand amiral, il fut historiographe de France. Écrivain et poète de peu de valeur, il fut l’ami fidèle de Racine et de Boileau : il était dépositaire du manuscrit de la Vie de Louis XIV par Racine ; cette pièce précieuse fut brûlée, en 1726, dans l’incendie qui dévora les sept ou huit mille volumes formant la bibliothèque de Valincour. Élu le 30 mai 1699 en remplacement de Racine, il fut reçu par La Chapelle le 27 juin suivant, et harangua, comme directeur, le roi Louis XV lorsqu’il visita l’Académie le 22 juillet 1719. -

Exoticism and the Jew: Racine's Biblical Tragedies by Stanley F
Exoticism and the Jew: Racine's Biblical Tragedies by Stanley F. Levine pour B. Ponthieu [The Comedie franchise production of Esther (1987) delighted and surprised this spectator by the unexpected power of the play itself as pure theater, by the exotic splendor of the staging, with its magnificent gold and blue decor and the flowing white robes of the Israelite maidens, and most particularly by the insistent Jewish references, some of which seemed strikingly contemporary. That production underlies much of this descussion of the interwoven themes of exoticism and the Jewish character as they are played out in Racine's two final plays.] Although the setting for every Racinian tragedy was spatially or temporally and culturally removed from its audience, the term "exotic" would hardly be applied to most of them. With the exception of Esther and Athalie, they lack the necessary 'local color' which might give them the aura of specificity.1 The abstract Greece of Andromaque or Phedre, for example, pales in comparison with the more circumstantial Roman world of Shakespeare's Julius Caesar and Titus Andronicus, to say nothing of the lavish sensual Oriental Egypt in which Gautier's Roman de la Momie luxuriates. To be sure, there are exotic elements, even in Racine's classical tragedies: heroes of Greco-Roman history and legend, melifluous place and personal names ("la fille de Minos et de Pasiphae"), strange and barbaric customs (human sacrifice in Iphigenie). Despite such features, however, the essence of these plays is ahistorical. Racine's Biblical tragedies present a far different picture. Although they may have more in common 52 STANLEY F. -

The French Romantic Drama and Its Relations with English Literature
THE FRENCH ROMANTIC DRAMA AND ITS RELATIONS WITH ENGLISH LITERATURE I THE CONFLICT BETWEEN THE FRENCH CLASSICAL AND THE SHAKESPEARIAN DRAMA N the days which preceded the Entente Cordiale, the I relations between France and England, as is well known, were on the whole anything but cordial. For generations, almost for centuries, the two nations had stood “hand on hilt” in the words of Kipling, and “ready to strike first”. Few were the subjects on which they could agree, and if by chance they were of one mind, and happened to think that a certain thing was good in itself and its acquisition desir- able, they soon were ready to go to war about it. Their very pastimes failed to provide a ground for mu- tual toleration and understanding. The drama itself became the subject of endless controversy. This can easily be un- derstood. Each nation had early in its history achieved a supremacy of its own in the field of dramatic literature. By the end of the sixteenth century England had Shake- speare; early in the seventeenth century France had the first of her three great dramatists, Corneille, Racine, Moliire, who were soon to place the French stage in a position of ‘A series of three lectures delivered at the Rice Institute on January 29, February 5, and 12, 1928, by Marcel Moraud, AgrCgd de I’UniveraitC de France, Professor of French at the Rice Institute. 75 76 The French Romantic Drama undisputed authority on the continent. Not only was each of the two nations unwilling to surrender its supremacy, but neither could imagine why the dramatists of the other nation should be entitled to any celebrity. -

THE SEVENTEENTH CENTURY PAUL SCOTT, University of Kansas
THE SEVENTEENTH CENTURY PAUL SCOTT, University of Kansas 1. GENERAL Orientalism and discussions of identity and alterity form part of an identifiable trend in our field during the coverage of the two calendar years. Another strong current is the concept of libertinage and its literary and social influence. In terms of the first direction, Nicholas Dew, Orientalism in Louis XlV's France, OUP, 2009, xv+301 pp., publishes an overview of what he terms 'baroque Orientalism' and explores the topos through chapters devoted to the production of texts by d'Herbelot, Bernier, and Thevenot which would have an important reception and influence during the 18th century. The network of the Republic of Letters was crucial in gaining access to and studying oriental works and, while this was a marginal presence during the period, D. reveals how the curiosity of vth-c. scholars would lay the foundations of work that would be drawn on by the philosophes. Duprat, Orient, is an apt complement to Dew's volume, and A. Duprat, 'Le fil et la trame. Motifs orientaux dans les litteratures d'Europe' (9-17) maintains that the depiction of the Orient in European lit. was a common attempt to express certain desires but, at the same time, to contain a general angst as a result of incorporating scientific progress and territorial expansion. Brian Brazeau, Writing a New France, 1604-1632: Empire and Early Modern French Identity, Farnham, Ashgate, 2009, x +132 pp., selects the period following the end of the Wars of Religion because this early period of colonization gave rise to some of the most enthusiastic accounts as well as the fact that they established the pioneering debate for future narratives. -

Programme Bajazet 20/21
BAJAZET Jean Racine Mise en scène Éric Ruf BAJAZET tragédie en cinq actes de Jean Racine Mise en scène Éric Ruf 17 octobre > 15 novembre 2020 durée 2h05 sans entracte Lumière et vidéo Avec Bertrand Couderc Sylvia Bergé Zatime Clotilde de Bayser Roxane Hervé Pierre Acomat Bakary Sangaré Osmin Birane Ba Bajazet Élissa Alloula Atalide Claïna Clavaron Zaïre La Comédie-Française remercie M.A.C COSMETICS et Champagne Barons de Rothschild Réalisation du programme L’avant-scène théâtre LA TROuPE les comédiens de la Troupe présents dans le spectacle sont indiqués par la cocarde Guillaume Gallienne Michel Vuillermoz Elsa Lepoivre Christian Gonon SOCIÉTAIRES Claude Mathieu Véronique Vella Thierry Hancisse Julie Sicard Loïc Corbery Serge Bagdassarian Hervé Pierre Anne Kessler Sylvia Bergé Éric Génovèse Alain Lenglet Bakary Sangaré Pierre Louis-Calixte Christian Hecq Nicolas Lormeau Florence Viala Coraly Zahonero Denis Podalydès Alexandre Pavloff Gilles David Stéphane Varupenne Suliane Brahim Adeline d’Hermy Françoise Gillard Clotilde de Bayser Jérôme Pouly Laurent Stocker Jérémy Lopez Clément Hervieu-Léger Benjamin Lavernhe Sébastien Pouderoux Didier Sandre Christophe Montenez Birane Ba Élissa Alloula Clément Bresson Marina Hands PENSIONNAIRES ARTISTE AUXILIAIRE Nâzim Boudjenah Danièle Lebrun Jennifer Decker Claïna Clavaron COMÉDIENS DE L’ACADÉMIE Laurent Lafitte Noam Morgensztern Claire de La Rüe du Can Anna Cervinka Salomé Benchimol Aksel Carrez Flora Chéreau Rebecca Marder Pauline Clément Dominique Blanc Julien Frison Mickaël Pelissier Camille Seitz -

Bérénice, Tragédie
BÉRÉNICE TRAGÉDIE RACINE, Jean 1671 Publié par Gwénola, Ernest et Paul Fièvre, Septembre 2015 - 1 - - 2 - BÉRÉNICE TRAGÉDIE PAR M. RACINE À PARIS Chez CLAUDE BARBIN, au Palais, sur le second perron de la Sainte-Chapelle. M. DC. LXXI. AVEC PRIVILÈGE DU ROI. - 3 - À Monseigneur COLBERT. SECRÉTAIRE D'ÉTAT, Contrôleur général des finances, Surintendant des bâtiments, grand Trésorier des Ordres du roi, Marquis de Seignelay, etc. MONSEIGNEUR, Quelque juste défiance que j'aie de moi-même et de mes ouvrages, j'ose espérer que vous ne condamnerez pas la liberté que je prends de vous dédier cette tragédie. Vous ne l'avez pas jugée tout à fait indigne de votre approbation. Mais ce qui fait son plus grand mérite auprès de vous, c'est, MONSEIGNEUR, que vous avez été témoin du bonheur qu'elle a eu de ne pas déplaire à Sa Majesté. L'on sait que les moindres choses vous deviennent considérables, pour peu qu'elles puissent servir ou à sa gloire ou à son plaisir. Et c'est ce qui fait qu'au milieu de tant d'importantes occupations, où le zèle de votre prince et le bien public vous tiennent continuellement attaché, vous ne dédaignez pas quelquefois de descendre jusqu'à nous, pour nous demander compte de notre loisir. J'aurais ici une belle occasion de m'étendre sur vos louanges, si vous me permettiez de vous louer. Et que ne dirais-je point de tant de rares qualités qui vous ont attiré l'admiration de toute la France, de cette pénétration à laquelle rien n'échappe, de cet esprit vaste qui embrasse, qui exécute tout à la fois tant de grandes choses, de cette âme que rien n'étonne, que rien ne fatigue ? Mais, MONSEIGNEUR, il faut être plus retenu à vous parler de vous-même et je craindrais de m'exposer, par un éloge importun, à vous faire repentir de l'attention favorable dont vous m'avez honoré ; il vaut mieux que je songe à la mériter par quelques nouveaux ouvrages : aussi bien c'est le plus agréable remerciement qu'on vous puisse faire. -
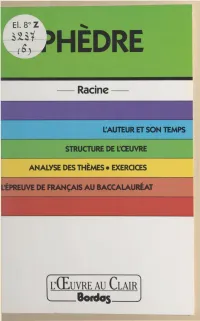
Phèdre, Racine
PHEDRE Racine par Christian GAMBOTTI Ancien élève de l'E.N.S. de Saint-Cloud Agrégé de Lettres modernes L'ŒUVRE AU CLAIR Bordas Maquette de couverture : Michel Méline. Maquette intérieure : Jean-Louis Couturier. Document de la page 3 : portrait de Racine, gravure de Edelinck, XVIIe siècle. Musée Carnavalet, Paris. Ph. © Bulloz-Archives Photeb. "Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur, ou de ses ayants-droit, ou ayants-cause, est illicite (loi du 11 mars 1957, alinéa le' de l'article 40) Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait une contrefaçon sanction- née par les articles 425 et suivants du Code pénal. La loi du 1 1 mars 1957 n'autorise, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, que les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective d'une part, et d'autre part, que les analyses et les courtes cita- tions dans un but d'exemple et d'illustration" @ Bordas, Paris, 1989. ISBN 2-04-018278-0 ISSN 0993-6297 RACINE 1639 - 1699 DRAMATURGE 1677 - Phèdre de 1664 à 1691 - Onze tragédies 1668 - Une comédie Les Plaideurs La faiblesse aux humains n'est que trop naturelle. (Racine, Phèdre, Acte IV, scène 6). Racine ET SON TEMPS Points de repère M Racine est un dramaturge du XVIIe siècle, auteur essentiellement de tragédies*. Son œuvre théâtrale ne comprend que douze pièces, ce qui est peu par rapport à Corneille (33 pièces) ou Molière (34 pièces). -

On the Passions of Kings: Tragic Transgressors of the Sovereign's
ON THE PASSIONS OF KINGS: TRAGIC TRANSGRESSORS OF THE SOVEREIGN’S DOUBLE BODY IN SEVENTEENTH-CENTURY FRENCH THEATRE by POLLY THOMPSON MANGERSON (Under the Direction of Francis B. Assaf) ABSTRACT This dissertation seeks to examine the importance of the concept of sovereignty in seventeenth-century Baroque and Classical theatre through an analysis of six representations of the “passionate king” in the tragedies of Théophile de Viau, Tristan L’Hermite, Pierre Corneille, and Jean Racine. The literary analyses are preceded by critical summaries of four theoretical texts from the sixteenth and seventeenth centuries in order to establish a politically relevant definition of sovereignty during the French absolutist monarchy. These treatises imply that a king possesses a double body: physical and political. The physical body is mortal, imperfect, and subject to passions, whereas the political body is synonymous with the law and thus cannot die. In order to reign as a true sovereign, an absolute monarch must reject the passions of his physical body and act in accordance with his political body. The theory of the sovereign’s double body provides the foundation for the subsequent literary study of tragic drama, and specifically of king-characters who fail to fulfill their responsibilities as sovereigns by submitting to their human passions. This juxtaposition of political theory with dramatic literature demonstrates how the king-character’s transgressions against his political body contribute to the tragic aspect of the plays, and thereby to the -

Fiche Pédagogique-Britannicus
Fiche pédagogique BRITANNICUS de Jean Racine mise en scène de Jean-Louis Martinelli Du vendredi 14 septembre au samedi 27 octobre 2012 Théâtre Nanterre-Amandiers – Salle transformable Contacts scolaires Aline Joyon T 01 46 14 70 61 [email protected] ______ horaires du mardi au samedi à 20h30, dimanche à 15h30 ( relâche lundi) Les jeudis à 19h30 ________ Théâtre Nanterre-Amandiers 7, avenue Pablo-Picasso 92022 Nanterre RER Nanterre-Préfecture (ligne A) Navette assurée par le théâtre avant et après les représentations www.nanterre-amandiers.com 1 Britannicus De Jean Racine Mise en scène Jean-Louis Martinelli Scénographie Gilles Taschet Lumière Jean-Marc Skatchko Costumes Ursula Patzak Coiffures, maquillages Françoise Chaumayrac Assistante à la mise en scène Amélie Wendling Avec Agrippine Anne Benoît Britannicus Éric Caruso Néron Alain Fromager Narcisse Grégoire Œstermann Albine Agathe Rouiller Junie Anne Suarez Burrhus Jean-Marie Winling Production : Théâtre Nanterre-Amandiers Le texte Britannicus est publié aux éditions Gallimard, collection La Pléiade. Durée : 2h10 2 Jean Racine, auteur Jean Racine (1639-1699) a reçu une formation janséniste au monastère de Port-Royal, une institution exemplaire qui se distinguait par la qualité et la « modernité » de son enseignement. Il est l’un des rares grands écrivains du XVII eme siècle à pouvoir lire dans le texte original les auteurs tragiques grecs. Il fait ses débuts littéraires en composant des poèmes classiques d’inspiration profane. En 1667, il crée Andromaque qui remporte un vif succès. Pendant les dix années qui suivent, Racine écrit ses chefs-d’œuvre les plus connus. En 1669, il met en scène Britannicus , une tragédie politique romaine sur les jeux et enjeux liés à la quête du pouvoir (tyrannique). -

Tragedy Syllabus
ENG 339 Tragedy T/Th 11:30am-12:50pm Merrill 403 Instructor: Professor Daniel Sack Office: Johnson Chapel, Room 30C Hours: Tuesday 1-3pm (and by appointment) Contact: [email protected] Course Description A survey of some of the many lives and deaths of tragedy as a theatrical form, this course considers representative plays in the genre from its origins in Ancient Greece through to the crisis of the form in the 20th and 21st century. This is not a seminar in Classics; it is an investigation of a genre as a mode of thought and artistic production. However, all tragedy to follow revolves around the initial statements in the Classical period, so we will ground our discussions here. Signal moments in other times and traditions inform subsequent readings, but our primary focus will be upon the way in which modern and contemporary artists in the English language have revised, rehearsed, and rejected the oldest genre of Western theatrical production. One could certainly speak of a broader tragic vision or sensibility extending into other forms of artistic production (novels and films, for eXample) or even into everyday life as in the newscaster’s daily lament about whatever catastrophe or downfall. In this course we are concerned with how tragedy is performed in the theatre and what its location there promises for its audiences. In addition to the plays we read, theory and philosophy on the nature of the tragic will help guide our conversation. Performance thinks differently than literature, differently than philosophy. Play scripts presuppose a staged performance and represent but one facet of a larger artistic whole, so too our readings of plays and theory will always refer to what is possible or expected upon the stage. -

Extrait De La Publication Extrait De La Publication
Extrait de la publication Extrait de la publication Extrait de la publication BRITANNICUS Du même auteur dans la même collection BAJAZET. BÉRÉNICE (édition avec dossier). BRITANNICUS. IPHIGÉNIE (édition avec dossier). PHÈDRE (édition avec dossier). LES PLAIDEURS (édition avec dossier). THÉÂTRE I : LA THÉBAÏDE. ALEXANDRE LE GRAND. ANDRO- MAQUE. LES PLAIDEURS. BRITANNICUS. BÉRÉNICE. THÉÂTRE II : BAJAZET. MITHRIDATE. IPHIGÉNIE. PHÈDRE. ESTHER. ATHALIE. Extrait de la publication RACINE BRITANNICUS Édition de Jacques MOREL GF Flammarion Extrait de la publication © 2010, Flammarion, Paris, pour cette édition. ISBN : 978-2-0812-3804-6 Extrait de la publication INTERVIEW « François Taillandier, pourquoi aimez-vous Britannicus ?» arce que la littérature d’aujourd’hui se nourrit de celle d’hier, la GF a interrogé des écrivains contem- Pporains sur leur « classique » préféré. À travers l’évocation intime de leurs souvenirs et de leur expérience de lecture, ils nous font partager leur amour des lettres, et nous laissent entrevoir ce que la littérature leur a apporté. Ce qu’elle peut apporter à chacun de nous, au quotidien. François Taillandier est romancier et essayiste, auteur notamment de la suite romanesque La Grande Intrigue (Stock, 5 volumes) et de La Langue française au défi (Flammarion). Il a accepté de nous parler de Britannicus de Racine, et nous l’en remercions. Extrait de la publication II INTERVIEW Quand avez-vous découvert cette pièce pour la première fois? Racontez-nous les circonstances de cette découverte. C’est très banal : la pièce était au programme de la seconde. L’année précédente, nous avions déjà étudié Andromaque. On en expliquait des scènes en classe, et on devait aussi en apprendre des extraits par cœur.