Claudel Pour Racine, Les Raisons D'un Revirement
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Marins Sous La Coupole
Marins sous la Coupole Le 22 juin 1989 dans son discours d’accueil de Jacques-Yves COUSTEAU à l’Académie française l’académicien Bertrand Poirot-Delpech déclarait : "Vous voilà le septième officier de la Royale à prendre le Quai Conti à l’abordage, après l’amiral d’Estrées en 1715, l’amiral de la Gravière en 1888, Pierre Loti en 1891, Maurice de Broglie en 1934, Claude Farrère en 1935, et, en 1936, l’amiral Lacaze, ministre de la Marine pendant la Grande Guerre, cet amiral un peu coléreux, à qui Henri Mondor, en bon médecin, lança un jour, pour prévenir un coup de sang : « Amiral, attention à vos vaisseaux ! » Il avait omis l’amiral Jean-Baptiste-Henri de VALINCOUR élu en 1699 et il faut rajouter Michel Serres élu académicien en 1990 ce qui porte à neuf le nombre d’officiers de marine "Immortels". http://www.academie-francaise.fr 1699 Jean-Baptiste-Henri de VALINCOUR (1653-1730) Historiographe, amiral Élu en 1699 au fauteuil 13 Prédécesseur : Jean RACINE Successeur : Jean-François LERIGET de LA FAYE Né à Paris, le 1er mars 1653. Secrétaire des commandements du comte de Toulouse, prince du sang et grand amiral, il fut historiographe de France. Écrivain et poète de peu de valeur, il fut l’ami fidèle de Racine et de Boileau : il était dépositaire du manuscrit de la Vie de Louis XIV par Racine ; cette pièce précieuse fut brûlée, en 1726, dans l’incendie qui dévora les sept ou huit mille volumes formant la bibliothèque de Valincour. Élu le 30 mai 1699 en remplacement de Racine, il fut reçu par La Chapelle le 27 juin suivant, et harangua, comme directeur, le roi Louis XV lorsqu’il visita l’Académie le 22 juillet 1719. -

French Catholicism's First World War
University of Pennsylvania ScholarlyCommons Publicly Accessible Penn Dissertations 2016 Calvary Or Catastrophe? French Catholicism's First World War Arabella Leonie Hobbs University of Pennsylvania, [email protected] Follow this and additional works at: https://repository.upenn.edu/edissertations Part of the European History Commons, Other Languages, Societies, and Cultures Commons, and the Religion Commons Recommended Citation Hobbs, Arabella Leonie, "Calvary Or Catastrophe? French Catholicism's First World War" (2016). Publicly Accessible Penn Dissertations. 2341. https://repository.upenn.edu/edissertations/2341 This paper is posted at ScholarlyCommons. https://repository.upenn.edu/edissertations/2341 For more information, please contact [email protected]. Calvary Or Catastrophe? French Catholicism's First World War Abstract CALVARY OR CATASTROPHE? FRENCH CATHOLICISM’S FIRST WORLD WAR Arabella L. Hobbs Professor Gerald Prince The battlefield crucifixes that lined the Western Front powerfully connected industrialized warfare with the Christian past. This elision of the bloody corporeality of the crucifixion with the bodily suffering wrought by industrial warfare forged a connection between religious belief and modern reality that lies at the heart of my dissertation. Through the poignancy of Christ’s suffering, French Catholics found an explanatory tool for the devastation of the Great War, affirming that the blood of ther F ench dead would soon blossom in rich harvest. This dissertation argues that the story of French Catholicism and the Great War uncovers a complex and often dissonant understanding of the conflict that has become obscured in the uniform narrative of disillusionment and vain sacrifice ot emerge in the last century. Considering the thought to emerge from the French renouveau catholique from 1910 up to 1920, I argue that far from symbolizing the modernist era of nihilism, the war in fact created meaning in a world that had lost touch with its God. -

Tragedy Syllabus
ENG 339 Tragedy T/Th 11:30am-12:50pm Merrill 403 Instructor: Professor Daniel Sack Office: Johnson Chapel, Room 30C Hours: Tuesday 1-3pm (and by appointment) Contact: [email protected] Course Description A survey of some of the many lives and deaths of tragedy as a theatrical form, this course considers representative plays in the genre from its origins in Ancient Greece through to the crisis of the form in the 20th and 21st century. This is not a seminar in Classics; it is an investigation of a genre as a mode of thought and artistic production. However, all tragedy to follow revolves around the initial statements in the Classical period, so we will ground our discussions here. Signal moments in other times and traditions inform subsequent readings, but our primary focus will be upon the way in which modern and contemporary artists in the English language have revised, rehearsed, and rejected the oldest genre of Western theatrical production. One could certainly speak of a broader tragic vision or sensibility extending into other forms of artistic production (novels and films, for eXample) or even into everyday life as in the newscaster’s daily lament about whatever catastrophe or downfall. In this course we are concerned with how tragedy is performed in the theatre and what its location there promises for its audiences. In addition to the plays we read, theory and philosophy on the nature of the tragic will help guide our conversation. Performance thinks differently than literature, differently than philosophy. Play scripts presuppose a staged performance and represent but one facet of a larger artistic whole, so too our readings of plays and theory will always refer to what is possible or expected upon the stage. -

Jean Racine (1639-1699)
Jean Racine (1639-1699) Biographie ean Racine (22 décembre 1639 à 21 avril 1699) naquit à la Ferté Milon, dans l'Aisne. Issu d'un milieu bourgeois plutôt, il fut orphelin de mère à 2 ans et de père à 4 ans. Il fut alors J (1643) recueilli par ses grands-parents maternels. Les relations avec l'abbaye janséniste de Port-Royal imprégnèrent toute la vie de Racine. Il y subit l'influence profonde des «solitaires» et de leur doctrine exigeante. L'une de ses tantes y fut religieuse ; sa grand-mère s'y retint à la mort de son mari (1649). L'enfant fut alors admis aux Petites Écoles à titre gracieux. Deux séjours dans des collèges complétèrent sa formation : le collège de Beauvais (1653-1654) et le collège d'Harcourt, à Paris, où il fit sa philosophie (1658). À 20 ans, nantis d'une formation solide mais démuni de biens, Racine fut introduit dans le monde par son cousin Nicolas Vitart (1624-1683), intendant du duc de Luynes. Il noua ses premières relations littéraires (La Fontaine) et donna ses premiers essais poétiques. En 1660, son ode la Nymphe de la Seine à la Reine, composée à l'occasion du mariage de Louis XIV, retint l'attention de Charles Perrault. Mais, pour assurer sa subsistance, il entreprit de rechercher un bénéfice ecclésiastique et séjourna à Uzès (1661-1663) auprès de son oncle, le vicaire général Antoine Sconin. Rentré à Paris en 1663, il se lança dans la carrière des lettres. 140101 Bibliotheca Alexandrina Établi par Alaa Mahmoud, Mahi Rabie et Salma Hamza Rejetant la morale austère de Port-Royal et soucieux de considération mondaine et de gloire officielle, Racine s'orienta d'abord vers la poésie de cour : une maladie que contracta Louis XIV lui inspira une Ode sur la convalescence du Roi (1663). -

Mise En Page 1
COUV_23_04_2013_Mise en page 1 05/04/13 12:07 Page1 ANACREON LEON-PAUL FARGUE HENRI MICHAUX MONIQUE APPLE GUSTAVE FLAUBERT OCTAVE MIRBEAU APOLLINAIRE JEAN FOLLAIN MOLIERE LOUIS ARAGON ALBERT GABRIEL ADRIENNE MONNIER ANTONIN ARTAUD EDOUARD GARNIER MONTESQUIEU LEON AZEMA CHARLES DE GAULLE ANATOLE DE MONZIE ALY BEY BAHGAT THEOPHILE GAUTIER PAUL MORAND P. F. BAILLY GEORGES GIACOMETTI ALBERTO MORAVIA JACQUES BAINVILLE ANDRE GIDE BRUCE MORISSETTE THEODORE DE BANVILLE BJIEBANL GIIOONOTHÈQUELEON MOUSSINAC SAMUEL BECKETT JEAN GIRAUDOUX ALFRED DE MUSSET P. A. BENOIT REMY DE GOURMONT ANTONII NERI BERR DE TURIQUDE E MOANNDRSEI GERAUNETR PAUL LCHÉAROLESN NODIER RENE BERTELE GŒTHE PAUL NOUGE PIERRE BETTENCOURT JEULTIEN GÀRE EDN IVERS OVIDE ANDRE BILLY JACQUES GRUBER JEAN D’ORMESSSON LEON BLOY LOUIS HAUTECŒUR PIERRE PATOUT BOCCACE PAUL HELBRONNER BENJAMIN PERET NICOLAS BOILEAU RENE HERBST ROGER PEYREFITTE JULES BOISSIERE LOUISE HERVIEU PABLO PICASSO BONAPARTE MICHEL HOOG ANTOINE DE PLUVINEL GEORGES BONTEMPS J.-K. HUYSMANS DOIGNY DU PONCEAU GEORGES BRAQUE MAX JACOB JACQUES PREVERT ARNO BREKER LEMAU DE LA JAISSE GREGORIO PRIETO ANDRE BRETON PAUL JAMOT SERGE PROKOFIEFF BUFFON ALFRED JARRY MARCEL PROUST BUSSY-RABUTIN OWEN JONES QUINTE-CURCE. ALBERT CAMUS PIERRE JEAN JOUVE JEAN RACINE EUGENE CANSELIET JOSEPH KESSEL YVANHOE RAMBOSSON LEWIS CARROLL ALEXANDRE KOYRE RESTIF DE LA BRETONNE LOUIS-FRANCOIS CASSAS LA BRUYERE CHARLES REVEL COMTE DE CAYLUS JACQUES LACAN ARTHUR RIMBAUD CERVANTES CHODERLOS DE LACLOS SERGE ROCHE CHAMFORT LOUIS LAPRADE GEORGES RODENBACH PIERRE CHAREAU VALERY LARBAUD JULES ROMAINS CHATEAUBRIAND PATRICE DE LA TOUR DU PIN MAURICE ROSTAND ABBE DE CHOISY MARIE LAURENCIN ALEXANDRE ROSS JEAN BAPTISTE CHRISTYN LEON LE CLERC JEAN-JACQUES ROUSSEAU PAUL CLAUDEL PIERRE LEFEVRE SAINTE BEUVE JEAN COCTEAU FREDERIC LEFEVRE SAINT EVREMOND COLETTE FERNAND LEGER FAUJAS DE SAINT FOND PIERRE CORNEILLE PAUL-ANDRE LEMOISNE SAINT-JUST FRANÇOIS. -

Three Different Jocastas by Racine, Cocteau and Cixous
University of Central Florida STARS Electronic Theses and Dissertations, 2004-2019 2010 Three Different Jocastas By Racine, Cocteau And Cixous Kyung Mee Joo University of Central Florida Part of the Theatre and Performance Studies Commons Find similar works at: https://stars.library.ucf.edu/etd University of Central Florida Libraries http://library.ucf.edu This Masters Thesis (Open Access) is brought to you for free and open access by STARS. It has been accepted for inclusion in Electronic Theses and Dissertations, 2004-2019 by an authorized administrator of STARS. For more information, please contact [email protected]. STARS Citation Joo, Kyung Mee, "Three Different Jocastas By Racine, Cocteau And Cixous" (2010). Electronic Theses and Dissertations, 2004-2019. 1623. https://stars.library.ucf.edu/etd/1623 THREE DIFFERENT JOCASTAS BY RACINE, COCTEAU, AND CIXOUS by KYUNG MEE JOO A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in the Department of Theatre in the College of Arts and Humanities at the University of Central Florida Orlando, Florida Fall Term 2010 Major Professor: Julia Listengarten ©2010 Kyung Mee Joo ii ABSTRACT This study is about three French plays in which Jocasta, the mother and wife of Oedipus, is shared as a main character: La Thébaïde (The Theban Brothers) by Jean Racine, La Machine Infernale (The Infernal Machine) by Jean Cocteau, and Le Nom d’Oedipe (The Name of Oedipus) by Hélène Cixous. Jocasta has always been overshadowed by the tragic destiny of Oedipus since the onset of Sophocles’ works. Although these three plays commonly focus on describing the character of Jocasta, there are some remarkable differences among them in terms of theme, style, and stage directions. -
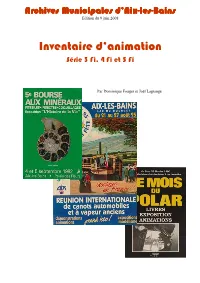
Affiches Animation Correction3
Archives MunicipaleMunicipaless d’Aixd’Aix----lesleslesles----BainsBains 0Archives MunicipalesEdition du 9 juin 2008 d’Aixd’Aix- ---lesleslesles----BainsBains Edition du 9 juin 2008 Inventaire d’animation Série 3 Fi, 4 Fi et 5 Fi Par Dominique Fouger et Joël Lagrange Archives municipales d'Aix-les-Bains - 2, rue Lamartine, 73100 Aix-les-Bains - Tél 04.79.61.40.84 Mél : [email protected] Archives Municipales d’Aixd’Aix----lesleslesles----BainsBains Edition du 9 juin 2008 Introduction Ce catalogue rassemble les inventaires de trois sous séries d’affiches se rapportant à l’animation ou aux manifestations culturelles ayant eut lieu à Aix-les-Bains. La sous série 5 Fi provient d’un versement ancien de l’Office du tourisme est close. En revanche, les deux autres sous séries, 3 et 4 Fi, sont alimentées régulièrement soit par l’Office du Tourisme, soit par d’autres canaux. Elles sont scindées uniquement en fonction de leur taille, la série 3 Fi comprenant les affiches de grande taille (sup. à 120 x 180 cm) qui sont conservées roulées, les autres étant à plat dans des meubles à plans. Bien qu’en consultation ces affiches sont parfois difficilement manipulables à cause de leur taille. Outre ce catalogue, répertoire numérique des trois sous séries agrémenté d’un index en tête, une base de données informatique est accessible aux Archives qui facilite les recherches thématiques. Cette base de données à l’avantage d’être mise à jour en permanence. 1 Archives Municipales d’Aixd’Aix----lesleslesles----BainsBains Edition du 9 juin 2008 Table des -

Le « Parlé-Chanté » Dans Phèdre De Jean Racine Et Partage De Midi De Paul Claudel
Quêtes litt éraires nº 6, 2016 Marine Deregnoncourt Université Catholique de Louvain Louvain-la-Neuve Le « parlé-chanté » dans Phèdre de Jean Racine et Partage de midi de Paul Claudel Introduction Les Anciens [...] distinguaient trois sortes de chants, qu’ils nommaient voix continue quand on parle, voix intermédiaire, quand on lit des vers héroïques ou quand on déclame, voix séparée par des intervalles, quand on chante, ce qui s’appelle encore unité mélodique (Tack, 2001 : 111). Comment la forme hybride du « parlé-chanté » apparaît-elle spécifiquement dans Phèdre de Jean Racine et Partage de midi de Paul Claudel ? Telle est la problématique que nous nous proposons d’aborder dans cet article. Pour ce faire, notre réflexion se divisera en trois parties. Tout d’abord, il s’agira, dans la première partie, de définir ce qu’il faut précisément entendre par le « parlé-chanté ». À quoi cette notion renvoie-t-elle précisément et est-elle liée au Sprechgesang schön- bergien ? Tandis que la deuxième partie concernera Phèdre de Jean Racine, la troi- sième et dernière partie se focalisera sur Partage de midi de Paul Claudel. Comment les protagonistes de la tragédie racinienne et du drame claudélien se trouvent-ils à la lisière du parlé et chanté ? Comment ces deux dramaturges se positionnent-ils face aux discours de leur temps ? Telles sont les questions que nous nous posons et auxquelles nous allons tenter de répondre. Marine Deregnoncourt – candidate à l’École Doctorale en Langues et Lettres de l’Université Catholique de Louvain. Adresse pour correspondance : B. – Place Blaise Pascal, 1, 1348 Louvain-la Neuve (Belgique) ; e-mail : [email protected] 46 Marine Deregnoncourt 1. -

Z:\My Documents Folder from Old Machine\Communio Files\Issues by Date\2007 Spring the Kingdom of God\08. DCS Claudel\Dcsclaudel
WHY WE NEED PAUL CLAUDEL • D. C. Schindler • “If the poet thus stands ‘before the Cross,’ as the title of one of his books has it, the mystery upon which he meditates is not just one possibility of many, but is in fact the sole mystery that allows him to celebrate the universe in its totality, which means the mystery that allows him truly to be a poet, as Claudel understands the vocation.” According to Paul Claudel, there are three qualities that a poet must possess in order to stand among the world’s greatest: inspiration, intelligence, and “catholicity.”1 By this last term, which would no doubt surprise the average literary critic, Claudel intends the quality exhibited by those poets who “have received from God such vast things to express that nothing less than the entire world is adequate for their work. Their creation is an image and a vision of creation as a whole, of which their inferior brothers offer only particular aspects.”2 If a poet’s significance tends to be as broad as his vision, then a “catholic” poet, as Claudel understands him, would be one who speaks not only to his own country and age, but in some sense to humanity. To use Thornton Wilder’s term, we might call an artist of this scope a “world poet.” 1Paul Claudel, “Introduction à un poème sur Dante,” in Positions et propositions (Paris: Gallimard, 1928), 161–164. For an English translation, see “Religion and the Artist: Introduction to a Poem on Dante,” Communio: International Catholic Review 22, no. -

Catalogue of the Hartley Collection Compiled by Elizabeth Guilford
The Hartley Collection Catalogue Compiled by Elizabeth Guilford A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A ABOUT, Edmond Les Mariages de Paris. Par Edmond About. Introduction par Emile Faguet (de l'Académie française). Paris : Nelson, Éditeurs, [n.d.]. (Collection Nelson) 12mo, 12, [iv], 351pp, coloured frontispiece. Bound in cloth with decorated front cover, spine and endpapers. ABOUT, Edmond Le nez d'un notaire, roman [par] Edmond About. Illustrations de Henri Dimpre. Paris : Librairie Gründ, c1947. (Série coquelicot, romans classiques français) 12mo, 188pp and Table des Matières, illustrated. Bound in cloth. ABOUT, Edmond Le roman d'un brave homme [par] Edmond About. Illustrations de Jean Reschofsky. [Paris] : Hachette, c1935. 12mo, 288pp, illustrated. Bound in cloth. ACHARD, Amédée La Toison d'or par Amédée Achard. 1 Paris : Nelson, Éditeurs, 1951. (Collection Nelson) 12mo, 375pp. Bound in cloth. ALAIN-FOURNIER, 1886-1914. Le Grand Meaulnes [par] Alain-Fournier. Paris : Éditions Émile-Paul Frères, c1913. 12mo, 328pp. Bound in cloth. Annotated in part. ALAIN-FOURNIER, 1886-1914. Le grand meaulnes [par] Alain-Fournier. [Nouvelle édition] Paris : Éditions Émile-Paul, c1913. 12mo, 318pp and Table des Matières. Paper covers. Les Animaux dans la légende, dans la science, dans l'art dans le travail : leur utilisation & leur exploitation par l'homme. Ouvrage publié avec la Collaboration de MM Le Lieutenant Chollet [et les autres]. Paris : Maison d' Édition Bong & Cie, [n.d.]. 2 vols. 4to, illustrated, many coloured and some folded. Bound in woollen cloth with illustration, gold decoration on cover and spine and marbled endpapers. -

French Literature
French Literature Companions to Literature The following companions and guides will provide valuable insights into French literature. The Oxford companion to French literature 840.3 OXF A short history of French literature 840.9 BRE The Concise Oxford dictionary of French literature 840.3 CON The new Oxford companion to literature in French 840.3 NEW Guide to modern world literature / Vol.2, [includes French literature] 809.04 SEY A guide to contemporary French literature: from Valery to Sartre. 840.90091 FOW La littérature française du 20e siècle by S. Jouanny 842.91 JOU Poetry French poetry can be found at class mark 841. We have works by Aragon, Guillaume Apollinaire, Baudelaire, André Breton, George Brassens, Aimé Césaire, René Char, Edouard Glissant, Michel Houellebecq, Victor Hugo, Abdelkébir Khatibi, Laforgue, Lapaque, Lautréamont, Mallarmé, Michaux, Francis Ponge, Jacque Prévert, Renaud, Rimbaud, Léopold Sédar Senghor, Boris Vian, Verlaine, as well as anthologies of material such as Laurent and Nepveu’s La poésie Québécoise, and Poètes francais des XIXe et XXe siècles. For critical studies of French poetry see Bloom, H. (ed) (1990) French poetry: the Renaissance through 1915 and Verdier, L. (2001) Introduction à la poésie modern et contemporaine. Drama Plays written in French can be found at class mark 842. We have works by Jean Anouilh, Samuel Beckett, Albert Camus, Aimé Césaire, Paul Claudel, Marguerite Duras, Jean Genet, Michel de Ghelderode, Jean Giraudoux, Jean-Claude Grumberg, Eugene Ionesco, Alfred Jarry, Bernard-Marie Koltès, Eugene Labiche, George Feydeau, Marivaux, Moliére, René de Obaldia, André Obey, Jean Racine, Jean-Paul Sartre, Nathalie Sarraute, Jean Tardieu, Michel Tremblay and Michel Vinaver. -

Fron Barnard College
COLLECTION^ OF CORRESPONDENCE .iKD :IAWUSCRIPT UCCUTTSMTS N..F1S OF COLLECTION: Marguerite Hespoulet Papers SOURCE: Fron Barnard College SUBJECT: Contemporary French literature DATES COVERED; ca. 1925-1964 NUMBER OF ITEMS: ca. 13,000 STATUS: (check appropriate description) Cataloged: X Listed: Arrangedt X Not orgnnized: CONDITION: (give number of vols., boxos, or shelves) Bound: Boxod: 138 Stored: LOCATION: (Library) Special Collections CALL-NUVP3R Spec Ms Coll Mespoulet RESTRICTIONS 01! J^SE Cannot be used except with the permission of the French Department of Barnard College, APPLY FOR PERMISSION TO THE CURRENT CHAIR OF THE Barnard French Department OR to Professor Emeriti Tatiana Greene 3^Q fi^e^^ck Pr/y< Ao* //CjV~A/V /oQ2S DESCRIPTION: Correspondence, notes, lectures, and clippings of Marguerite Mespoulet, Professor of French at 3arnard College, relating to her work and •writings on French literature of the nineteenth and twentieth centuries, T-iith special emphasis on Charles Baudelaire, Paul Claudel, and Max Jacob. There are 11 letters and one manuscript, "Partage de rnidi" of Paul Claudel, 6 letters and 7 manuscripts of Max Jacob, and 7 letters of Pierre Reverdy. Tor a list of the collection see 'following pages. DESCRIPTION-INDEX OF TiE PAPERS LEFT BY PROFESSOR MARGUERITE MSSPOULET, d. Jan. 2, 1965, New York. (Professor Emeritus, French Department, Barnard College; Professor Columbia University.- Property Barnard College). In SPECIAL COLLECTIONS, COLUMBIA UNIVERSE*. " . Call number l [ ' ^[^^^ <\^(k \ ^ h'1^^^1 '.'••. :-\.n. • '--.---M 1 Shoe box marked "Chambre double-Le Re"ve pur" - much on Dante and Petrarch. Extremely interesting. 2. Shoe box.marked "Fsnfarlo -Curiosit*s est etiques -Art Romantique'*- notes, excerpts.