L'autel De Saintes Et Les Triades Gauloises
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Exclusively Made Barn 14 Hip No. 1
Consigned by Tres Potrillos, Agent Barn Hip No. 14 Exclusively Made 1 Gone West Elusive Quality.................. Touch of Greatness Exclusive Quality .............. Glitterman Exclusively Made First Glimmer.................... Bay Filly; First Stand March 8, 2011 Danzig Furiously........................... Whirl Series Mad About Julie ............... (1999) Restless Restless Restless Julie.................... Witches Alibhai By EXCLUSIVE QUALITY (2003). Black-type winner of $92,600, Spectacular Bid S. [L] (GP, $45,000). Sire of 3 crops of racing age, 166 foals, 94 start- ers, 59 winners of 116 races and earning $2,727,453, including Sr. Quisqueyano ($319,950, Calder Derby (CRC, $150,350), etc.), Exclusive- ly Maria ($100,208, Cassidy S. (CRC, $60,000), etc.), Boy of Summer ($89,010, Journeyman Stud Sophomore Turf S.-R (TAM, $45,000)), black- type-placed Quality Lass ($158,055), Backstage Magic ($128,540). 1st dam MAD ABOUT JULIE, by Furiously. Winner at 3 and 4, $33,137. Dam of 4 other registered foals, 4 of racing age, 2 to race, 2 winners, including-- Jeongsang Party (f. by Exclusive Quality). Winner at 2, placed at 3, 2013 in Republic of Korea. 2nd dam Restless Julie, by Restless Restless. 2 wins at 2, $30,074, 2nd American Beauty S., etc. Dam of 11 other foals, 10 to race, all winners, including-- RESTING MOTEL (c. by Bates Motel). 8 wins at 2 and 3 in Mexico, cham- pion sprinter, Clasico Beduino, Handicap Cristobal Colon, Clasico Velo- cidad; winner at 4, $46,873, in N.A./U.S. PRESUMED INNOCENT (f. by Shuailaan). 7 wins, 3 to 6, $315,190, Jersey Lilly S. (HOU, $30,000), 2nd A.P. -

El Culto a Victoria Y La Interpretatio Indígena En El Occidente De Hispania, Galia Y El Norte De Britania
olteanu teodora6:BSSA 05/06/2009 12:48 Página 197 EL CULTO A VICTORIA Y LA INTERPRETATIO INDÍGENA EN EL OCCIDENTE DE HISPANIA, GALIA Y EL NORTE DE BRITANIA The Cult of Victoria and its Interpretation by Native People in Western Iberia, Gallia, and Northern Britannia TEODORA OLTEANU* Resumen: El estudio de datos epigráficos y arqueológicos relativos a tres zonas diferentes del Occidente del Imperio Romano nos permite proponer una nueva visión sobre el culto a la diosa romana Victoria y su interpretatio indígena. Hay una estrecha relación entre su culto y los cultos lo- cales a divinidades con atributos parecidos: Trebaruna en Lusitania, Brigantia en Britania y An- darta en Galia. Palabras clave: Victoria romana, interpretatio, culto. Abstract: The study of epigraphic and archaeological data relative to three different areas from the Occidental part of the Roman Empire, allows us to propose a new vision of the cult of roman Victoria and the local interpretatio. There is a tight relationship between her cult and the local cults to divinities with similar attributes: Trebaruna in Lusitania, Brigantia in Britain and An- darta in Galia. Key words: Roman Victory, interpretatio, cult. La idea de este artículo nace de la constatación de que, analizando el culto a la diosa Victoria en el occidente del Imperio romano, notamos una cierta concen- tración de hallazgos en algunas zonas (Mapas 1 y 2). Son tres áreas geográficas bien determinadas que tienen en común el substrato celta y pertenecen a tres pro- * Becaria FPU del Departamento de Prehistoria, Arqueología, Antropología Social y Ciencias y Técnicas Historiográficas, Universidad de Valladolid, con la tutela de la profesora Carmen García Merino, a quién agradecemos las orientaciones recibidas para la realización de este artículo. -

La Langue Gauloise
LA VOCATION DE L’ARBRE D’OR est de partager ses admirations avec les lecteurs, son admiration pour les grands textes nourrissants du passé et celle aussi pour l’œuvre de contem- porains majeurs qui seront probablement davantage appréciés demain qu’aujourd’hui. Trop d’ouvrages essentiels à la culture de l’âme ou de l’identité de chacun sont aujourd’hui indisponibles dans un marché du livre transformé en industrie lourde. Et quand par chance ils sont disponibles, c’est financiè- rement que trop souvent ils deviennent inaccessibles. La belle littérature, les outils de développement personnel, d’identité et de progrès, on les trouvera donc au catalogue de l’Arbre d’Or à des prix résolument bas pour la qualité offerte. LES DROITS DES AUTEURS Cet e-book est sous la protection de la loi fédérale suisse sur le droit d’auteur et les droits voisins (art. 2, al. 2 tit. a, LDA). Il est également pro- tégé par les traités internationaux sur la propriété industrielle. Comme un livre papier, le présent fichier et son image de couverture sont sous copyright, vous ne devez en aucune façon les modifier, les utili- ser ou les diffuser sans l’accord des ayant-droits. Obtenir ce fichier autre- ment que suite à un téléchargement après paiement sur le site est un délit. Transmettre ce fichier encodé sur un autre ordinateur que celui avec lequel il a été payé et téléchargé peut occasionner des dommages informatiques susceptibles d’engager votre responsabilité civile. Ne diffusez pas votre copie mais, au contraire, quand un titre vous a plu, encouragez-en l’achat. -
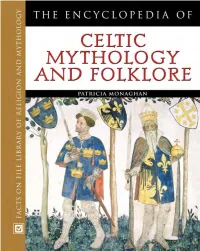
Encyclopedia of CELTIC MYTHOLOGY and FOLKLORE
the encyclopedia of CELTIC MYTHOLOGY AND FOLKLORE Patricia Monaghan The Encyclopedia of Celtic Mythology and Folklore Copyright © 2004 by Patricia Monaghan All rights reserved. No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval systems, without permission in writing from the publisher. For information contact: Facts On File, Inc. 132 West 31st Street New York NY 10001 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Monaghan, Patricia. The encyclopedia of Celtic mythology and folklore / Patricia Monaghan. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 0-8160-4524-0 (alk. paper) 1. Mythology, Celtic—Encyclopedias. 2. Celts—Folklore—Encyclopedias. 3. Legends—Europe—Encyclopedias. I. Title. BL900.M66 2003 299'.16—dc21 2003044944 Facts On File books are available at special discounts when purchased in bulk quantities for businesses, associations, institutions, or sales promotions. Please call our Special Sales Department in New York at (212) 967-8800 or (800) 322-8755. You can find Facts On File on the World Wide Web at http://www.factsonfile.com Text design by Erika K. Arroyo Cover design by Cathy Rincon Printed in the United States of America VB Hermitage 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 This book is printed on acid-free paper. CONTENTS 6 INTRODUCTION iv A TO Z ENTRIES 1 BIBLIOGRAPHY 479 INDEX 486 INTRODUCTION 6 Who Were the Celts? tribal names, used by other Europeans as a The terms Celt and Celtic seem familiar today— generic term for the whole people. -

Test Abonnement
L E X I C O N O F T H E W O R L D O F T H E C E L T I C G O D S Composed by: Dewaele Sunniva Translation: Dewaele Sunniva and Van den Broecke Nadine A Abandinus: British water god, but locally till Godmanchester in Cambridgeshire. Abarta: Irish god, member of the de Tuatha De Danann (‘people of Danu’). Abelio, Abelionni, Abellio, Abello: Gallic god of the Garonne valley in South-western France, perhaps a god of the apple trees. Also known as the sun god on the Greek island Crete and the Pyrenees between France and Spain, associated with fertility of the apple trees. Abgatiacus: ‘he who owns the water’, There is only a statue of him in Neumagen in Germany. He must accompany the souls to the Underworld, perhaps a heeling god as well. Abhean: Irish god, harpist of the Tuatha De Danann (‘people of Danu’). Abianius: Gallic river god, probably of navigation and/or trade on the river. Abilus: Gallic god in France, worshiped at Ar-nay-de-luc in Côte d’Or (France) Abinius: Gallic river god or ‘the defence of god’. Abna, Abnoba, Avnova: goddess of the wood and river of the Black Wood and the surrounding territories in Germany, also a goddess of hunt. Abondia, Abunciada, Habonde, Habondia: British goddess of plenty and prosperity. Originally she is a Germanic earth goddess. Accasbel: a member of the first Irish invasion, the Partholans. Probably an early god of wine. Achall: Irish goddess of diligence and family love. -

Luciano Golzi Saporiti. I Toponimi Del Seprio
LUCIANO GOLZI SAPORITI. I TOPONIMI DEL SEPRIO 0 LUCIANO GOLZI SAPORITI. I TOPONIMI DEL SEPRIO I TOPONIMI DEL SEPRIO INTRODUZIONE Le etimologie proposte per buona parte dei toponimi del Seprio e delle aree immediatamente adiacenti risultano spesso fantasiose, dubbie e contraddittorie: scopo di questo studio è di tentare di stabilirne l’origine e il significato reali. Ricordiamo, innanzitutto, che i nomi di luogo, quando furono attribuiti, avevano un significato preciso e comprensibile, quasi sempre legato ad una divinità, al nome di una persona o a qualche visibile caratteristica fisica del territorio. A seconda delle epoche e delle mode, cambiarono i criteri di denominazione, ma rimasero sempre “semplici” spesso ripetitivi, come oggi i vari Albergo Bellavista, Ristorante della Posta, Trattoria da Giovanni, Residence Lago Blu, Villa Francesca, Cascina Bianchi, Santa Maria di..., Podere del Roveto, Grand Hôtel Terme, Villaggio le Ginestre, eccetera. In un lungo periodo di colonizzazione agricola del territorio, risultarono sempre particolarmente popolari i toponimi “prediali”, indicanti cioè il nome del fondatore e primo proprietario dell’insediamento. Ben raramente le località furono “ribattezzate”, ma i loro nomi subirono radicali modifiche, legate alle variazioni progressive della lingua e della pronuncia; con il passare del tempo, l’origine dei toponimi fu dimenticata e il loro significato divenne incomprensibile. Facciamo degli esempi. Sabaudia, Carbonia e Latina [già Littoria] sono toponimi recenti; ne conosciamo sia il significato che l’origine: tra una generazione saranno dimenticati. Montechiaro, Villafranca, Castelnuovo, Roncaccio sono toponimi medievali ancora comprensibili: abbiamo però dimenticato perchè si chiamino così. Di Busto, Varese, Tradate e Abbiate non conosciamo il significato nè l’origine: possiamo solo ipotizzarli. -

Bababababababababababa
PART SEVEN THE DRUID MISCELLANY Introduction Most of the material in this section is of very little importance to most pre 1986 Carleton Druids (because of its heavy Celtic Pagan orientation), but I feel that it has great importance for understanding the later NRDNA, and it may be of use to modern Carleton Druids. The books have been pretty much reprinted in order and verba- tim from DC(E). This is better preserves the historical nature of these documents, to show the approach and “angle” that the DC(E) of 1976 was presenting, especially to the compilers of religious ency- clopedists. Many issues of The Druid Chronicler magazine would essentially add to this section from 1976 to 1980. I removed the Book of Footnotes, broke it up and placed them under the appropri- ate texts rather than stuffing all of them in this obscure section of ARDA. I have added those sections and indicated so. As with every section of this collection, none of this material is necessarily indicative of the opinion of any other Druid except that of the author(s). The material is not dogmatic or canonical, and can not be assumed to represent the Reform as a whole. Most of it is terribly out of date, and much better recent materials are available. Day 1 of Foghamhar Year XXXIV of the Reform (August 1st, 1996 c.e.) Michael Schardin THE DRYNEMTUM PRESS BABABABABABABABABABABABABABAB The Original Chapter Contents OtherOther: The Humanist Society:* check local phone book. in DC(E) The Theosophical Society:* clpb Different Strokes The Vedanta Society:* The Pronunciation -

Rome: Decline and Fall History
Rome: Decline and Fall Everything in the document is public knowledge and can be read by both players and the DM. It is 998 AUC (Ab Urbe Condita, years since the founding of Rome) [245 AD in the modern calendar]. The empire struggles with invasion, social collapse and neglect. The nobility of Rome has increasingly turned away from the Olympian gods and towards the easy power granted by demon-kind. Last year, the current emperor, Marcus Julius Philippus (Philip the Arab), killed the teenage, ineffectual child-emperor Gordian while fighting the dwarves of the East. He has since returned to Rome and to consolidate his power. Already his rival generals are considering their own moves for the throne. As Rome’s nobles fight among themselves, the rest of the empire is left to get by as best it can. History Prehistory Scholar believe the world are created from the elemental chaos by ancient gods now long forgotten. It may also be that these ancient gods became the world. Only two of these creator gods are now known: Gaea (the earth) and Uranus (the sky). The creator gods were overthrown and destroyed by their own children, the Titans. The current fate of the creator gods is unknown. The Titans, also known as the Primordials, did not create the world itself, but they populated it with many strange and gargantuan creatures. They reshaped the world to amuse themselves, creating the first great civilizations to worship them. During that time, the known world was divided between two great nations: the lands of the giant-kin in Europe and the empire of the dragon-kings in North Africa and the Middle East. -

Volume4entier.Pdf
Chronozones 4/1998 Le passé a!t!il un avenir? Equipe Chronozones Coach Réponse affirmative et enthousiaste+ pour peu que l’on se penche sur Sébastien Freudiger cette nouvelle mouture de la revue Chronozones, D’une Diane Libéro médiévale aux antiques apnéistes+ d’une inscription romaine oubliée Thierry Theurillat aux postures grecques du phallus+ ces contributions hétéroclites se Gardien rassemblent pourtant sous le dénominateur peu commun de la Benoît Montandon passion : passion de l’Antiquité et enthousiasme à la transmettre, Stopper Thierry Luginbühl Si ce foisonnement et cette implication des étudiants en sciences Demi droit de l’Antiquité de l’Université de Lausanne enrichissent cette Nathalie Vuichard cuvée %-+ ils suscitent également quelques questions, Combien Ailier droit d’entre!nous+ une fois libérés du cadre nourricier de l’université+ Delphine Wagner auront l’opportunité de poursuivre et d’approfondir leurs Ailier gauche recherches personnelles ? Combien+ soumis à des contingences Léonore Veya alimentaires+ iront voir ailleurs ? Perspectives ! qui en manquent Masseur d’ailleurs singulièrement ! navrantes+ mais pourtant bien Wladimir Dudan prévisibles, Du reste+ on nous avait prévenu, Arbitre François Meylan Heureuse coïncidence+ le prochain séminaire d’archéologie ! sous Juge de touche le label « interdisciplinaire » ! aura pour thème : L’archéologie à Anne Schopfer l’aube du XXIe siècle : histoire et enjeux d’une discipline , Le lieu Remplaçant et l’occasion semblent ainsi propices pour apprendre et remettre Gianluca Vietti -

La Langue Gauloise : Grammaire, Textes Et Glossaire
m COLLECTION POUR [ÉTUDE DES ANTIQUITÉS NATIONALES II LA LANGUE GAULOISE PAR G.DOTTIN amammama PARIS HBRAnilE CKimCKSIECK m-r- /t'uijui TldàSiâ^ LA LANGUE (GAULOISE Précédemment paru dans la même collection. G. DoTTiN, Les anciens peuples de l'Europe, in-H^ relié, 6 fP. COLLECTION POUR L'ETUDE DES ANTIQUITÉS NATIONALES II LA LANGUE GAULOISE COLLECTION POUR L'ÉTUDE DES ANTIQUITÉS NATIONALES II LA LANGUE GAULOISE GRAMMAIRE, TEXTES ET GLOSSAIRE Georges DOTTIN DOYEN \>V. LA IACH.TK I>I:s I.KTTl^RS DE HENNES PARIS LIBRAIRIE C. KLINCKSIEGK M, RUE DE LILLE, H 1918 Tous droits réservés. Copyright }>ij C. Klincki^leck, 191 S. Le livre de M. DoUin renferme tout ce que nous savons de la langne gauloise, c'esl-à-dir€ de la langue parlée dans la Ganie, il y a deux mille ans, par les peuples qui s'appelaient les Gaulois. Ce que dous savons de celle langue est malheureu- sement fort peu de chose : quelques; mots, conservés par les Anciens ; beaucoup de noms propres, dont le sens est souvent douteux lot assez restreint d'in- ; un scriptions, plus faciles à déchiffrer qu'à traditire. Si le vocabulaire ne nous est point inconnu, la strucliire de la langue, qui est l'essentiel, nous échappe à peu près complètement. Ce livre, si copieux soit^il, n'est donc qu'un monument d'attente en vue d'un avenir qu'on a le droit d'espérer. Je dis qu'on a le droit d'espérer un avenir qui nous fera connaître, de la langue gauloise, beaucoup de ce que nous ignorons. -

Histoire De La Gaule
HISTOIRE DE LA GAULE TOME VI. — LA CIVILISATION GALLO-ROMAINE - ÉTAT MORAL. CAMILLE JULLIAN PARIS. — 1920 CHAPITRE PREMIER. — LES DIEUX. I. La tolérance religieuse. — II . Cohabitation des dieux. — III . Transformation des dieux. — IV . Figuration des dieux indigènes. — V. Influence de l'imagerie classique. — VI . Mercure. — VII . Autres grands dieux. — VIII . Les déesses classiques. — IX . Les survivances des dieux celtiques. — X. Divinités du sol. — XI . Dieux sociaux. — XII . Les dieux de chacun. — XIII . Auguste. — XIV . Talismans. — XV . Rites. — XVI . Dieux orientaux. — XVII . Le ciel et le temps. — XVIII . Le Christianisme. CHAPITRE II. — LA VIE INTELLECTUELLE. I. La propagation du latin. — II . De l'intervention de est en matière de langage. — III . Les résistances du celtique. — IV . Sur l'existence d'un latin provincial de Gaule. — V. Enseignement. — VI . Épigraphie. — VII . Le grec en Gaule. — VIII . Lecture et librairie. — IX . Art oratoire. — X. Poésie. — XI . Prose. — XII . Oubli des traditions nationales. — XIII . Théâtre. — XIV . Des pratiques scientifiques. CHAPITRE III. — L'ART. I. Des conditions de l'art en Gaule. — II . Importation d'objets d'art. — III . Artistes étrangers. — IV . Artistes indigènes. — V. Statuaire religieuse. — VI . Le portrait. — VII . Le bas-relief. — VIII . La petite sculpture. — IX . Peinture et mosaïque. — X. La maison ou la villa. — XI . La tombe. — XII . Le temple. — XIII . La basilique. — XIV . Édifices civils. — XV . Art décoratif. — XVI . Musique et danse. CHAPITRE IV. — LA VIE MORALE. I. La dévotion. — II . Les devoirs. — III . La personnalité humaine ; le culte des morts. — IV . La vie familiale. — V. L'amour. — VI . La femme. — VII . L'enfant : les noms. — VIII . La vie de l'enfant. -

The Religion of the Ancient Celts by J.A
THE RELIGION OF THE ANCIENT CELTS BY J.A. MACCULLOCH HON. D.D.(ST. ANDREWS); HON. CANON OF CUMBRAE CATHEDRAL AUTHOR OF "COMPARATIVE THEOLOGY" "RELIGION: ITS ORIGIN AND FORMS" "THE MISTY ISLE OF SKYE" "THE CHILDHOOD OF FICTION: A STUDY OF FOLK-TALES AND PRIMITIVE THOUGHT" Edinburgh: T. & T. CLARK, 38 George Street 1911 Printed by MORRISON & GIBB LIMITED, FOR T. & T. CLARK, EDINBURGH. LONDON: SIMPKIN, MARSHALL, HAMILTON, KENT, AND CO. LIMITED. NEW YORK: CHARLES SCRIBNER'S SONS. TO ANDREW LANG PREFACE The scientific study of ancient Celtic religion is a thing of recent growth. As a result of the paucity of materials for such a study, earlier writers indulged in the wildest speculative flights and connected the religion with the distant East, or saw in it the remains of a monotheistic faith or a series of esoteric doctrines veiled under polytheistic cults. With the works of MM. Gaidoz, Bertrand, and D'Arbois de Jubainville in France, as well as by the publication of Irish texts by such scholars as Drs. Windisch and Stokes, a new era may be said to have dawned, and a flood of light was poured upon the scanty remains of Celtic religion. In this country the place of honour among students of that religion belongs to Sir John Rh[^y]s, whose Hibbert Lectures On the Origin and Growth of Religion as illustrated by Celtic Heathendom (1886) was an epoch-making work. Every student of the subject since that time feels the immense debt which he owes to the indefatigable researches and the brilliant suggestions of Sir John Rh[^y]s, and I would be ungrateful if I did not record my indebtedness to him.