Histoire De La Gaule
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Gottheit (99) 1 Von 10
Gottheit (99) Suche Startseite Profil Konto Gottheit Zurück zu Witchways Diskussionsforum Themenübersicht Neues Thema beginnen Thema: Gottheit Thema löschen | Auf dieses Thema antworten Es werden die Beiträge 1 - 30 von 97 angezeigt. 1 2 3 4 Shannah Witchways Abnoba (keltische Muttergöttin) Abnoba war eine keltische Muttergöttin und personifizierte den Schwarzwald, welcher in der Antike den Namen Abnoba mons trug. Mythologie Sie galt als Beschützerin des Waldes, des Wildes und der Quellen, insbesondere als Schutzpatronin der Heilquellen in Badenweiler. Wild und Jäger unterstanden ihrem Schutz. Nach der bei der Interpretatio Romana üblichen Vorgehensweise wurde sie von den Römern mit Diana gleichgesetzt, wie etwa eine in Badenweiler aufgefundene Weiheinschrift eines gewissen Fronto beweist, der damit ein Gelübde einlöste. Wahrscheinlich stand auf dem Sockel, der diese Inschrift trägt, ursprünglich eine Statue dieser Gottheit. Ein in St. Georgen aufgefundenes Bildwerk an der Brigachquelle zeigt Abnoba mit einem Hasen, dem Symbol für Fruchtbarkeit, als Attribut. Tatsächlich wurden in Badenweiler auch Leiden kuriert, die zu ungewollter Kinderlosigkeit führten, und in den Thermen dieses Ortes war ungewöhnlicherweise die Frauenabteilung nicht kleiner als die für Männer. Abnoba dürfte für die Besucher von Badenweiler also vor allem als Fruchtbarkeitsgottheit gegolten haben. vor etwa einem Monat Beitrag löschen Shannah Witchways Aericura (keltische Totengottheit) Aericura ist eine keltisch-germanische Fruchtbarkeits- und Totengottheit. Mythologie Aericura, auch Aeracura, Herecura oder Erecura, ist eine antike keltisch-germanische (nach einigen Theorien jedoch ursprünglich sogar eine illyrische) Gottheit. Sie wird zumeist mit Attributen der Proserpina ähnlich dargestellt, manchmal in Begleitung eines Wolfs oder Hundes, häufig jedoch auch mit ruchtbarkeitsattributen wie Apfelkörben. Manchmal wird Aericura als Fruchtbarkeitsgottheit gedeutet, häufig jedoch eher als Totengöttin. -

„LITANIA” DO CELTYCKIEJ BOGINI „Litanię”
ROCZNIKI HUMANISTYCZNE Tom XXXIV, zeszyt 2 - 1986 EDWARD ZWOLSKI Lublin „LITANIA” DO CELTYCKIEJ BOGINI „Litanię” układam z wezwań, kierowanych do bogini w ziemiach celtyckich od luzytańskiego zachodu i brytyjsko-iryjskiej północy po italskie południe i galacki wschód. Za wezwania biorę żeńskie imiona boskie z napisów na ołtarzach, coko łach, płytach dedykacyjnych i wotywnych. Pewne jawią się często, inne rzadko, nawet raz, ale wszystkie są „mowne”, ponieważ do bogini celtyckiej, nie wspiera nej powagą państwa, modlił się człowiek, który w nią wierzył. Starałem się odszukać wszystkie imiona. Nie wszystkie włączam do litanii, bo pewne, jak Navia w Hiszpanii, w Galii zaś: Acionna, Ancamna, Alauna, Ica, Icauna, Icovellauna, Soio i Qnuava, chociaż w części lub całości brzmią po celtyc- ku, swego znaczenia nie odsłaniają. Dzieła, po które sięgałem szukając napisów: Przede wszystkim berliński Corpus Inscriptionum Latinarum (skrót: CIL); dla Galii Narbońskiej - vol. XII, ed. O. Hirschfeld, 1888; dla trzech Galii (Lugduńskiej, Belgijskiej, Akwitańskiej) i obu Germanii (Górnej i Dolnej, założonych na ziemiach celtyckich) - vol. XIII, ed. A. Domaszewski, O. Bohn et E. Stein, 1899-1943 (praktycznie do 1916 r.); dla ziem dunajskich i Wschodu - vol. III, ed. Th. Mommsen, O. Hirschfeld et A. Domaszewski, 1873 (Supplementa, 1889-1902); dla Galu italskiej, vol. V, ed. Th. Mommsen, 1872-1877. Przedłużają CIL: Tom XII: E. Esperandieu, Inscriptions latines de Gaule (Narbonnaise), Paris 1929 (skrót: ILG). Tom XIII: H. Finke, Neue Inschriften, 17. Bericht der Römischgermanischen Kom mission, 1927, Berlin 1929 (skrót: 17, BRGK); H. Nesselhauf, Neue Inschriften aus dem römischen Germanien und den angrenzenden Gebieten, 27. BRGK, 1937, Berlin 1939 (skrót: 27. BRGK); F. -

Exclusively Made Barn 14 Hip No. 1
Consigned by Tres Potrillos, Agent Barn Hip No. 14 Exclusively Made 1 Gone West Elusive Quality.................. Touch of Greatness Exclusive Quality .............. Glitterman Exclusively Made First Glimmer.................... Bay Filly; First Stand March 8, 2011 Danzig Furiously........................... Whirl Series Mad About Julie ............... (1999) Restless Restless Restless Julie.................... Witches Alibhai By EXCLUSIVE QUALITY (2003). Black-type winner of $92,600, Spectacular Bid S. [L] (GP, $45,000). Sire of 3 crops of racing age, 166 foals, 94 start- ers, 59 winners of 116 races and earning $2,727,453, including Sr. Quisqueyano ($319,950, Calder Derby (CRC, $150,350), etc.), Exclusive- ly Maria ($100,208, Cassidy S. (CRC, $60,000), etc.), Boy of Summer ($89,010, Journeyman Stud Sophomore Turf S.-R (TAM, $45,000)), black- type-placed Quality Lass ($158,055), Backstage Magic ($128,540). 1st dam MAD ABOUT JULIE, by Furiously. Winner at 3 and 4, $33,137. Dam of 4 other registered foals, 4 of racing age, 2 to race, 2 winners, including-- Jeongsang Party (f. by Exclusive Quality). Winner at 2, placed at 3, 2013 in Republic of Korea. 2nd dam Restless Julie, by Restless Restless. 2 wins at 2, $30,074, 2nd American Beauty S., etc. Dam of 11 other foals, 10 to race, all winners, including-- RESTING MOTEL (c. by Bates Motel). 8 wins at 2 and 3 in Mexico, cham- pion sprinter, Clasico Beduino, Handicap Cristobal Colon, Clasico Velo- cidad; winner at 4, $46,873, in N.A./U.S. PRESUMED INNOCENT (f. by Shuailaan). 7 wins, 3 to 6, $315,190, Jersey Lilly S. (HOU, $30,000), 2nd A.P. -

The Shifting Baselines of the British Hare Goddess
Open Archaeology 2020; 6: 214–235 Research Article Luke John Murphy*, Carly Ameen The Shifting Baselines of the British Hare Goddess https://doi.org/10.1515/opar-2020-0109 received May 13, 2020; accepted August 20, 2020. Abstract: The rise of social zooarchaeology and the so-called ‘animal turn’ in the humanities both reflect a growing interest in the interactions of humans and non-human animals. This comparative archaeological study contributes to this interdisciplinary field by investigating the ways in which successive human cultures employed religion to conceptualise and interact with their ecological context across the longue durée. Specifically, we investigate how the Iron Age, Romano-British, early medieval English, medieval Welsh, and Information Age populations of Great Britain constructed and employed supranatural female figures – Andraste, Diana, Ēostre, St. Melangell, and the modern construct ‘Easter’ – with a common zoomorphic link: the hare. Applying theoretical concepts drawn from conservation ecology (‘shifting baselines’) and the study of religion (‘semantic centres’) to a combination of (zoo)archaeological and textual evidence, we argue that four distinct ‘hare goddesses’ were used to express their congregations’ concerns regarding the mediation of violence between the human in-group and other parties (human or animal) across two millennia. Keywords: Archaeology of Religion, Animal Studies, British Archaeology, Comparative Archaeology, Social Zooarchaeology Abbreviations CISR = Corpus signorum imperii Romani, Corpus of Sculpture of the Roman World. RIB = Roman Inscriptions of Britain database. 1 Introduction: Shifting Baselines and Semantic Centres The recent rise of social zooarchaeology (Russell, 2011; Sykes, 2014) and the so-called ‘animal turn’ in the humanities (Peterson, 2016; Ritvo, 2007) both reflect a growing scholarly interest in the interactions of humans and non-human animals. -

El Culto a Victoria Y La Interpretatio Indígena En El Occidente De Hispania, Galia Y El Norte De Britania
olteanu teodora6:BSSA 05/06/2009 12:48 Página 197 EL CULTO A VICTORIA Y LA INTERPRETATIO INDÍGENA EN EL OCCIDENTE DE HISPANIA, GALIA Y EL NORTE DE BRITANIA The Cult of Victoria and its Interpretation by Native People in Western Iberia, Gallia, and Northern Britannia TEODORA OLTEANU* Resumen: El estudio de datos epigráficos y arqueológicos relativos a tres zonas diferentes del Occidente del Imperio Romano nos permite proponer una nueva visión sobre el culto a la diosa romana Victoria y su interpretatio indígena. Hay una estrecha relación entre su culto y los cultos lo- cales a divinidades con atributos parecidos: Trebaruna en Lusitania, Brigantia en Britania y An- darta en Galia. Palabras clave: Victoria romana, interpretatio, culto. Abstract: The study of epigraphic and archaeological data relative to three different areas from the Occidental part of the Roman Empire, allows us to propose a new vision of the cult of roman Victoria and the local interpretatio. There is a tight relationship between her cult and the local cults to divinities with similar attributes: Trebaruna in Lusitania, Brigantia in Britain and An- darta in Galia. Key words: Roman Victory, interpretatio, cult. La idea de este artículo nace de la constatación de que, analizando el culto a la diosa Victoria en el occidente del Imperio romano, notamos una cierta concen- tración de hallazgos en algunas zonas (Mapas 1 y 2). Son tres áreas geográficas bien determinadas que tienen en común el substrato celta y pertenecen a tres pro- * Becaria FPU del Departamento de Prehistoria, Arqueología, Antropología Social y Ciencias y Técnicas Historiográficas, Universidad de Valladolid, con la tutela de la profesora Carmen García Merino, a quién agradecemos las orientaciones recibidas para la realización de este artículo. -

La Langue Gauloise
LA VOCATION DE L’ARBRE D’OR est de partager ses admirations avec les lecteurs, son admiration pour les grands textes nourrissants du passé et celle aussi pour l’œuvre de contem- porains majeurs qui seront probablement davantage appréciés demain qu’aujourd’hui. Trop d’ouvrages essentiels à la culture de l’âme ou de l’identité de chacun sont aujourd’hui indisponibles dans un marché du livre transformé en industrie lourde. Et quand par chance ils sont disponibles, c’est financiè- rement que trop souvent ils deviennent inaccessibles. La belle littérature, les outils de développement personnel, d’identité et de progrès, on les trouvera donc au catalogue de l’Arbre d’Or à des prix résolument bas pour la qualité offerte. LES DROITS DES AUTEURS Cet e-book est sous la protection de la loi fédérale suisse sur le droit d’auteur et les droits voisins (art. 2, al. 2 tit. a, LDA). Il est également pro- tégé par les traités internationaux sur la propriété industrielle. Comme un livre papier, le présent fichier et son image de couverture sont sous copyright, vous ne devez en aucune façon les modifier, les utili- ser ou les diffuser sans l’accord des ayant-droits. Obtenir ce fichier autre- ment que suite à un téléchargement après paiement sur le site est un délit. Transmettre ce fichier encodé sur un autre ordinateur que celui avec lequel il a été payé et téléchargé peut occasionner des dommages informatiques susceptibles d’engager votre responsabilité civile. Ne diffusez pas votre copie mais, au contraire, quand un titre vous a plu, encouragez-en l’achat. -

Ancient Celtic Goddesses Author(S): E
Ancient Celtic Goddesses Author(s): E. Anwyl Source: The Celtic Review, Vol. 3, No. 9 (Jul., 1906), pp. 26-51 Published by: Stable URL: http://www.jstor.org/stable/30069895 Accessed: 23-11-2015 23:24 UTC Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at http://www.jstor.org/page/ info/about/policies/terms.jsp JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. http://www.jstor.org This content downloaded from 128.122.230.148 on Mon, 23 Nov 2015 23:24:25 UTC All use subject to JSTOR Terms and Conditions 26 THE CELTIC REVIEW ANCIENT CELTIC GODDESSES Professor E. ANWYL THE extant remains of the Celtic forms of religion afford abundant testimony to the great variety of divine names which were associated therewith. No student of Celtic religion can fail to be impressed with the number of Celtic deities, who appear to have been local or tribal in character. Even where a certain deity appears to have become non-local, it will generally be found on investigation that the sphere of the extended worship has fairly well-defined areas and centres. We cannot take as our first guide for the classification and grouping of Celtic gods a Pantheon like that of Homer, behind which there is a long history of religious development, and upon which there is the impress of a literary tradition. -
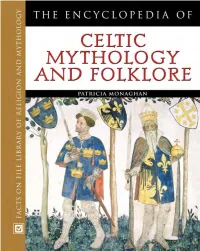
Encyclopedia of CELTIC MYTHOLOGY and FOLKLORE
the encyclopedia of CELTIC MYTHOLOGY AND FOLKLORE Patricia Monaghan The Encyclopedia of Celtic Mythology and Folklore Copyright © 2004 by Patricia Monaghan All rights reserved. No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval systems, without permission in writing from the publisher. For information contact: Facts On File, Inc. 132 West 31st Street New York NY 10001 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Monaghan, Patricia. The encyclopedia of Celtic mythology and folklore / Patricia Monaghan. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 0-8160-4524-0 (alk. paper) 1. Mythology, Celtic—Encyclopedias. 2. Celts—Folklore—Encyclopedias. 3. Legends—Europe—Encyclopedias. I. Title. BL900.M66 2003 299'.16—dc21 2003044944 Facts On File books are available at special discounts when purchased in bulk quantities for businesses, associations, institutions, or sales promotions. Please call our Special Sales Department in New York at (212) 967-8800 or (800) 322-8755. You can find Facts On File on the World Wide Web at http://www.factsonfile.com Text design by Erika K. Arroyo Cover design by Cathy Rincon Printed in the United States of America VB Hermitage 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 This book is printed on acid-free paper. CONTENTS 6 INTRODUCTION iv A TO Z ENTRIES 1 BIBLIOGRAPHY 479 INDEX 486 INTRODUCTION 6 Who Were the Celts? tribal names, used by other Europeans as a The terms Celt and Celtic seem familiar today— generic term for the whole people. -

Test Abonnement
L E X I C O N O F T H E W O R L D O F T H E C E L T I C G O D S Composed by: Dewaele Sunniva Translation: Dewaele Sunniva and Van den Broecke Nadine A Abandinus: British water god, but locally till Godmanchester in Cambridgeshire. Abarta: Irish god, member of the de Tuatha De Danann (‘people of Danu’). Abelio, Abelionni, Abellio, Abello: Gallic god of the Garonne valley in South-western France, perhaps a god of the apple trees. Also known as the sun god on the Greek island Crete and the Pyrenees between France and Spain, associated with fertility of the apple trees. Abgatiacus: ‘he who owns the water’, There is only a statue of him in Neumagen in Germany. He must accompany the souls to the Underworld, perhaps a heeling god as well. Abhean: Irish god, harpist of the Tuatha De Danann (‘people of Danu’). Abianius: Gallic river god, probably of navigation and/or trade on the river. Abilus: Gallic god in France, worshiped at Ar-nay-de-luc in Côte d’Or (France) Abinius: Gallic river god or ‘the defence of god’. Abna, Abnoba, Avnova: goddess of the wood and river of the Black Wood and the surrounding territories in Germany, also a goddess of hunt. Abondia, Abunciada, Habonde, Habondia: British goddess of plenty and prosperity. Originally she is a Germanic earth goddess. Accasbel: a member of the first Irish invasion, the Partholans. Probably an early god of wine. Achall: Irish goddess of diligence and family love. -

Luciano Golzi Saporiti. I Toponimi Del Seprio
LUCIANO GOLZI SAPORITI. I TOPONIMI DEL SEPRIO 0 LUCIANO GOLZI SAPORITI. I TOPONIMI DEL SEPRIO I TOPONIMI DEL SEPRIO INTRODUZIONE Le etimologie proposte per buona parte dei toponimi del Seprio e delle aree immediatamente adiacenti risultano spesso fantasiose, dubbie e contraddittorie: scopo di questo studio è di tentare di stabilirne l’origine e il significato reali. Ricordiamo, innanzitutto, che i nomi di luogo, quando furono attribuiti, avevano un significato preciso e comprensibile, quasi sempre legato ad una divinità, al nome di una persona o a qualche visibile caratteristica fisica del territorio. A seconda delle epoche e delle mode, cambiarono i criteri di denominazione, ma rimasero sempre “semplici” spesso ripetitivi, come oggi i vari Albergo Bellavista, Ristorante della Posta, Trattoria da Giovanni, Residence Lago Blu, Villa Francesca, Cascina Bianchi, Santa Maria di..., Podere del Roveto, Grand Hôtel Terme, Villaggio le Ginestre, eccetera. In un lungo periodo di colonizzazione agricola del territorio, risultarono sempre particolarmente popolari i toponimi “prediali”, indicanti cioè il nome del fondatore e primo proprietario dell’insediamento. Ben raramente le località furono “ribattezzate”, ma i loro nomi subirono radicali modifiche, legate alle variazioni progressive della lingua e della pronuncia; con il passare del tempo, l’origine dei toponimi fu dimenticata e il loro significato divenne incomprensibile. Facciamo degli esempi. Sabaudia, Carbonia e Latina [già Littoria] sono toponimi recenti; ne conosciamo sia il significato che l’origine: tra una generazione saranno dimenticati. Montechiaro, Villafranca, Castelnuovo, Roncaccio sono toponimi medievali ancora comprensibili: abbiamo però dimenticato perchè si chiamino così. Di Busto, Varese, Tradate e Abbiate non conosciamo il significato nè l’origine: possiamo solo ipotizzarli. -

Celtic Religion Across Space and Time
Celtic Religion across Space and Time J. Alberto Arenas-Esteban (ed.) IX Workshop F.E.R.C.AN FONTES EPIGRAPHICI RELIGIONVM CELTICARVM ANTIQVARVM JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA - 2010 FICHA CATALOGRÁFICA Workshop F.E.R.C.A.N. (9 ª.2010. Molina de Aragón) Celtic Religion across space and time : fontes epigraphici religionvm celticarvm antiqvarvm / J. Alberto Arenas-Esteban (ed) . – Molina de Aragón : CEMAT (Centro de Estudios de Molina y Alto Tajo) ; Toledo : Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Servicio del Libro, Exposiciones y Audiovisuales, 2010. 298 p. : il. ; 29 cm. – (Actas) ISBN: 978-84-7788-589-4 Depósito Legal: AB-328-2010 1. Antropología social 2. Historia Antigua 3. Arqueología 39 (364) : 94 902 (364) Con la colaboración de C.E.M.A.T. Queda rigurosamente prohibida la reproducción parcial o total de esta obra sin la autorización escrita de los titulares del copyright. © de los autores I.S.B.N.: 978-84-7788-589-4 Depósito Legal: AB-328-2010 FOTOGRAFÍA DE PORTADA: Altar de los Lugoves. (Cortesía del Museo Numantino, Soria) MAQUETACIÓN: M. Marco Blasco IMPRIME: Sonora Comunicación Integral, S.L. EDICIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y CULTURA DE CASTILLA-LA MANCHA Impreso en España - Printed in Spain Contents PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL. PRESENTATION. Jesús Alberto Arenas-Esteban. 1. EPIGRAPHY AND PHILOLOGY: METHODOLOGICAL REMARKS AND REGIONAL STUDIES. Patrizia de Bernardo Stempel Method in the analysis of Romano-Celtic theonymic materials: improved readings and etymological interpretations. 18 Patrizia de Bernardo Stempel & Manfred Hainzmann Sive in theonymic formulae as a means for introducing explications and identifications. 28 Bernard Rémy Corpus Fercan: les provinces romaines des Alpes occidentales (Alpes graies, cottiennes, maritimes, pœnines). -

Dictionary of Gods and Goddesses.Pdf
denisbul denisbul dictionary of GODS AND GODDESSES second edition denisbulmichael jordan For Beatrice Elizabeth Jordan Dictionary of Gods and Goddesses, Second Edition Copyright © 2004, 1993 by Michael Jordan All rights reserved. No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval systems, without permission in writing from the publisher. For information contact: Facts On File, Inc. 132 West 31st Street New York NY 10001 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data denisbulJordan, Michael, 1941– Dictionary of gods and godesses / Michael Jordan.– 2nd ed. p. cm. Rev. ed. of: Encyclopedia of gods. c1993. Includes bibliographical references and index. ISBN 0-8160-5923-3 1. Gods–Dictionaries. 2. Goddesses–Dictionaries. I. Jordan, Michael, 1941– Encyclopedia of gods. II. Title. BL473.J67 2004 202'.11'03–dc22 2004013028 Facts On File books are available at special discounts when purchased in bulk quantities for businesses, associations, institutions, or sales promotions. Please call our Special Sales Department in New York at (212) 967-8800 or (800) 322-8755. You can find Facts On File on the World Wide Web at http://www.factsonfile.com Text design by David Strelecky Cover design by Cathy Rincon Printed in the United States of America VBFOF10987654321 This book is printed on acid-free paper. CONTENTS 6 PREFACE TO THE SECOND EDITION v INTRODUCTION TO THE FIRST EDITION vii CHRONOLOGY OF THE PRINCIPAL RELIGIONS AND CULTURES COVERED IN THIS BOOK xiii DICTIONARY OF GODS AND GODDESSES denisbul1 BIBLIOGRAPHY 361 INDEX 367 denisbul PREFACE TO THE SECOND EDITION 6 It is explained in the introduction to this volume and the Maori.