Télécharger En Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Framing 'The Other'. a Critical Review of Vietnam War Movies and Their Representation of Asians and Vietnamese.*
Framing ‘the Other’. A critical review of Vietnam war movies and their representation of Asians and Vietnamese.* John Kleinen W e W ere Soldiers (2002), depicting the first major clash between regular North-Vietnamese troops and U.S. troops at Ia Drang in Southern Vietnam over three days in November 1965, is the Vietnam War version of Saving Private Ryan and The Thin Red Line. Director, writer and producer, Randall Wallace, shows the viewer both American family values and dying soldiers. The movie is based on the book W e were soldiers once ... and young by the U.S. commander in the battle, retired Lieutenant General Harold G. Moore (a John Wayne- like performance by Mel Gibson).1 In the film, the U.S. troops have little idea of what they face, are overrun and suffer heavy casualties. The American GIs are seen fighting for their comrades, not their fatherland. This narrow patriotism is accompanied by a new theme: the respect for the victims ‘on the other side’. For the first time in the Hollywood tradition, we see fading shots of dying ‘VC’ and of their widows reading loved ones’ diaries. This is not because the filmmaker was emphasizing ‘love’ or ‘peace’ instead of ‘war’, but more importantly, Wallace seems to say, that war is noble. Ironically, the popular Vietnamese actor, Don Duong, who plays the communist commander Nguyen Huu An who led the Vietnamese People’s Army to victory, has been criticized at home for tarnishing the image of Vietnamese soldiers. Don Duong has appeared in several foreign films and numerous Vietnamese-made movies about the War. -

Mapping Ethnic Diversity in Highland Northern Vietnam
GeoJournal 57: 305–323, 2002. 305 © 2003 Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands. Mapping ethnic diversity in highland Northern Vietnam Jean Michaud1, Sarah Turner2,∗ and Yann Roche3 1Chaire des Etudes´ asiatiques, Universit´e de Montr´eal, C.P. 6128, Succ. Centre-Ville, Montr´eal, Qc, H3C 3J7, Canada; 2Department of Geography, McGill University, 805 St., Montr´eal, Qc, H3A 2K6, Canada; 3Department of Geography Uni- versit´eduQu´ebeca ` Montr´eal, C.P. 8888, Succ. Centre-Ville, Montr´eal, Qc, H3C 3P8, Canada; ∗Author for correspondence (Tel: (1 514) 398-4955; Fax: (1 514) 398-7437; E-mail: [email protected]) Received 5 March 2003; accepted 29 July 2003 Key words: cartography, ethnological maps, highland minorities, Northern Vietnam, Tonkin Abstract In this paper we initially present a critical review of a range of ethnological maps produced over the last 130 years for highland northern Vietnam. In particular we illustrate the many difficulties faced when trying to represent mosaics of ethnic highland minority groups on two dimensional maps. Such historical maps included no attempts to bring topographic details into the picture, an idea that would have been virtually impossible anyway, given the cartographic technologies at the time. Yet by not including such details or not representing them clearly, a partial image of these populations has been created that, over time, has become a standardised representation. Therefore, as a more systematic approach to the analysis of these highland minority groups, we present recent attempts to create more functional maps and models for the northern Vietnam province of Lao Cai, using modern cartographic techniques and geographic information systems. -

Asian Perspectives
ASIAN PERSPECTIVES THE BULLETIN OF THE FAR-EASTERN PREHIS1'ORY ASSOCIATION VOLUME VIII. I SlJMMER I 964 Ed£tor WILHELM G. SOLHEIM II HONG KONG UNIVERSITY PRESS 19 66 © Hong Kong University Press, I966 Printed in April I966, I200 copies THE OXFORD UNIVERSITY PRESS, ELY HOUSE, 37 DOVER STREET, LONDON, W.I ARE THE EXCLUSIVE AGENTS FOR ALL COUNTRIES EXCEPT ASIA EAST OF BURMA Printed in Hong Kong by CATHAY PRESS 3I Wong Chuk Hang Road, Aberdeen ASIAN PERSPECTIVES Bulletin of the Far-Eastern Prehistory Association Editor: Wilhelm G. Solheim II; Regional Editors: Northeast Asia-Chester S. Chard; Korea-Kim Won-Yong; Japan-Ichiro Yawata; RyGkyG-Allan H. Smith; China Mainland-Kwang-chih Chang; Hong Kong-S. G. Davis; Vietnam-Truong Buu Lam; Cambodia-Bernard P. GrosIier; Thailand-Chin You-di and Vidya Intakosai; Burma-U Aung Thaw; India-B. B. Lal; Pakistan A. H. Dani; Ceylon-P. Deraniyagala; Madagascar-Pierre Verin; Malaya Alastair Lamb; Indonesia-R. Soekmono and R. P. Soejono; Malaysian Borneo Barbara Harrisson; Philippines-Alfredo E. Evangelista; Formosa-Kwang-chih Chang; Micronesia-Allan H. Smith; Polynesia-Yo H. Sinoto; New Zealand Owen Wilkes ; Melanesia-Richard Shutler, Jr ; Australia-Frederick D. McCarthy. Topical Editors: Trans-Pacific Contat.ts-Gordon F. Ekhohn; Linguistics-Milton E. Barker; Geography-Ooi Jin Bee. Occasional Contributors: Hallam L. Movius, Jr. THE FAR-EASTERN PREHISTORY ASSOCIATION International Officers: Council Members: Chairman-Wilhelm G. Solheim II,* Secretary-Roger Duff* (New Zealand), Ichiro Yawata* and Namio Egami (Japan), BernardP. Groslier* (Cambodia), Frederick McCarthy and Jack Golson* (Australia), A. P. Okladnikov** (Russia), Yu-ho Toh** (North Korea), Che-won Kim (South Korea), Li Chi (Republic of China, Taiwan), Hsia Nai** (China, Peking), F. -

In Memory of Georges Condominas and His Contributions to the Anthropology of the Mekong Region
In Memory of Georges Condominas and His Contributions to the Anthropology of the Mekong Region by Ronald D. Renard Professor Georges Condominas was the pre-eminent anthropologist of Mainland Southeast Asia of his time. He was born in Haiphong in 1921 to Louis Condominas, a French “sous-officier” in the French colonial Garde and Adeline Ribeiro-Vieira a Vietnamese mother (who was also part Chinese and Portuguese). He pursued a conventional course of studies at the Lycée Lakanal south of Paris and later in the field of law. He then returned to Hanoi where he served as a colonial official, studied visual arts in 1943 at the Ecole supérieure des Beaux-Arts d’Indochine in Hanoi, and earned a law degree that year. He was then taken into the Marine nationale in Saigon in September 1944. From March until September 1945 he was interned by the Japanese in what the inmates informally called the “Mikado Hotel”. By this time, Condo had already taken an interest to those he first called “Moi” (a general Vietnamese word—now out of favor—referring to indigenous peoples of Indochina). He explains that when, at the age of ten, along with his older sister, first met minorities, he found them more intriguing and not at all as menacing as he had previously been led to think. He also gained an appreciation of them from his father’s letters and photos as well as from a great aunt and a great uncle named Charles. All this helped him appreciate the “nobility of the French peasantry” as well as ethnic diversity in Indochina and elsewhere where his father had served, such as Tunisia (L’Exotique 1965, pp. -

Anais De História De Além-Mar
ANAIS DE HISTÓRIA DE ALÉM-MAR Periodicidade Anual Apoio Apoio do Programa Operacional Ciência, Tecnologia, Inovação do Quadro Comunitário de Apoio III Direcção Artur Teodoro de Matos Conselho Editorial Artur Teodoro de Matos; Luís Filipe Thomaz; Ana Isabel Buescu; Maria do Rosário Pimentel; João Paulo Oliveira e Costa; Ângela Domingues; Pedro Cardim; Jorge Flores Secretário Pedro Cardim Edição, propriedade, Centro de História de Além-Mar assinaturas e divulgação: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas Universidade Nova de Lisboa Av. de Berna, 26-C 1069-061 Lisboa [email protected] Preço deste número: 30 R Capa: Patrícia Proença Revisão: Francisco de Paiva Boléo Tiragem: 1.000 ex. ISSN: 0874-9671 Depósito Legal: 162657/01 Composição e impressão: Barbosa & Xavier Lda. Rua Gabriel Pereira de Castro, 31 A-C Telefs. 253 263 063 / 253 618 916 • Fax 253615 350 4700-385 Braga Articles appearing in this journal are abstracted and indexed in HISTORICAL ABSTRACS and AMERICA: HISTORY AND LIFE N.º 3, 2002 Anais de História de Além-Mar ÍNDICE APRESENTAÇÃO, Artur Teodoro de Matos ......................................................................... 5 ENTREVISTA, Ana Isabel Buescu e Jorge Flores .............................................................. 7 BIBLIOGRAFIA DE LUÍS FILIPE FERREIRA REIS THOMAZ, Jorge Flores ................ 23 ARTIGOS MOURO PARA OS CRISTÃOS E CRISTÃO PARA OS MOUROS, Maria Augusta Lima Cruz .............................................................................................................................. 39 BACCIO DA FILICAIA: UM FLORENTINO ENTRE PORTUGAL E O BRASIL EM FINAIS DO SÉCULO XVI E PRINCÍPIOS DO SÉCULO XVII, Carmen Radulet .... 65 O NAUFRÁGIO DA NAU «S. ALBERTO» E AS CAUSAS DAS PERDAS DA CARREIRA DA ÍNDIA SEGUNDO JOÃO BAPTISTA LAVANHA, Francisco Contente Domingues... 79 O IMPÉRIO PORTUGUÊS EM MEADOS DO SÉCULO XVI, João Paulo Oliveira e Costa 87 A ÚLTIMA CARTA DE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE (COCHIM, 31 DE DEZEM- BRO DE 1503), Zoltán Biedermann .......................................................................... -

Geographical Warfare in the Tropics: Yves Lacoste and the Vietnam War Gavin P
This article was downloaded by: [University Of Maryland] On: 23 July 2013, At: 12:30 Publisher: Routledge Informa Ltd Registered in England and Wales Registered Number: 1072954 Registered office: Mortimer House, 37-41 Mortimer Street, London W1T 3JH, UK Annals of the Association of American Geographers Publication details, including instructions for authors and subscription information: http://www.tandfonline.com/loi/raag20 Geographical Warfare in the Tropics: Yves Lacoste and the Vietnam War Gavin P. Bowd a & Daniel W. Clayton b a School of Modern Languages, University of St. Andrews b School of Geography and Geosciences, University of St. Andrews Published online: 23 Mar 2012. To cite this article: Gavin P. Bowd & Daniel W. Clayton (2013) Geographical Warfare in the Tropics: Yves Lacoste and the Vietnam War, Annals of the Association of American Geographers, 103:3, 627-646, DOI: 10.1080/00045608.2011.653729 To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/00045608.2011.653729 PLEASE SCROLL DOWN FOR ARTICLE Taylor & Francis makes every effort to ensure the accuracy of all the information (the “Content”) contained in the publications on our platform. However, Taylor & Francis, our agents, and our licensors make no representations or warranties whatsoever as to the accuracy, completeness, or suitability for any purpose of the Content. Any opinions and views expressed in this publication are the opinions and views of the authors, and are not the views of or endorsed by Taylor & Francis. The accuracy of the Content should not be relied upon and should be independently verified with primary sources of information. Taylor and Francis shall not be liable for any losses, actions, claims, proceedings, demands, costs, expenses, damages, and other liabilities whatsoever or howsoever caused arising directly or indirectly in connection with, in relation to or arising out of the use of the Content. -
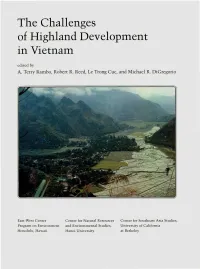
The Challenges of Highland Development in Vietnam Edited by A
The Challenges of Highland Development in Vietnam edited by A. Terry Rambo, Robert R. Reed, Le Trong Cue, and Michael R. DiGregorio East-West Center Center for Natural Resources Center for Southeast Asia Studies, Program on Environment and Environmental Studies, University of California Honolulu, Hawaii Hanoi University at Berkeley The Challenges of Highland Development in Vietnam edited by A. Terry Rambo, Robert R. Reed, Le Trong Cue, and Michael R. DiGregorio October 1995 East-West Center Center for Natural Resources Center for Southeast Asia Studies, Program on Environment and Environmental Studies, University of California Honolulu, Hawaii Hanoi University at Berkeley A. Terry Rambo Robert R. Reed Director, Program on Environment Chair, Center for Southeast Asia Studies East-West Center University of California, Berkeley 1777 East-West Road 2223 Fulton Street, Room 617 Honolulu, HI 96848 USA Berkeley, CA 94720 USA Le Trong Cue Michael R. DiGregorio Deputy Director Graduate School of Architecture and Urban Planning Center for Natural Resources University of California, LA and Environmental Studies 405 Hilgard Avenue Hanoi University Los Angeles, CA 90025 USA Hanoi, Vietnam LIBRARY OF CONGRESS CATALOGING-IN-PUBLICATION DATA The challenges of Highland development in Vietnam / edited by A. Terry Rambo . [et al.]. p. cm. Includes bibliographical references. ISBN 0-86638-176-7 1. Natural resources—Vietnam—Central Highlands—Management— Congresses. 2. Central Highlands (Vietnam)—Economic conditions— Congresses. 3. Central Highlands (Vietnam)—Economic policy— Congresses. I. Rambo, A. Terry. HC444.Z7C463 1995 338.9597—dc20 95-41204 Cover photo: Thai village in Mai Chau district, Hoa Binh province (photo taken in January 1992). Cover photo credit: A. -

La Saviesa I La Cultura
SAVIES A I CULTURA Francesc J. Hernàndez (Universitat de València) Portada: Alexandre Fragonard: Raison. Grav. Louis-François Mariage (Bibliothèque Nationale de France) Pròleg Je ne compose point, je ne suis point auteur, je lis ou je converse, j’interroge o je réponds. (Denis Diderot: Essai sur les règnes de Claude et de Néron ou Vie de Sénèque le Philosophe, París, 1823, llib. I, p. 3) n la seua primera versió, aquest llibre era un conjunt de temes per a repartir entre E l’estudiantat universitari, alguns dels quals, com ara els que tractaven de música i gastronomia, incorporaven aportacions decisives fetes pel meu fill, Carles Hernàndez. Els temes foren sotmesos a una acurada revisió per Guillem Calaforra, del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València. Hi ha una versió digital en Internet, amb 12 capítols, que porta com a títol Llulltube. Aproximació sociològica a la cultura1. La segona versió del text, ampliada, fou publicada per l’editorial Reproexpress l’any 2012, amb el títol La saviesa i la cultura. Novament el text fou revisat i ampliat, per la qual cosa vaig decidir partir-lo en dos volums. El primer, De la saviesa a la cultura, fou novament editat per Reproexpress el 2013; el segon, De la ciència a la creativitat, fou repartit en policòpia. A l’estiu del 2015 vaig refer el text, agrupant en un volum el dos precedents, eliminant algunes parts i afegint-ne de noves fins arribar a l’emblemàtica xifra dels 40 capítols agrupats en 7 parts. En el curs 2015-16 vaig incorporar nous capítols i torní a publicar-lo com La saviesa. -

Highlands of History: Indigenous Identity and Its Antecedents in Cambodia
bs_bs_banner Asia Pacific Viewpoint, Vol. 54, No. 3, December 2013 ISSN 1360-7456, pp282–295 Highlands of history: Indigenous identity and its antecedents in Cambodia Jonathan Padwe Department of Anthropology, University of Hawai’i at Ma¯noa, Honolulu, HI 96822, USA. Email: [email protected] Abstract: The notion that Cambodia’s highland people may claim a distinct ‘Indigenous’ identity has emerged only recently in Cambodia. To date, advocacy for rights under the banner of indigeneity has produced few results for highlanders. Among the problems faced by advocates for Indigenous rights, problems of definition and translation represent an important challenge. Arguing that concepts like ‘Indigeneity’ are not simply adopted ex nihilo in new settings, but are rather incorporated into existing structures of meaning, this paper explores culturally produced understandings of who highlanders are, concentrating in particular on the way that the term ‘Indigenous’ has been translated into Khmer. The use of the Khmer word daeum, or ‘original’, to distinguish between Indigenous and other forms of ethnic belonging in the newly derived translation of ‘Indigenous Peoples’ points to historically sedimented beliefs about highlanders as living ancestors of modern Khmers. Keywords: Cambodia, human rights, Indigenous identity, translation In a recent debate on the floor of Cambodia’s them figured Mane Yun, a media-savvy young National Assembly, Chheang Vun, a lawmaker Bunong woman who is the founding director from the ruling Cambodian People’s Party of the newly formed Cambodian Indigenous (CPP), attacked Kem Sokha, the leader of the Youth Association. A political cartoon of Cambodian Human Rights Party. ‘Have you ever the day, published on a suppressed anti- built roads or bridges?’ he demanded to know. -

Introduction: Five Theses on Ethnography As Colonial Practice1
//is/of'i/ mid Anthropology, 1994 o Hiirwoixl Academic Publishers GmbH, W4 Vol. 8, NIos. 1-4, pp. 1-34 Printed in Malaysia Photocopying permitted by license only INTRODUCTION: FIVE THESES ON ETHNOGRAPHY AS COLONIAL PRACTICE1 Peter Pels International Institute for Asian Studies, Leiden Oscar Salemink University of Amsterdam Despite the influence of Thomas Kuhn on critical assessments of anthropology, disciplinary histories written by anthropologists still tend to be self-serving. To this day, it seems evident to look upon the great thinkers of anthropology, those whom we think revolutionized its theories and methods, as the main carriers of the history of anthropology. Our own research projects, concerning localized, contextual histories of ethnographic practices in colonial Tanganyika (Pels) and Vietnam (Salemink), made us consider the history of anthropology from another angle. We feel that the emphasis on the "big men" of anthropology in disciplinary histories obscures the way in which ethnography was linked to the construction of colonial and neo-colonial societies. In the following text we elaborate some theses on the historical relevance of ethnographic practice, understood in relation to the anthropological discipline and to its respective local and historical contexts. These theses are obviously not the definitive outcome of a rewriting of anthropology's history, but we consider them to be necessary steps toward a critical reflection on the relations between ethnography and colonialism. Rfifnt'l. First Thesis: Disciplinary history obscures the way in which academic anthropology was linked to the construction of colonial and neo-colonial societies through ethnographic practice. When the collection of essays on Anthropology and the Colonial Encounter (Asad 1973) was published, its message was drowned in heated arguments. -

Page 89 H-France Review Vol. 10
H-France Review Volume 10 (2010) Page 89 H-France Review Vol. 10 (January 2010), No. 17 David Chandler and Christopher E. Goscha, eds, Paul Mus (1902-1969): L'espace d'un regard. Paris: Les Indes Savantes, 2006. 335 pp. Preface, introduction, footnotes, bibliography, chronology, appendices, index, table of contents. 34 Euros (pb). ISBN 2-84654-131-0. Review by Bradley C. Davis, Eastern Washington University. A Life in Four Acts Producing a volume of essays about a person is a difficult task. Fortunately, this collection of pieces concerning the life and work of Paul Mus benefits from the able editorship of two prolific scholars of Southeast Asia: David Chandler and Christopher E. Goscha. Paul Mus (1902-1969): L'espace d'un regard presents the thought, writing, and experiences of an intellectual as deeply rooted in "orientalist" philology as possessed of a vibrant sociological curiosity. Paul Mus' life spanned the final decades of French colonial rule in Indochina. He returned after the August Revolution, during which the Viet Minh proclaimed the Democratic Republic of Vietnam (DRV), to assist the negotiation of a settlement between the French Republic and Ho Chi Minh. Throughout his life, Mus remained passionately concerned about scholarship without becoming detached from world events. He was, as Ian Mabbett acknowledges in this volume, well-positioned within a European tradition of humanist erudition (p. 117). The editors group the nineteen individual essays into four sections: "I. Autour de l'homme," "II. L'Asie vue par Mus," "III. Paul Mus face au colonialisme et à l'orientalisme," and "IV. Paul Mus et le décolonisation." A brief preface by Christopher Goscha and an informative biographical introduction by David Chandler precede the main text. -

Forests, Spirits, and High Modernist Development
Forests, Spirits, and High Modernist Development ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS Uppsala Studies in Cultural Anthropology no 55 Nikolas Århem Forests, Spirits and High Modernist Development A Study of Cosmology and Change among the Katuic Peoples in the Uplands of Laos and Vietnam Dissertation presented at Uppsala University to be publicly examined in Geijersalen, Engelska parken, Thunbergsvägen 3H, Uppsala, Monday, 27 January 2014 at 10:15 for the degree of Doctor of Philosophy. The examination will be conducted in English. Faculty examiner: Pro- fesseur Titulaire Jean Michaud (Département d'anthropologie, Université Laval). Abstract Århem, N. 2014. Forests, Spirits and High Modernist Development. A Study of Cosmology and Change among the Katuic Peoples in the Uplands of Laos and Vietnam. Uppsala Studies in Cultural Anthropology 55. 463 pp. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.ISBN 978-91- 554-9113-0. This thesis explores how Katuic-speaking indigenous groups in the Central Annamitic Cor- dillera of Vietnam and Laos understand their environment – hills, streams and forest. Katuic eco-cosmology assumes that the natural landscape is imbued with spirit agents, with whom people must continuously communicate lest misfortune will strike and their livelihoods fail. The thesis posits the hypothesis that these spirit beliefs, and a variety of taboo notions ac- companying them, can be interpreted as expressions of a complex socio-environmental adaptation. Today, the indigenous groups in the study region are confronted with a massive development- and modernisation push on two fronts – that of the global development industry on the one hand, and the implementation of national development policies and programs as part of the high-modernist state project in communist Vietnam and Laos, on the other.