LES AS DE LA GUERRE 1939-1945 - Tome 2
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Victory! Victory Over Japan Day Is the Day on Which Japan Surrendered in World War II, in Effect Ending the War
AugustAAuugugusstt 201622001166 BRINGING HISTORY TO LIFE See pages 24-26! Victory! Victory over Japan Day is the day on which Japan surrendered in World War II, in effect ending the war. The term has been applied to both of the days on which the initial announcement of Japan’s surrender was made – to the afternoon of August 15, 1945, in Japan, and, because of time zone differences, to August 14, 1945. AmericanAmerican servicemenservicemen andand womenwomen gathergather inin frontfront ofof “Rainbow“Rainbow Corner”Corner” RedRed CrossCross clubclub inin ParisParis toto celebratecelebrate thethe unconditionalunconditional surrendersurrender ofof thethe Japanese.Japanese. 1515 AugustAugust 19451945 Over 200 NEW & RESTOCK Items Inside These Pages! • PLASTICPPLAASSSTTIIC MODELM KITS • MODEL ACCESSORIES • BOOKS & MAGAZINES • PAINTS & TOOLS • GIFTS & COLLECTIBLES See back cover for full details. Order Today at WWW.SQUADRON.COM or call 1-877-414-0434 August Cover Version 1.indd 1 7/7/2016 1:02:36 PM Dear Friends One of the most important model shows this year is taking place in Columbia, South Carolina in August…The IPMS Nationals. SQUADRON As always, the team from Squadron will be there to meet you. We look forward to this event because it gives us a chance to PRODUCTS talk to you all in person. It is the perfect time to hear any sugges- tions you might have so we can serve you even better. If you are at the Nationals, please stop by our booth to say hello. We can’t wait to meet you and hear all about your hobby experi- ences. On top of that, you’ll receive a Squadron shopping bag NEW with goodies! Our booth number is 819. -

TDH N°3 (02/05/2017)
Le Temps des Hélices n e r r o t n e d Le Caudron G-3, n a V l’emblème k c de l’Amicale… i r é d é r F N°3 - Cerny-La Ferté-Alais / Mai 2 017 © e 2 45 édition Actualités à La Ferté… 3 Sommaire du “Temps n 2 - Edito des Hélices” Volez en Ju-52 ou en DH-104 Dove ! qui se complète au fil des semaines. 45 e édition du “Temps des Hélices” Les 3 et 4 juin, ces vols de 30 mn environ – 20 mai : T-6 à Cosne-sur-Loire 3 - L’actualité de l’AJBS auront lieu entre 9h00 et 12h00, soit avant le – 20 et 21 mai : Ju-52 à Saint-André de l’Eure. ue de chemin parcouru début du meeting. Un Junkers Ju-52 de la –1er -2 juillet : Ju-52 à Coburg. Quelques nouvelles er 6 - Largage en Ju-52 en 45 éditions de ce société suisse Ju Air peut accueillir 17 passa - –1 -2 juillet : Skyraider et Zero à Juvancourt. Q er Le Ju autorisé largage avec SOA meeting… On est désormais gers. Ceux-ci retrouveront l’ambiance des –1 -2 juillet : Se-5a et MS-317 à Saint-Dizier 8 - Hurricane MkIIA loin des premières manifesta - voyages aériens de la fin des années 1930… – 17 septembre : MS-317 et Ju-52 à Laval Un vétéran de la Bataille de France tions organisées entre Pour les années 1950, c’est à bord d’un De – 17 septembre : Zero à Dinan copains sur le plateau de l’Ar - Havilland DH-104 Dove, appartenant à Meier - n denay, au début des années Motors (Allemagne), qu’il faut s’envoler. -

Address Section
ADDRESS SECTION DIRECfORY OF THE MEMBERS OF THE EUROPEAN PARLIAMENT The following list of the European Members of Parliament is arranged in alphabetical order by country. European MPs are given in alphabetical order by their surnames. Each entry consists of the MP's name; the political party of his own country; the political group of the European Parliament; the committee(s) of which the MP is a member; the address and telephone number of the MP. The abbreviations for the political parties of each country are given at the beginning of the list for that country. The abbreviations for the political groups of the European Parliament are as follows: CDI Group for the Technical Co L Liberal and Democratic Group ordination and Defence of Inde NI Non-attached pendent Groups and Members PPE Group of the European People's COM Communist and Allies Group Party {Christian democratic Dep Group of European Progressive Group} Democrats s Socialist group ED European Democratic Group BELGIUM (abbreviations of political parties) S.P. Socialistische Partij F.D.F.-R.W. Front democratique des Fran- P.S. Parti Socialiste cophones (Rassemblement C.V.P.-E.V.P. Christelijke Volkspartij Wallon) (Europese Volkspartij) P .R.L. Parti des reformes et de Ia Liberte P.S.C.-P.P.E. Parti social-chretien (Parti P.V.V.-E.L.D. Partij voor vrijheid en voo Populaire Europeen) ruitgang (Europese Liberalen en Demokraten) Volksunie V.U. Volksunie Breyer de Ryke, Luc. P.R.L.; L; Committee on Youth, Culture, Education, Information and Sport; Delegation to the Joint Parliamentary Committee of the EEC-Greece Association; 19a avenue du Gui, B-1180 Brussels (374-30-70) CoDa, Marcel G.B. -

European Par/1 Ent
european par/1 ent COMPOSITION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE INSTITUTIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES BRIEF BIOGRAPHIES April 1972 COUVEINHES, Rent! France European Democratic Union Group Member of European Parliament since Aprill97l Born 16 June 1925 in Montpellier. Secretary-general of "Commission nationale d'amenagement du territoire" (regional planning). Member of "Conseil superieur de l'amenagement rural" (rural development). Secretary-general of "Conseil superieur de la construction". Member of National Assembly since 1968 Parliamentary group: UDR Addresses: Mas de Fidarege 34 Castelnau-le-Lez Assemblee nationale Palais Bourbon 75 Paris (7e) Tel. 551 60 00 COVELLI, Alfredo Italy Liberal and Allies Group Member of European Parliament since January 1969 Born 22 February 1914 in Bonito, Avellino. Doctor of Letters, Philosophy and Laws. Journalist. Director of various newspapers and periodicals. Member of the Constituent Assembly and secretary of its bureau. Former member of Rome municipal council. PNM national secretary 1947-59. Chairman of PNM parliamentary group 1948-59. PDIUM national secretary and chairman of PDIUM group in the Chamber of Deputies since 1959. Member of Chamber of Deputies since 1946 Parliamentary group: PDIUM Addresses: Camera dei deputati 00100 Roma Tel. 67 60 Via Savastano 20 00197 Roma Tel. 87 00 03 D' ANGELOSANTE, Francescopaolo Italy Non-attached Member of European Parliament since January 1969 B.CJ.m 17 September 1922 in Penne, Pescara. Doctor of Laws. Lawyer. Vice-chairman of the Senate's commission on the European Communities. Member of Senate since 1963 Parliamentary group: PCI Addresses: Via Regina Elena 62 65100 Pescara Tel. 231 24 Senato 00100 Roma Tel. -

GOOD BYE ROLAND DE LA POYPE Honor and the Defense of Freedom
http://www.caffrenchwing.fr AIRSHOW http://www.lecharpeblanche.fr CAF FRENCH WING - BULLETIN MENSUEL - MONTHLY NEWSLETTER http://www.worldwarbirdnews.com Volume 17 - N° 11 - Novembre 2012 EDITORIAL s I was preparing the excellent article Asent by Stéphane Duchemin, about one of the Normandie-Niemen mechanics, Guy Leloup, the terrible news about the death of Roland de la Poype arrived. Decidedly, life is full of those happy or dramatic coincidences… So I changed my plans about this edition of our Newsletter and wrote a modest article intended to pay tribute to a very great man whose popularity was due to his huge modesty, to his great intellect, to his creative spirit, and to his uncountable acts of bravery during the Second World War. Roland de la Poype has joined General Risso, Marcel Albert, and all the members of the Neuneu who have already disappeared, pilots, mechanics, and every man and woman who accomplished their tasks conscientiously in the name of GOOD BYE ROLAND DE LA POYPE Honor and the defense of Freedom. ou will not find any news about the work Yin the hangar this month because illness hit the two main actors of this project, Roger Gouzon and myself. The other volunteers also became rather rare because of their professional and personal occupations, but I hope that they will be more available soon. The list of things to do is still very long. You will find it on the new French Wing web site in the part restricted to members. his web site is progressively built by TBertrand Brown, Stéphane Duchemin, and myself, but if some members feel like helping with the elaboration of its contents, they will be very welcome. -
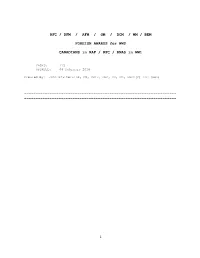
1 AFC / DFM / AFM / GM / DCM / MM / BEM FOREIGN AWARDS for WW2
AFC / DFM / AFM / GM / DCM / MM / BEM FOREIGN AWARDS for WW2 CANADIANS in RAF / RFC / RNAS in WW1 PAGES: 115 UPDATED: 04 February 2018 Created by: John Blatherwick, CM, CStJ, OBC, CD, MD, FRCP(C) LLD (Hon) ================================================================== ================================================================== 1 SECTION F: AIR FORCE CROSS --------------------------- BAR to the AIR FORCE CROSS to the RCAF in WW2 (AFC*) LG+ / CG NAME RANK UNIT NUMBER # DECORATIONS / 06/01/45 HONE, John S/L AFHQ C1294 AFC* ================================================================================================================ ============================================================================================================== AIR FORCE CROSS to the RCAF in WW2 (AFC) LG+ / CG NAME RANK UNIT NUMBER # DECORATIONS / 14/06/45+ ADAMS, Robert Austin F/L 353 SQD J7340 AFC 18/11/44 AGAR, Carlyle Clare F/L 24 EFTS C24744 AFC 17/09/45+ AINSLIE, Thomas Edgar Craig F/L 420 SQD C28055 DFC AFC 17/04/43 AISTROP, Charles Sydney P/O 1 SFTS J13484 AFC 16/06/45 AITKEN, George Dennis F/L 2 WS J15623 AFC 06/01/45 ALEXANDER, Ernest Archibald S/L 1 SFTS J4866 AFC 16/06/45 ALEXANDER, Kenneth Alexander F/L 2 SFTS J10557 AFC 05/01/46 ALLISTON, Edward Arthur F/L 168 (R) J23595 AFC 05/01/46 ANNAN, Douglas Bruce S/L 13 EFTS J4554 AFC 05/01/46 ANDERSON, Gordon John F/O 23 EFTS C29786 AFC 16/06/45 ANDERSON, John Devlin F/O 2 WS J20995 AFC 06/01/45 ANDERSON, Norman Stanley Alton W/C 4 TCHQ C784 AFC 05/01/45 ANDERSON, Thomas George F/L 12 SFTS J4250 AFC 13/05/44 ANDREW, Byron W/C 10 SFTS C1295 AFC 05/01/46 ARCHAMBAULT, Leon Gustave G. -

The Friends Ambulance Unit and the Friends Relief Service, 1939 to 1948
Graduate Theses, Dissertations, and Problem Reports 2019 Training Friends and Overseas Relief: The Friends Ambulance Unit and the Friends Relief Service, 1939 to 1948 Nerissa Kalee Aksamit West Virginia University, [email protected] Follow this and additional works at: https://researchrepository.wvu.edu/etd Part of the Christian Denominations and Sects Commons, European History Commons, and the Holocaust and Genocide Studies Commons Recommended Citation Aksamit, Nerissa Kalee, "Training Friends and Overseas Relief: The Friends Ambulance Unit and the Friends Relief Service, 1939 to 1948" (2019). Graduate Theses, Dissertations, and Problem Reports. 7405. https://researchrepository.wvu.edu/etd/7405 This Dissertation is protected by copyright and/or related rights. It has been brought to you by the The Research Repository @ WVU with permission from the rights-holder(s). You are free to use this Dissertation in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you must obtain permission from the rights-holder(s) directly, unless additional rights are indicated by a Creative Commons license in the record and/ or on the work itself. This Dissertation has been accepted for inclusion in WVU Graduate Theses, Dissertations, and Problem Reports collection by an authorized administrator of The Research Repository @ WVU. For more information, please contact [email protected]. Graduate Theses, Dissertations, and Problem Reports 2019 Training Friends and Overseas Relief: The Friends Ambulance Unit and the Friends Relief Service, 1939 to 1948 Nerissa Kalee Aksamit West Virginia University, [email protected] Follow this and additional works at: https://researchrepository.wvu.edu/etd Part of the Christian Denominations and Sects Commons, European History Commons, and the Holocaust and Genocide Studies Commons Recommended Citation Aksamit, Nerissa Kalee, "Training Friends and Overseas Relief: The Friends Ambulance Unit and the Friends Relief Service, 1939 to 1948" (2019). -

The First Ace
Chapter One The First Ace It is generally agreed that the title ‘ace’ applies to any fighter pilot who has destroyed five or more enemy aircraft in air to air combat. It is also generally agreed that the term originated with the French in the early part of 1915. It is not generally known, however, that the first pilot to earn this accolade was a Frenchman named Roland Garros, who was a lieutenant in the French air force. At the time he was trying out a new device which was fitted to his Morane monoplane. This was very much his own idea, and allowed him to fire a fixed machine gun through the arc of his propeller. It consisted simply of fitting deflector plates to the airscrew blades. The story is told in more detail in later paragraphs, but for the present it is only necessary to note that his success was immediate and decisive. Garros shot down five German aircraft in just over two weeks between l and 16 April 1915. This was a feat absolutely unheard of at the time, and seldom equalled since. He received the Legion of Honour, and his victories were given prominence in most of the Allied newspapers. He became a hero overnight. How the term ‘ace’ came to be applied to him and to future airmen is best told by Arch A Morane-Saulinier Type N aircraft. (AWM H04376) 1 AUSTRALIAN FIGHTER ACES Whitehouse in his book Decisive Air Battles of the First World War: Five victories in sixteen days! That was the initial harvest of Roland Garros’ front-firing guns. -
Aircraft Designed by Kurt Tank NEW in the Late 1930S and Widely Used During World War II
EARLY SUMMER 2018 BRINGING HISTORY TO LIFE CHECK OUT OUR SPECIAL DEALS - SEE PAGES GOOD WHILE SUPPLIES LAST! 60-61. Check Out Our Sci-Fi P. 47 Bring Your Model To Life With Vallejo Paint NEW P. 56 Set Sail With Ships FOCKE-WULF FW190A-8, P.3 P. 42 GREAT PRICES — LIMITED QUANTITIES! P.60 EAGLEQUEST 2018 P.35 See back cover for full details. Order Today at WWW.SQUADRON.COM or call 1-877-414-0434 Dear Friends, I hope you all had a wonderful Father’s Day. Here at Squadron we are regrouping from EagleQuest 27. Another successful event under our belt and a reassurance that our hobby is still going strong. Check out Squadron.com to see the incredible models entered this year. With all the accessories and weathering sets that are on the market today, modeling has reached a new height, where it is not only about the enjoyment of putting a plastic kit together but rather the achievement of being able to finish a competitive model. This flyer is full of great new products you won’t want to miss. One highlight is the new Squadron Signal book SS10206, the F-14 Tomcat by David Doyle on the back cover. This American, two seat, variable-sweep wing Fighter was mainly developed for the US Navy. During its 35-year life span, it underwent many configurations and served as the US. Navy primary maritime interceptor. The F-14 was made extremely popular in 1986 with the release of the movie “Top Gun”. In our TD Premium update sets, we have 6 new items available. -

Guerre De 1939-1945. Archives De L'amicale Des Réseaux Action De La France Combattante
Guerre de 1939-1945. Archives de l'Amicale des réseaux Action de la France combattante 72AJ/3300-72AJ/3404 Relevé détaillé des dossiers individuels effectué par Anne-Marie ROCHON, Olivier MAUGÉ et Alexandre RABETLLAT, avec le concours de Djemel CHAREF, Mathilde GIROS et Yann LE PELVÉ. Inventaire révisé et mis en ligne par Patricia GILLET, conservateur général du patrimoine Première édition électronique Archives nationales (France) Pierrefitte-sur-Seine 2018 1 https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_057246 Cet instrument de recherche a été rédigé dans le système d'information archivistique des Archives nationales. Ce document est écrit en français. Conforme à la norme ISAD(G) et aux règles d'application de la DTD EAD (version 2002) aux Archives nationales. 2 Archives nationales (France) Préface Dans le souci de contribuer aux nombreuses recherches sur les parcours individuels de résistants, et sans attendre le classement de l'ensemble des archives de l'Amicale des réseaux Action, cet instrument de recherche détaille les dossiers nominatifs de ses membres. Il s'agit donc d'un inventaire provisoire, ayant vocation à s'enrichir. 3 Archives nationales (France) INTRODUCTION Référence 72AJ/3300-72AJ/3404 Niveau de description pièce Intitulé Archives de l'Association amicale d'entraide des anciens officiers chargé de missions Action et de leurs collaborateurs recrutés en France, devenue l'Amicale des réseaux Action de la France combattante Date(s) extrême(s) 1940-2002 Importance matérielle et support 8,70 ml (105 articles) -

Niouz04/2000 UK
CONFEDERATE AIR FORCE - FRENCH SUPPORTER SQUADRON Volume 5 - N° 4 Bulletin Mensuel du CAF French Supporter Squadron April 2000 Sommaire Invitation for the Normandie Niemen Association à but non lucratif régie par AIRSHOW est une publication du French Page 1 Current projects la loi de 1901, et enregistrée sous le Supporter Squadron de la Confederate Air Editorial Page 6 numéro 2473 au Journal Officiel du 10 Force, Inc - Toute reproduction entière ou Juillet 1996. Welcome Jean-Claude Miniggio What’s new ? partielle des textes et illustrations contenus dans ce bulletin mensuel est interdite sans Letter of Commendation for the FSS Page 7 Président accord préalable de l’éditeur. Page 2 What’s new ? Col. Bernard DELFINO The Free French in the BoB Ecrire au siège de l’association Page 8 Vice-Président Page 3 19 rue de Cannes 2000/2001 FSS annual dues Col. Stéphane DUCHEMIN The Free French in the BoB Trésorier 93600 Aulnay sous Bois Page 4 L Bird Sponsors Col. Christian FREZARD Tél. & Fax : 0148690457 The Free French in the BoB (End) Code Name Alpha and the FSS Secrétaire E-mail: [email protected] Page 5 The FSS P.X. Col. Yann LE SAOÛT Web Site: http://www.caf-france.com WELCOME Jean-Claude MINIGGIO NEW MEMBER OF THE CAF AND THE FSS The arrival of Jean-Claude Miniggio is an Fond of aviation and a confirmed private pilot, colonel Jean-Claude MINIGGIO is also the proud event that will mark the history of the FSS. owner of two aircraft: A Piper PA19 and a splendid Morane Saulnier 315, fitted with a Salmson Jean-Claude has already announced that engine, whose restoration is almost complete. -

The Poor School Sisters of Notre Dame in Hitler's
“BITTER TIMES:” THE POOR SCHOOL SISTERS OF NOTRE DAME IN HITLER’S GERMANY, 1933 TO 1945 A Dissertation Submitted to the Graduate School of the University of Notre Dame in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy by Martina Cucchiara Doris L. Bergen, Director Graduate Program in History Notre Dame, Indiana November 2011 Copyright 2011 Martina Cucchiara “BITTER TIMES:” THE POOR SCHOOL SISTERS OF NOTRE DAME IN HITLER’S GERMANY, 1933-1945 Abstract by Martina Cucchiara This dissertation focuses on Catholic sisters in modern Germany, with a particular emphasis on Nazi Germany. In the 1930s, nearly one hundred thousand nuns lived in Germany; this figure compares to about 22,000 priests. I present a representative case study of the Poor School Sisters of Notre Dame. With about 4,000 members, the institute of the Poor School Sisters of Notre Dame was one of the largest teaching congregations in Germany in the 1930s. My work destabilizes common historical narratives that associate women’s progress in the modern era only with secularization. Catholic religious vocations in fact offered countless women an alternative to marriage, a higher education, and the chance to enter a profession at a time when opportunities for women contracted in the secular realm. But longstanding saccharine and mocking portrayals of nuns in popular culture, such as in films like The Sound of Music and Sister Act, have contributed to the dismissal of nuns in the modern era as serious historical actors. Clichés of nuns are in fact linked to the women’s contested status in patriarchal Western society that expressed common Martina Cucchiara anxieties about women foregoing marriage and childbearing in favor of a life of public service in all-female communities.