Compte-Rendu JE IHS-CGT Rdv Blois 2014
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Fonds André Fougeron Inventaire
Fonds André Fougeron (1913-1998) Inventaire Versement de 2001 201FGR/1 - 201FGR/29 Instrument de rechercheréalisé par Anysia l’Hôtellier sous la direction de Sandrine Samson octobre 2012 révisé en janvier 2019 © Imec - Tous droits réservés Introduction Identification Producteur : André Fougeron Bbiographie : Autodidacte issu d’un milieu ouvrier, André Fougeron entra en peinture dans les années 1935-1936 et adhéra au Parti communiste français en 1939. Tout en continuant à exposer pendant l’Occupation, il transforma son atelier en imprimerie clandestine et fonda le Front national des arts avec Édouard Goerg et Édouard Pignon. À la Libération, attaché au cabinet de Joseph Billiet, directeur des Beaux-Arts, il fut chargé d’organiser l’épuration de la scène artistique française et de préparer un hommage à Picasso au Salon d’automne de 1944. Élu secrétaire général de l’Union des arts plastiques, il obtint le prix national des Arts et des Lettres (1946). À partir de 1947-1948, s’éloignant d’une certaine tradition moderne proche de Picasso et du fauvisme, Fougeron devint le chef de file du Nouveau Réalisme, trop facilement perçu comme la version française du réalisme socialiste. Sa toile Parisiennes au marché, véritable manifeste pictural, fit scandale au Salon d’automne de 1948. Fidèle à ses convictions communistes, André Fougeron n’a cessé de questionner son époque à travers une œuvre souvent teintée d’allégorie. Durant les années soixante-dix, il fut considéré comme un précurseur de la Nouvelle Figuration critique. Modalité d'entrée Fonds déposé par les ayants droit en 2001. Contenu et structure Présentation du contenu : Une importante correspondance (avec notamment Renato Guttuso, Jean Guillon, Peintres témoins de leur temps, Union des artistes de l'URSS...) et de nombreux dossiers thématiques éclairent tout à la fois l'évolution artistique et les activités militantes au sein du Parti communiste français d'André Fougeron. -

Communistes, Résistants. (1939-1945)
Presse, délits d'opinion. Activités subversives : communistes, résistants. (1939-1945) Répertoire (BB/18/7005-BB/18/7107) Par Françoise ADNES Archives nationales (France) Pierrefitte-sur-Seine 2007 1 https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_024169 Cet instrument de recherche a été encodé en 2012 par l'entreprise Numen dans le cadre du chantier de dématérialisation des instruments de recherche des Archives Nationales sur la base d'une DTD conforme à la DTD EAD (encoded archival description) et créée par le service de dématérialisation des instruments de recherche des Archives Nationales 2 Archives nationales (France) INTRODUCTION Référence BB/18/7005-BB/18/7107 Niveau de description fonds Intitulé Presse, délits d'opinion. Activités subversives : communistes, résistants. Date(s) extrême(s) 1939-1945 Localisation physique Pierrefitte 3 Archives nationales (France) Répertoire (BB/18/7005-BB/18/7107) BB/18/7005 2 BL 1 à 49 Condamnation du journal Le Libertaire, de Fernand Vintringer, gérant, et de Le Meillour, pour provocation à la violence et provocation de militaires à la désobéissance. 28 décembre 1938-23 novembre 1939. (2 BL 1 auquel est joint 2 BL 25). Information sur la diffusion de tracts critiquant la gestion d'Eugène Milliès-Lacroix, sénateur-maire de Dax. 29 décembre 1938-31 août 1939. (2 BL 2). Condamnation du journal La Commune pour provocation de militaires à la désobéissance dans un but de propagande anarchiste, et pour atteinte à l'intégrité du territoire national. 30 décembre 1938-16 mai 1939. (2 BL 3). Condamnation d'Edmond Bechtold, de Strasbourg, pour coups volontaires lors d'une réunion organisée par le Parti communiste. -
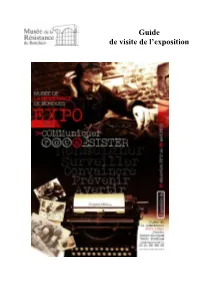
Guide De Visite De L'exposition
Guide de visite de l’exposition 1 En guise d’introduction En lien avec le thème du Concours National de la Résistance et de la Déportation 2012-2013, « Communiquer pour résister. 1940- 1945 », l’exposition proposée par le Musée de la Résistance de Bondues invite à explorer le rôle joué par les moyens de communication dans la lutte contre l’Allemagne nazie et le régime de Vichy. Si l’on définit simplement la communication comme l’acte d’établir des relations avec quelqu’un, on constate que ce rôle est double : la communication des résistants est orientée d’une part vers une forme de propagande et de contre-propagande (communication « externe ») et d’autre part vers l’organisation du « monde résistant » (communication « interne »). En effet, les différentes techniques de communication sont utilisées par les résistants à la fois pour convaincre ceux qui ne résistent pas, soit l’immense majorité de la population française, et nuire aux ennemis. Elles permettent également aux résistants d’échanger entre eux et d’organiser la circulation des informations et du matériel. Quelle qu’en soit la forme, la communication constitue une part non négligeable du travail des résistants. Certains d’entre eux s’y consacrent même exclusivement, au péril de leur vie. Le présent guide de visite reprend chacun des treize panneaux de l’exposition. Chaque panneau fait l’objet d’une synthèse, qui s’efforce de mettre en lumière les acteurs de la Résistance dans une perspective le plus souvent régionale. Toutes les synthèses sont suivies de quelques documents qui les illustrent ou les approfondissent. -

Journal OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
* Année 4964 . -- N° 19 A. N. Le Numéro . 0,20 F Jeudi 16 Avril 1964 * a jOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DÉBATS PARLEMENTAIRES ASSEMBLÉ" NATIONALE COMPTE RENDU INTÉGRAL DES SÉANCES Abonnements à l'Ediflon des DEBATS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE : FRANCE ET OUTRE-MER : 22 F ; ETRANGER : 40 !r (Compte chèque postal : 9063.13, Paris .) PRIÈRE DE JOINDRE LA DERNIÈRE BANDE DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION POUR LES CHANGEMENTS D'ADRESSE aux renouvellements et réclamations 26, RUE DESAIX, PARIS 15• AJOUTER 0,20 F CONSTITUTION DU 4 'OCTOBRE 1958 2° Législature 2' SESSION ORDINAIRE DE 1963-1964 COMPTE RENDU 1NTECRAL - 6 e SEANCE Séance du Mercredi 15 Avril 1964. Art . 3. SOMMAIRE M. Longequeue. 1. — Haute Cour de justice. — Scrutin pour l'élection de deux Adoption Je l'article 3. jurés titulaires (p . 756). Art. 4. — Adoption. 2. — Retrait de l'ordre du jour d'un projet de loi (p . 756). MM. le président, Marcellin, ministre de la santé publique et Article additionnel. de la population. Amendement n° 3 de M . Fanton : MM. Fanton, le rapporte» 3. — Vaccination antipoliomyélitique . — Discussion d'un projet de le ministre de la santé publique et de la population. loi (p. 756). Amendement du Gouvernement. M . Mainguy, rapporteur de la commission des affaires culturelles, Retrait de l'amendement n° 3 est adoption de l'amendement dE familiales et sociales. Gouvernement. Discussion générale : MM. Labéguerie, Tourné, Marcellin, ministre Explication de vote : M. Tourné. de la santé publique et de la population. — Clôture. Adoption de l'ensemble du projet de loi. Art. 1•• et 2. — Adoption. Après l'article 2. -

Annexe : Assemblée Consultative Provisoire De Paris
Archives nationales (Paris) Annexe du répertoire : Assemblée consultative provisoire (Paris) 1944-1945 (C//15247 à C//15281) par Anne-Marie Gouriou, archiviste, revu et mis à jour par Roseline Salmon, conservateur du patrimoine En collaboration avec le Département de l'informatique des Archives nationales (Paris) Paris Archives nationales 2008 1 Archives nationales (Paris) ASSEMBLEE CONSULTATIVE PROVISOIRE : PARIS I. COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE LISTE ALPHABETIQUE DES DELEGUES1 A ABOULKER José (V. 06.12.44) ANXIONNAZ Paul* (V. 07.11.44) ARRIGHI Paul (V. 20.07.45) ASTIER Marcel* (V. 07.11.44) ASTIER DE LA VIGERlE (D') Emmanuel (V. 07.11.44) ASTIER DE LA VIGERlE (D') Jean (V. 20.07.45) AUBRAC Lucie (V. 07.11.44) AUDEGUIL Jean-Fernand (V. 07.11.44) AURANGE Paul* AURIOL Vincent* (V. 07.11.44) AVININ Antoine (V. 07.11.44) B BACON Paul (V. 07.11.44) BADIE Vincent (V. 20.07.45) BASTID Paul (V. 07.11.44) BASTIDE Joseph (V. 09.11.44) BAUD André (V. 09.11.44) BAUMEL Jacques (V. 07.11.44) BAYET Albert (V. 07.11.44) BECART Etienne (V. 20.07.45) BEDIN Camille (V. 20.07.45) BENDJELLOUL Mohamed * BENET Jacques (V. 07.11.44) BERGERON Louis (V. 23.02.45) BERLIOZ Joanny* (V. 07.11.44) BERTIN-CHEVANCE Maurice voir : CHEVANCE Maurice BINE Robert (V. 07.11.44) BIONDI Jean (V. 20.07.45) BIRIEN Jean (Robert KASKOREFF) (V. 07.11.44) BLANC Raymond* BLANK Aristide (V. 07.11.44) BLOCH Jean voir : PIERRE-BLOCH Jean BLOCQ-MASCART Maxime (V. 07.11.44) BOILLOT Félix* 1 L'astérisque suivant certains noms de délégués signifie leur appartenance à l'Assemblée consultative d'Alger. -

Guide Des Sources « La Résistance En Pas-De-Calais, 1940-1945 »
GUIDE DES SOURCES Guide des sources « La Résistance en Pas-de-Calais, 1940-1945 » LA RÉSISTANCE EN PAS-DE-CALAIS 1940-1945 Guide des sources Par : Laura SCHRIVE, stagiaire en Master 2 « Archivistique et Monde du Travail » de l’Université de Lille au Comité d’Histoire du Haut-Pays (avril-juillet 2019). Sous la direction de : René LESAGE, historien, Président du Comité d’Histoire du Haut-Pays, Ivan PACHEKA, attaché de conservation du patrimoine aux Archives départementales du Pas-de-Calais. Édité par : Fauquembergues Août 2019 2 | Comité d’Histoire du Haut-Pays – www.resistancepasdecalais.fr Guide des sources « La Résistance en Pas-de-Calais, 1940-1945 » INTRODUCTION Quelques aspects de la résistance dans le Pas-de-Calais La Résistance dans le Pas-de-Calais est un phénomène d’ampleur dont l’importance s’explique par la situation du département, qui, détaché de la zone occupée, est directement administré par les autorités allemandes bruxelloises. Zone sensible au positionnement et aux activités industrielles stratégiques, le département du Pas-de-Calais dut faire face à une présence constante des forces allemandes, aux difficultés de la vie quotidienne et aux nombreux bombardements. Par cette situation, la zone rattachée du « Nord-Pas-de-Calais » offre un contexte particulièrement négatif. Dans une région très largement couverte par les forces d’occupation, les agents de la Gestapo veillent constamment, la communication est rendue difficile et la circulation est soumise à de nombreuses restrictions. Face à cette situation complexe, la résistance s’organise, ses moyens d’action variant en fonction de la densité des troupes d’occupation et des méthodes répressives de l’ennemi. -

Jour:Nu Officiel De La République Fbançaise
* Année 1963-1964 . — N" 102 A. N. Le Numéro 0,5o F Mercredi 9 Octobre 1963 * JOUR:NU OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FBANÇAISE DÉBATS PARLEMENTAIRES ASSEMBLÉE NATIONALE COMPTE RENDU INTÉGRAL DES SÉANCES Abonnements à I 'Edltion des DEBATS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE : FRANCE ET OUTRE-MER : 22 F ; ETRANGER : 40 F (Compte cheque puslnl : 9063 .13, Paris.) PRIÈRE DE JOINDRE LA DERNIÈRE BANDE I DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION POUR LES CHANGEMENTS D'ADRESSE aux renouvellements et réclamations 26, RUE DESAIX, PARIS 15' AJOUTER 0,20 F CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 2" Législature 1'° SESSION ORDINAIRE DE 1963 -1964 COMP 'I' i IIENI).l IN'l'E( :ltAL — J 0 SEANCE Séance du Mardi 8 Octobre 1963 . Art . 36. SOMMAIRE Amendement n° 45 de la commission tendant à la suppres- sion de l'article : MM . le rapporteur, le ministre de la construction. 1 . — Construction d'immeubles en copropriété à usage d ' habita- — Adoption. tion . — Suite de la discussion d ' un projet de loi adopté par le Sénat Art. 37. (p. 5049). Amendement n° 46 de la commission : MM . le rapporteur, Art . 33. le ministre de la construction, Carter, de Tinguy . — Rejet. Amendement n° 41 de la commission spéciale : MM. Laurin, Amendement n " 47 de la commission : M . le rapporteur. — Rejet. rapporteur de la commission spéciale ; Maziol, ministre de la Amendement n° 48 de la commission . — Rejet. construction . — Adoption. Adoption de l 'article 37. Adoption de l ' article 33 modifié. Art . 37 bis. Art . 34. Amendement n° 49 de la commission tendant à une nou- velle rédaction et sous-amendement n° 265 de M . -

Entrer En Résistance
19 CONCOURS NATIONAL DE LA RÉSISTANCE 40Entrer ET DE LA DÉPORTATION en Résistance Comprendre, refuser, résister ! Livret d’EXPOSITION relatif à la thématique du CNRD 2020 MUSÉE DE LA RÉSISTANCE DE BONDUES 01 - ENTRÉE EN GUERRE : 3 septembre 1939 02 - « L’étrange DÉFAITE » 03 - Terres du NORD, terre de RÉSISTANCE ire 04 - RÉPONDRE À L’APPEL : depuis la France A 05 - RÉPONDRE À L’APPEL : depuis l’Empire 06 - RÉSISTANCE des corps constitués et m intermédiaires 07 - « FAIRE QUELQUE CHOSE » : les actes spontanés m 08 - Résister avec ou sans DE GAULLE ? O 02 09 - La PRESSE CLANDESTINE en 1940 S 10 - L’aidE À L’évASION et les PREMIÈRES FILIÈRES FOCUS : Ils s’engagent en 1940 : hommage aux fusillés du Fort de Bondues 194011 - Le PCF face aux décisions de l’URSS < 12 - De Gaulle découvre LA RÉSISTANCE INTÉRIEURE FOCUS : Mobiliser les Français : le rôle de Radio Londres 13 - VICHY révèle son visage Lexique Bibliographie 1940, ENTRER EN RÉSISTANCE : COMPRENDRE, REFUSER, RÉSISTER En lien avec le thème du Concours National de la Résistance et de la Déportation 2019-2O20, « 1940, ENTRER EN RÉSISTANCE : COMPRENDRE, REFUSER, RÉSISTER », ... ... l’exposition réalisée par le Musée de ION ION la Résistance de Bondues, l’association Souvenir de la Résistance et des fusillés cT du Fort de Bondues est destinée aux élèves des établissements qui préparent le CNRD. INTRODU Le livret reprend l’essentiel du texte des différents panneaux de l’exposition et quelques documents présentés. Pour compléter l’exposition, ou plutôt la prolonger, nous proposons des « focus » sur des aspects ne pouvant être intégrés 03 dans l’exposition afin d’en privilégier la lisibilité. -

Janvier Courtecuisse, De L'ombre À La Lumière », Pays De Pévèle, SHPP
Heddebaut Monique, « Janvier Courtecuisse, de l’ombre à la lumière », Pays de Pévèle, SHPP, 2017, n° 82 La rue Janvier Courtecuisse au lieudit Lesrues, à proximité du pont de chemin de fer, a été inaugurée par le Docteur Vandelanoitte, maire de Templeuve (1977-1987). Si les Templeuvois connaissent aujourd’hui son nom, en revanche, bien peu d’entre eux savent qui était ce modeste agriculteur et surtout ils ignorent le rôle capital qu’il a joué dans la Résistance. Or, son engagement politique, puis dans la clandestinité, lui ont fait plus que croiser la route des dirigeants nationaux du Parti communiste et de l’Internationale communiste. Mais les paysans ont peu témoigné et l’action des résistants dans le monde rural était peu visible. Les préjugés anciens sur l’individualisme et le conservatisme des paysans restent donc à nuancer ainsi que le montre l’itinéraire de Janvier Courtecuisse. L’entrée en guerre Quelques dates et jalons historiques sont nécessaires pour comprendre la place et l’implication de Janvier Courtecuisse dans l’enchaînement des événements qui vont se précipiter avant même la déclaration de guerre entre la France et l’Allemagne le 3 septembre 1939. Le 23 août 1939 est signé entre l’Allemagne et l’Union soviétique un pacte de non-agression connu aussi sous le nom de pacte Ribbentrop-Molotov (du nom des deux ministres des Affaires étrangères qui ont négocié l'accord). Le Parti communiste français (P.C.F.) est alors sommé de condamner l’Union soviétique. Il approuve le pacte tout en réaffirmant la nécessité de rassembler la nation contre la menace hitlérienne. -
Études Rurales, 171-172 | 2004, « Les « Petites Russies » Des Campagnes Françaises » [Online], Online Since 01 July 2004, Connection on 22 September 2020
Études rurales 171-172 | 2004 Les « petites Russies » des campagnes françaises Rose Marie Lagrave (dir.) Electronic version URL: http://journals.openedition.org/etudesrurales/2974 DOI: 10.4000/etudesrurales.2974 ISSN: 1777-537X Publisher Éditions de l’EHESS Printed version Date of publication: 1 July 2004 Electronic reference Rose Marie Lagrave (dir.), Études rurales, 171-172 | 2004, « Les « petites Russies » des campagnes françaises » [Online], Online since 01 July 2004, connection on 22 September 2020. URL : http:// journals.openedition.org/etudesrurales/2974 ; DOI : https://doi.org/10.4000/etudesrurales.2974 This text was automatically generated on 22 September 2020. © Tous droits réservés 1 TABLE OF CONTENTS Le marteau contre la faucille Introduction Rose Marie Lagrave I. Terres d'implantation, terres d'élection L’implantation du PCF Bastions ruraux, bastions urbains Julian Mischi and Michel Streith La résistance du vote rural (1981-2002) Jean-Claude Bontron and Agnès Roche Socialistes et communistes dans l’entre-deux-guerres Edouard Lynch Être communiste en milieu rural Julian Mischi La petite propriété fait le communisme (Limousin, Dordogne) Laird Boswell Paradoxes et diversité du communisme rural drômois (1945-1981) Alain Chaffel Les nouveaux « Bonnets rouges » de Basse-Bretagne Ronan Le Coadic II. Un département témoin : l'exception bourbonnaise Un terreau favorable Agnès Roche Tensions entre socialisme et communisme en Bourbonnais (1945-2002) Fabien Conord Propagande et effets de propagande Le canton de Bourbon-l’Archambault -

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 2° Législature
ASSEMBLEE NATIONALE — 2° SEANCE DU 4 JUIN 1963 3175 CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 2° Législature 2' SESSION ORDINAIRE DL 1962-1963 COMPTE RENDU INTEGRAL — 47° SEANCE 2° Séance du Mardi 4 Juin 1963. SOMMAIRE — 2 — 1. — Nomination par suite de vacance d'un représentant suppléant de la France à l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe HAUTE COUR DE JUSTICE (p. 3175). 2. — Haute Cour de justice. — Scrutin pour l'élection du président Scrutin pour l'élection du président. (p. 3175). 3. — Priorité de l'emploi des réformés. — Adoption d'un projet M. le président. L'ordre du jour appelle le scrutin dans Ies de loi (p. 3175). salles voisines de la salle des séances, pour l'élection du prési - MM. Vanier, rapporteur suppléant de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales ; Foyer, garde des sceaux, dent de la Haute Cour de justice, instituée par l'ordonnance du ministre de la justice . _ 18 roiembre 1944 modifiée. Article unique . — Adoption. Les candidatures ont été affichées à partir du 28 mai 1963 4. — Droit à séparation des victimes de la silicose et de l'asbestose et publiées à la suite du compte rendu intégral des séances du professionnelles. — Discussion, en deuxième lecture; d'une pro- 28 et du 31 mai et au Journal officiel des 29 mai et 1" juin. position de loi (p. 3176). Le scrutin est secret. La majorité absolue des suffrages expri- M. Darchicourt, rapporteur de la commission des affaires cultu- relles, familiales et sociales. _més est requise aux deux premiers tours de scrutin - au troisième Discussion générale : MM . -

Jour Al Officiel De La République Française
* * Année 1964. — Na 37 A. N. Le Numéro : 0,50 F Vendredi 22 Mai 4964 JOUR AL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DÉBATS PARLEMENTAIRES ASSEMBLÉE NATIONALE COMPTE RENDU INTÉGRAL DES SÉANCES Abonnements è I'Edttion des DEBATS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE t FRANCE ET OUTRE-MER : 22 F ; ETRANGER : 40 F (Compte chèque postal : 9063-13, Paris .) PRIÈRE DE JOINDRE LA DERNIÈRE BANDE DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION Potin LES CHANGEMENTS D' ADRESSE aux renouvellements et réclamations 26, RUE DESAIX, PARIS 15' AJoUTER 0,20 F CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 2° Législature 2° SESSION ORDINAIRE DE 1963-1964 COMPTE RENDU INTECRAL -- SEANCE Séance du Jeudi 21 Mai 1964. Amendements n°' 6 de M . Coste-Floret et 25 de M. Nessler: SOMMAIRE MM. Dubuis, Nessler, le rapporteur, le ministre de l'intérieur. 1. — FIxation de l'ordre du jour (p . 12O~ ;. Rejet, au scrutin, de l'amendement n° 6. 2. — Rappel au règlement (p. 1296). Retrait de l'amendement n° 25. MM. Gaudin, le président. Amendement n° 26 de M. Nessler. — Retrait. Amendement n° 37 de M . Vivien : MM . Vivien, le rapporteur, le 3. — Déclaration de l'urgence d'un projet de loi (p . 1297). ministre de l'intérieur. — Retrait. 4. — Elections municipales dans les villes de plus de 30 .000 habitants. Amendement n° 5 de M . Coste-Floret et sous-amendement n° 24 — Suite de la discussion, après déclaration de l'urgence, d'un de M. Delachenai et amendement n° 8 de la commission : projet de loi (p . 1297). MM. Dubuis, Delachenal, le rapporteur, le ministre de l'intérieur. Discussion générale (suite) : MM.