03/02/2021 Prendre L'air
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Coastwatcher
13 JUN-CTWG Op Eval TRANEX TBA-JUL CTWG Encampment 21-23 AUG-CTWG/USAF Evaluation Missions for 15-23 AUG-NER Glider Academy@KSVF America 26-29 AUG-CAP National Conference Semper vigilans! 12 SEP-Cadet Ball-USCGA Semper volans! CADET MEETING REPORT The Coastwatcher 24 February, 2015 Publication of the Thames River Composite Squadron Connecticut Wing Maj Roy Bourque outlined the Squadron Civil Air Patrol Rocketry Program and set deadlines for Cadet submission of plans. 300 Tower Rd., Groton, CT http://ct075.org . The danger of carbon monoxide poisoning was the subject of the safety meeting. C/2dLt Jessica LtCol Stephen Rocketto, Editor Carter discussed the prevention and detection of [email protected] this hazardous gas and opened up the forum to comments and questions from the Cadets. C/CMSgt Virginia Poe, Scribe C/SMSgt Michael Hollingsworth, Printer's Devil C/CMSgt Virginia Poe delivered her Armstrong Lt David Meers & Maj Roy Bourque, Papparazis Lecture on the “The Daily Benefits of the Hap Rocketto, Governor-ASOQB, Feature Editor Aerospace Program.” Vol. IX 9.08 25 February, 2015 Maj Brendan Schultz delivered his Eaker Lecture explaining the value of leadership skills learned in SCHEDULE OF COMING EVENT the Cadet Program and encouraged Cadets to apply their learning to the world outside of CAP. 03 MAR-TRCS Staff Meeting 10 MAR-TRCS Meeting C/SrA Thomas Turner outlined the history of 17 MAR-TRCS Meeting rocket propulsion from Hero's Aeopile to the 21 MAR-CTWG WWII Gold Medal Ceremony landing on the moon. He then explained each of 24 MAR-TRCS Meeting Newton's Three Laws of Dynamics and showed 31 MAR-TRCS Meeting their applications to rocketry. -

3-VIEWS - TABLE of CONTENTS to Search: Hold "Ctrl" Key Then Press "F" Key
3-VIEWS - TABLE of CONTENTS To search: Hold "Ctrl" key then press "F" key. Enter manufacturer or model number in search box. Click your back key to return to the search page. It is highly recommended to read Order Instructions and Information pages prior to selection. Aircraft MFGs beginning with letter A ................................................................. 3 B ................................................................. 6 C.................................................................10 D.................................................................14 E ................................................................. 17 F ................................................................. 18 G ................................................................21 H................................................................. 23 I .................................................................. 26 J ................................................................. 26 K ................................................................. 27 L ................................................................. 28 M ................................................................30 N................................................................. 35 O ................................................................37 P ................................................................. 38 Q ................................................................40 R................................................................ -

Abstracts from the Scientific and Technical Press Titles And
April, 1944 Abstracts from the Scientific and Technical Press (No. 121. March, 1944) AND Titles and References of Articles and Papers Selected from Publications (Reviewed by R.T.P.3) TOGETHER WITH List of Selected Translations (No. 67) London : •THE ROYAL AERONAUTICAL SOCIETY" with which is incorporated "The Institution of Aeronautical Engineers" 4, Hamilton Place, W.I Telephone: Grosvenor 3515 (3 lines) ABSTRACTS FROM THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL PRESS. Issued by the Directorates of Scientific Research and Technical Development, Air. Ministry. (Prepared by R.T.P.3.) No. 121. MAECH, 1944. Notices and abstracts from the Scientific and Technical Press are prepared primarily for the information of Scientific and Technical Staffs. Particular attention is paid to the work carried out in foreign countries, on the assumption that the more accessible British work (for example that published by the Aeronautical Research Committee) is already known to these Staffs. Requests from scientific and technical staffs for further information of transla tions should be addressed to R.T.P.3, Ministry of Aircraft Production, and not to the Royal Aeronautical Society. Only a limited number of the articles quoted from foreign journals are trans lated and usually only the original can be supplied on loan. If, however, translation is required, application should be made in writing to R.T.P.3, the requests being considered in accordance with existing facilities. NOTE.—As far as possible, the country of origin quoted in the items refers to the original .source. American Bomb Types. (Inter. Avia., Nos. 898-899, Dec. nth, 1943, pp. 21-22.) (121/1 U.S.A.) Depending upon the use to which they are put, the following American bomb designs are in use:— (1) DEMOLITION BOMBS. -

Avions Civils
SOMMAIRE DU VOLUME I LA CONDUITE DES PROGRAMMES CIVILS AVANT-PROPOS ET REMERCIEMENTS........................................................................... 3 PREFACE.............................................................................................................................. 5 PRESENTATION GENERALE ............................................................................................. 9 CHAPITRE 1 PRESENTATION DE L’ACTIVITE...................................................................................... 11 LE MARCHE DU TRANSPORT AERIEN .................................................................................. 11 Le passager et l’évolution du trafic.......................................................................................... 11 Les compagnies et la flotte d’avions ....................................................................................... 13 LA CONSTRUCTION DES AVIONS CIVILS .............................................................................. 14 Les caractéristiques de l’activité.............................................................................................. 14 La compétition et son évolution............................................................................................... 18 La dimension économique et monétaire ................................................................................. 20 L’ ADMINISTRATION ET SES MISSIONS ................................................................................. 22 La tutelle militaire de -

Les Avions NIEUPORT-DELAGE
Les avions NIEUPORT-DELAGE Les avions Nieuport-Delage Par Gérard Hartmann Le Nieuport-Delage NiD-29 V n° 10 vainqueur de la Coupe Gordon-Bennett 1920, piloté par Joseph Sadi-Lecointe. (Catalogue constructeur). 1 Les avions NIEUPORT-DELAGE Comme toute la construction aéronautique Nieuport-Astra française, Nieuport est frappé par les taxes de guerre votées en avril 1920 et la société est mena- En novembre 1917, les usines Nieuport cée de disparition. Des 4 200 ouvriers employés d’Issy-les-Moulineaux emploient 3 600 ouvriers dans les usines d’Issy-les-Moulineaux en octobre sur sept ateliers de 4 500 m2. Les usines Astra de 1918 ne subsistent plus que 650 personnes en Billancourt ont suivi la même évolution et 1923. Ce sont les capitaux nouveaux des action- l’atelier d’Argenteuil (ex Tellier) est devenu une naires (en particulier la famille Deutsch de la usine. En effet, en août 1918, Alphonse Tellier Meurthe), le succès du NiD-29 C1 et les ventes à dont la santé se détériore vend ses ateliers du l’étranger qui vont la sauver de la disparition. quai de Seine à Argenteuil à la Société Nieuport. Le même mois, le NiD-29 C1, meilleur appa- reil jamais réalisé à Issy-les-Moulineaux chez Nieuport, débute ses essais. Avions Nieuport utilisés par l’aviation américaine en France, 1918. Le 24 novembre 1919, Henry Deutsch de la Meurthe propriétaire de l’ensemble de ces usines meurt à 73 ans au château de Romainville à Ec- quevilly (Yvelines). Forts des licences de fabrica- tion vendues à l’étranger et des revenus pétro- liers (la famille créa la première essence Le 25 septembre 1920 à Etampes, Kirsch (1892-1969) sur Nieu- d’aviation en France, la société des pétroles Jupi- port 29 bat le record du monde de vitesse, avec 269,058 km/h. -
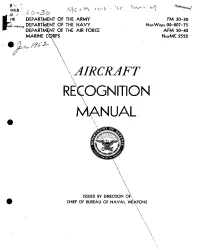
\Aircraft Recognition Manual
Jf V t 9fn I 4-'!- Vw'^ ' 'o | ^ renai; 408.$ /•> ,A1.AI / -3o FM DEPARTMENT OF THE ARMY FM 30-30 DEPARTMENT OF THE NAVY NavWeps 00-80T-75 DEPARTMENT OF THE AIR FORCE AFM 50-40 MARINE CORPS NavMC 2522 \AIRCRAFT RECOGNITION MANUAL SI ISSUED BY DIRECTION OF\ CHIEF OF BUREAU OF NAVAL WEAPONS \ \ I 4 DEPARTMENT OF THE ARMY FM 30-30 DEPARTMENT OF THE NAVY NavWeps 00-80T-75 DEPARTMENT OF THE AIR FORCE AFM 50-40 MARINE CORPS NavMC 2522 AIRCRAFT RECOGNITION MANUAL •a ISSUED BY DIRECTION OF CHIEF OF BUREAU OF NAVAL WEAPONS JUNE 1962 DEPARTMENTS OF THE ARMY, THE NAVY AND THE AIR FORCE, WASHINGTON 25, D.C., 15 June 1962 FM 30-30/NAVWEPS 00-80T-75/AFM 50-40/NAVMC 2522, Aircraft Recognition Manual, is published for the information and guidance of all concerned. i BY ORDER OF THE SECRETARIES OF THE ARMY, THE NAVY, AND THE AIR FORCE: G. H. DECKER, General, Umted States Army, Official: Chief of Staff. J. C. LAMBERT, Major General, United States Army, The Adjutant General. PAUL D. STROOP Rear Admiral, United States Navy, Chief, Bureau of Naval Weapons. CURTIS E. LEMAY, Official: Chief of Staff, United States Air Force, R. J. PUGH, Colonel, United States Air Force, Director of Administrative Services. C. H. HAYES, Major General, U.S. Marine Corps, Deputy Chief of Staff (Plans). H DISTRIBUTION: ARMY: Active Army : DCSPER (1) Inf/Mech Div Co/Btry/Trp 7-2 44-112 ACSI (1) (5) except Arm/Abn Div 7- 44-236 52 DCSLOG (2) Co/Trp (1) 8- 44-237 137 DCSOPS(5) MDW (1) 8-500 (AA- 44-446 ACSRC (1) Svc Colleges (3) AH) 44447 CNGB (1) Br Svc Sch (5) except 10-201 44^536 -

L'arsenal De L'aéronautique
L’impressionnant bimoteur prototype VG 10-02 en cours de montage durant l’hiver 1944-1945. L’Arsenal de l’aéronautique Ce devait être une société laboratoire, un modèle. Ce ne fut qu’un constructeur de plus, mais ses ingénieurs avec l’assistance des Centre d’essais mirent au point toutes les techniques modernes. 1 Capable d’enterrer les meilleures idées et les projets les plus utiles, le corbillard de la mort est un vé- hicule commandé par trois forts leviers : la bêtise, la mollesse et la fainéantise. On repère le premier à son inscription : « je ne sais pas », le second porte la mention : « je ne veux pas », le troisième : « ce n’est pas à moi de la faire ». Gérard Hartmann, 33 ans d’expérience professionnelle. 2 Une société modèle Dans les années trente, les députés (qui votent les budgets) et les dirigeants militaires français réalisent que par suite de manque de concentration et de partage des compétences, l’industrie aéronautique nationale a pris du re- tard par rapport aux grandes nations étrangè- res, Allemagne, Italie, Russie, Etats-Unis, Grande-Bretagne. C’est pourquoi ils décident de doter la France des structures adéquates. Avant même l’arrivée au pouvoir du Front po- pulaire, le rapporteur du budget de l’Air, le député socialiste Pierre Renaudel (1871-1935) défend l’idée d’une « société d’étude et de construction aéronautique modèle » (d’Etat). Ce sera L’Arsenal de l’aéronautique. La Grande soufflerie de Chalais-Meudon, inaugurée en 1934. Le Centre d’Essais des Moteurs et des Hélices de l’aviation militaire française passe sous le contrôle du ministère de l’Air. -

1991: AOPA Pilot TB Article
imagine gathering Boeing, McDonnell models may remain in production. Douglas, General Dynamics, Bell Heli- .The second Piper asset that most in- ~. copters, and Mooney under a single cor- Socata needs more terests Socata is a nationwide network of porate umbrella belonging to the federal service centers. Many of these Piper- government. production capacity affiliated fixed-base operations could To play the analogy out a little fur- for its piston singles take on wholesale distribution and retail ther, Mooney, the small airplane manu- sales, just as they did before Piper went facturer in the group, would be buying and the TBM 700 to factory-direct sales. Piper. There is more than a little irony in turboprop single. Socata's u.s. subsidiary, Aerospatiale that analogy because Mooney is itself a General Aviation (AGA), located in French-owned company. Socaia's home near Tarbes, France. Grand Prairie, Texas, has been distribut- Socata has been interested in Piper ing airplanes through dealers for six since 1970, the year Socata became a ager of sales. Topping the list is Piper's years-about 300 TB-series airplanes part of Aerospatiale. Before Millar product line, which ranges from the Ca- are operating in the United States-but bought Piper in 1987, Socata had tried det primary flight trainer to the Chey- it has been an uphill effort. AGA has to purchase the rights to the Malibu. enne 400 twin turboprop. By buying only recently achieved stability in its However, Forstmann Little, Piper's par- Piper, Socata instantly acquires a com- sales network, and many pilots still are ent at the time, wasn't interested in sell- plete product line. -

Confédérafion Générale Du Travail CFTC
CGT : Confédération générale du travail 1895 : Congrès constitutif de la confédération générale du travail CGT à Limoges du 23 au 28 septembre. Les principaux piliers en sont la fédération du livre et celle des cheminots, mais de nombreux métiers rejoindront la CGT par la suite. CFTC : Confédération française des travailleurs chrétiens 1919 : Les dirigeants du syndicat des employés du commerce et de l’industrie sont à l'initiative de la fondation de la CFTC les 1er et 2 novembre 1919, regroupant 321 syndicats et se réclamant de l’encyclique Rerum Novarum. Son objectif est de contrer la toute-puissance de la CGT dans le milieu ouvrier. CFE-CGC : Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres 1944 : La CGC a été créée le 15 octobre 1944. Catégorielle, la CGC a élargi son champ en devenant CFE-CGC en 1981, s'ouvrant aux techniciens, agents de maîtrise, ... CGT-FO : Force Ouvrière 1948 : Le 12 avril 1948 a lieu le congrès constitutif de Force Ouvrière. La décision de scission d’une branche de la CGT pour la création du syndicat Force Ouvrière a été précipité en septembre 1947 lors de la prise d’opposition de la CGT au plan Marshall (plan américain pour aider la reconstruction de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale). CFDT : Confédération française démocratique du travail 1964 : Après la Libération, une minorité de gauche, regroupée dans la tendance « reconstruction », anime un débat interne en faveur de la « déconfessionalisation » de la CFTC. La rupture se produit en 1964 : le congrès extraordinaire des 6 et 7 novembre transforme la CFTC en CFDT. -

Pionniers En Rhone Alpes
LES PIONNIERS DE L'AVIATION DANS LE DEPARTEMENT DU RHÔNE, AVANT 1914 LES PIONNIERS DE L'AVIATION DANS LE DEPARTEMENT DU RHÔNE, AVANT 1914 LOUP , Michel. Cet ouvrier givordain et lyonnais fut le précurseur de l’aviation lyonnaise. Il avait dessiné en 1852 le premier projet français d’«aéroplane». C’était une sorte de plan de glissement à profil d’oiseau, incorporant de part et d’autre de l’axe de déplacement, deux propulseurs quadripales emplumés et rotatifs que Loup nomma ses «ailes». La machine reposait sur deux roues en tandem ou sur un train tricycle. Mais il resta muet sur la nature et l’emplacement de la machine motrice qui aurait pu insuffler aux deux «ailes» l’énergie indispensable. Dans une brochure publiée en 1853, et intitulée «Solution du problème de la locomotion aérienne», Michel Loup a décrit son propulseur. En 1869, Michel Loup prend la direction d'une société d'aviation qui vient de se créer. LETUR ou LETURE , Louis-Charles, né en 1801, en région lyonnaise. En 1852, il dépose un brevet pour une machine volante à ailes battantes, munie d'un parachute. Les essais ne donnèrent guère de résultats. Le 27 juin 1854, à Londres, il fut grièvement blessé dans sa nouvelle tentative et mourut quelques jours plus tard. SIVAL-LASERVE, Jean-Désiré, né le 17 mars 1828 à Lyon. Dès l’âge de 25 ans, il s’occupe activement de perfectionner le matériel de tissage de son père et, plus tard, des métiers à tulle. Mais il se passionnait aussi pour le plus lourd que l’air. -

Der Lange Schatten Der Rüstung: Die Entwicklung Der Luftfahrtindustrie Im Raum Toulouse Von Der Mitte Der 1930Er Jahre Bis 1970
Der lange Schatten der Rüstung: Die Entwicklung der Luftfahrtindustrie im Raum Toulouse von der Mitte der 1930er Jahre bis 1970 Inauguraldissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Philosophie der Fakultät für Geschichtswissenschaft der Ruhr-Universität Bochum vorgelegt von Bettina Glaß aus Beckum Bochum, im April 2004 Meinen Eltern Ute und Heinz Glaß Inhalt Abkürzungen Vorwort Einleitung 1 1. Verstaatlichung und strategische Dezentrali- 17 sierung: Schaffung eines neuen institutionellen Umfeldes (1936 – Juni 1940) 1.1. Die Verstaatlichung der Luftfahrtindustrie 19 1936/1937 und ihre Auswirkungen auf den Raum um Toulouse 1.2. Die Rolle der Caisse de Compensation pour la 38 Décentralisation de l'Industrie Aéronautique beim Ausbau der Luftfahrtindustrie im Raum Toulouse 1.3. Rüstung und ihre Folgen: Die Anpassung des 46 institutionellen Umfeldes 2. Überleben um jeden Preis. Die Luftfahrtin- 50 dustrie im Raum Toulouse und die deutsche Besatzung 2.1. Für die Luftfahrtindustrie zuständige Organisa- 51 tionen unter der deutschen Besatzung 2.2. Produktion der Luftfahrtunternehmen im Raum 60 Toulouse bis zum Einmarsch der deutschen Truppen im November 1942 2.3. Wende zur vollständigen Ausnutzung der Luft- 99 fahrtindustrie im Raum Toulouse für die deutsche Rüstung 2.3.1. Produktion der Luftfahrtunternehmen im Raum 101 Toulouse für das Deutsche Reich, November 1942 bis August 1944 2.3.2. Der Entzug von Maschinen und Arbeitskräften im 113 Raum Toulouse 2.4. Das Beispiel der Société d’exploitation des 124 matériels Hispano-Suiza in Tarbes 2.5. Die Schäden durch alliierte Bombardements 130 2.6. Der Beitrag der französischen Luftfahrtindustrie 138 zu den Rüstungsbemühungen des Dritten Reiches 1940 bis 1944 3. -

Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis Zur Gecchichte das Flugzeugs 7 7 Transavia PI-12 „Airtruk'7PL-12 U „Flying CHINA Mango" 36/570 1. Die Nachahmung des Vogelflugs 77 Harbin C-11 57/572 „Jie-Fang" 57/572 2. Die Vorbilder Nanchang F-6bis 58/572 für den Flug des Menschen 12 BELGIEN „Peking-1" 58/572 3. Die ersten Motorflugzeugprojekte 12 Avions Fairey „Tipsy Nipper" 37/570 4. Die Verwirklichung des Gleitflugs- SABCAS-2 37/570 Voraussetzung für den Motorflug 14 Stampe et Renard SV-4 C 38/570 CSSR 6. Der erste Motorflug der Brüder Wright 75 Aero Ae-02 59/572 6. Die ersten Motorflüge in Europa AeroA-42 59/572 und die Entwicklung der Luftfahrttechnik BRASILIEN Aero 145 60/572 bis zum Jahre 1914 76 AviaBH-3 60/572 7. Der erste Weltkrieg EMBRAER EMB-110 „Bandeirante" 39/570 Avia B-534 67/572 und die Luftfahrttechnik 17 EMBRAER EMB-200/201 „Ipanema" 39/570 AviaB-135 67/572 ITA „Urupema" 40/570 HC-2 „Heli Baby'7HC-102 62/572 8. Der Aufschwung der Luftfahrttechnik Neiva 360 C „Regente"/„Regenta Elo'7 L-13„Blanik" 63/572 in den Jahren 1919 bis 1939 19 „Lanceiro" 40/570 L-60 „Brigadyr" 63/572 8.1. Bauweisen 19 Neiva Paulistinha 56-C/56-D 47/570 L-40 „Meta Sokol" 64/572 8.2. Triebwerke 20 Neiva N-621 „Universal"/T-25 47/570 L-200 „Morava" 64/572 8.3. Aerodynamik 21 L-29 „Delfin" 65/572 8.4. Geschwindigkeiten 22 L-39 „Albatros" 65/572 8.5. Das Verkehrsflugzeug 24 L-410 „Turbolet" 66/572 8.6.