Encyclopédie Berbère, 12 | 1993 Ceuta 2
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ceuta, Monte Hacho Population: 68,000 Inhab
EUROPAN 5 – CE UTA – ESPAÑA Location: Ceuta, Monte Hacho Population: 68,000 inhab. Area: 3.9 ha CONURBATION SITE Ceuta is in North Africa, at the most eastern point of the Straits of Gibraltar. The site is on the Mount Hacho peninsula, in the isthmus formed by the town Occupied territory as far back as the Punic Wars, when it was used as a of Ceuta. It comprises Sarchal beach, the mountainous gradient contiguous maritime base, Ceuta was successively in the hands of the Ancient Romans, to the beach right up to the Mont Hacho orbital road, and a stretch of land Vandals, Byzantines and Arabs. In the 15th century is was invaded by the beyond the road on which is a cluster of dwellings, a few market gardens, Portuguese then, in the 16th century, by the Spanish and is now part of the and a disused quarry. province of Cadiz. To the west, the Almina enceinte wall was a rampart-walk placed high on the Initially the town occupied just the isthmus, and was fortified to the south and overhang between Sarchal and Peña beaches. Built in 1757, it was 700m to the north, its eastern and western boundaries delimited by two channels, long and 15m wide and took advantage of the escarpments of the south the navigable Real and the dry Almiral. It later developed towards the east up coast to unite several gun emplacements and toll gates. Going east from the to the Cortadura del Valle which separates it from Mount Hacho. ring-road is a lower rampart-walk that is a stretch of the Mont Hacho fortified The commercial boom of recent decades has been the town’s lifeblood, as it enceinte that runs along the coast and unites Sarchal beach to the Punta del has no other resources. -

Dos Feitos De Hércules Aos Feitos Lusitanos. Ceuta E O Estreito No Mundo Antigo E Medieval
DOS FEITOS DE HÉRCULES AOS FEITOS LUSITANOS. CEUTA E O ESTREITO NO MUNDO ANTIGO E MEDIEVAL Vasco Gil Mantas O renome do Estreito de Gibraltar, que os contemporâneos da Antiguidade Clássica denominavam poeticamente como Colunas de Hércules ( ǾȡȐțȜİȚȠȚ ȈIJȒȜĮȚ - Columnae Herculis ), ou mais prosaicamente através da versão romana Estreito de Cádis (Fretum Gaditanum ), sublinhando assim o indiscutível predomínio deste centro portuá- rio na região, foi enriquecido pela presença da cidade de Ceuta na sua margem africana. Ceuta é considerada como memória do prelúdio da moderna expansão europeia, de que se mantém como um dos últimos redutos, o que lhe atribui singular valor simbólico, naturalmente aberto às interpretações de quem vê a história com diferentes, ou opostas, perspectivas. Trata -se, portanto, de uma área votada desde muito cedo ao jogo dos imagi- nários mitológicos, históricos e políticos, não poucas vezes imbricados uns nos outros. Se a todos estes factores, já de si propícios a complexos desenvolvimentos, adicionarmos os aspectos estratégicos, sempre presentes nas preocupações de quem controlou esta estreita passagem entre mares e continentes, apreenderemos imediatamente a complexidade das situações que aqui se foram vivendo ao longo dos séculos, em grande parte relacionadas com a cidade de Ceuta (Fig.1). Fig.1 – Vista geral do território e da cidade de Ceuta, com o Jebel Musa ao fundo. Procuraremos apenas analisar as grandes linhas das relações de Ceuta com o Estreito de Gibraltar numa perspectiva de longue durée , justi2cável, como veremos, apesar da aceleração da história contemporânea, cada vez mais assente na precariedade, di2cultar 33 VASCO GIL MANTAS a procura de continuidades. -

Frontespizio Ric Ok
Corso di Laurea magistrale in Relazioni Internazionali Comparate – International Relations Tesi di Laurea Ceuta e Melilla La questione irrisolta tra Spagna e Marocco Relatore Ch. Prof. Antonio Trampus Correlatore Ch. Prof.ssa Sara De Vido Laureando Giorgia Busato Matricola 827573 Anno Accademico 2013 / 2014 INDICE INTRODUZIONE i ABSTRACT vi PRIMA PARTE - LE CITTÀ DI CEUTA E MELILLA 1 CAPITOLO 1 – CEUTA 3 1.1. Geografia 3 1.2. Storia 4 1.3. Economia 25 1.3.1 Il porto di Ceuta 27 1.4. Società 31 CAPITOLO 2 – MELILLA 33 2.1 Geografia 33 2.2 Storia 34 2.3 Economia 63 2.3.1 Il porto di Melilla 64 2.4 Società 69 SECONDA PARTE – CEUTA E MELILLA NELLA LEGISLAZIONE SPAGNOLA 71 CAPITOLO 3 - IL PERCORSO VERSO L’AUTONOMIA 73 CAPITOLO 4 – STATUTO DI AUTONOMIA DELLA CITTÀ DI CEUTA 83 CAPITOLO 4 – STATUTO DI AUTONOMIA DELLA CITTÀ DI MELILLA 87 TERZA PARTE - LE CONTROVERSIE TRA SPAGNA E MAROCCO SULLA QUESTIONE DI CEUTA E MELILLA 91 CAPITOLO 6 - LE RELAZIONI TRA SPAGNA E MAROCCO DOPO IL 1956 93 6.1 Dal 1956 al 1999 94 6.2 Dal 2000 a oggi 105 6.2.1 La crisi di Perejil 108 6.2.2 La crisi diplomatica del 2007 119 Approfondimento: le barriere di Ceuta e Melilla 122 APPENDICI 131 1. Statuto di Autonomia della città di Ceuta 131 2. Statuto di Autonomia della città di Melilla 151 INDICE DELLE IMMAGINI 171 BIBLIOGRAFIA 175 SITOGRAFIA 179 INTRODUZIONE Ceuta e Melilla sono due città spagnole sulla costa settentrionale del continente africano. La peculiarità di queste due città autonome è la loro posizione geografica: esse si trovano, infatti, all’interno dei confini marocchini, il che le qualifica come “exclave”. -

Background Profile
Spanish-Moroccan Border: Regional Profile By Xavier Ferrer, Nynke de Witte, Olivier Kramsch, Freerk Boedeltje, Henk van Houtum Nijmegen Centre for Border Research, the Netherlands The map of the casus-study Geographic location The border between Spain and Morocco is essentially a wet border (see map above). On the one hand it is comprised by the waters of the Strait of Gibraltar, which separate the Iberian Peninsula from the African continent; and on the other by the fragment of Moroccan Atlantic coast which lies opposite to the Canary Islands. Though, this predominant wet border landscape is altered by the boundaries between the enclaves of Ceuta and Melilla and their hinterlands, which form the Spanish-Moroccan land borders in the Maghreb. Apart from Ceuta (19,6 Km2 with a land perimeter of 8 km), Melilla (12Km2 with a land perimeter of 11 km) and the Canary Islands (7.446,62 Km2), also the Alborán Island (7,1 Km2) the Peñón de Vélez de la Gomera (2,2 Km2), the Peñón de Alhucemas (1,4 Km2) and the Chaffarine Islands (Congreso 4,5 Km2, Isabel II 2 Km2, Rey 0,6 Km2) complement the contested and less obvious geography of the Spanish-Moroccan border. From 1986 onwards, these territories are also part of the European Union. The border between Spain and Morocco can be understood as a border of borders. Beyond the territorial line between two nation-states, the Spanish-Moroccan border also marks the limits between, Christianity and Islam, Europe and Africa, the former colonizer and the former colonized, EU territory and non-EU territory, prosperous north and impoverished south. -
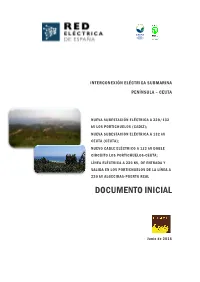
Documento Inicial
E-S B-000013 INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA SUBMARINA PENÍNSULA – CEUTA NUEVA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA A 220/132 kV LOS PORTICHUELOS (CADIZ); NUEVA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA A 132 kV CEUTA (CEUTA); NUEVO CABLE ELÉCTRICO A 132 kV DOBLE CIRCUITO LOS PORTICHUELOS-CEUTA; LÍNEA ELÉCTRICA A 220 KV, DE ENTRADA Y SALIDA EN LOS PORTICHUELOS DE LA LÍNEA A 220 kV ALGECIRAS-PUERTO REAL DOCUMENTO INICIAL Junio de 2016 DOCUMENTO INICIAL DEL PROYECTO Interconexión Eléctrica Submarina Península-Ceuta INDICE I MEMORIA 1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 7 2 ANTECEDENTES .................................................................................................................. 9 3 NECESIDAD Y OBJETIVO DE LAS INSTALACIONES .................................................... 11 4 ÁMBITO DE ESTUDIO ........................................................................................................ 15 5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ....................................................................................... 17 5.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS SUBESTACIONES A 132 KV LOS PORTICHUELOS Y CEUTA .................................................................................................... 17 5.1.1 Configuración ......................................................................................................... 17 5.1.2 Obra civil ................................................................................................................ 18 5.2 CABLE -

Eu Non-Native Organism Risk Assessment Scheme
EU NON-NATIVE SPECIES RISK ANALYSIS – RISK ASSESSMENT TEMPLATE V1.0 (27-04-15) completed with the RA 2020 template EU NON-NATIVE ORGANISM RISK ASSESSMENT SCHEME Name of organism: Rugulopteryx okamurae (E.Y. Dawson) I.K. Hwang, W.J. Lee & H.S. Kim 2009 Author: Ministry for Ecological Transition and Demographic Challenge – Spain (MITECO) Risk Assessment Area: The risk assessment area is the territory of the European Union (EU 27), excluding the outermost regions Peer review 1: María Altamirano Jeschke, Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal, Universidad de Málaga, Málaga, Spain Peer review 2: Marianela Zanolla, National University of Ireland Galway, Galway, Ireland Draft: February, 2020 Version Date File Name Author(s) Status and description 0.1 ##/01/2020 Rugulopteryx okamurae MITECO First draft for internal review RA 1.0 ##/02/2020 Rugulopteryx okamurae MITECO First draft for peer-review by the Scientific Forum RA 2.0 ##/09/2020 R. okamurae RA 4 Sept. MITECO Final RA following peer-review by the Scientific Forum: discussed at the meeting of the Scientific 2020 Forum of 17/11/2021 2.1 ##/03/2021 RA R. okamurae March MITECO Updated version after comments from Scientific Forum on 17/11/2021 discussed at the meeting of 2021 clean the Scientific Forum of 13/04/2021: positive opinion 3.0 13/04/2021 Rugulopteryx_okamurae_ MITECO Final RA for submission to the IAS Committee final_20210413 1 EU NON-NATIVE SPECIES RISK ANALYSIS – RISK ASSESSMENT TEMPLATE V1.0 (27-04-15) completed with the RA 2020 template EU CHAPEAU QUESTION RESPONSE It has been recorded in 2 member states: France (Verlaque et al. -

Africa-Geography Part 1
Africa: Major Geographic Features By: Linda Smith, Hawkeye Community College Participant in a University of Arizona Center for Middle Eastern Studies Fulbright-Hays GPA to Morocco Africa • Second largest continent • 11.7 million sq. miles • About 5,000 miles from N. to S. • About 4,000 miles from E. to W. • 3 times the size of the U.S. • Bisected by the equator • Over 1/3 desert • Second most populous continent with 1.3 billion people • 1250-3000 native languages Strait of Gibraltar • A narrow strait under 9 miles wide and 1,000-3,000 feet deep separates Europe from Africa and the Pacific Ocean from the Mediterranean Sea. • Renaissance tradition thought that beyond this passage was nothingness—where ships would go off the edge of the earth. The Rock of Gibraltar (Spain) is just under 9 miles from the north coast of Africa. Myths about Hercules In one version, Hercules enlisted Atlas’ aid to get the golden apples. Since Atlas was holding up the The Cave of Hercules on the pillars of the sky, Hercules relieved coast of Morocco by Tangier him. Atlas got the golden apples, but was going to skip out. Hercules asked him for help in readjusting the load, but then left Atlas holding the pillars. In another version, Hercules used his brute strength to dig out the channel and create the Rock of Gibraltar on one side and either Statue of Hercules Monte Hacho (Ceuta) or Jebel Musa holding up the pillars (Morocco) on the other side to of the sky (Ceuta, N. serve as pillars and relieve Atlas of Africa). -

European Port Cities: Disadvantaged Urban Areas in Transition“
“European Port Cities: Disadvantaged Urban Areas in Transition“ A collaborative project under the EU Transnational Ex- change Programme (“ Fight against Poverty and Social Ex- clusion ”) (VP/2002/010) Final Report – Phase I Prof. Dr. Waltraud Kokot Institut für Ethnologie Universität Hamburg Rothenbaumchaussee 67/69 20148 Hamburg Phone 040 – 42828 5741 Fax 040 – 42838 6288 [email protected] Contents 1. Introduction 2 1.1. Methodological issues: an ethnographic approach to social exclusion 4 1.2. Key concepts 1: transformations of “ urban subsistence “ in European port cities 5 1.3. Key concepts 2: “ social exclusion “ 6 1.4. “The street” – stage and context of urban subsistence strategies 7 2. Results and conclusions 7 2.1. Case studies and comparison – an overview of results 8 2.2. Preliminary recommendations 12 2.3. Illustrations 13 2.4. References 13 3. Case studies 15 3.1. Ethnographic Field Report: Algeciras (Researcher: Henk Driessen) 15 3.2. Ethnographic Field Report: Ceuta (Researcher: Eva Kaewnetara) 21 3.3 Ethnographic Field Report: Dublin (Researchers: Astrid Wonneberger) 30 3.4. Ethnographic Field Report: Hamburg (Researchers: Waltraud Kokot, Angelika Hillmer) 47 3.5. Ethnographic Field Report: Thessaloniki (Researcher: Salinia Stroux) 88 1. Introduction This project focuses on disadvantaged urban areas in European port cities, based on close collaboration between institutions of academic research and social work organisations direc- ted at disadvantaged local actors. According to the project schedule, the main task of phase I was to generate an overview of the specific problems in each of the cities under study, to identify relevant local actors and to build networks of possible partners for phase II. -

A Survey on Anthozoa and Its Habitats
Rev. Acad. Canar. Cienc., Vol. XXVII, 9-66 (diciembre de 2015) A survey on Anthozoa and its habitats along the Northwest African coast and some islands: new records, descriptions of new taxa and biogeographical, ecological and taxonomical comments. Part I. Ocaña 1*, O., Hartog 2, J.C. den , Brito 3, A., Moro 4, L., Herrera 5, R. , Martín 6, J., Ramos 7, A., Ballesteros 8, E. & Bacallado 9, J. J. 1 Museo del Mar de Ceuta, Muelle España, s/n, 51001 Ceuta, Spain 2 Curator of Colenterata from NNHM, Leiden, The Netherlands, Deceased 3 Grupo de investigación BIOECOMAC, Unidad Departamental de Ciencias Marinas Universidad de La Laguna, Canary Island, Spain 4 Servicio de Biodiversidad, Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias Edf. Usos Múltiples I. Av. Anaga nº 35. 38071, S/C de Tenerife, Canary Islands, Spain 5 Servicio de Biodiversidad. Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias Edificio de Servicios Múltiples II (5ª planta). Agustín Millares Carló, 18 35071, Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands, Spain 6 Calle Caracas nº 3, La Laguna, Tenerife, Canary Islands, Spain 7 Centro de Investigación Marina de Santa Pola (CIMAR), Universidad de Alicante 03130, Santa Pola, Alicante, Spain 8 Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CSIC), Acc. Cala, Sant Francesc 14 17300, Blanes, Girona, Spain 9 Museo de Ciencias Naturales de Tenerife. Ap. Correos 853, Santa Cruz de Tenerife, islas Canarias * Corresponding autor: Óscar Ocaña (email: [email protected] ) RESUMEN Varias especies de Actiniarios y Escleractinias han sido recolectadas y estudiadas a lo largo de la costa noroeste africana y algunos de sus archipiélagos. -

The Economic Legacies of Lingering Colonialism: a Case Study in Identity and Multiculturalism in Northern Morocco and the Spanish Enclaves
SIT Graduate Institute/SIT Study Abroad SIT Digital Collections Independent Study Project (ISP) Collection SIT Study Abroad Spring 2017 The conomicE Legacies of Lingering Colonialism: A Case Study in Identity and Multiculturalism in Northern Morocco and the Spanish Enclaves Jeremy Vale SIT Study Abroad Follow this and additional works at: https://digitalcollections.sit.edu/isp_collection Part of the African Studies Commons, Criminology Commons, Family, Life Course, and Society Commons, Other Economics Commons, and the Work, Economy and Organizations Commons Recommended Citation Vale, Jeremy, "The cE onomic Legacies of Lingering Colonialism: A Case Study in Identity and Multiculturalism in Northern Morocco and the Spanish Enclaves" (2017). Independent Study Project (ISP) Collection. 2633. https://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/2633 This Unpublished Paper is brought to you for free and open access by the SIT Study Abroad at SIT Digital Collections. It has been accepted for inclusion in Independent Study Project (ISP) Collection by an authorized administrator of SIT Digital Collections. For more information, please contact [email protected]. The Economic Legacies of Lingering Colonialism: A Case Study in Identity and Multiculturalism in Northern Morocco and the Spanish Enclaves Pictured: A man and two women look out from Melilla la Vieja with Morocco in the distance Jeremy Vale Colby College Major: Government Academic Director: Dr. Taieb Belghazi Advisor: Dr. Khalid Chegraoui Primary Research Locations: Ceuta, Spain; Melilla, -

New Lithologic and Structural Data of the Central and Eastern Part of Ceuta (Rif Cordillera)
GEOGACETA, 59, 2016 New lithologic and structural data of the central and eastern part of Ceuta (Rif Cordillera) Nuevos datos de la litología y de la estructura de los sectores central y oriental de Ceuta (Cordillera Bético-Rifeña) Carlos Sanz de Galdeano1 and María Dolores Ruiz Cruz2 1 Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (CSIC - Univ. Granada). Facultad de Ciencias. 18071. Granada, Spain. [email protected] 2 Dpto. de Química Inorgánica, Cristalografía y Mineralogía. Facultad de Ciencias. Univ. de Málaga. Campus de Teatinos. 29017. Málaga, Spain. [email protected] ABSTRACT RESUMEN In the central and eastern parts of Ceuta two tectonic units are dif- En los sectores central y oriental de Ceuta se diferencian dos ferentiated: a) the Hacho unit, formed by two groups of orthogneisses unidades: a) la unidad del Hacho, formada por dos grupos de ortogneises which foliation permits to establish the structure: an anticline with a cuya foliación permite establecer su estructura: un anticlinal que tiene periclinal end at its western edge, and b) the Istmo unit, with peridotites una terminación periclinal en su parte occidental, y b) la unidad del Istmo, at the bottom, followed by migmatitic granulites, gneisses, and dark mica con peridotitas en la base seguidas por granulitas migmatíticas, gneises schists. The thrust of the peridotites over the orthogneisses of the Hacho y esquistos oscuros. El cabalgamiento de las peridotitas sobre los unit occurred under fragile conditions. For the first time several types of ortogneises ocurrió en condiciones frágiles. Por primera vez se han rocks, not previously described, have been localized: dark mica schist and localizado afloramientos de rocas no descritos previamente: esquistos phyllites and quartzites, these two last perhaps corresponding to the oscuros y filitas y cuarcitas, estas dos últimas quizás correspondientes a Federico units. -

4 Atlas De Ceuta Y De Melilla
Ciencias Sociales Atlas de Ceuta 4 PRIMARIA y de Melilla El Atlas de Ceuta y de Melilla para 4.o curso de Primaria es una obra colectiva concebida, diseñada y creada en el Departamento de Ediciones Educativas de Santillana Educación, S. L., dirigido por Teresa Grence Ruiz. En su elaboración ha participado el siguiente equipo: TEXTO Gabriela Martín Bermejo Ruth Martín Jiménez ILUSTRACIÓN Jorge Arranz Digitalartis EDICIÓN Ruth Martín Jiménez EDICIÓN EJECUTIVA Aurora Moral Santa Olalla DIRECCIÓN DEL PROYECTO Lourdes Etxebarria Orella DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EDITORIAL DE PRIMARIA Maite López-Sáez Rodríguez-Piñero Índice Así es el relieve de Ceuta ................................... 4 Así es el relieve de Melilla ................................... 5 El clima y la vegetación de Ceuta ............................ 6 El clima y la vegetación de Melilla ............................ 7 ¿Cómo son las aguas de Ceuta? ............................. 8 ¿Cómo son las aguas de Melilla? ............................. 9 Conocemos la población de Ceuta ........................... 10 Conocemos la población de Melilla ........................... 11 ¿Cómo se gobierna Ceuta? ................................. 12 ¿Cómo se gobierna Melilla? ................................. 13 Descubrimos el patrimonio de Ceuta ......................... 14 Descubrimos el patrimonio de Melilla ......................... 15 Así es el relieve de Ceuta Punta Punta Blanca N de Benzú Mar Mediterráneo O E S Punta Bermeja Isla de Santa Catalina Cerro del Renegado Punta de 325 m Souciño Punta s Monte La Puntilla Almina e Playa n Anyera Embalse o Bahía l 349 m del Renegado de Benítez l de Ceuta Monte Hacho u 208 m B o e rn d e PENÍNSULA a Z r C A M P O E X T E R I O R n r O I Embalse Punta del ie A l DE ALMINA N r S royo de del Inerno Desnarigado A CEUTA N Cala del Sarchal E U T R Ensenada de A A rro L yo las Colmen la Almadraba de a s Playa del Chorrillo ALTITUD (En metros) Punta del Morro Más de 400 Playa del De 200 a 400 Arr Bomb oyo de las as Tarajal De 100 a 200 MARRUECOS Menos de 100 1.