Insaniyat / إنسانيات, 65-66
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Images of Non- -Aligned and Tricontinental Struggles
nesvrstani modernizmi non-aligned modernisms — sveska #5 / volume #5 Olivje Aduši SLIKE BORBE NESVRSTANIH I TRIKONTINENTALA — Olivier Hadouchi IMAGES OF NON- -ALIGNED AND TRICONTINENTAL STRUGGLES Olivje Haduši / Olivier Hadouchi SLIKE BORBE NESVRSTANIH I TRIKONTINENTALA — 5 IMAGES OF NON-ALIGNED AND TRICONTINENTAL STRUGGLES Olivier Hadouchi was born in Paris in 1972 where he lives and works. He received his Ph.D. degree in cinema studies. Hadouchi is a film curator, teacher and critic. His texts were published in Third Text, CinémAction, La Furia Umana, Mondes du cinéma and in the collective works (both in French): Ben- jamin Stora and Linda Amiri (Eds.), Algerians in France, 1954-1962, War, exile, the life (Autrement, 2012) and Bertrand Bacqué, Cyril Neyrat, Clara Schulmann and Véronique Terrier Hermann (Eds.), Serious Games. Cinema and Contemporary Art transforming Essay MAMCO-HEAD, 2015. He has held numerous lectures or film’s presentations in Berlin, Algiers, Belgrade, Paris, Béjaïa, Beirut, Prague, Lyon, etc. Olivier Hadouchi IMAGES OF NON-ALIGNED AND TRICONTINENTAL STRUGGLES The first conference of the Non-Aligned Move- ment was held in Belgrade from 1st to 6th Septem- ber 1961 and one of its goals was to circumvent the clutches of the world order which emerged after the end of the Second World War in 1945. The Non-Aligned Movement gathered together nations who longed for an alternative to the bi- polar cold war order, above all to create a third way which would not result in two superpowers nor would rest on the logic that every country is forced to decide between and subjugate itself ei- ther to a capitalist block (under the United States) or a socialist block (at the head of which was the Soviet Union whose dominant position was chal- lenged by another socialist country, China). -

Mecca of Revolution Oxford Studies in International History
Mecca of Revolution Oxford Studies in International History James J. Sheehan, series advisor The Wilsonian Moment Self- Determination and the International Origins of Anticolonial Nationalism Erez Manela In War’s Wake Europe’s Displaced Persons in the Postwar Order Gerard Daniel Cohen Grounds of Judgment Extraterritoriality and Imperial Power in Nineteenth- Century China and Japan Pär Kristoffer Cassel The Acadian Diaspora An Eighteenth- Century History Christopher Hodson Gordian Knot Apartheid and the Unmaking of the Liberal World Order Ryan Irwin The Global Offensive The United States, the Palestine Liberation Organization, and the Making of the Post– Cold War Order Paul Thomas Chamberlin Mecca of Revolution Algeria, Decolonization, and the Third World Order Jeffrey James Byrne Mecca of Revolution Algeria, Decolonization, and the Third World Order JEFFREY JAMES BYRNE 1 1 Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University’s objective of excellence in research, scholarship, and education by publishing worldwide. Oxford is a registered trade mark of Oxford University Press in the UK and certain other countries. Published in the United States of America by Oxford University Press 198 Madison Avenue, New York, NY 10016, United States of America. © Oxford University Press 2016 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission in writing of Oxford University Press, or as expressly permitted by law, by license, or under terms agreed with the appropriate reproduction rights organization. Inquiries concerning reproduction outside the scope of the above should be sent to the Rights Department, Oxford University Press, at the address above. -

Édifier La France En Algérie Coloniale Histoire Urbaine De Constantine (1901-1914)
Thierry Guillopé Mémoire de Master 2ème année Édifier la France en Algérie coloniale Histoire urbaine de Constantine (1901-1914) Sous la direction de Madame Anne-Laure Dupont et de Monsieur Rainer Hudemann Université Paris-Sorbonne (Paris IV) 2012-2013 1 2 Abréviations utilisées, bibliothèques de recherche et centres d’archives 4 Pour lire les références 5 Introduction 7 Chapitre liminaire. Situations 23 * * * Première partie. Installer lentement la France : assainir, fluidifier et bâtir un centre de pouvoir 41 Chapitre 1. Assainir la ville : des équipements vétustes à moderniser, des infrastructures nouvelles à créer 43 Chapitre 2. Sortir du Rocher et fluidifier les circulations : entre entraves et soutiens politiques et étatiques 67 Chapitre 3. Bâtir des palais : affirmer, malgré tout, sa puissance 95 Épilogue I. Des aménagements urbains « a-coloniaux » ? 115 Deuxième partie. Modeler des sensibilités et espaces français 117 Chapitre 4. Politiques d’aménagements scolaires, politiques communautaires 119 Chapitre 5. Considérations esthétiques et embellissements : des ressorts de l’aménagement urbain 157 Chapitre 6. Inaugurations et hommages : la mise en scène de la puissance française 173 Épilogue II. Incruster la France à Constantine : autonomies indigènes et affermissement colonial 194 Troisième partie. Gérer des vivants, gérer des défunts : habitat et cimetières en situation coloniale 197 Chapitre 7. Bâtir hors du Rocher ou s’y retrancher ? Mouvement HBM et habitat indigène 199 Chapitre 8. Protéger ses morts : dynamismes et victoires -

ASOM-CTHS(5).Pdf
LES SOCIETES SAVANTES ET L’OUTRE-MER LEUR ROLE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET SOCIAL HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN colloque tenu à Paris les 22 et 23 novembre 2011 sous la présidence de M. Paul BLANC entre l’Académie des sciences d’outre-mer (ASOM) et le Comité des travaux historiques et scientifiques (CTHS) organisé avec l’Association des amis du CTHS et des sociétés savantes sous la direction de MM. Bruno DELMAS et Ange ROVERE SOMMAIRE Préface - Pierre Gény et Claude Mordant Introduction - Bruno Delmas, Les sociétés savantes en France et outre-mer : des phénomènes parallèles ? - Louis Bergès, A la recherche des sources relatives à l’histoire des sociétés savantes d’outre- mer. I. Apparition et destin des sociétés savantes locales du temps des colonies à nos jours - Pascal Even, Les sociétés savantes de la côte charentaise et l’outre-mer ; les destins contrariés des sociétés de géographie de La Rochelle et Rochefort au tournant du XXe siècle. - Martine François, Les sociétés de géographie et l’expansion coloniale. - Jean Pierre Laporte, Les sociétés savantes historiques et géographiques d’Afrique du Nord avant les indépendances. - Sylvie et Pierre Guillaume, L’Association des amis du Vieux Huê. - Hubert Gerbeau, Les sociétés savantes de la Réunion. - Danielle Bégot, Les sociétés historiques de la Caraïbe, (XXe-XXIe siècles), état des lieux. II. Les sociétés savantes nationales et l’outre-mer aujourd’hui et demain 1 - Bernard Vandermeersch, La société française d’anthropologie et l’étude des hommes. - Jean-Pierre Mahé, La société asiatique et l’orientalisme européen. - Christian Coiffier, Genèse de la société des océanistes. -

L'algérie Et Les Algériens Sous Le Système Colonial. Approche
Insaniyat n°s 65-66, juillet - décembre 2014, p. 13-70 L’Algérie et les Algériens sous le système colonial. Approche historico historiogra- phique1 Gilbert MEYNIER(1) Rappel/introduction Avant d’explorer un passé plus ancien, remontons d’abord à 1830 et aux quatre décennies qui suivirent. Les morts algériens de l’implacable conquête de l’Algérie2 ont été évalués entre 250 000 et 400 000, voire plus3. Les victimes de la déstructuration du vieux mode de production communautaire, en particulier lors de la grande famine de 1868 suite à une récolte désastreuse4, furent bien aussi nombreuses, et peut-être plus : (1) Ex-professeur au lycée Pasteur, Oran (1967-1968), ex-maître de conférences à l’Université de Constantine (1968-1970), Professeur émérite de l’Université de Nancy II. 1 Ce texte, à l’origine préparé pour les débats d’El Watan du 22 octobre 2010, a été relu, corrigé et mis à jour. 2 Cf. entre autres - Ageron, C.-R. (1955), La politique indigène de Bugeaud, Paris : Larose, XII-383 p. 3 Cf. - Kateb, K. (2001), Européens, indigènes et Juifs en Algérie, 1830-1962: représen- tations et réalités des populations, préf. de B. Stora, Paris : Édit. de l'Institut National d'Études Démographiques : diff. PUF, XXVI-386 p.- * Frémeaux, J. (2002), La France et l‟Algérie en guerre, 1830-1870, 1954-1962, Paris : Commission Française d’Histoire Militaire/Institut de Stratégie Comparée/Economica, 365 p., p. 261 ; du même auteur, entre autres titres : - * L’Afrique à l’ombre des épées, 2 vol. - 1 (1993) : Des établisse- ments côtiers aux confins sahariens 1830-1930, Paris, Publications du Service Historique de l’Armée de Terre, 191 p., -2 (1995) : Officiers, administrateurs et troupes coloniales 1830-1930, ibid., 311 p. -

Journal De La DES 6.000 SOCIETES ET ECOLES R.\
f pm. '£r m - N° 356 OCTOBRE 1982 ORGANE MENSUEL DES 49 FÉDÉRATIONS, journal de la DES 6.000 SOCIETES ET ECOLES r.\ . • . ET DES 600.000 MUSICIENS FEDERES Là C.M.F. est reconnue d’UtlIità publique par décret du 2 Janvier 1957 et agréée par le minis tère dé la Culture et le ministère de la Jeunesse et des Sports. Elle est affiliée à la Confédérs- ■ tion Internationale des Sociétés Populaires de Musique et membre du Comité National de la * A. Musique. Confédérationmm B ■ ■ Numéro de la commission paritaire 34407. \ : Musicale de France ÜmV- : que n’a de valeur que si elle estprécédée et suivie de silence» Editorial Remise de la Croix d’Officier de la Légion d’Honneur au Président Gabriel Rolando Conseils par André Amellér, Président de la C. M. F. •> E voudrais évoquer ici un souci, non des moindres, c’est celui de la participation .de nos Le samedi 11 septembre, à la Maison des Jeunes et de la Culture de Saint-Fons Sodétés et éventuellement de nos musiciens. r~v J C'est avec une joie Intense et du Sud-Est, se sont réjouis à quelques instants par Mr. André N’oublions pas que toutes nos associations sont placées beaucoup d’émotion que fut l'annonce de votre nomination au Amellér, Président de la Confédé | sous la loi de 1901, c’est à dire à but non lucratif. remise la Croix de la Légion grade d'Officier dans l'Ordre de la ration Musicale de France qui . AJ Cependant, nombreuses sont les doléances de respon d’Honneur à M. -

1 Histoire De La Guerre D'indépendance Algérienne SYLVIE
1 Histoire de la guerre d'indépendance algérienne SYLVIE THÉNAULT À Kahina. Introduction (2012) Avec le XXIe siècle, la France et les Français ont découvert – redécouvert ? – leur histoire coloniale, ou, à tout le Moins, son épisode le plus Marquant par sa durée, son intensité et sa portée : la guerre d'Algérie. Et ce, dans un rapport placé sous le signe de la culpabilité ; en téMoigne le transfert, pour désigner cette guerre, des Métaphores nées de la dénonciation du régiMe de Vichy, « heures sombres », « pages noires » de l'histoire de la France conteMporaine. Le retour sur ce passé a débuté, en 2000-2001, avec la publication à la Une du Monde du téMoignage de Louisette Ighilahriz. Cette Militante de l'indépendance algérienne, qui fut torturée Mais sauvée par un Médecin dont elle connaît le nom, voulait retrouver pour lui dire, enfin, sa reconnaissance. Le débat a ensuite été ponctué par les regrets du général Massu, la reconnaissance de l'usage courant de la torture par le général Aussaresses et les déclarations du général Bigeard, évoquant cette pratique comMe « un Mal nécessaire » dans cette guerre1. Ont suivi quantité de livres, dont les retentissants MéMoires de Paul Aussaresses, des documentaires – notaMMent L'Ennemi intime, de Patrick RotMan, diffusé en prime time sur France 3 –, et MêMe des poursuites judiciaires pour « apologie de criMes de guerre » contre le général Aussaresses, à défaut de qualification juridique plus pertinente pour sanctionner des actes, au-delà des mots. La société a fait écho. Les Français ont été touchés par ce déferleMent de questions, d'accusations, de récits et d'iMages, bien au-delà des cercles directeMent concernés. -

Lionel Jospin À Gérard Collomb : « Surtout, Attends La Confirmation ! » Lomb, Répétant Que L’Alternan- Ce Ne Serait Pas « L’Abomina- LYON Enfin Acquise
LE MONDE ÉCONOMIE LE MONDE EMPLOI a L’Allemagne réforme les retraites a Les offres d’emplois Demandez notre supplément www.lemonde.fr 56e ANNÉE – Nº 17465 – 7,50 F - 1,14 EURO FRANCE MÉTROPOLITAINE MARDI 20 MARS 2001 FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY – DIRECTEUR : JEAN-MARIE COLOMBANI Malgré Paris et Lyon, la gauche est sur la défensive b Les victoires de la gauche à Paris et à Lyon sont une défaite personnelle pour Jacques Chirac b La droite garde Toulouse et gagne quarante villes de plus de 15 000 habitants b L’extrême droite Echecs ne perd que Toulon b Le communisme municipal s’effondre b Grande stabilité aux cantonales EN LEVER de rideau d’un proces- sus électoral qui va toucher les exé- LE SECOND tour des élections nait 301 villes de cette taille, la droi- cutifs des quatre pays européens municipales, dimanche 18 mars, a te 278, l’extrême droite 4 avant le membres du G7, d’abord l’Italie et donné la victoire aux listes de la scrutin ; ces chiffres passent, res- la Grande Bre- gauche plurielle menées par le pectivement à 259, 318 et 3 (trois tagne, puis la Parti socialiste à Paris et à Lyon, villes ont élu des listes inclassa- France et l’Al- mais a enlevé au PS et au PCF une bles). Sur les 244 villes de plus de lemagne en trentaine de villes de plus de trente mille habitants, la perte net- 2002, les scru- trente mille habitants, dont Stras- te de la majorité est de 23. Aux tins munici- bourg, Rouen, Orléans, Saint- élections cantonales, la gauche paux et can- Brieuc, Aix-en-Provence, Nîmes et remporte cinq départements, la tonaux sem- Tarbes. -

L'historiographie Française De L'algérie Et Les Algériens En
1 L’historiographie française de l’Algérie et les Algériens en système colonial Gilbert Meynier, Intervention à Alger le 22 octobre 2010 à l'invitation d'El Watan Rappel/introduction Avant d’explorer un passé plus ancien, remontons d’abord à 1830 et aux quatre décennies qui suivirent. Les morts algériens de l’implacable conquête de l’Algérie peuvent être évalués entre 250 000 et 400 0001. Les victimes de la destructuration du vieux mode de production communau- taire, en particulier lors de la grande famine de 1868 suite à une récolte désastreuse, étudiée notamment par André Nouschi2, furent bien aussi nombreuses, et peut-être plus : au total il y eut disparition peut-être bien d’un quart à un tiers de la population algérienne de 1830 à 1870. La popu- lation se mit à remonter à partir de la fin du XIXe siècle, plus du fait de ce que les Québécois appellent la « revanche des berceaux » que de la mé- decine : en 1914, l’Algérie, colonisée depuis 84 ans, compte 77 médecins de colonisation, moins qu’au Maroc, dont l’occupation a commencé sept ans plus tôt. Il y eut en Algérie aussi dépossession de 2,9 millions d’ha sur 9 millions cultivables : le tiers en quantité, mais plus en qualité car ce sont les meilleures terres qui furent prises – du fait des confiscations, des expro- priations pour cause d’utilité publique, de saisies pour dettes de paysans insérés de gré ou de force dans le système monétaire et ayant dû mettre leurs terres en gage. Quant à l’œuvre d’éducation tant vantée, d’après les chiffres officiels, 5% de la population était scolarisée dans les écoles fran- çaises en 1914, moins de 15% en 1954 ; et elle n’augmenta qu’in fine du- rant la guerre de libération et du fait du plan de Constantine. -

Analysis of the Causes of the Independent Movement of Algeria
IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 19, Issue 6, Ver. V (Jun. 2014), PP 79-95 e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845. www.iosrjournals.org Analysis of the Causes of the Independent Movement of Algeria Rabeya Khatun Islamic History and Culture Department, University of Dhaka, Bangladesh. Abstract: The aim of this paper is to identify and analysis the different causes of the Algerian War of Independence 1954-1962. The analysis extends to include various aspects of French colonization’s policy and their determination to maintain direct control of Algeria because of its strategic location and how they pillaged the land, destroyed old cultures, displaced local languages, transformed ancient customs, devastation of traditional society, economy and military alliances and how they created new ones throwing up in their wake new historical opportunities. It represents the undermining of women's roles and rights, and the exploitation of their willingness to shelve their feminist agenda in favor of participation in the nationalist cause. This paper also looks at the role of nationalist parties and leaders to rise of Algerian nationalism. This paper is traced to the nature of the socio-political Circumstances of Algeria that took over the leadership of the anti-colonial struggle, war of independence and subsequently of the Algerian state. Keywords: Algeria, colony, nationalism, women, independence. I. Preface It was the century of colonialism. The principal colonial powers were the United Kingdom, France, Russia and the Netherlands. The nations of Europe fanned out across the globe in search of profits and in the process subjugated vast regions of the earth, pillaging the land, destroying old cultures, displacing local languages, transforming ancient customs. -
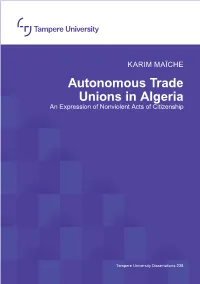
Autonomous Trade Unions in Algeria an Expression of Nonviolent Acts of Citizenship
KARIM MAÏCHE Autonomous Trade Unions in Algeria An Expression of Nonviolent Acts of Citizenship Tampere University Dissertations 238 Tampere University Dissertations 238 KARIM MAÏCHE Autonomous Trade Unions in Algeria An Expression of Nonviolent Acts of Citizenship ACADEMIC DISSERTATION To be presented, with the permission of the Faculty of Social Sciences of Tampere University, for public discussion in the auditorium 1100 of the Pinni B building, Kanslerinrinne 1, Tampere, on 17 April 2020, at 12 o’clock. ACADEMIC DISSERTATION Tampere University, Faculty of Social Sciences Finland Responsible Professor Emeritus supervisor Tuomo Melasuo and Custos Tampere University Finland Supervisor Doctor of Social Sciences Anitta Kynsilehto Tampere University Finland Pre-examiners Professor Daho Djerbal Professor Marnia Lazreg Université d’Alger 2 The City University of New York Algeria United States Opponent Professor Rachid Tlemçani Université d’Alger 3 Algeria The originality of this thesis has been checked using the Turnitin Originality Check service. Copyright ©2020 author Cover design: Roihu Inc. ISBN 978-952-03-1524-5 (print) ISBN 978-952-03-1525-2 (pdf) ISSN 2489-9860 (print) ISSN 2490-0028 (pdf) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1525-2 PunaMusta Oy – Yliopistopaino Tampere 2020 ACKNOWLEDGEMENTS Preparing this thesis has been simultaneously challenging and rewarding experience. My deepest gratitude goes to all the Algerian trade unionists who shared their views and experiences. The constructive and valuable comments of the pre- examiners, Professors Daho Djerbal and Marnia Lazreg, helped to improve this work from multiple aspects. I feel extremely grateful for my supervisors Professor Tuomo Melasuo and Doctor Anitta Kynsilehto. This thesis was prepared in Tampere Peace Research Institute (TAPRI). -

Decolonizing Christianity: Grassroots Ecumenism
DECOLONIZING CHRISTIANITY: GRASSROOTS ECUMENISM IN FRANCE AND ALGERIA, 1940-1965 by DARCIE S. FONTAINE A Dissertation submitted to the Graduate School-New Brunswick Rutgers, The State University of New Jersey in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Graduate Program in History written under the direction of Bonnie G. Smith and approved by ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ New Brunswick, New Jersey MAY, 2011 2011 Darcie Fontaine ALL RIGHTS RESERVED ABSTRACT OF THE DISSERTATION Decolonizing Christianity: Grassroots Ecumenism in France and Algeria, 1940-1965 By DARCIE S. FONTAINE Dissertation Director: Bonnie G. Smith This dissertation, “Grassroots Ecumenism: Christianity and Decolonization in France and Algeria, 1940-1965” is the first major study of how French Protestant and Catholic engagement in the Algerian War of Independence (1954-1962) reshaped Christianity in the modern world and influenced global religious movements like Ecumenical Movement and Vatican II. The moral questions that surfaced during the Algerian War, including the French military’s use of torture, the repression of civilian populations, and debates about the legitimacy of the Algerian nationalist positions forced Christians across the world to rethink the role of Christianity in imperialism and its future in a postcolonial world. This dissertation examines the shifting dynamics of Christianity’s role in the French empire, from the role that Christianity played in supporting the moral foundations for French colonialism in Algeria, to the ways in which Social Christianity, which emerged in France in the 1930s and 40s, undermined these same moral arguments, including the belief that French colonialism was both benevolent and the only means through which Christian interests could be protected in Algeria.