Clivages Et Partis En Belgique
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
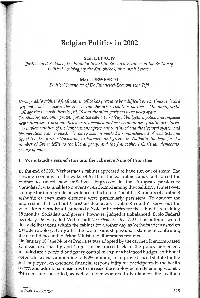
Belgian Polities in 2002
Belgian Polities in 2002 SamDEPAUW Postdoctoral Fellow of the Fund for Scientific Research-Flanders at the Section of Politica/ Sociology of the Katholieke Universiteit Leuven Mark DEWEERDT Politica/ Journalist of De Financieel-Economische Tijd Verhofstadt's cabinet's final year in office has proved to be a difficult one at times . Discord was noticeable between the greens and the other coalition partners. On immigrants' suffrage the Flemish liberals (VLD) and the other partners were poles apart. The slowing economie growth forced the cabinet toa frugal budgetary policy and impeded new initiatives. Corporate taxes were amended and eco-taxation was finally introduced. The implementation of the Lambermont agreement continued and the electoral system and bicameralism were revised. The party system mar/eed a rapprochement of socialists and Spirit (i .e. the farmer Volksunie) in Flanders and greens in Wallonia, the transfer of a number of Spirit MPs to the liberal party, and the francophone Christian democrats' change of name. I. Verhofstadt's second start and the cabinet's Note of Priorities By the end of 2001 Verhofstadt's cabinet appeared to have run out of steam. The slowing economy in the wake of 9/11 restricted public funds and forced the cabinet to cancel new initiatives. Engrossed in the European presidency Verhofstadtwas unable to prevent open discord among the coalition partners over suffrage for immigrants or sentence reduction for 'pentiti'. Rumours of a cabinet reshuffle or even snap elections were particularly persistent. To counter the irnpression that without Christian democrats a cabinet couldn't serve out the whole term Verhofstadt launched a Note of Priorities for the cabinet's remaining 18 months. -

Independent Relics Or Heralds of Party Decline?
Independent Relics or Heralds of Party Decline? The Role of Non-National Lists in Local Politics An Heyerick Examination Commission Prof. Dr. Kristof Steyvers, Universiteit Gent (Supervisor) Prof. Dr. Herwig Reynaert, Universiteit Gent (Co-supervisor) Prof. Dr. Tony Valcke, Universiteit Gent (Chairman) Prof. Dr. Marcel Boogers, Universiteit Twente Prof. Dr. Carl Devos, Universiteit Gent Prof. Dr. Johan Ackaert, Universiteit Hasselt Dr. Linze Schaap, Universiteit Tilburg Dr. Koenraad De Ceuninck, Universiteit Gent ii Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen Vakgroep Politieke Wetenschappen Independent Relics or Heralds of Party Decline? The Role of Non-National Lists in Local Politics Dissertation to obtain the degree of doctor in Political Sciences 2016 Supervisor: Prof. Dr. Kristof Steyvers Co-supervisor: Prof. Dr. Herwig Reynaert iii TABLE OF CONTENTS List of Figures .................................................................................................................... vii List of tables...................................................................................................................... viii Dankwoord ......................................................................................................................... ix 1 General Introduction .................................................................................................... 1 1.1 The melting pot of nonpartisan actors in local politics ........................................................... 1 1.2 Research questions and analytical -

Beste Ekerenaar, Vlaams Belang
EEKERENKEREN vvooruitooruit Informatietijdschrift voor Ekeren van het kartel Vlaams Belang - VLOTT - Jaargang 7 - september 2006 - 1e verkiezingsnummer V.U.: Filip Dewinter - Amerikalei 98 - 2000 Antwerpen Beste Ekerenaar, Over nog slechts een dikke Hoogboom en Zilverenhoek. maand trekken weer met zijn allen naar de stembus. Ein- Verder in dit nummer bren- delijk kan u, na 6 jaar Ekers gen wij enkele verrassende 9 uitdagingen voor wanbestuur, kiezen voor het politieke nieuwtjes, waaruit Ekeren enige alternatief: het kartel eens te meer blijkt dat het cor- lees pagina 2 Vlaams Belang - VLOTT. don sanitaire wankelt. Enkele kopstukken uit de traditionele Uiteraard bent u nieuwsgierig partijen maken namelijk een naar het verschil dat een be- overstap naar Vlaams Belang Politiek nieuws stuur onder leiding van Vlaams en VLOTT. Lees pagina’s 3 tot 5 Belang en VLOTT zal maken. Om u een idee te geven, stel- Achteraan in het nummer len we hiernavolgend onze 9 brengen wij u het dossier Vei- Een Ekerse stem in de uitdagingen aan u voor. Zij ligheid, waarin wij u meer ver- Antwerpse provincieraad vormen de rode lijn doorheen tellen over de stand van zaken lees pagina 3 ons programma. Aan de hand in dit dossier, maar ook over van deze 9 uitdagingen zul- de manier waarop door het Dossier veiligheid len wij onze beleidsverklaring huidige bestuur met ons aller opstellen en 6 jaar lang een veiligheid omgegaan wordt. lees pagina’s 6 en 7 degelijk beleid voeren. Eigenlijk is dit een les in hoe het niet moet… Ekeren in gevaar Het kartel Vlaams Belang de stad -

A Theory-Guided Statistical Historiography Of
A statistical historiography of Belgium’s national electoral and party system Tom Schamp1 & Carl Devos Background paper For the paper submitted for ECPR‟s Joint Sessions of Workshops “Party system dynamics. New tools for the study of party system change and party transformation” 11-16 March, 2013 Mainz, Germany 1 Ghent University Faculty of Social and Political sciences Department of Political science Universiteitstraat 8, 9000 Gent, Belgium e-mail: [email protected] 1 1. Introduction In their overview of the Belgian national electoral results and party systems since 1830, Matagne and Verjans (2012:85) concluded that Belgium advanced from a bipolar political system since 1848, via what Giovanni Sartori (1976) called a two-and-a-half party system in the 1920s to the fractionalized and highly volatile multiparty system that present-day Belgium is worldwide known for. In this paper we study the linkages between the changing political system, the process of electoral reforms and the development of the party system. We intend to do so focusing on an old democracy: Belgium. We analyze origin, rise and fall of Belgian political parties participating in the national legislative elections, of the nature and complexity and change of the national electoral system, of the persistence, consolidation and change of the national party system, and last but not least of the perception of democracy in itself.2 These issues are among the most central issues studied by political scientists. There are plenty of explanations for today‟s party system fragmentation. Ever since the 1960s political parties in Belgium, in The Netherlands and in many other Western European representative democracies were principally uprooting from social cleavages. -

2003.11.05 Vreemdelingenstemrecht DV
NATIONAAL SECRETARIAAT - STUDIEDIENST INHOUD 1. Inleiding. 2. 40 jaar vreemdelingenstemrecht: iedereen is medeschuldig. 3. Het vreemdelingenstemrecht in enkele OESO-landen. 4. Het Vlaams Blok en het vreemdelingenstemrecht. 5. De voorstellen van het Vlaams Blok. Madouplein 8, bus 9 - 1210 Brussel - Tel. (02) 219 60 09 - Fax (02) 218 19 58 URL :http://www.vlaamsblok.be - e-mail : [email protected] 1. Inleiding Het regeerakkoord zette de deur reeds wagenwijd open en nu is het zover. Terwijl de VLD in de regeerperiode nog terzijde werd gestaan door Louis Michel zijn het nu de Franstalige liberalen die – in navolging van alle andere Franstalige partijen en de Vlaamse linkse partijen – in de senaat een wetsvoorstel tot toekenning van gemeentelijke vreemdelingenstemrecht hebben ingediend. Dat het vreemdelingenstemrecht een louter Franstalige en linkse eis is, is evenwel een misvatting. Uit de volgende nota blijkt dat elke Vlaamse partij medeschuldig is aan de invoering van het vreemdelingenstemrecht. Het Vlaams Blok is de enige politieke partij die net zoals de meerderheid van de Vlamingen ronduit gekant is tegen het vreemdelingenstemrecht, of het nu op nationaal of op lokaal niveau is. Met het voorstel om de beslissing inzake de toekenning van het vreemdelingenstemrecht over te laten aan de gewesten ontloopt de VLD haar verantwoordelijkheid. Dit voorstel tot ‘regionalisering van het vreemdelingenstemrecht is overigens zowel vanuit politiek – Brussel – als vanuit juridisch oogpunt problematisch. De VLD zette zélf de deur open voor het vreemdelingenstemrecht door haar instemming met het regeerakkoord dat deze beslissing overlaat aan het federaal parlement. De VLD heeft Vlaanderen alweer buitenspel gezet. 2 2. 40 jaar vreemdelingenstemrecht: iedereen is medeschuldig A. -

Belgian Polities in 2001
Belgian Polities in 2001 SamDEPAUW Postdoctora/ Fellow of the Fund for Scientific Research-Flanders at the Section of Politica/ Sociologi; of the Katholieke Universiteit Leuven Mark DEWEERDT Politica/ Journalist of De Financieel-Economische Tijd Throughout 2001 government policy focused on tax reduction, a sustainable health insurance, the reform of the police farces, the elimination of judicia! backlog and the EU presidency. Not without difficulty yet another step was taken in the reform of the state. The government suffered a serious blow, however, by the demise of the national airline carrier, Sabena . 1. Budgetary and Fiscal Policy A. Budgetary Results for 2000 and a twofold Contra/ of the 2001-Budget OnJanuary 5th the ministers of the Budget, Vande Lanotte, and Finance, Reynders, announced that the government (the federal, community, regional, and local governments as wel! as the public bodies involved in social security) had realised a surplus of€ 100 million. For the first time in half a century, the public finances were in equilibrium. Tuis result was better than anticipated by the Stability Programme 2000-2003, arising from a favorable economie trend - the growth rate equalled 4 % rather than the expected 2.5 %-and the ensuing additional revenues. By the end of 2000 the deficit had declined to 110.6 % of GDP. On the other hand, the minor interest in four UMTS-licenses, i.e. third generation radiotelephonic networks, was a setback for the federal government. In 2001 the anticipated proceeds amounted to€ 1 to 1.5 billion, to be used as a starting capita! for the Ageing Fund that would meet the costs of the increasing ageing population (pensions and health insurance) from 2012. -

Belgian Polities in 2005
Belgian Polities in 2005 Sam DEPAUW Postdoctoral Fellow of the Fund for Scientific Research - Flanders at the University of Leuven Mark DEWEERDT Politica! Journalist of De Tijd The first months of 2005 were dominated by the search fora solution to the issue of the Brussels-Halle-Vilvoorde constituency - that was palatable for both the Flemish and francophone political parties. After the government threw in the towel, the focus shifted more to socio-economie issues. Concern over low activity rates among the over-50's led to the presentation of the Generation Pact, but the trade unions refused to endorse it. Throughout the year discord persisted: between the federal and regional govern ments over the Zaventem flight dispersal plans, between the coalition partners over the issue of energy cheques, and within VLD - most notably over the contin ua! refusal to cooperate with Vlaams Belang. 1. Verhofstadt's Government On October 17th Deputy Prime Minister and Minister for the Budget and Public Enterprise Johan Vande Lanotte (SP.A) resigned from the federal government in order to replace Steve Stevaert at the head of the Socialist Party. He was replaced by Freya Van den Bossche as Deputy Prime Minister and Minister for the Bud get - she kept her portfolio of Consumer Affairs. Her portfolio of Employment passed on to Peter Vanvelthoven, who was succeeded in his turn by Bruno Tuy bens as State Secretary for Public Enterprise. Previously, Tuybens had been head of the Sustainable and Socially Responsible Investment Department at KBC Asset Management and a member of the board at Arnnesty International. -

3.99 109Th Gastro Tki'eat Adds
7 ." X 1BUB8DAT, MOYEMBER 15, H91 ; f a g e t w e n t t -f o x j b A veng* Dgily, Net Pren Ron . For the Week Kn<M The Weather most satisfactory of all the.'vio musto -'With iHiich to dtaplay Ms in a while to dig in as though iKf- JttUet” bedught the program to a Atvard Candded NovsuSber 16,19*3 •torecoat ef U. S. WmOmt Bniise •r •-I lin conoerU; not the greatest, you a r t is t ix ing to iiqprovs mi tiM. oonaposerls moat aueesaatul close. I rather A b o u t T o w n VariedMusic Mr. Ferras gave a brilliant per dynsmlc markings.' like Mr.. knOder’s readings 6t AU aT7STA,'M slno—AH »B4 tnciceslng doadfaieM and wann understand^ only the most satis er tonight witii otaonee ef ratal dd- J formance of the first movement, . Taken by . and large it was a Tsohaikowsky. n * emiductor in members of the 37th Maine Ih- 13,803 factory. The soloist doesn’t have a well-considered and carefully very exceHent performance, both vests them with a restraint vdiieh fantry were awarded the Medal od Mfinbii of tte AnMt it u T n it ig vrioping toward m onlng, low $B- C3haiMi>*n C ourt, O rder o f A m - On Program w rou^t interpretation of the sec by Mr. Ferras and by the or the composer himself failed to Honor during the ClvQ War. But 40. Bohuday mostiy riondy enl.a anath, wlU meet tomorrow at to battle against tite orchestral Uneen ef Otmilntlan V,V ond, and a rather cursory reading chestra, but I must admit I was utilise. -

Eihibitll United Progreuivei for Victory Pren and Media
NH fl O O O Eihibitll United Progreuivei for Victory Pren and Media. Homt * Who We Are ' Get Involved ' Get Informed ' Press & Media Media Contecte Press contact PRESSQUPF un AIAMC. K1 ORGANIZATION: DM PHONE: SubmaOmry j RepofleShwlle^ O AaPiQgreaaheaPaaartllBClBr.Riglftttnip October 28,2004 WASHINGTON - Ralph Nader has received mom ttwi $125,000 from GOP dorwrs and consultants Jr^^ Veterans for Truth a larger figure than previously reported, United Progressives for Victory said today. UPfofVtatory.com's teteat research draws on press lapoito art Fadanri Electim CommMm tuiKflxibutMmeoe by the GOP in drculaUng arid defending Nao^ • 8wHI Boat Vaterana far Nader? Eight donors to trie Wanwjs Swift Boat Vtetenvm tor Truth 527, who have given $3^ Kenya military service, neve ateo given Nader $11.250. [FEC] • rao^^nu. Corporate SuppOftFto of the lafgertd targeted moderate RapuHcana, have given $7,500 to Nadar. They nave grven $450,000 to trie Club for Growth in the past I cydes. Seven contributors to tr*Pro-Giow» Action Teem, sr^^ [FEC] i Stave Werk raised $30.000 for Choices for America, a group that paid for aignatui Neder^ ballot effort in Nevada. [Las Vegas Review Journal, B/2&VD4] m New Hampshire, Republican consultant David Carney, htov^ ami his bustoessassm to Nader to cover the coat of petition gathering that Can»*MHBtedonNadartbarwlf.TI^ in George H.W. Bush's White House, responsible for 3 out of every 6 o^tara that ntedarraiaad in tnaGianlte State. In MUfgan, lha Rapubiein party made a S3.4W iri« baaot them after the RapubVcane turned in 46,000 signatures foe Wm end vi^ent to court for him. -

Een Onderzoek Naar Vlaamse Schijnverkozenen (1994-2007)
UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN ’Alle hens aan dek’: een onderzoek naar Vlaamse schijnverkozenen (1994-2007) Wetenschappelijke verhandeling Aantal woorden: 24.999 FREDERIK SCHEERLINCK MASTERPROEF POLITIEKE WETENSCHAPPEN afstudeerrichting NATIONALE POLITIEK PROMOTOR: (PROF.) DR. HERWIG REYNAERT COMMISSARIS: (PROF.) DR. KRISTOF STEYVERS COMMISSARIS: LIC. HILDE VAN LIEFFERINGE ACADEMIEJAAR 2008 - 2009 Inzagerecht in de masterproef (*) Ondergetekende, ……………………………………………………. geeft hierbij toelating / geen toelating (**) aan derden, niet- behorend tot de examencommissie, om zijn/haar (**) proefschrift in te zien. Datum en handtekening ………………………….. …………………………. Deze toelating geeft aan derden tevens het recht om delen uit de scriptie/ masterproef te reproduceren of te citeren, uiteraard mits correcte bronvermelding. ----------------------------------------------------------------------------------- (*) Deze ondertekende toelating wordt in zoveel exemplaren opgemaakt als het aantal exemplaren van de scriptie/masterproef die moet worden ingediend. Het blad moet ingebonden worden samen met de scriptie onmiddellijk na de kaft. (**) schrappen wat niet past ________________________________________________________________________________________ Dankwoord Graag zou ik eerst nog enkele mensen willen bedanken. Laat me beginnen met mijn promotor, prof. dr. Herwig Reynaert. Op het moment dat ik niet meer goed wist wat ik in mijn onderzoek allemaal wou behandelen, was hij er om me in een bepaalde richting te sturen. Daarnaast -

The Use of Racist, Antisemitic and Xenophobic Arguments in Political Discourse
The use of racist, antisemitic and xenophobic arguments in political discourse Jean-Yves Camus ECRI: European Commission against Racism and Intolerance March 2005 The opinions expressed in this work are the responsibility of the author and do not necessarily reflect the official policy of the Council of Europe or of any of the mechanisms or monitoring bodies established by it. ECRI (European Commission against Racism and Intolerance) Council of Europe F-67075 Strasbourg Cedex © Council of Europe, 2005 Printed at the Council of Europe Foreword The European Commission against cal discourse or of a discourse otherwise Racism and Intolerance (ECRI) is a mecha- impacting on racism and intolerance within nism which was established by the first public opinion. It was agreed that the analy- Summit of Heads of State and Governments sis should cover the European Parliament of the Council of Europe (October 1993). elections of June 2004, and national or local ECRI's task is to combat racism, xenopho- elections, which took place between June bia, antisemitism and intolerance at the 2003 and June 2004 in at least three Council level of greater Europe and from the per- of Europe member States. The study was spective of the protection of human rights. forwarded by the consultant to ECRI at its ECRI is composed of independent and plenary meeting from 14-17 December 2004. impartial members, nominated on the basis ECRI decided to adopt at its plenary of their moral authority and recognized meeting from 15-17 March 2005 a Declara- expertise in dealing with matters related to tion on the issue and to publish it together the fight against racism and intolerance. -

Muslims in Antwerp
OSI.MIE.ANTWERP.PF2:Layout 1 8/18/2011 4:16 PM Page 1 AT HOME IN EUROPE ★ MUSLIMS IN ANTWERP Muslims in Antwerp Whether citizens or migrants, native born or newly-arrived, Muslims are a growing and varied population that presents Europe with challenges and opportunities. The crucial tests facing Europe’s commitment to open society will be how it treats minorities such as Muslims and ensures equal rights for all in a climate of rapidly expanding diversity. The Open Society Foundations’ At Home in Europe project is working to address these issues through monitoring and advocacy activities that examine the position of Muslims and other minorities in Europe. One of the project’s key efforts is this series of reports on Muslim communities in the 11 EU cities of Amsterdam, Antwerp, Berlin, Copenhagen, Hamburg, Leicester, London, Marseille, Paris, Rotterdam, and Stockholm. The reports aim to increase understanding of the needs and aspirations of diverse Muslim communities by examining how public policies in selected cities have helped or hindered the political, social, and economic participation of Muslims. By fostering new dialogue and policy initiatives between Muslim communities, local officials, and international policymakers, the At Home in Europe project seeks to improve the participation and inclusion of Muslims in the wider society while enabling them to preserve the cultural, linguistic, and religious practices that are important to their identities. muslim-antwerpen-incover-publish-11-08-17-OSF:publish.qxd 8/17/2011 8:32 AM Page 1 Muslims in Antwerp At Home in Europe Project muslim-antwerpen-incover-publish-11-08-17-OSF:publish.qxd 8/17/2011 8:32 AM Page 2 ©2011 Open Society Foundations This publication is available as a pdf on the Open Society Foundations website under a Creative Commons license that allows copying and distributing the publication, only in its entirety, as long as it is attributed to the Open Society Foundations and used for noncommercial educational or public policy purposes.