Décision Relative À L'agrément D'un Plan Collectif De Restructuration Du
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

1. from the Beginnings to 1000 Ce
1. From the Beginnings to 1000 ce As the history of French wine was beginning, about twenty-five hundred years ago, both of the key elements were missing: there was no geographi- cal or political entity called France, and no wine was made on the territory that was to become France. As far as we know, the Celtic populations living there did not produce wine from any of the varieties of grapes that grew wild in many parts of their land, although they might well have eaten them fresh. They did cultivate barley, wheat, and other cereals to ferment into beer, which they drank, along with water, as part of their daily diet. They also fermented honey (for mead) and perhaps other produce. In cultural terms it was a far cry from the nineteenth century, when France had assumed a national identity and wine was not only integral to notions of French culture and civilization but held up as one of the impor- tant influences on the character of the French and the success of their nation. Two and a half thousand years before that, the arbiters of culture and civilization were Greece and Rome, and they looked upon beer- drinking peoples, such as the Celts of ancient France, as barbarians. Wine was part of the commercial and civilizing missions of the Greeks and Romans, who introduced it to their new colonies and later planted vine- yards in them. When they and the Etruscans brought wine and viticulture to the Celts of ancient France, they began the history of French wine. -
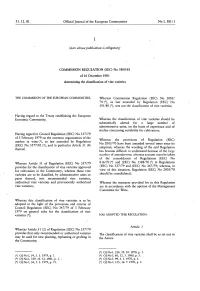
Determining the Classification of Vine Varieties Has Become Difficult to Understand Because of the Large Whereas Article 31
31 . 12 . 81 Official Journal of the European Communities No L 381 / 1 I (Acts whose publication is obligatory) COMMISSION REGULATION ( EEC) No 3800/81 of 16 December 1981 determining the classification of vine varieties THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Whereas Commission Regulation ( EEC) No 2005/ 70 ( 4), as last amended by Regulation ( EEC) No 591 /80 ( 5), sets out the classification of vine varieties ; Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, Whereas the classification of vine varieties should be substantially altered for a large number of administrative units, on the basis of experience and of studies concerning suitability for cultivation; . Having regard to Council Regulation ( EEC) No 337/79 of 5 February 1979 on the common organization of the Whereas the provisions of Regulation ( EEC) market in wine C1), as last amended by Regulation No 2005/70 have been amended several times since its ( EEC) No 3577/81 ( 2), and in particular Article 31 ( 4) thereof, adoption ; whereas the wording of the said Regulation has become difficult to understand because of the large number of amendments ; whereas account must be taken of the consolidation of Regulations ( EEC) No Whereas Article 31 of Regulation ( EEC) No 337/79 816/70 ( 6) and ( EEC) No 1388/70 ( 7) in Regulations provides for the classification of vine varieties approved ( EEC) No 337/79 and ( EEC) No 347/79 ; whereas, in for cultivation in the Community ; whereas those vine view of this situation, Regulation ( EEC) No 2005/70 varieties -
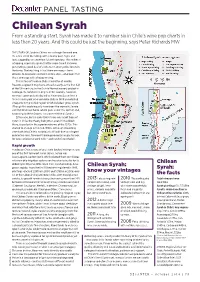
Chilean Syrah from a Standing Start, Syrah Has Made It to Number Six in Chile’S Wine Pop Charts in Less Than 20 Years
PANEL TASTING Chilean Syrah From a standing start, Syrah has made it to number six in Chile’s wine pop charts in less than 20 years. And this could be just the beginning, says Peter Richards MW The sTory of syrah in Chile is not a straightforward one. It’s a tale still in the telling, with a murky past, highs and lows, capped by an uncertain future trajectory. This makes it intriguing, especially given that for some time it has been generating a good deal of excitement among wine lovers in the know. The key thing is that there are many – from drinkers to producers and wine critics alike – who hope that this is one saga with a happy ending. The history of syrah in Chile is a matter of debate. records suggest it may have arrived as early as the first half of the 19th century, in the Quinta Normal nursery project in santiago. Its commercial origins in the country, however, are most commonly attributed to Alejandro Dussaillant, a french immigrant who arrived in Chile in 1874 and planted vineyards in the Curicó region which included ‘gross syrah’. (Though this could equally have been the aromatic savoie variety Mondeuse Noire, which goes under this epithet and, according to Wine Grapes, is a close relative of syrah.) either way, by the early 1990s there was scant trace of syrah in Chile, the theory being that, even if it had been there, it was lost in the agrarian reforms of the 1970s. This started to change in the mid-1990s. -

Red Winegrape Varieties for Long Island Vineyards
Strengthening Families & Communities • Protecting & Enhancing the Environment • Fostering Economic Development • Promoting Sustainable Agriculture Red Winegrape Varieties for Long Island Vineyards Alice Wise, Extension Educator, Viticulturist, Cornell Cooperative Extension of Suffolk County February, 2013; rev. March, 2020 Contemplation of winegrape varieties is a fascinating and challenging process. We offer this list of varieties as potential alternative to the red wine varieties widely planted in the eastern U.S. – Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc and Pinot Noir. Properly sited and well-managed, these four varieties are capable of producing high quality fruit. Some regions have highlighted one of these varieties, such as Merlot and Cabernet Franc on Long Island and Cabernet Franc in the Finger Lakes. However, many industry members have expressed an interest in diversifying their vineyards. Clearly, there is room for exploration and by doing so, businesses can distinguish themselves from a marketing and stylistic viewpoint. The intent of this article is to introduce a selection of varieties that have potential for Long Island. This is by no means an exhaustive list. These suggestions merit further investigation by the winegrower. This could involve internet/print research, tasting wines from other regions and/or correspondence with fellow winegrowers. Even with a thoughtful approach, it is important to acknowledge that vine performance may vary due to site, soil type and management practices. Fruit quality and quantity will also vary from season to season. That said, a successful variety will be capable of quality fruit production despite seasonal variation in temperature and rainfall. The most prominent features of each variety are discussed based on industry experience, observations and results from the winegrape variety trial at the Long Island Horticultural Research and Extension Center, Riverhead, NY (cited as ‘LIHREC vineyard’). -

SYRAH May 15, 2017 with Special Expert Host Jeb Dunnuck, Wine Advocate Reviewer
Colorado Cultivar Camp: SYRAH May 15, 2017 With special expert host Jeb Dunnuck, Wine Advocate Reviewer COLORADO DEPARTMENT OF AGRICULTURE Colorado Wine Industry Development Board Agenda • All about Syrah • History • Geography • Biology • Masterclass tasting – led by Jeb Dunnuck • Rhone, California, Washington, Australia • Blind comparison tasting • Colorado vs. The World COLORADO DEPARTMENT OF AGRICULTURE Colorado Wine Industry Development Board Jancis Robinson’s Wine Course By Jancis Robinson https://www.youtube.com/watch?v=0r1gpZ0e84k All About Syrah • History • Origin • Parentage • Related varieties • Geography • France • Australia • USA • Biology • Characteristics • Flavors COLORADO DEPARTMENT OF AGRICULTURE Colorado Wine Industry Development Board History of Syrah • Myth suggests it was brought from Shiraz, Iran to Marseille by Phocaeans. • Or name came from Syracuse, Italy (on island of Sicily) • Widely planted in Northern Rhône • Used as a blending grape in Southern Rhône • Called Shiraz (sometimes Hermitage) in Australia • second largest planting of Syrah • Brought to Australia in 1831 by James Busby • Most popular cultivar in Australia by 1860 • Export to US in 1970s • Seventh most planted cultivar worldwide now, but only 3,300 acres in 1958 COLORADO DEPARTMENT OF AGRICULTURE Colorado Wine Industry Development Board History of Syrah • Parentage: • Dureza • Exclusively planted in Rhône • In 1988, only one hectare remained • Mondeuse blanche • Savoie region of France • Only 5 hectares remain • Not to be confused with Petite Sirah -

European Commission
29.9.2020 EN Offi cial Jour nal of the European Union C 321/47 OTHER ACTS EUROPEAN COMMISSION Publication of a communication of approval of a standard amendment to the product specification for a name in the wine sector referred to in Article 17(2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 (2020/C 321/09) This notice is published in accordance with Article 17(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 (1). COMMUNICATION OF A STANDARD AMENDMENT TO THE SINGLE DOCUMENT ‘VAUCLUSE’ PGI-FR-A1209-AM01 Submitted on: 2.7.2020 DESCRIPTION OF AND REASONS FOR THE APPROVED AMENDMENT 1. Description of the wine(s) Additional information on the colour of wines has been inserted in point 3.3 ‘Evaluation of the products' organoleptic characteristics’ in order to add detail to the description of the various products. The details in question have also been added to the Single Document under the heading ‘Description of the wine(s)’. 2. Geographical area Point 4.1 of Chapter I of the specification has been updated with a formal amendment to the description of the geographical area. It now specifies the year of the Geographic Code (the national reference stating municipalities per department) in listing the municipalities included in each additional geographical designation. The relevant Geographic Code is the one published in 2019. The names of some municipalities have been corrected but there has been no change to the composition of the geographical area. This amendment does not affect the Single Document. 3. Vine varieties In Chapter I(5) of the specification, the following 16 varieties have been added to those listed for the production of wines eligible for the ‘Vaucluse’ PGI: ‘Artaban N, Assyrtiko B, Cabernet Blanc B, Cabernet Cortis N, Floreal B, Monarch N, Muscaris B, Nebbiolo N, Pinotage N, Prior N, Soreli B, Souvignier Gris G, Verdejo B, Vidoc N, Voltis B and Xinomavro N.’ (1) OJ L 9, 11.1.2019, p. -

French Wine Scholar
French Wine Scholar Detailed Curriculum The French Wine Scholar™ program presents each French wine region as an integrated whole by explaining the impact of history, the significance of geological events, the importance of topographical markers and the influence of climatic factors on the wine in the the glass. No topic is discussed in isolation in order to give students a working knowledge of the material at hand. FOUNDATION UNIT: In order to launch French Wine Scholar™ candidates into the wine regions of France from a position of strength, Unit One covers French wine law, grape varieties, viticulture and winemaking in-depth. It merits reading, even by advanced students of wine, as so much has changed-- specifically with regard to wine law and new research on grape origins. ALSACE: In Alsace, the diversity of soil types, grape varieties and wine styles makes for a complicated sensory landscape. Do you know the difference between Klevner and Klevener? The relationship between Pinot Gris, Tokay and Furmint? Can you explain the difference between a Vendanges Tardives and a Sélection de Grains Nobles? This class takes Alsace beyond the basics. CHAMPAGNE: The champagne process was an evolutionary one not a revolutionary one. Find out how the method developed from an inexpert and uncontrolled phenomenon to the precise and polished process of today. Learn why Champagne is unique among the world’s sparkling wine producing regions and why it has become the world-class luxury good that it is. BOURGOGNE: In Bourgogne, an ancient and fractured geology delivers wines of distinction and distinctiveness. Learn how soil, topography and climate create enough variability to craft 101 different AOCs within this region’s borders! Discover the history and historic precedent behind such subtle and nuanced fractionalization. -

Download Tasting Notes
Retail Savings $16.99 $30.00 43% NV Jean Vullien Méthode Traditionelle Roséproduct-timed-pdf - Vin de Savoie, France - Only 40 Cases in the U.S. Why We're Drinking It In the far eastern corner of France next to the Alps sits the AOC of Vin de Savoie. Known for their own particular style and even varietals, this is an off-the-beaten-path appellation forward-looking wine lovers go to find that are particularly interesting, and typically difficult to find. Case in point, this gem here: the NV Jean Vullien Méthode Traditionelle Brut Rosé. With only 40 cases imported to the U.S., it's the definition of under-the-radar sparkling rosé that may have otherwise slipped by unnoticed had we not originally tasted it in Paris in a small, private tasting of Savoie. Crafted with a unique blend of 50% Gamay, 30% Pinot Noir, and 20% Mondeuse, it shows bubbles so fine and elegant, it literally has the palate lost – forgetting the fact it was grown outside of Champagne. Leading with a nose that features orange blossoms, candied fruit, and fresh pastries, it transcends the palate with fresh wild strawberries that play against the perfect amount of acidity. Finishing fresh and light, with a hint of ripe cherries, it leaves Sparkling lovers with the sentiment: “the greatest wines are those you don’t fine en masse”. Inside Fact: Mondeuse Noire is a red wine grape that is grown primarily in the Savoy region of France. In Savoie, the grape is used in blending with Gamay, Pinot Noir, and Poulsard where it contributes its dark color and high acid levels to the wine that allow the wines to age well. -

Glen Carlou Syrah 2010
Glen Carlou Syrah 2010 Our 2010 Grand Classique exhibits intense dark cherry red with purple hues to the eye; well integrated cassis and blackberry fruits with slight spicy hints of cinnamon. The ripe and concentrated briary fruit, cherry and cocoa flavours on the palate of this rich and well balanced wine has a long finish which is balanced by fine tannins and a harmonious acidity. The ideal red wine to lie down in your cellar for up to 10 years whereby you will be richly rewarded. You say Shiraz, I say Syrah - it's the same grape none-the-less. In France it is known and grown as Syrah, and responsible for some of the Northern Rhone's big, bold red wines. However, in Australia and South Africa it goes by Shiraz. DNA profiling in 1999 found Syrah to be the offspring of two obscure grapes from southeastern France, Dureza and Mondeuse blanche. Syrah should not be confused with Petite Sirah, a synonym for Durif, a cross of Syrah with Peloursin dating from 1880. Our favourite pairing at the moment is pan seared Venison Loin with potato rosti, pomegranate jus, bacon panna cotta and squash puree variety : Shiraz | 94% Syrah, 6% Mourvèdre winery : Glen Carlou Vineyards winemaker : Arco Laarman wine of origin : Paarl analysis : alc : 14.5 % vol rs : 2.2 g/l pH : 3.6 ta : 5.6 g/l type : Red style : Dry wooded pack : Bottle closure : Cork ageing : Optimum drinkability: 2013 to 2021 in the vineyard : Our Syrah vines are in the very warm region situated around the picturesque town of Paarl without the cooling sea breezes of some of the other quality areas but with uniqueness that makes it very popular. -
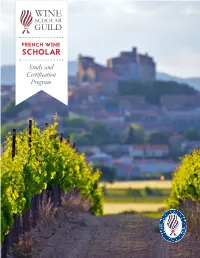
SCHOLAR Study and Certification Program
FRENCH WINE SCHOLAR Study and Certification Program The French Wine Scholar is a very serious wine program but fun and “ “ very enjoyable to follow. The teaching is superb and the quality of the material brilliant. GERARD BASSET, MW, MS, Best Sommelier in the World 2010 PROGRAM OVERVIEW The French Wine Scholar program is a study and certification program providing current, accurate and in-depth information on the wines and wine regions of France. Developed and administrated by the Wine Scholar Guild with the support of the French Ministry of Agriculture, this program is aimed at advanced students of wine whether professionals or serious wine hobbyists. Individuals who follow this in-depth curriculum and pass the exam, earn the French Wine Scholar title and the FWS post-nominal which may be incorporated into a professional signature (e.g. John Smith, FWS). PROGRAM CONTENT & DESIGN SPECIALIZATION FOR The development of this course of study involved many French COMMITTED STUDENTS OF WINE Inter-Professional organizations which shared resources, information and assistance. The FWS program allows wine professionals to set themselves apart from their peers by specializing in the wines of France. The Wine Scholar Guild incorporated this body of information into a study program covering viticultural and winemaking It is a great resource and supplement for students of wine practices, grape varieties, topography, climate, soils, history moving toward advanced general wine study programs such as and wine law for all of the French wine regions including Jura, WSET Diploma, Master of Wine, Court of Master Sommeliers’ Savoie and Corsica. Advanced Sommelier (and up) or Certified Wine Educator. -

Blanche = Mondeuse Noire × Viognier Is Rejected by DNA Analysis. in This Case, Viognier Is a Progeny of Mondeuse Blanche and a Half-Sibling of Syrah
Blanche = Mondeuse Noire × Viognier is rejected by DNA analysis. In this case, Viognier is a progeny of Mondeuse Blanche and a half-sibling of Syrah. Conversely, if mondeuse noire is a progeny of mondeuse blanche through a natural cross-pollination with an unknown and probably extinct variety, then Mondeuse Noire is a half- sibling of Syrah (option B on p 1025). In this case, viognier may either be the parent of Mondeuse Blanche, and a grandparent of Syrah and Mondeuse Noire, or Viognier could be a progeny of Mondeuse Blanche as well, and thus a half-sibling of both Mondeuse Noire and Syrah (option C), the other parents of Viognier and Mondeuse Noire being distinct, unknown and probably extinct. As a consequence, Syrah is either a grandchild or a half-sibling of both mondeuse noire and viognier, which explains why Mondeuse Noire was called Grosse Syrah in the Drôme region, and why all four varieties were clustered in the Sérine ampelographic group (see p xxvii; Bisson 2009). syrah’s most complete family tree Keeping in mind that other pedigree reconstructions are theoretically possible for the reasons explained above, we propose the most plausible and comprehensive family tree for Syrah (see diagram 3 below): it is a natural progeny of mondeuse blanche and dureza, a half-sibling of viognier, a grandchild of mondeuse noire, a niece/nephew of teroldego and a great-grandchild of pinot. SYRAH PEDIGREE DIAGRAM 3 The discovery of the natural parents of syrah has put a stop to rumours about its eastern origins, and the family tie with pinot challenges the view that they were introduced independently to Europe. -

An Homage to the Grape
VOLUME 29, No. 4 {2015} AN HOMAGE TO THE GRAPE A REMARKABLE FRUIT SIGNATURE TEAM Éric Bertoldi Simon Gaudreault-Rouleau Stéphane Leroux Julie Perreault Luc Rolland Justin Rouette LEGEND RATINGS AGING POTENTIAL ST Signature Team – out of 100 The aging potential of a wine Drink now WA Wine Advocate (Robert Parker) – out of 100 is its potential lifespan in good V Vinous (A. Galloni, S. Tanzer) – out of 100 cellaring conditions. Note that it’s Drink now a simple suggestion tool; the year or keep until WS Wine Spectator – out of 100 mentioned indicates the vintage’s year indicated JR Jancis Robinson – out of 20 peak. Of course, certain wines RVF Revue du vin de France – out of 20 may be to your liking long before Drink during the BD Bettane & Desseauve – out of 20 the year mentioned. indicated period B Burghound – out of 100 of maturity 000 Quantity of bottles available THE SIGNATURE TEAM’S SAQ CODE CURRENT FAVOURITES 00000000 O U E White wine Red wine R I T FAV O U R AN HOMAGE TO THE GRAPE A REMARKABLE FRUIT This edition of the Courrier vinicole celebrates grapes in their purest form. It is an homage to the fruit that marks each wine with its particu- lar character and that naturally provides an infi nite palette of aromas. This edition features varieties of all sorts—some that are well-known and others that are quite rare. They are our guides to the discovery of wines from around the world. Selected with the utmost care, they are the vehicles that express the very best of great terroirs.