La Langue Au Québec
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

A Comparative Study of French-Canadian and Mexican-American Contemporary Poetry
A COMPARATIVE STUDY OF FRENCH-CANADIAN AND MEXICAN-AMERICAN CONTEMPORARY POETRY by RODERICK JAMES MACINTOSH, B.A., M.A. A DISSERTATION IN SPANISH Submitted to the Graduate Faculty of Texas Tech University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of DOCTOR OP PHILOSOPHY Approved Accepted May, 1981 /V<9/J^ ACKNOWLEDGMENTS I am T«ry grateful to Dr. Edmundo Garcia-Giron for his direction of this dissertation and to the other mem bers of my committee, Dr. Norwood Andrews, Dr. Alfred Cismaru, Dr. Aldo Finco and Dr. Faye L. Bianpass, for their helpful criticism and advice. 11 ' V^-^'s;-^' CONTENTS ACKNOWI£DGMENTS n I. k BRIEF HISTORY OF QUE3EC 1 II• A BRIEF HISTORY OF MEXICAN-AMERICANS ^9 III. A LITERARY HISTORY OF QUEBEC 109 IV. A BRIEF OUTLINE OF ^MEXICAN LITERATURE 164 7» A LITERARY HISTORY OF HffiXICAN-AT/lERICANS 190 ' VI. A COMPARATIVE LOOK AT CANADZkll FRENCH AND MEXICAN-AMERICAN SPANISH 228 VII- CONTEMPORARY PRSNCK-CANADIAN POETRY 2^7 VIII. CONTEMPORARY TffiCICAN-AMERICAN POETRY 26? NOTES 330 BIBLIOGRAPHY 356 111 A BRIEF HISTORY OF QUEBEC In 153^ Jacques Cartier landed on the Gaspe Penin sula and established French sovereignty in North America. Nevertheless, the French did not take effective control of their foothold on this continent until 7^ years later when Samuel de Champlain founded the settlement of Quebec in 1608, at the foot of Cape Diamond on the St. Laurence River. At first, the settlement was conceived of as a trading post for the lucrative fur trade, but two difficul ties soon becam,e apparent—problems that have plagued French Canada to the present day—the difficulty of comirunication across trackless forests and m.ountainous terrain and the rigors of the Great Canadian Winter. -

Orientations to French Language Varieties Among Western Canadian French-As-A-Second- Language Teachers
Meike Wernicke The University of British Columbia ORIENTATIONS TO FRENCH LANGUAGE VARIETIES AMONG WESTERN CANADIAN FRENCH-AS-A-SECOND- LANGUAGE TEACHERS Abstract: In Canada, official French-English bilingualism and the long-standing presence of Indigenous and immigrant languages has shaped how these languages and their varieties are learned, taught, and used in educational contexts. To date, there has been little inquiry into French-as-a-second-language (FSL) teachers’ orientations to the varieties of French they teach, in particular Canadian French language varieties (Arnott, Masson, and Lapkin 2019), despite studies showing that ideologies associated with different language varieties can impact teachers’ instructional choices. This article presents an analysis of the narrated experiences of FSL teachers from Western Canada, drawn from journal and interview accounts, about their encounters with different language varieties while on professional development in France. Thematic and discourse analytic perspectives bring to light complex negotiations of ideological meaning and representation related to language variation in French, as well as the discursive strategies employed by the participants in orientating to these meanings. These discursive actions make evident deeply embedded language ideologies that have significant implications for both French as a first and as a second language education, not only in terms of a prevailing linguistic insecurity among francophones but equally significant for FSL teachers’ professional identity construction, especially those who are themselves second language speakers of French. The analysis and discussion highlight the importance of integrating pluralistic perspectives into teacher education programs and ongoing teacher professional development initiatives. Keywords: French language education w Canadian French w linguistic insecurity w standardized language w language ideology Wernicke, Meike. -

Language Attitudes Towards Canadian French and English, 1691-1902: the Emergence of the Canadian Voices
Language Attitudes towards Canadian French and English, 1691-1902: The Emergence of the Canadian Voices by Beau Brock A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in French Linguistics Department of French Studies University of Toronto © Copyright by Beau Brock 2014 Language Attitudes towards Canadian French and English, 1691- 1902: The Emergence of the Canadian Voices Beau Brock Doctor of Philosophy in French Linguistics Department of French Studies University of Toronto 2014 Abstract This dissertation examines the origins and development of attitudes (in the guise of beliefs and stereotypes) towards Canadian French and Canadian English during the 18th and 19th centuries, as expressed primarily by foreign travellers to North America. By conducting a comparative study of these two languages, I aim to build a bridge between French Canadian studies on Canadian French, and Anglophone Canadian studies on Canadian English, two fields which have historically been distinct and separate. The time period studies (1691-1902) is marked by major political and social change, including the English Conquest, the creation of Upper and Lower Canada (and later the United Province of Canada), and the Dominion, all of which had major, lasting effects on the development and status of both languages. In order to study the evolution of language attitudes during this period, I employed content analysis on the metalinguistic and cultural commentary in a wide variety of texts, including travel journals, scholarly and newspaper articles, monographs, and prescriptive texts, written in French and English. My analysis has shown that British commentators were the most critical of both languages (and peoples), and relied almost entirely on beliefs and stereotypes rather than empirical evidence to ii support their claims. -

We Are French. Et Anglais Nous Restons
University of Massachusetts Amherst ScholarWorks@UMass Amherst Masters Theses Dissertations and Theses August 2014 We Are French. Et Anglais Nous Restons. Alison Jane Bowie University of Massachusetts Amherst Follow this and additional works at: https://scholarworks.umass.edu/masters_theses_2 Part of the Cultural History Commons, Dramatic Literature, Criticism and Theory Commons, Fine Arts Commons, French and Francophone Literature Commons, Other Languages, Societies, and Cultures Commons, Other Theatre and Performance Studies Commons, Performance Studies Commons, Playwriting Commons, Race, Ethnicity and Post-Colonial Studies Commons, and the Theatre History Commons Recommended Citation Bowie, Alison Jane, "We Are French. Et Anglais Nous Restons." (2014). Masters Theses. 4. https://doi.org/10.7275/5415302 https://scholarworks.umass.edu/masters_theses_2/4 This Open Access Thesis is brought to you for free and open access by the Dissertations and Theses at ScholarWorks@UMass Amherst. It has been accepted for inclusion in Masters Theses by an authorized administrator of ScholarWorks@UMass Amherst. For more information, please contact [email protected]. ! ! We Are French. Et Anglais Nous Restons. Rethinking translation and adaptation for the stage as a tool for affecting bicultural and bilingual identity through an analysis and the practice of translating and adapting Armand Leclaire's 1916 ! play Le petit maître d'école ! ! ! ! A Thesis Presented By ALISON JANE BOWIE ! ! ! Submitted to the Graduate School of the University of -

Universitat Pompeu Fabra Departament De Traducció I
Universitat Pompeu Fabra Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge Programa Oficial de Doctorat Pluricentric dubbing in French and Spanish The translation of linguistic variation and prefabricated orality in films Presentat per Pascale Trencia Supervisió del projecte per Dra. Victòria Alsina, Dra. Jenny Brumme i Dra. Kristin Reinke Barcelona, setembre de 2019 Dedicatòria i Agraïments A mis padres, Guy y Lise, a mi hermana Marion, a Guillermo, a mis directoras, Vicky, Jenny y Kristin, y a todos los que han cruzado mi camino durante estos cincos años de estudios doctorales. Esta tesis lleva un poco de cada uno de vosotros. Resum El present estudi examina com es tradueix el discurs fílmic, especialment els elements marcadors de la variació lingüística, al francès i al castellà, dues llengües pluricèntriques, és a dir, llengües que tenen més d’un centre normatiu. El fet que diverses nacions adoptin mesures per promoure la indústria nacional del doblatge, en general per motius econòmics i culturals, en ocasions porta a duplicar les varietats de doblatge. Per tant, una qüestió clau és saber com es comparen aquestes versions doblades i com aconsegueixen transmetre la variació lingüística i la oralitat prefabricada a través de les seves respectives traduccions. L’objectiu d’aquesta investigació consisteix a examinar quines són les principals diferències i similituds entre el discurs fílmic doblat de Quebec i de França (per al francés) i d’Espanya i Amèrica Llatina (per a l’espanyol), sobre la base d’un estudi de la pel·lícula Death Proof (2007) de Quentin Tarantino. Aquesta pel·lícula va ser seleccionada pel seu alt nivell de variació lingüística i la importància que Tarantino dóna a la llengua (no estàndard) de les seves pel·lícules. -
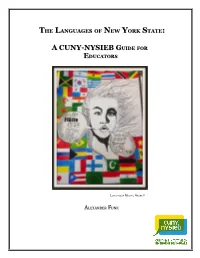
Languages of New York State Is Designed As a Resource for All Education Professionals, but with Particular Consideration to Those Who Work with Bilingual1 Students
TTHE LLANGUAGES OF NNEW YYORK SSTATE:: A CUNY-NYSIEB GUIDE FOR EDUCATORS LUISANGELYN MOLINA, GRADE 9 ALEXANDER FFUNK This guide was developed by CUNY-NYSIEB, a collaborative project of the Research Institute for the Study of Language in Urban Society (RISLUS) and the Ph.D. Program in Urban Education at the Graduate Center, The City University of New York, and funded by the New York State Education Department. The guide was written under the direction of CUNY-NYSIEB's Project Director, Nelson Flores, and the Principal Investigators of the project: Ricardo Otheguy, Ofelia García and Kate Menken. For more information about CUNY-NYSIEB, visit www.cuny-nysieb.org. Published in 2012 by CUNY-NYSIEB, The Graduate Center, The City University of New York, 365 Fifth Avenue, NY, NY 10016. [email protected]. ABOUT THE AUTHOR Alexander Funk has a Bachelor of Arts in music and English from Yale University, and is a doctoral student in linguistics at the CUNY Graduate Center, where his theoretical research focuses on the semantics and syntax of a phenomenon known as ‘non-intersective modification.’ He has taught for several years in the Department of English at Hunter College and the Department of Linguistics and Communications Disorders at Queens College, and has served on the research staff for the Long-Term English Language Learner Project headed by Kate Menken, as well as on the development team for CUNY’s nascent Institute for Language Education in Transcultural Context. Prior to his graduate studies, Mr. Funk worked for nearly a decade in education: as an ESL instructor and teacher trainer in New York City, and as a gym, math and English teacher in Barcelona. -

Les Parlers Français Oubliés D'amérique : Le Franco-Minnesotain Et Le Franco-Dakotain Robert A
Document généré le 2 oct. 2021 14:58 Revue de l’Université de Moncton Les parlers français oubliés d'Amérique : le franco-minnesotain et le franco-dakotain Robert A. Papen Les variétés de français en Amérique du Nord. Évolution, innovation Résumé de l'article et description Depuis Valdman (1979) on connaît assez bien les divers parlers français des Volume 37, numéro 2, 2006 États-Unis, mais il reste deux variétés qui n'ont jamais été décrites : le français de plusieurs communautés « canadiennes » des comtés de Polk et de Red Lake URI : https://id.erudit.org/iderudit/015844ar dans le nord-ouest du Minnesota et le français mitchif du village de Belcourt et DOI : https://doi.org/10.7202/015844ar de ses environs au Dakota du Nord. L'objectif de cet article est premièrement de tracer rapidement l'histoire des premiers habitants de ces deux ensembles de communautés et deuxièmement de décrire les caractéristiques Aller au sommaire du numéro fondamentales des variétés de français parlées dans ces villages, les comparant soit aux verna-culaires cousins des provinces de l'Ouest canadien, soit au parler des Mitchif s du Canada. Éditeur(s) Revue de l'Université de Moncton ISSN 0316-6368 (imprimé) 1712-2139 (numérique) Découvrir la revue Citer cet article Papen, R. A. (2006). Les parlers français oubliés d'Amérique : le franco-minnesotain et le franco-dakotain. Revue de l’Université de Moncton, 37(2), 149–171. https://doi.org/10.7202/015844ar Tous droits réservés © Revue de l'Université de Moncton, 2006 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. -

Proquest Dissertations
University of Alberta L'Acadie communautaire: The Inclusion and Exclusion of New Brunswick Francophones by Christina Lynn Keppie © A thesis submitted to the Faculty of Graduate Studies and Research in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Modern Languages and Cultural Studies Edmonton, Alberta Fall 2008 Library and Bibliotheque et 1*1 Archives Canada Archives Canada Published Heritage Direction du Branch Patrimoine de I'edition 395 Wellington Street 395, rue Wellington Ottawa ON K1A0N4 Ottawa ON K1A0N4 Canada Canada Your file Votre reference ISBN: 978-0-494-46343-7 Our file Notre reference ISBN: 978-0-494-46343-7 NOTICE: AVIS: The author has granted a non L'auteur a accorde une licence non exclusive exclusive license allowing Library permettant a la Bibliotheque et Archives and Archives Canada to reproduce, Canada de reproduire, publier, archiver, publish, archive, preserve, conserve, sauvegarder, conserver, transmettre au public communicate to the public by par telecommunication ou par Plntemet, prefer, telecommunication or on the Internet, distribuer et vendre des theses partout dans loan, distribute and sell theses le monde, a des fins commerciales ou autres, worldwide, for commercial or non sur support microforme, papier, electronique commercial purposes, in microform, et/ou autres formats. paper, electronic and/or any other formats. The author retains copyright L'auteur conserve la propriete du droit d'auteur ownership and moral rights in et des droits moraux qui protege cette these. this thesis. Neither the thesis Ni la these ni des extraits substantiels de nor substantial extracts from it celle-ci ne doivent etre imprimes ou autrement may be printed or otherwise reproduits sans son autorisation. -

Discourse Markers “Well” and “Ben” in Chiac Emilie Leblanc and Selena Phillips-Boyle This Paper Investigates the Use Of
Discourse Markers “well” and “ben” in Chiac Emilie LeBlanc and Selena Phillips-Boyle This paper investigates the use of the discourse markers “well” and “ben” in speakers of Chiac, a dialect of Acadian French in southeast New Brunswick. Chiac is characterised by extensive borrowings and code-switching with English (Chevalier 2007; Perrot 1995; King 2008). Previous work analyses the discourse marker “well” (Schiffrin 1987a), “ben” (Bruxelles and Traverso 2001; D’Amboise and Léard 1996; Hansen 1995), and the alternations between “well” and “ben” in Acadian French (Chevalier 2000, 2002). The present study fills a gap in the literature by using quantitative and qualitative methodologies to address the following questions: 1) What linguistic and social factors condition the use of “well” and “ben” in this variety? and 2) What discursive function(s) are accomplished by the use of "well" or "ben", and how can we explain why speakers chose to employ one variant over the other? The corpus used for the present study was collected in 2012 and includes ten participants, students at the two French-medium high schools in Moncton: Mathieu-Martin and L’Odyssée. The participants are between the ages of 15 and 17 and are native French speakers. There are four male and six female participants. The data were collected through sociolinguistic interviews conducted by a native speaker of Chiac. The participants were each interviewed for approximately 30 minutes. The data have been transcribed and coded in Elan (Wittenburg et al. 2006). We exclude some tokens from the present study, namely fixed expressions (for example, “well then”, “ben là”, “ben c’est ça) along with the use of “ben” as a conjunction. -

French from Canada Versus French from France?
CJAL * RCLA Wernicke 1 Hierarchies of Authenticity in Study Abroad: French From Canada Versus French From France? Meike Wernicke University of British Columbia Abstract For many decades, Francophone regions in Canada have provided language study exchanges for French as a second language (FSL) learners within their own country. At the same time, FSL students and teachers in Canada continue to orient to a native speaker standard associated with European French. This Eurocentric orientation manifested itself in a recent study examining conceptions of authentic language among Canadian FSL teachers on professional study abroad in France. Taking an interactional perspective (De Fina & Georgakopoulou, 2012), this article examines how the teachers negotiated discourses of language subordination (Lippi-Green, 1997) that construct Canadian French as less authentic than French from France. Findings show some teachers drawing on this hierarchization of French to “authenticate” (Coupland, 2010) an identity as French language expert, either by contrasting European and Canadian varieties of French or by projecting France as the locus of French language and culture as exclusively representative of authentic “Frenchness.” Résumé Depuis des décennies, les régions francophones au Canada ont offert aux apprenants de français langue seconde (FLS) des programmes d’échange linguistique dans leur propre pays. Toutefois, les étudiants et les enseignants de FLS au Canada ont tendance à toujours se référer à la norme standard du locuteur natif parlant le français européen. Cette orientation eurocentrique a été relevée récemment dans une enquête examinant la notion d’authenticité linguistique auprès d’un groupe d’enseignants de FLS à la suite d’un stage de formation en France. -

Canadian French for Better Travel Contents
CANADIAN FRENCH CANADIAN FOR BETTER TRAVEL Travel Travel Phrasebook FRENCH FOR BETTER TRAVEL Hundreds of colourful expressions, with their meanings in standard French and English / History and basics of French in Québec and Canada / Phonetic transcriptions to help you speak and understand Canadian French / Full index in Canadian French and English / Sidebars CH on Québécois culture and linguistic particularities / A great little travel companion to help you discover and appreciate Canadian French! CANADIAN FREN www.ulyssesguides.com ISBN 978-2-89665-018-7 (digital version) PC_Canadian-French-FBT(9657).indd 1 2011-03-30 15:40:39 KEY WORDS AND PHRASES 1 Introduction Bonjour Bonjour/Au revoir Hello/Goodbye 2 Vive la Différence! Bonswêr Bonsoir Good evening 3 Basic Québécois Words and Expressions Bienvenue Je vous en prie/De rien You’re welcome 4 Daily Life Pardon? Vous dites? Excuse me? (to ask someone 5 Outdoors to repeat themselves) 6 Creature Comforts S’cusez/S’cusez-mwé Excusez-moi Excuse me (to pass or 7 Human Relations interrupt someone) 8 Index t’suite/tsu suite tout de suite right now/right away asteure maintenant/ now/ de nos jours these days à matin ce matin this morning à swèr ce soir tonight/this evening chu/ch’ je suis I am mwé moi me twé toi you nous autres/nouzô’te nous us/we vous autres/vouzô’te vous you (plural) eux autres/euzô’te ils, elles them Ch’sé pâs./Ch’é pâs. Je ne sais pas. I don’t know. t’sé/t’sé, lâ tu sais you know LE QUÉBÉCOIS, CÉ L’fONNE à’ mORT! (see p. -

Francophone Dynamics in a Translated Canada: from the Margins to the Centre and Back Denise Merkle
Francophone Dynamics in a Translated Canada: From the Margins to the Centre and Back Denise Merkle Abstract This paper examines French Acadian literature’s at times conflicted relationship with the target language, English, the other official language of New Brunswick. A broad survey of Acadian literature since 1960 is punctuated with brief discussions of selected works in their socio- political context of production. Translations of these works can be placed variously on a continuum that ranges from extremes of vertical to horizontal translation. At one extreme, vertical translation homogenises a fractured identity into the dominant language through annexation. Alternatively, at the foreignising extreme, a translator may opt for a horizontal, minoritising, translation strategy in an effort to decentre the traditional power relationship between the two cultures. This paper gives an overview introduction to these strategies used to translate Acadian literature. Introduction Along with its reputation as a bilingual country, Canada is known throughout the world as a country of immigration and immigrants, and with (im)migration comes cultural and linguistic diversity. While today’s multilingualism in such cities as Toronto, Montréal and Vancouver is impressively diverse, it must not be forgotten that Canada has a long history of multilingualism. The first French explorers exchanged with First Nations communities who spoke Iroquois, Huron and Cree, among other languages. The extent to which Canada’s First Nations communities have been marginalised is generating mounting national and international concern. This paper will concentrate on another group that has been marginalised in Canada, although to a lesser extent than Canada’s First Nations peoples: Canada’s Acadian population.