Les Armes D'insulinde Conservees
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

ANALISA HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM TRADISIONAL Oleh : PRAMUDIA GILANG MAHESA 616110190 Untuk Meme
ANALISA HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM TRADISIONAL Oleh : PRAMUDIA GILANG MAHESA 616110190 SKRIPSI Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM MATARAM 2020 ii HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI ANALISA HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM TRADISIONAL Oleh : PRAMUDIA GILANG MAHESA 616110190 Menyetujui Pembimbing Pertama Pembimbing Kedua Dr. RINA ROHAYU, S.H.,M.H FAHRURROZI, S.H., M.H NIDN : 0830118204 NIDN : 0817079001 iii iv v vi MOTO “Dalam Mengolah Pikiran Tidak Sekedar Mendulang Emas Di Tong Sampah Tapi Sesungguhnya Bagaimana Membuat Sampah Menjadi Emas” vii PERSEMBAHAN Terimakasih Tuhan atas berkah rahmat serta kesahatan yang engkau berikan sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Skipsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya : 1. Ibunda tercinta saya ibu Dia Titin Winda Astiti yang sangat berarti berjasa dalam hidup saya, orang yang senantiasa memberikan doa-doanya tanpa henti, dukungan, serta moril kepada saya. 2. Ayahanda tercinta saya ayahanda Mun-Mun Chang Dia, terima kasih atas segalanya atas doa, motivasi serta saran yang diberikan atas harapan pada anaknya menjadi seorang sarjana yang mampu memberikan sumbangsi pemikiran untuk bangsa dan tanah kelahirannya. 3. Untuk adek-adekku, yang ketiga Raoran Tahta Rabina, dan yang kedua Dia Gargarin Krisna Deva terima kasih atas dukuganya yang dibeikan kepada Kakak tercinta. 4. Untuk Seluruh keluarga besar dari ibu dan ayah, terima kasih atas semuanya yang selalu membuatku semangat dalam menyelesaikan perkuliahan ini dengan tepat waktu. 5. Untuk sahabat-sahabatku, Ahadiaz Agustav Putra, Imam Maliki, Lanov, Rizal Bahsin, Rahmat Novalda, Rizki Rahmand, Serta Ariya Tarabifaa terima kasih untuk semuanya atas dukungan serta kebahagian yang diberikan. -

Angsa Sebagai Sumber Ide Penciptaan Kujang
ANGSA SEBAGAI SUMBER IDE PENCIPTAAN KUJANG HALAMAN JUDUL TUGAS AKHIR KARYA Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Diploma IV (D-4) Program Studi Senjata Tradisional Keris Jurusan Kriya Oleh: ACHMAD FATHONY 14153104 FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA 2020 PENGESAHAN TUGAS AKHIR KARYA ANGSA SEBAGAI SUMBER IDE PENCIPTAAN KUJANG Oleh: ACHMAD FATHONY NIM. 14153104 Telah di uji dan dipertahankan di hadapan Tim penguji Pada tanggal 19 Maret 2020 Tim Penguiji Ketua Penguji : Dr. Karju, M.Pd (……………) Penguji Bidang I : Aji Wiyoko, S.Sn., M.Sn (……………) Penguji/Pembimbing : Basuki Teguh Yuwono, S.Sn., M.Sn (……………) Deskripsi karya ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Terapan Seni (S.Tr.Sn) pada Institut Seni Indonesia Surakarta Surakarta, 30 Maret 2020 Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain Joko Budiwiyanto, S.Sn., M.A NIP. 197207082003121001 ii PERNYATAAN Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : Achmad Fathony NIM : 14153104 Jurusan : Kriya Program Studi : Senjata Tradisional Keris Judul Tugas Akhir Karya : Angsa Sebagai Sumber Ide Penciptaan Kujang Menyatakan bahwa karya Tugas Akhir ini merupakan karya original dari penulis dan bukan jiplakan atau plagiarisme dari karya orang lain. Apabila dikemudian hari, terbukti sebagai hasil jiplakan atau plagiarisme, maka penulis bersedia mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Penulis menyetujui jika laporan Tugas Akhir Karya ini dipublikasikan secara online ataupun cetak oleh Institut Seni Indonesia Surakarta, dengan tetap memperhatikan etika penulisan karya ilmiah untuk keperluan akademis. Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya. Surakarta, 30 Maret 2020 Yang menyatakan Achmad Fathony NIM. 14153104 iii KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala anugerah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir karya dengan judul “Angsa Sebagai Sumber Ide Penciptaan Kujang”. -
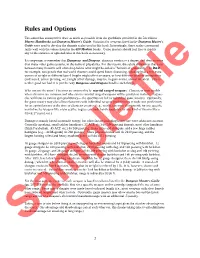
Rules and Options
Rules and Options The author has attempted to draw as much as possible from the guidelines provided in the 5th edition Players Handbooks and Dungeon Master's Guide. Statistics for weapons listed in the Dungeon Master's Guide were used to develop the damage scales used in this book. Interestingly, these scales correspond fairly well with the values listed in the d20 Modern books. Game masters should feel free to modify any of the statistics or optional rules in this book as necessary. It is important to remember that Dungeons and Dragons abstracts combat to a degree, and does so more than many other game systems, in the name of playability. For this reason, the subtle differences that exist between many firearms will often drop below what might be called a "horizon of granularity." In D&D, for example, two pistols that real world shooters could spend hours discussing, debating how a few extra ounces of weight or different barrel lengths might affect accuracy, or how different kinds of ammunition (soft-nosed, armor-piercing, etc.) might affect damage, may be, in game terms, almost identical. This is neither good nor bad; it is just the way Dungeons and Dragons handles such things. Who can use firearms? Firearms are assumed to be martial ranged weapons. Characters from worlds where firearms are common and who can use martial ranged weapons will be proficient in them. Anyone else will have to train to gain proficiency— the specifics are left to individual game masters. Optionally, the game master may also allow characters with individual weapon proficiencies to trade one proficiency for an equivalent one at the time of character creation (e.g., monks can trade shortswords for one specific martial melee weapon like a war scythe, rogues can trade hand crossbows for one kind of firearm like a Glock 17 pistol, etc.). -

56 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Hasil Penelitian Penelitian Legenda Tokoh Pencak Silat Indonesia Yaitu En
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Hasil Penelitian Penelitian legenda tokoh pencak silat Indonesia yaitu Enny Rukmini Sekarningrat, Suko Winadi, dan Eddie Mardjoeki Nalapraya akan membahas mengenai sepak terjang ketiga tokoh tersebut di dalam mengembangkan pencak silat di Indonesia dan luar negeri. Penelitian legenda tokoh pencak silat Indonesia, Enny Rukmini Sekarningrat dilakukan di Jawa Barat terutama di Kabupaten Garut dan Kota Bandung. Kemudian penelitian legenda tokoh pencak silat Indonesia, Suko Winadi dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terakhir penelitian legenda tokoh pencak silat Indonesia, Eddie Mardjoeki Nalapraya dilakukan di Provinsi DKI Jakarta. Langkah penelitian dimulai dengan melakukan wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumentasi serta berbagai arsip yang berkaitan dengan legenda tokoh pencak silat Indonesia (Enny Rukmini Sekarningrat, Suko Winadi, Eddie Mardjoeki Nalapraya). Wawancara tidak hanya dilakukan dengan ketiga legenda tokoh pencak silat Indonesia tersebut melainkan juga dengan keluarga atau ahli waris dan para kerabat dekat pencak silat dari setiap tokoh. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi lapangan seperti mengunjungi rumah legenda tokoh pencak silat Indonesia, Padepokan Pencak Silat Indonesia (PnPSI), dan beberapa tempat bersejarah yang berkaitan dengan legenda tokoh pencak silat Indonesia untuk menunjang dalam melakukan pengambilan data penelitian. 56 B. Pembahasan dan Temuan 1. Rd. Enny Rukmini Sekarningrat a. Riwayat Hidup Rd. Enny Rukmini Sekarningrat Enny Rukmini Sekarningrat cukup terkenal dikalangan masyarakat luas terutama bagi mereka yang mencintai seni budaya beladiri pencak silat. Bahkan namanya telah tercatat sebagai Majelis Pakar PB. IPSI (1999) dan Dewan Pertimbangan PB. IPSI (2003: 41). Tidaklah mengherankan apabila namanya sudah dikenal hingga ke tingkat Internasional. Memang kalau kita belum mengenalnya sekilas terlihat galak apalagi didukung oleh sorot mata yang tajam membuat orang yang melihatnya menjadi segan. -

Warhammer Fantasy Roleplay Price List
Warhammer Fantasy Roleplay Price List Introduction to Universal Price List System Purpose This system was started in 1982 with the intention of providing a comprehensive pricing and encumbrance system for all the medieval fantasy games systems currently in use in the club where I used to role-play. It has been used, and still is being used, by a number of GMs for various games systems including Advanced Dungeons and Dragons, DragonQuest, HârnMaster, RoleMaster and RuneQuest. In fact the system became a club standard, which eased moving characters between various games. The intention of this system is to replace the monetary system and the (often woefully incomplete) price lists provided with the games system. However, it is assumed that one penny is equal to the basic unit of currency in the game system when it is required to translate prices from the host game to this system. For instance, one AD&D silver piece is equivalent to 1d in this system. Prices are quoted in pennies which is the basic silver coin, where 1d is one penny. Since I use a system of twelve pennies equalling one schilling, a lot of the more expensive items are quote in multiples of 3d. My fatigue / encumbrance systems work on weight of the item. Weight of most items likely to be carried are quoted in pounds (lb.) to the nearest 1/10th or ¼ of a pound for small items (and occasionally in fractions of an ounce (oz)). The price list is categorised by occupation, which do not necessarily have anything to do with guild structure, nor do they imply that goods are only sold in such specialist shops/workshops. -

THE ARMOURER and HIS CRAFT from the Xith to the Xvith CENTURY by CHARLES FFOULKES, B.Litt.Oxon
GQ>0<J> 1911 CORNELL UNIVERSITY LIBRARY BOUGHT WITH THE INCOME OF THE SAGE ENDOWMENT FUND GIVEN IN 1891 BY HENRY WILLIAMS SAGE Cornell University Ubrary NK6606 .F43 1912 The armourer and his craft from the xith C Date iSIORAGE 3 1924 030 681 278 Overs olin a^(Mr;= :3fff=iqfPfr.g^h- r^ n .^ I aAri.^ ^ Cornell University Library XI The original of this book is in the Cornell University Library. There are no known copyright restrictions in the United States on the use of the text. http://www.archive.org/details/cu31924030681278 THE ARMOURER AND HIS CRAFT UNIFORM WITH THIS VOLUME PASTE By A. Beresford Ryley < 'A w <1-1 K 2; < > o 2 o 2; H ffi Q 2; < w K o w u > w o o w K H H P W THE ARMOURER AND HIS CRAFT FROM THE XIth TO THE XVIth CENTURY By CHARLES FFOULKES, B.Litt.Oxon. WITH SIXTY-NINE DIAGRAMS IN THE TEXT AND THIRTY-TWO PLATES METHUEN & CO. LTD. 36 ESSEX STREET W.G. LONDON Kc tf , First Published in igi2 TO THE RIGHT HONOURABLE THE VISCOUNT DILLON, Hon. M.A. Oxon. V.P.S.A., Etc. Etc. CURATOR OF THE TOWER ARMOURIES PREFACE DO not propose, in this work, to consider the history or develop- ment of defensive armour, for this has been more or less fully I discussed in v^orks which deal with the subject from the historical side of the question. I have rather endeavoured to compile a work which will, in some measure, fill up a gap in the subject, by collecting all the records and references, especially in English documents, which relate to the actual making of armour and the regulations which con- trolled the Armourer and his Craft. -

Pengembangan Permainan Monopoli Berbantuan Media Audiovisual Mupel Ips Materi Keragaman Pakaian Adat Diindonesia Kelas Iv Sdn Pongangan Gunungpati Semarang
PENGEMBANGAN PERMAINAN MONOPOLI BERBANTUAN MEDIA AUDIOVISUAL MUPEL IPS MATERI KERAGAMAN PAKAIAN ADAT DIINDONESIA KELAS IV SDN PONGANGAN GUNUNGPATI SEMARANG SKRIPSI diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Oleh Nurul Hidayah 1401416215 JURUSAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2020 i PENGEMBANGAN PERMAINAN MONOPOLI BERBANTUAN MEDIA AUDIOVISUAL MUPEL IPS MATERI KERAGAMAN PAKAIAN ADAT DIINDONESIA KELAS IV SDN PONGANGAN GUNUNGPATI SEMARANG SKRIPSI diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Oleh Nurul Hidayah 1401416215 JURUSAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2020 i ii iii iv MOTO DAN PERSEMBAHAN MOTO “Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk merubah dunia”. (Nelson Mandela) PERSEMBAHAN Skripsi ini peneliti persembahkan kepada orangtua yang selalu mendukung dan mendoakan, Bapak Giyarno dan Ibu Yanti. v ABSTRAK Hidayah, Nurul. 2020. Pengembangan Permainan Monopoli berbantuan Media Audiovisual Mupel IPS Keragaman Pakaian Adat di Indonesia Kelas IV SDN Pongangan Gunungpati Semarang. Sarjana Pendidikan, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, Pembimbing Dr. Ali Sunarso, M.Pd. 420 halaman. Suryani (2018:14) mengemukakan bahwa media bermanfaat untuk membuat pengajaran lebih menarik sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar pada siswa, memperjelas isi pembelajaran agar lebih mudah dipahami, menjadikan metode pembelajaran menjadi lebih variasi, serta membuat siswa lebih terlibat dalam pembelajaran. Permasalahan yang terdapat di Kelas IV SDN Pongangan dalam pembelajaran IPSyaitu kurangnya media yang dimiliki sekolah, khususnya media yang tepat untuk menyampaikan materi pada mupel IPS materi Keragaman budaya di Indonesia.Sehingga diperlukan media pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan agar siswa lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran IPS yaitu melalui Permainan Monopoli berbantuan Media audiovisual. -

Slavery and Social Change in Early Modern Southeast Asia
215 Journal of Southeast Asian Studies, 38(2), pp 215–245 June 2007. Printed in the United Kingdom. E 2007 The National University of Singapore doi:10.1017/S0022463407000021 Fugitive women: Slavery and social change in early modern Southeast Asia Eric A. Jones Female slaves in VOC-controlled Southeast Asia did not fare well under a legal code which erected a firm partition between free and slave status. This codification imposed a rigid dichotomy for what had been fluid, abstract conceptions of social hierarchy, in effect silting up the flow of underclass mobility. At the same time, conventional relationships between master and slave shifted in the context of a changing economic climate. This article closely narrates the lives of several eighteenth-century female slaves who, left with increasingly fewer options in this new order, resorted to running away. One day in the early months of 1793 authorities in the Dutch colonial capital became suspicious when they noticed a man carrying what appeared to be a bloody axe (golok). When they approached him about the axe (which turned out only to have rust on the blade) they discovered that he was in fact a fugitive slave. The runaway, named Augusto van Sumbauwa, was apprehended and revealed to them a complex of safe houses and runaway accomplices. Augusto had been on the run with his girlfriend, Sapia van Sumbauwa, moving from safe house to safe house. These slaves were given Dutch- style ‘last names’ with ‘van’ implying their ethnicity or geographical origin. They had first rented a back room in the home of a ‘free non-Christian woman’ called Ma or Nyai Sauwa, partially in exchange for repairing her roof, and then moved to a large plantation mansion with other runaways. -

UC Irvine Flashpoints
UC Irvine FlashPoints Title The Fear of French Negroes: Transcolonial Collaboration in the Revolutionary Americas Permalink https://escholarship.org/uc/item/3j476038 ISBN 9780520271128 Author Johnson, Sara E. Publication Date 2012-09-15 Peer reviewed eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California The Fear of French Negroes Transcolonial Collaboration in the Revolutionary Americas Sara E. Johnson university of california press Berkeley • Los Angeles • London The Fear of French Negroes flashpoints The series solicits books that consider literature beyond strictly national and disciplin- ary frameworks, distinguished both by their historical grounding and their theoretical and conceptual strength. We seek studies that engage theory without losing touch with history and work historically without falling into uncritical positivism. FlashPoints aims for a broad audience within the humanities and the social sciences concerned with mo- ments of cultural emergence and transformation. In a Benjaminian mode, FlashPoints is interested in how literature contributes to forming new constellations of culture and history and in how such formations function critically and politically in the present. Available online at http://repositories.cdlib.org/ucpress. Series Editors: Ali Behdad (Comparative Literature and English, UCLA); Judith Butler (Rhetoric and Comparative Literature, UC Berkeley), Founding Editor; Edward Dimendberg (Film & Media Studies, UC Irvine), Coordinator; Catherine Gallagher (English, UC Berkeley), Founding Editor; Jody Greene (Literature, UC Santa Cruz); Susan Gillman (Literature, UC Santa Cruz); Richard Terdiman (Literature, UC Santa Cruz) 1. On Pain of Speech: Fantasies of the First Order and the Literary Rant, by Dina Al-Kassim 2. Moses and Multiculturalism, by Barbara Johnson, with a foreword by Barbara Rietveld 3. -

Inventory of the Oriental Manuscripts of the Library of the University of Leiden
INVENTORIES OF COLLECTIONS OF ORIENTAL MANUSCRIPTS INVENTORY OF THE ORIENTAL MANUSCRIPTS OF THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF LEIDEN VOLUME 7 MANUSCRIPTS OR. 6001 – OR. 7000 REGISTERED IN LEIDEN UNIVERSITY LIBRARY IN THE PERIOD BETWEEN MAY 1917 AND 1946 COMPILED BY JAN JUST WITKAM PROFESSOR OF PALEOGRAPHY AND CODICOLOGY OF THE ISLAMIC WORLD IN LEIDEN UNIVERSITY INTERPRES LEGATI WARNERIANI TER LUGT PRESS LEIDEN 2007 © Copyright by Jan Just Witkam & Ter Lugt Press, Leiden, The Netherlands, 2006, 2007. The form and contents of the present inventory are protected by Dutch and international copyright law and database legislation. All use other than within the framework of the law is forbidden and liable to prosecution. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, translated, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission of the author and the publisher. First electronic publication: 17 September 2006. Latest update: 30 July 2007 Copyright by Jan Just Witkam & Ter Lugt Press, Leiden, The Netherlands, 2006, 2007 2 PREFACE The arrangement of the present volume of the Inventories of Oriental manuscripts in Leiden University Library does not differ in any specific way from the volumes which have been published earlier (vols. 5, 6, 12, 13, 14, 20, 22 and 25). For the sake of brevity I refer to my prefaces in those volumes. A few essentials my be repeated here. Not all manuscripts mentioned in the present volume were viewed by autopsy. The sheer number of manuscripts makes this impossible. -

Studi Tentang Keris Karya Suyanto (Kajian Tentang Estetika Dan Proses Pembuatan)
Studi tentang keris karya suyanto (kajian tentang estetika dan proses pembuatan) Oleh: Estri Ristianingrum NIM. K.3201022 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Keris merupakan benda seni dengan teknologi metalurgi tinggi yang rumit, penuh dengan sentuhan artistik serta karya yang bermutu seni yang mempunyai nilai estetika tinggi. Tidak semua orang bisa meniru dalam hal pembuatan, atau mewarisinya karena pada tiap jaman mempunyai teknik pembuatan tertentu disertai campuran bahan baku baik besi, baja, dan pamor, yang sampai sekarang masih diselimuti rahasia. Kecuali masih ada hubungan keturunan maupun keahlian dalam membuat keris ataupun memecahkan sendiri rahasia yang terkandung didalamnya melalui eksperimen pembuatan keris. Membuat keris tidaklah mudah untuk menghasilkan keris yang bermutu seni tinggi dan mempunyai nilai estetika tinggi diperlukan ritual-ritual khusus seperti menjalani laku tapa dan macam-macam latihan rohani kejawen. Selain itu membuat keris tradisional atau klasik yang sesuai dengan pribadi pemesan dan punya “isi” perlu waktu yang lama, setahun mungkin hanya bisa membuat 2-3 keris dengan biaya mahal. Ada kriteria tertentu untuk mendapatkan keris klasik atau tradisional, kriteria yang harus dipenuhi, antara lain wutuh, sepuh dan tangguh. Yang dimaksud dari kriteria tersebut adalah kondisi keris harus terlihat wutuh dengan tidak ada cacatnya, baik itu bilah, pola pamor besi, baja dan kelengkapan berupa warangka, ukiran maupun pendoknya. Dari masing-masing komponen tersebut seandainya ada salah satu yang cacat maka keris itu sudah kurang sempurna. Sedangkan yang dimaksud dengan sepuh adalah keris itu betul-betul tua usianya. Hal ini perlu diperhatikan, sebab proses kimiawi bisa merubah keris buatan manusia kini seolah-olah menjadi keris tua. Kemudian yang dimaksud tangguh adalah keris itu harus jelas asal-usulnya. -

Tribal & Ethnic
33 AUCTION SINGAPORE SO U T H E A ST A SI AN T R I BA L & ETHNIC AR T 1 1 OC T 2014 SOUTHEAST ASIAN 33 AUCTION PTE LTD 27A Loewen Road TRIBAL & ETHNIC ART Singapore 248839 SG015 Te l : +65 6747 4555 Fax : +65 6747 4111 SINGAPORE 11 OCTOBER 2014 Email: [email protected] www . 33auct ion. com Detail of Lot 5040 A Dayak Carving of a Forked- Detail of Lot 5084 Post Featuring Two Men A Toraja Female Tau Tau Statue Detail of Lot 5040 A Dayak Carving of a Forked- Detail of Lot 5084 Post Featuring Two Men A Toraja Female Tau Tau Statue Southeast Asian Tribal & Ethnic Art 東南亞部落藝術 Singapore, 11 October 2014 新加坡, 2014年 10月 11日 Auction 拍賣 Saturday, 11 October 2014, 7.15pm onwards 2014年 10月 11日,星期六,傍晚7點15分 開始 Grand Salon 1, Level 2 新加坡君悅酒店二层 Grand Salon 1 Grand Hyatt Singapore 史各士路 10, 新加坡 228211 10 Scotts Road, Singapore 228211 Auction Day Schedule 11.00am Singaporean Art 新加坡藝術 1.30pm Asian Modern and Contemporary Art 亞州現代與當代藝術 4.45pm Chinese Contemporary Ceramics 中國現代與當代陶瓷 7.15pm Southeast Asian Tribal & Ethnic Art 東南亞部落藝術 Viewing 預展 5 - 10 October 2014, 11am to 8pm 2014年 10月 5日 - 10日, 早上11點 - 晚上8點 MoCA@Loewen MoCA@Loewen 27A Loewen Road, Singapore 248839 27號A羅文路, 新加坡 248839 Sale Information 拍賣信息 In sending written bids or making enquiries, please quote this sale number ‘SG015’ 在發送畫面競投或查詢,請註明這個拍賣編號 ‘SG015’。 The sale will be conducted in English. Bidding is carried out in Singapore Dollars. 拍賣將用英語進行 竞价时將用新加坡幣 請注 Please note that all US Dollar estimates are for reference only.