3 Joseph Kessel
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
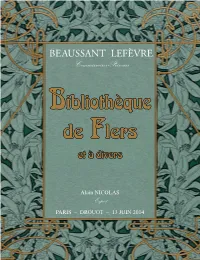
Bibliothèque De Flers Et À Divers
BEAUSSANT LEFÈVRE Commissaires-Priseurs Bibliothèque de Flers et à divers Alain NICOLAS Expert PARIS – DROUOT – 13 JUIN 2014 Ci-dessus : Voltaire, n° 203 En couverture : Mucha - Flers, n° 168 BIBLIOTHÈQUE DE FLERS et à divers VENDREDI 13 JUIN 2014 à 14 h Par le ministère de Mes Eric BEAUSSANT et Pierre-Yves LEFÈVRE Commissaires-Priseurs associés Assistés de Michel IMBAULT BEAUSSANT LEFÈVRE Société de ventes volontaires Siren n° 443-080 338 - Agrément n° 2002-108 32, rue Drouot - 75009 PARIS Tél. : 01 47 70 40 00 - Télécopie : 01 47 70 62 40 www.beaussant-lefevre.com E-mail : [email protected] Assistés par Alain NICOLAS Expert près la Cour d’Appel de Paris Assisté de Pierre GHENO Archiviste paléographe Librairie « Les Neuf Muses » 41, Quai des Grands Augustins - 75006 Paris Tél. : 01.43.26.38.71 - Télécopie : 01.43.26.06.11 E-mail : [email protected] PARIS - DROUOT RICHELIEU - SALLE n° 7 9, rue Drouot - 75009 Paris - Tél. : 01.48.00.20.20 - Télécopie : 01.48.00.20.33 EXPOSITIONS – chez l’expert, pour les principales pièces, du 5 au 10 Juin 2014, uniquement sur rendez-vous – à l’Hôtel Drouot le Jeudi 12 Juin de 11 h à 18 h et le Vendredi 13 Juin de 11 h à 12 h Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01 48 00 20 07 Ménestrier, n° 229 CONDITIONS DE LA VENTE Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants : pour les livres : 20,83 % + TVA (5,5 %) = 21,98 % TTC pour les autres lots : 20,83 % + TVA (20 %) = 25 % TTC La vente est faite expressément au comptant. -

'Le Chant Des Partisans' (Song of the Partisans), Sung by Anna Marly, Was One of the Most Important and Frequently Performed
http://holocaustmusic.ort.org/resistance-and-exile/french-resistance/le-chant-des-partisans/ ‘Le Chant des partisans’ (Song of the partisans), sung by Anna Marly, was one of the most important and frequently performed songs in the French Resistance. It became a symbol of France’s stand against the Nazis, and also played a functional role in several resistance movements in France and abroad. Born in Russia during the October Revolution of 1917, Marly escaped with her mother shortly after her first birthday. She led a remarkably varied life, including living in Menton, working as a ballet dancer in Monte Carlo and studying with Prokofiev, before moving in 1934 to Paris where she worked in the cabarets. After the fall of France in 1940, Marly fled to London, where she made contact with the Free French forces. Emmanuel d’Astier, a prominent Resistance leader, heard Marly singing an old Russian air and had the idea of adding resistance lyrics. While taking refuge in d’Astier’s house, journalist Joseph Kessel and his nephew Maurice Druon carried out this task and the song was first broadcast on Radio-Londres, the French Resistance radio station broadcast from London, in 1943. Its popularity soared from here: the radio presenter André Gillois liked the song so much that he made it the theme tune for the BBC. In France, since the national anthem ‘La Marseillaise’ (The song of Marseille) was banned by the Nazis, ‘Le Chant des partisans’ was used instead as the official ersatz national anthem by the Free French Forces, and after the war it became a temporary national anthem for France. -

Cp Lauréat Kessel 2009
Communiqué Paris, le 19 mai 2009 Prix Joseph Kessel 2009 à Erik Orsenna « Quand j’avais huit ans, je voulais être Tintin et quand j’ai eu quinze ans, Albert Londres… Il faut être libre et j’ai décidé que l’écriture serait le lieu de ma liberté. » Présidé par Olivier Weber et composé de Tahar Ben Jelloun, Jean-Marie Drot, Pierre Haski, Michèle Kahn, Gilles Lapouge, Michel Le Bris, Patrick Rambaud, Jean-Christophe Rufin et André Velter, le jury a attribué au 2ème tour de scrutin le Prix Joseph Kessel 2009 à Erik Orsenna pour son livre L’Avenir de l’eau Petit précis de mondialisation II (Editions Fayard) Après un tour du monde accroché à un fil de coton, Erik Orsenna décrit au fil de l’eau, ou de ce qu’il en restera dans vingt ans, le désastre du dérèglement climatique. De l’Australie à la Chine, du Bangladesh au Tchad, il parcourt le monde pendant deux ans et dénonce l’inaction de la communauté internationale face à cet enjeu mondial essentiel. L’Avenir de l’eau est aussi un livre écrit avec tendresse, tant le regard du romancier s’attarde sur les personnages qu’il a rencontrés. Né en 1947, Erik Orsenna est écrivain et membre de l’Académie française. Après des études d’économie, de philosophie et de sciences politiques, il devient enseignant-chercheur. Il sera conseiller au ministère de la Coopération, conseiller culturel à l’Elysée puis conseiller d’Etat. Il est membre du Haut Conseil de la Francophonie. Lauréat du Prix Roger-Nimier 1978 pour La Vie comme à Lausanne (Seuil) et du Prix Goncourt en 1988 pour L’Exposition coloniale (Seuil), il est l’auteur de nombreux ouvrages dont, parmi les plus récents, le très remarqué Voyage aux pays du coton : petit précis de mondialisation I (Fayard, 2006). -

Notions of Self and Nation in French Author
University of Connecticut OpenCommons@UConn Doctoral Dissertations University of Connecticut Graduate School 6-27-2016 Notions of Self and Nation in French Author- Aviators of World War II: From Myth to Ambivalence Christopher Kean University of Connecticut - Storrs, [email protected] Follow this and additional works at: https://opencommons.uconn.edu/dissertations Recommended Citation Kean, Christopher, "Notions of Self and Nation in French Author-Aviators of World War II: From Myth to Ambivalence" (2016). Doctoral Dissertations. 1161. https://opencommons.uconn.edu/dissertations/1161 Notions of Self and Nation in French Author-Aviators of World War II: From Myth to Ambivalence Christopher Steven Kean, PhD University of Connecticut, 2016 The traditional image of wartime aviators in French culture is an idealized, mythical notion that is inextricably linked with an equally idealized and mythical notion of nationhood. The literary works of three French author-aviators from World War II – Antoine de Saint- Exupéry, Jules Roy, and Romain Gary – reveal an image of the aviator and the writer that operates in a zone between reality and imagination. The purpose of this study is to delineate the elements that make up what I propose is a more complex and even ambivalent image of both individual and nation. Through these three works – Pilote de guerre (Flight to Arras), La Vallée heureuse (The Happy Valley), and La Promesse de l’aube (Promise at Dawn) – this dissertation proposes to uncover not only the figures of individual narratives, but also the figures of “a certain idea of France” during a critical period of that country’s history. -

Lundi 4 Novembre Texte De Jo
Dictée du lundi 4 novembre 2019 : extrait de « Le lion », de Joseph KESSEL Un visiteur arrive dans le parc Royal du Kenya pour y passer quelques jours, au cours d’un long périple en Afrique. Il y rencontre Patricia, une petite fille de 10 ans qui évolue parmi les animaux sauvages avec une aisance surprenante. Il s’agit de la fille de l’administrateur du Parc, John Bullit, et de sa femme, Sybil. Si John est fasciné par le don de sa fille, sa femme est terrorisée. En effet, la petite passe ses journées dans la brousse aux côtés d’un lion avec qui elle entretient une relation fusionnelle. EXTRAIT : « Gazelles, antilopes, girafes, gnous, zèbres, rhinocéros, buffles, éléphants – les animaux s’arrêtaient ou se déplaçaient au pas du loisir, au gré de la soif, au goût du hasard. Le soleil encore doux prenait en écharpe les champs de neige qui s’étageaient au sommet du Kilimandjaro. La brise du matin jouait avec les dernières nuées. Tamisés par ce qu’il restait de brume, les abreuvoirs et les pâturages qui foisonnaient de mufles et de naseaux, de flancs sombres, dorés, rayés, de cornes droites, aiguës, arquées ou massives, et de trompes et de défenses, composaient une tapisserie fabuleuse suspendue à la grande montagne d’Afrique. Quand et comment je quittai la véranda pour me mettre en marche, je ne sais. Je ne m’appartenais plus. Je me sentais appelé par les bêtes vers un bonheur qui précédait le temps de l’homme. J’avançai(s) sur le sentier au bord de la clairière, le long d’un rideau formé par les arbres et les buissons. -

“L'art N'a Pas De Patrie?” Musical Production and Resistance in Nazi
Title Page “L’art n’a pas de patrie?” Musical Production and Resistance in Nazi-Occupied Paris, 1940-1944 by Julie Ann Cleary B.M. in Clarinet Performance, Rhode Island College, 2012 M.F.A. in Historical Musicology, Brandeis University, 2014 Submitted to the Graduate Faculty of the Kenneth P. Dietrich School of Arts & Sciences in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy University of Pittsburgh 2019 Committee Membership Page UNIVERSITY OF PITTSBURGH DIETRICH SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES This dissertation was presented by Julie Ann Cleary It was defended on April 22, 2019 and approved by Dr. Olivia Bloechl, Professor, Department of Music Dr. Lisa Brush, Professor, Department of Sociology Dr. Michael Heller, Associate Professor, Department of Music Dr. Deane L. Root, Professor, Department of Music Dissertation Director: M.A. James P. Cassaro, Professor, Department of Music ii Copyright © by Julie Ann Cleary 2019 iii Abstract “L’art n’a pas de patrie?” Music Production and Resistance in Nazi-Occupied Paris, 1940-1944 Julie Ann Cleary, Ph.D. University of Pittsburgh, 2019 Scholarship from various fields including history, Vichy studies, sociology, and musicology have dissected myths surrounding the Occupation of France (1940-1944), which fall into two generalities of total collaboration or total resistance. The reality lies in the middle, in which many individuals participated in resistance or collaboration in a variety of degrees. I argue that composing, performing, and listening to music are substantial resistant acts, using the resistance movements in Occupied Paris as a case study. This study has two overarching goals. -

Joseph Kessel (1898-1979)
1/29 Data Joseph Kessel (1898-1979) Pays : France Langue : Français Sexe : Masculin Naissance : Clara (Argentine), 10-02-1898 Mort : Avernes (Val-d'Oise), 23-07-1979 Note : Écrivain et journaliste, dialoguiste. - Membre de l'Institut, Académie française (élu en 1962) ISNI : ISNI 0000 0001 2281 8821 (Informations sur l'ISNI) Joseph Kessel (1898-1979) : œuvres (577 ressources dans data.bnf.fr) Œuvres textuelles (484) Les Temps sauvages "La lanterne magique" (1975) (1980) de Jeanne Witta-Montrobert avec Joseph Kessel (1898-1979) comme Préfacier Belles histoires de chevaux "Mon père était Rémy" (1968) (1970) de Catherine de Castilho avec Joseph Kessel (1898-1979) comme Préfacier Les cavaliers (1967) "De Clément Ader à Gagarine" (1967) de Louis Castex avec Joseph Kessel (1898-1979) comme Préfacier Saint-Ex "Israël que j'aime" (1964) (1966) de Noël Calef avec Joseph Kessel (1898-1979) comme Préfacier data.bnf.fr 2/29 Data Inde, péninsule des dieux "Le premier quart d'heure ou L'Algérie des Algériens, de (1960) 1962 à aujourd'hui" (1964) de Edmond Bergheaud avec Joseph Kessel (1898-1979) comme Préfacier Avec les alcooliques anonymes (1960) Le lion (1958) "Les invités du tour du monde" "Accusés hors série" (1958) (1957) de François Gall et autre(s) de Henry Torrès avec Joseph Kessel (1898-1979) comme Préfacier avec Joseph Kessel (1898-1979) comme Préfacier La piste fauve (1954) "L'étoile, les ailes et la couronne" (1954) de Bernard Duperier avec Joseph Kessel (1898-1979) comme Préfacier Le procès des enfants perdus "Les dieux et les -
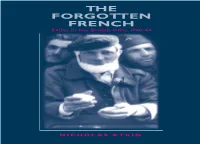
2499 Prelims 7/4/03 2:40 Pm Page I
Atkin 2 colours 30/4/03 4:54 pm Page 1 It is widely assumed that the French in the Cover illustration: A French soldier and two of his British Isles during the Second World War comrades, coming from Dunkirk, receive a snack THE were fully-fledged supporters of General after landing in Great Britain, 1940. Courtesy of Photos12.com – Oasis de Gaulle, and that across the channel at FORGOTTEN least, the French were a ‘nation of THE ATKIN resisters’. This highly provocative study reveals that most exiles were on British FORGOTTEN FRENCH soil by chance rather than by design, and Exiles in the British Isles, 1940-44 many were not sure whether to stay. FRENCH Overlooked by historians, who have Exiles in the British Isles, 1940-44 concentrated on the ‘Free French’ of de Gaulle, these were the ‘Forgotten French’: The forgotten French refugees swept off the beaches of Dunkirk; servicemen held in camps after the Franco-German armistice; Vichy consular officials left to cater for their compatriots; and a sizeable colonist community based mainly in London. This is a really interesting and important work, which will Drawing on little-known archival sources, this study examines the hopes and fears of be of interest to scholars of twentieth-century Britain and these communities who were bitterly France because it throws light on so many other issues. divided among themselves, some being attracted to Pétain as much as to de Dr Richard Vinen, King’s College, London Gaulle. It also looks at how they fitted into British life and how the British in turn responded. -

Programme Complet
MASQUES LESBAS 21 → 24 avril 2016 Entrée libre lelivreametz.com 3 Bas les masques ! Thématique 2016 ÉDITOS Dans la continuité de l’édition 2015 et de son « Mauvais genre ! », Dominique Gros, le festival Le Livre à Metz – Littérature & Journalisme s’adresse maire de Metz, conseiller départemental de la Moselle à tous les publics et met en avant la fête et la réflexion avec Les revoici donc, écrivains, journalistes, libraires, femmes et hommes du livre, qui sa nouvelle thématique « Bas les masques ! ». depuis bientôt trente ans créent l’événement à Metz. Un événement dont nous Invitation au jeu mais aussi à la révélation et au dévoilement, savons désormais qu’il porte loin la réputation d’accueil et d’ouverture de notre l’expression est une injonction à dire enfin la vérité, à traverser ville. Les revoilà, nous sommes heureux de les saluer. Nos sociétés souffrent, elles les apparences, à se débarrasser des travestissements pour paient même le prix du sang. En ces temps difficiles les liens du vivre-ensemble sont parfois aux limites de la rupture. C’est pourtant là que le livre trouve sa place, regarder la réalité en face, dans les yeux et en pleine lumière. dans ce qu’il a de généreux, de fraternel, dans ce qu’il signifie de rencontres, Pendant quatre jours d’échanges, d’entretiens et de débats, de partages, d’émotions. Faut-il le rappeler, les mots, le savoir demeurent le plus retrouvez des romanciers, des essayistes, des journalistes, solide des remparts contre l’obscurantisme. C’était en son temps le combat des dessinateurs et scénaristes de BD qui confronteront leurs de Rabelais contre l’ignorance – il avait trouvé refuge à Metz. -

Anniversaire Du Grand Prix Du Roman
100e ANNIVERSAIRE DU GRAND PRIX DU ROMAN DOSSIER DE PRESSE Académie française Contact : 23, quai de Conti Secrétariat de l’Académie française 75006 Paris tél : 01-44-41-43-00 www.academie-francaise.fr [email protected] SOMMAIRE § PETIT HISTORIQUE Ø La création p. 3 Ø Les particularités des premiers prix et leur empreinte p. 3 Ø Délibérations et attribution du prix de 1915 à 1960 p. 4 Ø L’organisation des années 1960 p. 5 Ø Le règlement de 1984 p. 6 Ø Règles et usage des règles de 1985 à nos jours p. 7 Encadré : Le Prix du roman en quelques dates p. 7 § L’ATTRIBUTION ACTUELLE DU GRAND PRIX DU ROMAN p. 8 Encadré : Définition, règlement, modalités de vote p. 9 § LES CENT DEUX LAURÉATS Ø Palmarès p. 10 Ø Destinées académiques p. 13 Ø Autres récompenses littéraires des lauréats p. 14 Ø Quelques particularités (Prix Nobel, âge des lauréats, répartition homme/femme, premiers romans, nationalité des lauréats) p. 16 DATES À RETENIR § Attribution du Grand Prix du roman du centenaire : le jeudi 29 octobre 2015 § Table ronde sur l’histoire du Prix à la Fondation Singer-Polignac : le mardi 20 octobre 2015. PETIT HISTORIQUE Ø La création Le Prix du roman de l’Académie française, dont le projet de création date de mars 1914, a été décerné pour la première fois en juillet 1915. Pareilles dates seraient très surprenantes si elles ne résultaient d’un processus antérieur. Il faut remonter quatre à cinq ans plus tôt. À ce moment-là, l’Académie française vient de bénéficier de deux legs importants (les legs Charruau et Broquette- Gonin) dont les revenus sont en tout ou partie librement disponibles. -

B As Les Masq U Es
MASQUES LESBAS 21 → 24 avril 2016 Entrée libre lelivreametz.com Bas les masques ! Thématique 2016 Dans la continuité de l’édition 2015 et de son « Mauvais genre ! », le festival Le Livre à Metz – Littérature & Journalisme s’adresse à tous les publics et met en avant la fête et la réflexion avec sa nouvelle thématique « Bas les masques ! ». Invitation au jeu mais aussi à la révélation et au dévoilement, l’expression est une injonction à dire enfin la vérité, à traverser les apparences, à se débarrasser des travestissements pour regarder la réalité en face, dans les yeux et en pleine lumière. Pendant quatre jours d’échanges, d’entretiens et de débats, retrouvez des romanciers, des essayistes, des journalistes, des dessinateurs et scénaristes de BD qui confronteront leurs différentes manières de voir le monde au-delà de ses masques. SOMMAIRE On ouvre le bal 4 On récompense 5 Invités d’honneur 6 Programme Mercredi / jeudi 7 Vendredi 8 Samedi 15 Dimanche 21 À découvrir aussi 26 Jeunesse 30 Bande dessinée 32 L’équipe du festival 33 Merci à nos partenaires 34 Adresses utiles 35 Infos pratiques 36 3 ÉDITOS Dominique Gros, maire de Metz, conseiller départemental de la Moselle Les revoici donc, écrivains, journalistes, libraires, femmes et hommes du livre, qui depuis bientôt trente ans créent l’événement à Metz. Un événement dont nous savons désormais qu’il porte loin la réputation d’accueil et d’ouverture de notre ville. Les revoilà, nous sommes heureux de les saluer. Nos sociétés souffrent, elles paient même le prix du sang. En ces temps difficiles les liens du vivre-ensemble sont parfois aux limites de la rupture. -

Joseph Kessel, Army of Shadows
JOSEPH KESSEL JOSEPH KESSEL MELVILLE ARMY RESISTANCE ofArmy Shadows OF SHADOWS Translated by Rainer J. Hanshe Introduion by Stuart Kendall JOSEPH KESSEL –––– .. JOSEPH KESSEL ARMY OF SHADOWS TRANSLATED BY RAINER J. HANSHE INTRODUCTION BY STUART KENDALL Translation L’Armée des ombres Library of Congress © 2017 Rainer J. Hanshe; Cataloguing-in-Publication Data introduction © 2017 Stuart Kessel, Joseph, 1898–1979 Kendall [L’Armée des ombres. English.] Army of Shadows / Joseph Kessel ; First Contra Mundum Press translated from the French by Edition 2017. Rainer J. Hanshe All Rights Reserved under International & Pan-American —ıst Contra Mundum Press Copyright Conventions. Edition No part of this book may be 314 pp., 5 x 8 in. reproduced in any form or by any electronic means, including isbn 9781940625225 information storage and retrieval systems, without permission in I. Kessel, Joseph. writing from the publisher, II. Title. except by a reviewer who may III. Hanshe, Rainer J. quote brief passages in a review. IV. Translator. V. Stuart Kendall. VI. Introduction. 2017940108 TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION I PREFACE 0 1. THE ESCAPE 4 2. THE EXECUTION 44 3. LEAVING FOR GIBRALTAR 62 4. THESE PEOPLE ARE WONDERFUL 94 5. PHILIPPE GERBIER’S NOTES 108 6. A VIGIL IN THE HITLERIAN AGE 192 7. THE SHOOTING RANGE 204 8. MATHILDE’S DAUGHTER 214 INTRODUCTION WHEN FACT BECOMES LEGEND STUART KENDALL Plato famously proposed banning poets from his ideal Re- public. Poetry and the arts in general offer nothing but imi- tations of the things of the world, he argued, and therefore serve no useful purpose. Worse, poetry might incite the pas- sions and spread fear and delusion among those who can least endure such things.