Bouquin Resumes AFEM Finalvusu
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Supplementary Material 16S Rrna Clone Library
Kip et al. Biogeosciences (bg-2011-334) Supplementary Material 16S rRNA clone library To investigate the total bacterial community a clone library based on the 16S rRNA gene was performed of the pool Sphagnum mosses from Andorra peat, next to S. magellanicum some S. falcatulum was present in this pool and both these species were analysed. Both 16S clone libraries showed the presence of Alphaproteobacteria (17%), Verrucomicrobia (13%) and Gammaproteobacteria (2%) and since the distribution of bacterial genera among the two species was comparable an average was made. In total a 180 clones were sequenced and analyzed for the phylogenetic trees see Fig. A1 and A2 The 16S clone libraries showed a very diverse set of bacteria to be present inside or on Sphagnum mosses. Compared to other studies the microbial community in Sphagnum peat soils (Dedysh et al., 2006; Kulichevskaya et al., 2007a; Opelt and Berg, 2004) is comparable to the microbial community found here, inside and attached on the Sphagnum mosses of the Patagonian peatlands. Most of the clones showed sequence similarity to isolates or environmental samples originating from peat ecosystems, of which most of them originate from Siberian acidic peat bogs. This indicated that similar bacterial communities can be found in peatlands in the Northern and Southern hemisphere implying there is no big geographical difference in microbial diversity in peat bogs. Four out of five classes of Proteobacteria were present in the 16S rRNA clone library; Alfa-, Beta-, Gamma and Deltaproteobacteria. 42 % of the clones belonging to the Alphaproteobacteria showed a 96-97% to Acidophaera rubrifaciens, a member of the Rhodospirullales an acidophilic bacteriochlorophyll-producing bacterium isolated from acidic hotsprings and mine drainage (Hiraishi et al., 2000). -

Novel and Unexpected Bacterial Diversity in An
Delavat et al. Biology Direct 2012, 7:28 http://www.biology-direct.com/content/7/1/28 RESEARCH Open Access Novel and unexpected bacterial diversity in an arsenic-rich ecosystem revealed by culture-dependent approaches François Delavat, Marie-Claire Lett and Didier Lièvremont* Abstract Background: Acid Mine Drainages (AMDs) are extreme environments characterized by very acid conditions and heavy metal contaminations. In these ecosystems, the bacterial diversity is considered to be low. Previous culture-independent approaches performed in the AMD of Carnoulès (France) confirmed this low species richness. However, very little is known about the cultured bacteria in this ecosystem. The aims of the study were firstly to apply novel culture methods in order to access to the largest cultured bacterial diversity, and secondly to better define the robustness of the community for 3 important functions: As(III) oxidation, cellulose degradation and cobalamine biosynthesis. Results: Despite the oligotrophic and acidic conditions found in AMDs, the newly designed media covered a large range of nutrient concentrations and a pH range from 3.5 to 9.8, in order to target also non-acidophilic bacteria. These approaches generated 49 isolates representing 19 genera belonging to 4 different phyla. Importantly, overall diversity gained 16 extra genera never detected in Carnoulès. Among the 19 genera, 3 were previously uncultured, one of them being novel in databases. This strategy increased the overall diversity in the Carnoulès sediment by 70% when compared with previous culture-independent approaches, as specific phylogenetic groups (e.g. the subclass Actinobacteridae or the order Rhizobiales) were only detected by culture. Cobalamin auxotrophy, cellulose degradation and As(III)-oxidation are 3 crucial functions in this ecosystem, and a previous meta- and proteo-genomic work attributed each function to only one taxon. -

Contents Topic 1. Introduction to Microbiology. the Subject and Tasks
Contents Topic 1. Introduction to microbiology. The subject and tasks of microbiology. A short historical essay………………………………………………………………5 Topic 2. Systematics and nomenclature of microorganisms……………………. 10 Topic 3. General characteristics of prokaryotic cells. Gram’s method ………...45 Topic 4. Principles of health protection and safety rules in the microbiological laboratory. Design, equipment, and working regimen of a microbiological laboratory………………………………………………………………………….162 Topic 5. Physiology of bacteria, fungi, viruses, mycoplasmas, rickettsia……...185 TOPIC 1. INTRODUCTION TO MICROBIOLOGY. THE SUBJECT AND TASKS OF MICROBIOLOGY. A SHORT HISTORICAL ESSAY. Contents 1. Subject, tasks and achievements of modern microbiology. 2. The role of microorganisms in human life. 3. Differentiation of microbiology in the industry. 4. Communication of microbiology with other sciences. 5. Periods in the development of microbiology. 6. The contribution of domestic scientists in the development of microbiology. 7. The value of microbiology in the system of training veterinarians. 8. Methods of studying microorganisms. Microbiology is a science, which study most shallow living creatures - microorganisms. Before inventing of microscope humanity was in dark about their existence. But during the centuries people could make use of processes vital activity of microbes for its needs. They could prepare a koumiss, alcohol, wine, vinegar, bread, and other products. During many centuries the nature of fermentations remained incomprehensible. Microbiology learns morphology, physiology, genetics and microorganisms systematization, their ecology and the other life forms. Specific Classes of Microorganisms Algae Protozoa Fungi (yeasts and molds) Bacteria Rickettsiae Viruses Prions The Microorganisms are extraordinarily widely spread in nature. They literally ubiquitous forward us from birth to our death. Daily, hourly we eat up thousands and thousands of microbes together with air, water, food. -

Habitat Heterogeneity and Connectivity Shape Microbial
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE www.nature.com/scientificreportsprovided by CONICET Digital OPEN Habitat heterogeneity and connectivity shape microbial communities in South American receie: 1 eruar 2016 Accepte: 21 pri 2016 peatlands Puise: 10 a 2016 Felix Oloo1,*, Angel Valverde1,*, María Victoria Quiroga2, Surendra Vikram1, Don Cowan1 & Gabriela Mataloni3 Bacteria play critical roles in peatland ecosystems. However, very little is known of how habitat heterogeneity afects the structure of the bacterial communities in these ecosystems. Here, we used amplicon sequencing of the 16S rRNA and nifH genes to investigate phylogenetic diversity and bacterial community composition in three diferent sub-Antarctic peat bog aquatic habitats: Sphagnum magellanicum interstitial water, and water from vegetated and non-vegetated pools. Total and putative nitrogen-fxing bacterial communities from Sphagnum interstitial water difered signifcantly from vegetated and non-vegetated pool communities (which were colonized by the same bacterial populations), probably as a result of diferences in water chemistry and biotic interactions. Total bacterial communities from pools contained typically aquatic taxa, and were more dissimilar in composition and less species rich than those from Sphagnum interstitial waters (which were enriched in taxa typically from soils), probably refecting the reduced connectivity between the former habitats. These results show that bacterial communities in peatland water habitats are highly diverse and structured by multiple concurrent factors. Bacterial communities in peat bog ecosystems contribute signifcantly to nutrient cycling, to carbon sequestra- tion and to greenhouse gas emissions1–4. However, we still have a limited knowledge of the diversity and spatial distribution of bacterial assemblages in peat bogs. -

Multi-Marker Molecular Characterization of Ciliates and Their Endosymbionts
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali Corso di Laurea Magistrale in Conservazione ed Evoluzione Tesi di Laurea Magistrale Multi-marker molecular characterization of ciliates and their endosymbionts Candidato Vittorio Boscaro Relatore Dott. Giulio Petroni Correlatori Prof. Alberto Castelli Prof. Sergei Fokin Anno Accademico 2010/2011 "!#$%&'()*+&$(%#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, "!"!#+$-$.&/0#.%)#&1/$'#/%)(0234$(%&0#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5 !"!"!"#$%&'#(%)*$#%+#$,&-.%$.$#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""/ !"!"0"#1'+')23#4'256)'$#2+*#$,$5'&25.7$#%4#7.3.25'$#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""8 !"!"9"#'7%3%1,#%4#7.3.25'$#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""": !"!"/"#-275').23#'+*%$,&-.%+5$#%4#7.3.25'$#"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""; "!6!#3(-/+*-.'#3.'7/'0#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"6 !"0"!"#5<'#&635.=&2)>')#7<2)275').?25.%+#"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!0 !"0"0"#+673'2)#))+2#1'+'#$'@6'+7'$#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!8 !"0"9"#7%A!#1'+'#$'@6'+7'#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!B -

Download Special Issue
The Scientific World Journal Plant Abio-Stress and Bioresources Utilization for Sustainable Development Guest Editors: Hong-bo Shao, Marian Brestic, Si-Xue Chen, Zhao Chang-Xing, and Xu Gang Plant Abio-Stress and Bioresources Utilization for Sustainable Development The Scientific World Journal Plant Abio-Stress and Bioresources Utilization for Sustainable Development Guest Editors: Hong-bo Shao, Marian Brestic, Si-Xue Chen, Zhao Chang-Xing, and Xu Gang Copyright © 2014 Hindawi Publishing Corporation. All rights reserved. This is a special issue published in “The Scientific World Journal.”All articles are open access articles distributed under the Creative Com- mons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Contents Plant Abio-Stress and Bioresources Utilization for Sustainable Development, Hong-bo Shao, Marian Brestic, Si-Xue Chen, Zhao Chang-Xing, and Xu Gang Volume 2014, Article ID 163123, 2 pages Effect of Continuous Cropping Generations on Each Component Biomass of Poplar Seedlings during Different Growth Periods, Jiangbao Xia, Shuyong Zhang, Tian Li, Xia Liu, Ronghua Zhang, and Guangcan Zhang Volume 2014, Article ID 618421, 9 pages Effects of Salt-Drought Stress on Growth and Physiobiochemical Characteristics of Tamarix chinensis Seedlings, Junhua Liu, Jiangbao Xia, Yanming Fang, Tian Li, and Jingtao Liu Volume 2014, Article ID 765840, 7 pages Impacts of Groundwater Recharge from Rubber Dams on the Hydrogeological Environment in -

Distribution of Acidophilic Microorganisms in Natural and Man- Made Acidic Environments Sabrina Hedrich and Axel Schippers*
Distribution of Acidophilic Microorganisms in Natural and Man- made Acidic Environments Sabrina Hedrich and Axel Schippers* Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR), Resource Geochemistry Hannover, Germany *Correspondence: [email protected] https://doi.org/10.21775/cimb.040.025 Abstract areas, or environments where acidity has arisen Acidophilic microorganisms can thrive in both due to human activities, such as mining of metals natural and man-made environments. Natural and coal. In such environments elemental sulfur acidic environments comprise hydrothermal sites and other reduced inorganic sulfur compounds on land or in the deep sea, cave systems, acid sulfate (RISCs) are formed from geothermal activities or soils and acidic fens, as well as naturally exposed the dissolution of minerals. Weathering of metal ore deposits (gossans). Man-made acidic environ- sulfdes due to their exposure to air and water leads ments are mostly mine sites including mine waste to their degradation to protons (acid), RISCs and dumps and tailings, acid mine drainage and biomin- metal ions such as ferrous and ferric iron, copper, ing operations. Te biogeochemical cycles of sulfur zinc etc. and iron, rather than those of carbon and nitrogen, RISCs and metal ions are abundant at acidic assume centre stage in these environments. Ferrous sites where most of the acidophilic microorganisms iron and reduced sulfur compounds originating thrive using iron and/or sulfur redox reactions. In from geothermal activity or mineral weathering contrast to biomining operations such as heaps provide energy sources for acidophilic, chemo- and bioleaching tanks, which are ofen aerated to lithotrophic iron- and sulfur-oxidizing bacteria and enhance the activities of mineral-oxidizing prokary- archaea (including species that are autotrophic, otes, geothermal and other natural environments, heterotrophic or mixotrophic) and, in contrast to can harbour a more diverse range of acidophiles most other types of environments, these are ofen including obligate anaerobes. -

Oecophyllibacter Saccharovorans Gen. Nov. Sp. Nov., a Bacterial Symbiont of the Weaver Ant Oecophylla Smaragdina with a Plasmid-Borne Sole Rrn Operon
bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2020.02.15.950782; this version posted March 26, 2020. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder. All rights reserved. No reuse allowed without permission. Oecophyllibacter saccharovorans gen. nov. sp. nov., a bacterial symbiont of the weaver ant Oecophylla smaragdina with a plasmid-borne sole rrn operon Kah-Ooi Chuaa, Wah-Seng See-Tooa, Jia-Yi Tana, Sze-Looi Songb, c, Hoi-Sen Yonga, Wai-Fong Yina, Kok-Gan Chana,d* a Institute of Biological Sciences, Faculty of Science, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia b Institute of Ocean and Earth Sciences, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia c China-ASEAN College of Marine Sciences, Xiamen University Malaysia, 43900 Sepang, Selangor, Malaysia d International Genome Centre, Jiangsu University, Zhenjiang, China * Corresponding author at: Institute of Biological Sciences, Faculty of Science, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia Email address: [email protected] Keywords: Acetobacteraceae, Insect, Whole genome sequencing, Phylogenomics, Plasmid-borne rrn operon Abstract In this study, acetic acid bacteria (AAB) strains Ha5T, Ta1 and Jb2 that constitute the core microbiota of weaver ant Oecophylla smaragdina were isolated from multiple ant colonies and were distinguished as different strains by matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight (MALDI-TOF) mass spectrometry and distinctive random-amplified polymorphic DNA (RAPD) fingerprints. These strains showed similar phenotypic characteristics and were considered a single species by multiple delineation indexes. 16S rRNA gene sequence-based phylogenetic analysis and phylogenomic analysis based on 96 core genes placed the strains in a distinct lineage in family Acetobacteraceae. -

Human Gut Microbiota and Obesity
Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Doctoral Dissertations Graduate School 2017 Human Gut Microbiota and Obesity: How Is Gut Microbiota Associated with Obesity Improvement Induced by Bariatric Surgeries or Low-Calorie Diet Treatment? Rui Zhang Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations Part of the Environmental Sciences Commons Recommended Citation Zhang, Rui, "Human Gut Microbiota and Obesity: How Is Gut Microbiota Associated with Obesity Improvement Induced by Bariatric Surgeries or Low-Calorie Diet Treatment?" (2017). LSU Doctoral Dissertations. 4272. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations/4272 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Doctoral Dissertations by an authorized graduate school editor of LSU Digital Commons. For more information, please [email protected]. HUMAN GUT MICROBIOTA AND OBESITY: HOW IS GUT MICROBIOTA ASSOCIATED WITH OBESITY IMPROVEMENT INDUCED BY BARIATRIC SURGERIES OR LOW- CALORIE DIET TREATMENT? A Dissertation Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in The Department of Environmental Sciences by Rui Zhang B.S., North China Coal Medical University, 2003 M.S., Huazhong University of Science and Technology, 2008 M.S., Louisiana State University, 2012 May 2017 ACKNOWLEDGMENTS First and foremost, I would like to thank my advisor Dr. Aixin Hou for her generous direction, inspiration, and support in countless aspects during the process of the study. -

Cultivating Uncultured Bacteria from Northern Wetlands: Knowledge Gained and Remaining Gaps
REVIEW ARTICLE published: 16 September 2011 doi: 10.3389/fmicb.2011.00184 Cultivating uncultured bacteria from northern wetlands: knowledge gained and remaining gaps Svetlana N. Dedysh* Winogradsky Institute of Microbiology, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia Edited by: Northern wetlands play a key role in the global carbon budget, particularly in the bud- Josh David Neufeld, University of gets of the greenhouse gas methane. These ecosystems also determine the hydrology Waterloo, Canada of northern rivers and represent one of the largest reservoirs of fresh water in the North- Reviewed by: Marc Gregory Dumont, ern Hemisphere. Sphagnum-dominated peat bogs and fens are the most extensive types Max-Planck-Institute for Terrestrial of northern wetlands. In comparison to many other terrestrial ecosystems, the bacterial Microbiology, Germany diversity in Sphagnum-dominated wetlands remains largely unexplored. As demonstrated Levente Bodrossy, CSIRO Marine and by cultivation-independent studies, a large proportion of the indigenous microbial commu- Atmospheric Research, Australia nities in these acidic, cold, nutrient-poor, and water-saturated environments is composed of *Correspondence: Svetlana N. Dedysh, Winogradsky as-yet-uncultivated bacteria with unknown physiologies. Most of them are slow-growing, Institute of Microbiology, Russian oligotrophic microorganisms that are difficult to isolate and to manipulate in the laboratory. Academy of Sciences, Prospect Yet, significant breakthroughs in cultivation of these elusive organisms have been made 60-Letya Octyabrya 7/2, Moscow during the last decade. This article describes the major prerequisites for successful culti- 117312, Russia. e-mail: [email protected] vation of peat-inhabiting microbes, gives an overview of the currently captured bacterial diversity from northern wetlands and discusses the unique characteristics of the newly discovered organisms. -
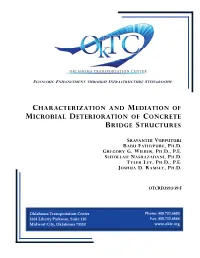
Characterization and Mediation of Microbial Deterioration of Concrete Bridge Structures
ECONOMIC ENHANCEMENT THROUGH INFRASTRUCTURE STEWARDSHIP CHARACTERIZATION AND MEDIATION OF MICROBIAL DETERIORATION OF CONCRETE BRIDGE STRUCTURES SRAVANTHI VUPPUTURI BABU FATHEPURE, PH.D. GREGORY G. WILBER, PH.D., P.E. SEIFOLLAH NASRAZADANI, PH.D. TYLER LEY, PH.D., P.E. JOSHUA D. RAMSEY, PH.D. OTCREOS9.1-39-F Oklahoma Transportation Center Phone: 405.732.6580 2601 Liberty Parkway, Suite 110 Fax: 405.732.6586 Midwest City, Oklahoma 73110 www.oktc.org DISCLAIMER The contents of this report reflect the views of the authors, who are responsible for the facts and accuracy of the information presented herein. This document is disseminated under the sponsorship of the Department of Transportation University Transportation Centers Program, in the interest of information exchange. The U.S. Government assumes no liability for the contents or use thereof. i TECHNICAL REPORT DOCUMENTATION PAGE 1. REPORT NO. 2. GOVERNMENT ACCESSION NO. 3. RECIPIENTS CATALOG NO. OTCREOS9.1-39-F 4. TITLE AND SUBTITLE 5. REPORT DATE April 2013 Characterization and Mediation of Microbial Deterioration of Concrete Bridge Structures 6. PERFORMING ORGANIZATION CODE 7. AUTHOR(S) 8. PERFORMING ORGANIZATION REPORT Sravanthi Vupputuri, Babu Fathepure, Gregory Wilber, Seifollah Nasrazadani, Tyler Ley, and Joshua D. Ramsey 9. PERFORMING ORGANIZATION NAME AND ADDRESS 10. WORK UNIT NO. Oklahoma State University School of Chemical Engineering 11. CONTRACT OR GRANT NO. 423 Engineering North Stillwater, OK 74078 DTRT06-G-0016 12. SPONSORING AGENCY NAME AND ADDRESS 13. TYPE OF REPORT AND PERIOD COVERED Final Report: June 2009 - April 2013 Oklahoma Transportation Center (Fiscal) 201 ATRC Stillwater, OK 74078 14. SPONSORING AGENCY CODE (Technical) 2601 Liberty Parkway, Suite 110 Midwest City, Oklahoma 73110 15. -

Relationships Among Airborne Microbial Communities, Urban Land Uses and Vegetation Cover: Implications for Urban Planning and Human Health
RELATIONSHIPS AMONG AIRBORNE MICROBIAL COMMUNITIES, URBAN LAND USES AND VEGETATION COVER: IMPLICATIONS FOR URBAN PLANNING AND HUMAN HEALTH by GWYNHWYFER MHUIREACH A DISSERTATION Presented to the Department of Landscape Architecture and the Graduate School of the University of Oregon in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy June 2018 DISSERTATION APPROVAL PAGE Student: Gwynhwyfer Mhuireach Title: Relationships Among Airborne Microbial Communities, Urban Land Uses and Vegetation Cover: Implications for Urban Planning and Human Health This dissertation has been accepted and approved in partial fulfillment of the requirements for the Doctor of Philosophy degree in the Department of Landscape Architecture by: Bart R. Johnson Chairperson Jessica L. Green Core Member Roxi Thoren Core Member Deb Johnson-Shelton Core Member G.Z. Brown Institutional Representative and Sara D. Hodges Interim Vice Provost and Dean of the Graduate School Original approval signatures are on file with the University of Oregon Graduate School. Degree awarded June 2018 ii © 2018 Gwynhwyfer Mhuireach This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs (United States) License. iii DISSERTATION ABSTRACT Gwynhwyfer Mhuireach Doctor of Philosophy Department of Landscape Architecture June 2018 Title: Relationships Among Airborne Microbial Communities, Urban Land Uses and Vegetation Cover: Implications for Urban Planning and Human Health Variation in exposure to environmental microbial communities has been implicated in the etiology of allergies, asthma and other chronic and immune disorders. In particular, preliminary research suggests that exposure to a high diversity of microbes during early life, for example through living in highly vegetated environments like farms or forests, may have specific health benefits, including immune system development and stimulation.