Distribution Et Statut Des Populations D'epimedium.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Status and Protection of Globally Threatened Species in the Caucasus
STATUS AND PROTECTION OF GLOBALLY THREATENED SPECIES IN THE CAUCASUS CEPF Biodiversity Investments in the Caucasus Hotspot 2004-2009 Edited by Nugzar Zazanashvili and David Mallon Tbilisi 2009 The contents of this book do not necessarily reflect the views or policies of CEPF, WWF, or their sponsoring organizations. Neither the CEPF, WWF nor any other entities thereof, assumes any legal liability or responsibility for the accuracy, completeness, or usefulness of any information, product or process disclosed in this book. Citation: Zazanashvili, N. and Mallon, D. (Editors) 2009. Status and Protection of Globally Threatened Species in the Caucasus. Tbilisi: CEPF, WWF. Contour Ltd., 232 pp. ISBN 978-9941-0-2203-6 Design and printing Contour Ltd. 8, Kargareteli st., 0164 Tbilisi, Georgia December 2009 The Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) is a joint initiative of l’Agence Française de Développement, Conservation International, the Global Environment Facility, the Government of Japan, the MacArthur Foundation and the World Bank. This book shows the effort of the Caucasus NGOs, experts, scientific institutions and governmental agencies for conserving globally threatened species in the Caucasus: CEPF investments in the region made it possible for the first time to carry out simultaneous assessments of species’ populations at national and regional scales, setting up strategies and developing action plans for their survival, as well as implementation of some urgent conservation measures. Contents Foreword 7 Acknowledgments 8 Introduction CEPF Investment in the Caucasus Hotspot A. W. Tordoff, N. Zazanashvili, M. Bitsadze, K. Manvelyan, E. Askerov, V. Krever, S. Kalem, B. Avcioglu, S. Galstyan and R. Mnatsekanov 9 The Caucasus Hotspot N. -

Bio 308-Course Guide
COURSE GUIDE BIO 308 BIOGEOGRAPHY Course Team Dr. Kelechi L. Njoku (Course Developer/Writer) Professor A. Adebanjo (Programme Leader)- NOUN Abiodun E. Adams (Course Coordinator)-NOUN NATIONAL OPEN UNIVERSITY OF NIGERIA BIO 308 COURSE GUIDE National Open University of Nigeria Headquarters 14/16 Ahmadu Bello Way Victoria Island Lagos Abuja Office No. 5 Dar es Salaam Street Off Aminu Kano Crescent Wuse II, Abuja e-mail: [email protected] URL: www.nou.edu.ng Published by National Open University of Nigeria Printed 2013 ISBN: 978-058-434-X All Rights Reserved Printed by: ii BIO 308 COURSE GUIDE CONTENTS PAGE Introduction ……………………………………......................... iv What you will Learn from this Course …………………............ iv Course Aims ……………………………………………............ iv Course Objectives …………………………………………....... iv Working through this Course …………………………….......... v Course Materials ………………………………………….......... v Study Units ………………………………………………......... v Textbooks and References ………………………………........... vi Assessment ……………………………………………….......... vi End of Course Examination and Grading..................................... vi Course Marking Scheme................................................................ vii Presentation Schedule.................................................................... vii Tutor-Marked Assignment ……………………………….......... vii Tutors and Tutorials....................................................................... viii iii BIO 308 COURSE GUIDE INTRODUCTION BIO 308: Biogeography is a one-semester, 2 credit- hour course in Biology. It is a 300 level, second semester undergraduate course offered to students admitted in the School of Science and Technology, School of Education who are offering Biology or related programmes. The course guide tells you briefly what the course is all about, what course materials you will be using and how you can work your way through these materials. It gives you some guidance on your Tutor- Marked Assignments. There are Self-Assessment Exercises within the body of a unit and/or at the end of each unit. -

Lenka Kočková
MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV BOTANIKY A ZOOLOGIE Velikost genomu a poměr bazí v genomu v čeledi Ranunculaceae Diplomová práce Lenka Kočková Vedoucí práce: Doc. RNDr. Petr Bureš, Ph. D. Brno 2012 Bibliografický záznam Autor: Bc. Lenka Kočková Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Ústav botaniky a zoologie Název práce: Velikost genomu a poměr bazí v genomu v čeledi Ranunculaceae Studijní program: Biologie Studijní obor: Systematická biologie a ekologie (Botanika) Vedoucí práce: Doc. RNDr. Petr Bureš, Ph. D. Akademický rok: 2011/2012 Počet stran: 104 Klíčová slova: Ranunculaceae, průtoková cytometrie, PI/DAPI, DNA obsah, velikost genomu, GC obsah, zastoupení bazí, velikost průduchů, Pignattiho indikační hodnoty Bibliographic Entry Author: Bc. Lenka Kočková Faculty of Science, Masaryk University, Department of Botany and Zoology Title of Thesis: Genome size and genomic base composition in Ranunculaceae Programme: Biology Field of Study: Systematic Biology and Ecology (Botany) Supervisor: Doc. RNDr. Petr Bureš, Ph. D. Academic Year: 2011/2012 Number of Pages: 104 Keywords: Ranunculaceae, flow cytometry, PI/DAPI, DNA content, genome size, GC content, base composition, stomatal size, Pignatti‘s indicator values Abstrakt Pomocí průtokové cytometrie byla změřena velikost genomu a AT/GC genomový poměr u 135 druhů z čeledi Ranunculaceae. U druhů byla naměřena délka a šířka průduchů a z literatury byly získány údaje o počtu chromozomů a ekologii druhů. Velikost genomu se v rámci čeledi liší 63-krát. Nejmenší genom byl naměřen u Aquilegia canadensis (2C = 0,75 pg), největší u Ranunculus lingua (2C = 47,93 pg). Mezi dvěma hlavními podčeleděmi Ranunculoideae a Thalictroideae je ve velikosti genomu markantní rozdíl (2C = 2,48 – 47,94 pg a 0,75 – 4,04 pg). -

Open As a Single Document
Ailanthus by SHIU YING Hu Ailanthus is called tree of heaven by some people. In its homeland, China, it is known as Ch’un Shu, pronounced almost like "train" and "sure" in English. Of all the trees introduced from China into Ameri- can gardens, ailanthus is the most widely naturalized. The speci- mens in the Harvard University Herbaria indicate that the species Ailanthus altissima (Miller) Swingle runs wild from Massachusetts in the East to Oregon in the West, and from Toronto, Canada in North America to Tucuman, Argentina (and Buenos Aires, by refer- ence) in South America. In neglected areas of large cities such as Boston, ailanthus grows as trees close to buildings, as hedges, or as bushy aggregates along railroad tracks, highway embankments, walls at the ends of bridges and overpasses, or in cracks of sidewalks and along boundary fences between properties (Figs. 1-2). Around some dwellings the trees are so close to the windows that they prevent light and sunshine from penetrating the rooms, or they send roots to invade the sewers or damage the foundations. Once ailanthus is established, it becomes very difficult to eradicate, for it can sprout from the stumps and on any portion of a root (Fig. 3, left); moreover, a female tree produces a large amount of winged fruits that spread and germinate in the gardens near, or even far away from, the mother plant. For these reasons, ailan- thus has been maligned as a weedy tree by city dwellers. Lately, however, it has attracted the interest of environmentalists, and many of them have asked me questions about the tree both by telephone and in letters. -

The Aromatic-Medicinal Plant Taxa of Pure Scots Pine Stands in Sürmene - Camburnu (Trabzon)
Int. J. Sec. Metabolite, Vol. 4: 3 (2017) pp. 517-529 Special Issue 2: Research Article ISSN: 2148-6905 online Journal homepage: http://www.ijate.net/index.php/ijsm The Aromatic-Medicinal Plant Taxa of pure Scots pine stands in Sürmene - Camburnu (Trabzon) Arzu ERGÜL BOZKURT *1, Salih TERZİOĞLU2 1Artvin Çoruh University, Faculty of Forestry, Artvin, Turkey 2Karadeniz Technical University, Faculty of Forestry, Trabzon, Turkey Received: 04 May 2017 – Revised: 21 September 2017 - Accepted: 03 November 2017 Abstract: Forests not only produce wood raw material ecosystems, but also that have rich medicinal and aromatic plants. In addition to this situation, forests have been produced many goods and services. Regulation of protection- utilization balance with wood and non-wood herbal products is very important to these ecosystems. In order to ensure sustainable utilization of forest ecosystems, first of all, it is necessary to identify the natural resource components in these ecosystems. In this study, medicinal-aromatic plants of natural Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands, which are a sensitive ecosystem, were investigated in 2013-2014. Pinus sylvestris has special ecological conditions in Sürmene-Çamburnu (Trabzon) region because in this region Pinus sylvestris is descending down to the beach. In the study, 81 (77%) out of 105 vascular plant taxa were found to have medicinal-aromatic potential. The parts of the identified plant taxa used for different medical and aromatic purposes are explained in detail. In addition, recommendations were made about regulation of utilization in sensitive ecosystems. Keywords: Pinewood, medicinal-aromatic plant, flora 1. INTRODUCTION Forests are the ecosystems that produce not only wood raw material but as well non-wood forest products. -
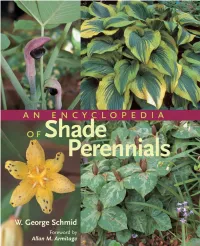
An Encyclopedia of Shade Perennials This Page Intentionally Left Blank an Encyclopedia of Shade Perennials
An Encyclopedia of Shade Perennials This page intentionally left blank An Encyclopedia of Shade Perennials W. George Schmid Timber Press Portland • Cambridge All photographs are by the author unless otherwise noted. Copyright © 2002 by W. George Schmid. All rights reserved. Published in 2002 by Timber Press, Inc. Timber Press The Haseltine Building 2 Station Road 133 S.W. Second Avenue, Suite 450 Swavesey Portland, Oregon 97204, U.S.A. Cambridge CB4 5QJ, U.K. ISBN 0-88192-549-7 Printed in Hong Kong Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Schmid, Wolfram George. An encyclopedia of shade perennials / W. George Schmid. p. cm. ISBN 0-88192-549-7 1. Perennials—Encyclopedias. 2. Shade-tolerant plants—Encyclopedias. I. Title. SB434 .S297 2002 635.9′32′03—dc21 2002020456 I dedicate this book to the greatest treasure in my life, my family: Hildegarde, my wife, friend, and supporter for over half a century, and my children, Michael, Henry, Hildegarde, Wilhelmina, and Siegfried, who with their mates have given us ten grandchildren whose eyes not only see but also appreciate nature’s riches. Their combined love and encouragement made this book possible. This page intentionally left blank Contents Foreword by Allan M. Armitage 9 Acknowledgments 10 Part 1. The Shady Garden 11 1. A Personal Outlook 13 2. Fated Shade 17 3. Practical Thoughts 27 4. Plants Assigned 45 Part 2. Perennials for the Shady Garden A–Z 55 Plant Sources 339 U.S. Department of Agriculture Hardiness Zone Map 342 Index of Plant Names 343 Color photographs follow page 176 7 This page intentionally left blank Foreword As I read George Schmid’s book, I am reminded that all gardeners are kindred in spirit and that— regardless of their roots or knowledge—the gardening they do and the gardens they create are always personal. -

Plant Species Recovery on a Compacted Skid Road
Sensors 2008, 8, 3123-3133; DOI: 10.3390/s8053123 OPEN ACCESS sensors ISSN 1424-8220 www.mdpi.org/sensors Article Plant Species Recovery on a Compacted Skid Road Murat Demir 1, *, Ender Makineci 2 and Beyza Sat Gungor 3 1 Istanbul University, Faculty of Forestry, Forest Construction and Transportation Department 34473 Bahcekoy / Sariyer / Istanbul / Turkey; E-mail: [email protected] 2 Istanbul University, Faculty of Forestry, Soil Science and Ecology Department 34473 Bahcekoy / Sariyer / Istanbul / Turkey; E-mail: [email protected] 3 Istanbul University, Faculty of Forestry, Landscape Architecture Department 34473 Bahcekoy / Sariyer / Istanbul / Turkey; E-mail: [email protected] * Author to whom correspondence should be addressed; E-mail: [email protected]; Tel. +90 212 2261100 (12 lines) Ext: 25289; Fax: +90 212 2261113 Received: 3 February 2008 / Accepted: 2 May 2008 / Published: 15 May 2008 Abstract: This study was executed to determine the plant species of herbaceous cover in a skid road subjected to soil compaction due to timber skidding in a beech ( Fagus orientalis Lipsky.) stand. Our previous studies have shown that ground based timber skidding destroys the soils extremely, and degradations on ecosystem because of the timber skidding limit recovery and growth of plant cover on skid roads. However, some plant species show healthy habitat, recovery and they can survive after the extreme degradation in study area. We evaluated composition of these plant species and their cover-abundance scales in 100 m x 3 m transect. 15 plant species were determined belongs to 12 plant families and Liliaceae was the highest representative plant family . -

A Comprehensive Dataset on Cultivated and Spontaneously Growing Vascular Plants in Urban Gardens
Data in brief 25 (2019) 103982 Contents lists available at ScienceDirect Data in brief journal homepage: www.elsevier.com/locate/dib Data Article A comprehensive dataset on cultivated and spontaneously growing vascular plants in urban gardens * David Frey a, b, , Marco Moretti a a Swiss Federal Research Institute WSL, Biodiversity and Conservation Biology, Zürcherstrasse 111, 8903 Birmensdorf, Switzerland b Institute of Terrestrial Ecosystems, Department of Environmental Systems Science, ETH Zurich, Universitatstrasse€ 16, 8092 Zürich, Switzerland article info abstract Article history: This article summarizes the data of a survey of vascular plants in 85 Received 2 February 2019 urban gardens of the city of Zurich, Switzerland. Data was acquired Received in revised form 16 April 2019 by two sampling methods: (i) a floristic inventory of entire garden Accepted 1 May 2019 lots based on repeated garden visits, including all vegetation pe- Available online 23 May 2019 riods; and (ii) vegetation releves on two plots of standardized size (10 m2) per garden during the summer. We identified a total of 1081 Keywords: taxa and report the origin status, i.e., whether a taxon is considered Allotment BetterGardens native or alien to Switzerland. Furthermore, the origin of a plant or Home gardens garden population was estimated for each taxon and garden: each Lawn taxon in each garden was classified as being either cultivated or Neophytes spontaneously growing. For each garden, the number of all native, Urban biodiversity cultivated, and spontaneously growing plant species is given, along Vegetation releves with additional information, including garden area, garden type and the landscape-scale proportion of impermeable surface within a 500-m radius. -

Environmental Factors-Ecological Species Group Relationships in The
Nordic Journal of Botany 35: 240–250, 2017 doi: 10.1111/njb.01221, ISSN 1756-1051 © 2016 The Authors. Nordic Journal of Botany © 2016 Nordic Society Oikos Subject Editor: Hans Sandén. Editor-in-Chief: Torbjörn Tyler. Accepted 13 September 2016 Environmental factors–ecological species group relationships in the Surash lowland-mountain forests in northern Iran Fatemeh Bazdid Vahdati, Shahryar Saeidi Mehrvarz, Daniel C. Dey and Alireza Naqinezhad F. Bazdid Vahdati and Sh. Saeidi Mehrvarz ([email protected]), Dept of Biology, Faculty of Science, Univ. of Guilan, Rasht, Iran. – D. C. Dey, USDA Forest Service, Northern Research Station, Columbia, MO, USA. – A. Naqinezhad, Dept of Biology, Faculty of Basic Sciences, Univ. of Mazandaran, Babolsar, Iran. Identification of the primary factors that influence the ecological distribution of species groups is important to managers of lowland-mountain forests in northern Iran. The aim of this study was to identify main ecological species groups, describe the site conditions associated with these species groups and the relationships between environmental factors and the distribution of ecological species groups using multi-variate analysis (Detrended correspondence analysis (DCA) and Canonical correspondence analysis (CCA)). For this purpose, 50 relevés (400 m2 each) were sampled using the Braun- Blanquet method. Vegetation was classified into three ecological species groups using a modified two-way indicator species analysis (TWINSPAN). In each relevé, environmental factors (topographic and soil variables) were measured and analysed using one-way ANOVA and Pearson r statistics. Further, species diversity indices were determined for the identified ecological species groups. Our results show that the environmental factors, e.g. -

Sayı Tam Dosyası
e-ISSN: 2717-770X www.turvehab.com Buraya resimler gelecek yıl cilt sayı 2020 1 2 Türler ve Habitatlar e-ISSN 2717-770X Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 2 Yılda 2 kez yayınlanır Sahibi Dr. Ergin Hamzaoğlu Yazışma Adresi Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, Hersek Binası TR-06560, Emniyet Mahallesi, Yenimahalle, Ankara, Türkiye Telefon: (+90) 535 391 17 80 E-posta: [email protected] Web: https://dergipark.org.tr/tr/pub/turvehab Baş Editör Dr. Ergin Hamzaoğlu Editörler Dr. Hakan Allı - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Dr. Murat Koç - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Dr. Ömer Faruk Kaya - Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Dr. Serdar Gökhan Şenol - Ege Üniversitesi, İzmir Dr. Tahir Atıcı - Gazi Üniversitesi, Ankara Dr. Tamer Keçeli - Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çankırı İngilizce Dil Editörü Ellen Yazar Mizanpaj Editörü Alperen Hamzaoğlu Türler ve Habitatlar e-ISSN 2717-770X Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 2 İçindekiler Araştırma Makaleleri 1. Confirmation of the existence of Russula praetervisa in Turkey ..................................................................... 45−52 Russula praetervisa’nın Türkiye’deki varlığının teyidi Ezgin Tırpan, Hakan Allı, Bekir Çöl 2. Euphorbia maculata’nın (Euphorbiaceae) Türkiye korolojisi ........................................................................ 53−57 Turkish chorology of Euphorbia maculata (Euphorbiaceae) Mehmet Sağıroğlu, Didem Karaduman 3. New locality records for two truffle taxa in Turkey ........................................................................................ -

Reproductive Characteristics As Drivers of Alien Plant Naturalization and Invasion
Reproductive characteristics as drivers of alien plant naturalization and invasion Dissertation submitted for the degree of Doctor of Natural Sciences presented by Mialy Harindra Razanajatovo at the Faculty of Sciences Department of Biology Date of the oral examination: 12 February 2016 First referee: Prof. Dr. Mark van Kleunen Second referee: Prof. Dr. Markus Fischer Konstanzer Online-Publikations-System (KOPS) URL: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-0-324483 Summary Due to human activity and global movements, many plant species have been introduced to non-native regions where they experience novel abiotic and biotic conditions. Some of these alien species manage to establish reproducing naturalized populations, and some naturalized alien species subsequently become invasive. Invasion by alien plant species can negatively affect native communities and ecosystems, but what gives the alien species an advantage under novel conditions is still not clear. Therefore, identifying the drivers of invasions has become a major goal in invasion ecology. Reproduction is crucial in plant invasions, because propagule supply is required for founding new populations, population maintenance and spread in non-native regions. Baker’s Law, referring to the superior advantage of species capable of uniparental reproduction in establishing after long distance dispersal, has received major interest in explaining plant invasions. However, previous findings regarding Baker’s Law are contradicting. Moreover, there has been an increasing interest in understanding the integration of alien plant species into native plant-pollinator networks but few studies have looked at the pollination ecology of successful (naturalized and invasive) and unsuccessful (non-naturalized and non-invasive) alien plant species. -

Antimicrobial and Antioxidant Activity of Epimedium Pinnatum
Vol. 59 No. 2 2013 DOI: 10.2478/hepo-2013-0009 EXPERIMENTAL PAPER Antimicrobial and antioxidant activity of Epimedium pinnatum MOHADDESE MAHBOUBI1*, NASTARAN KAZEMPOUR1, HOSSEIN HOSSEINI2, MONA MAHBOUBI3 1Microbiology Group Medicinal Plants Research Center of Barij Essence 87135-1178 Kashan, Iran 2Agricultural Group Medicinal Plants Research Center of Barij Essence 87135-1178 Kashan, Iran 3Chemistry Department Chabahar Free Trade and Industrial Zone Organization, Iran *corresponding author: tel.: +98 866436 2112, fax: +98 866436 2187, e-mail: [email protected], [email protected] Summary Epimedium pinnatum (Berberidaceae family) is used as an aphrodisiac in traditional Chinese medicine (TCM). The aim of this study was to evaluate the antimicrobial and antioxidant activity of E pinnatum extracts (ethanol, methanol and aqueous extracts). Total phenolic (TPC) and flavonoid contents (TFC) of each extract were assessed by spectrophotometric methods. It was exhibited that methanol extract had better antimicrobial activity than those of ethanolic extract or aqueous extract. The TPC and TFC of E pinnatum extracts was higher in methanol extract (149 and 36.6 mg/g) than that of ethanolic extract (137.2 and 19.5 mg/g) and aqueous extract (86.2 and 8.4 mg/g). The methanol extract had lower IC50 value (200 μg/ml) than ethanolic (250 μg/ml) and aqueous extract (400 μg/ml). There was a positive correlation between TPC, TFC in E pinnatum extract and their antioxidant and antimicrobial activity. Key words: Epimedium pinnatum, extract, total phenolics, total flavonoids, antimicrobial activity, antioxidant activity Antimicrobial and antioxidant activity of Epimedium pinnatum 25 INTRODUCTION Epimedium belongs to Berberidaceae family, also known as horny goat weed.