Journal Reference
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

By Cox & Kings • Issue 24 • Summer 2016
By Cox & Kings • Issue 24 • Summer 2016 ANDY HAMILTON LEVISON WOOD A life of funny business The advent of an adventurer SHORT BREAKS ARGENTINA Spain’s top city breaks for 2016 Pampas to Patagonia FromShimla toShere Khan In search of Kipling’s India TRAVEL NEWS • REVIEWS • INTERVIEWS G O AHEAD , PACK AN EXTRA SKIRT . EXTRA BLOUSE . EXTRA SHOES . AND MORE EXTRA SHOES . • The Baseline® Collection • Our CX™Briggs expansion system adds capacity, then compresses your belongings & securely in place. Reilly ad ™ ENGINEERED FOR REALITY . GUARANTEED FOR LIFE . Available at Harrods, John Lewis and other leading department and independent luggage stores. For a full list or to buy online visit briggs-riley.com G O AHEAD , PACK AN EXTRA SKIRT . EXTRA to Welcome BLOUSE . EXTRA SHOES . AND MORE EXTRA SHOES . ® • The Baseline Collection • Compass Our CX™ expansion system adds capacity, then compresses your belongings securely in place. Editorial A summer to celebrate Editor • Jennifer Cox Deputy Editor • Eleanor Day If there’s one thing we British do well, it’s a summer party. From the tennis at Online Editor • Kimberley Hay Wimbledon to picnic concerts at Kenwood House, we make the most of the long summer days. This summer marks Queen Elizabeth II’s 90th birthday, and – from Art & Design local street parties to outdoor spectacles – it is sure to be an exciting summer of Art Director • Ben Harrison national celebration. Designer • Ines Menendez Illustrations • Melissa Wood Images • Shutterstock, iStock, Katie In our own small way, we at Compass are celebrating an anniversary too, as we Cosstick, Nick Gregan (nickgregan.com), mark our 10th year of publishing. -

Bb1 Menu2020 Sep En.Pdf
menu COLD VEGETABLE STARTERS BAKU PICKLES VEGETABLE BOUQUET EGGPLANTS, WHITE CUCUMBERS, BAKU TOMATOES, BLACK THORNS, CHERRY PLUMS, BAKU CUCUMBERS, CHILLI PEPPER, CORNELIAN CHERRIES, KIR SALAD, DILL, PARSLEY, SCALLIONS, PARADISE APPLES, QUINCES BASIL, CILANTRO, RADISH 350 g 400 g -390- -680- BAKU VEGETABLES 300 g 420- BULL HEART TOMATOES 150 g 340- RUSSIAN PICKLES 350 g 320- EGGPLANT ROLLS 130/70 g 380- BAKU TOMATOES, BAKU CUCUMBERS, CHILLI PEPPER LIGHTLY SALTED CUCUMBERS, LIGHTLY SALTED TOMATOES, WITH CHEESE PICKLED GARLIC, RAMSON, PICKLED PEPPER, SAUERKRAUT EGGPLANT, PHILADELPHIA CHEESE, GOUDA CHEESE, GARLIC, HERBS GREENS 140 g 310- GREEN OLIVES, BLACK OLIVES 100 g 260- MARINATED MUSHROOMS 200 g 290- GEORGIAN LOBIO 180 g 290- BASIL, CILANTRO, KIR SALAD, RADISH, OIL MUSHROOMS, FIELD MUSHROOMS, HONEY MUSHROOMS, RED BEANS, GARLIC, ONIONS, WALNUTS, DILL, SCALLIONS, PARSLEY RED ONION, BELL PEPPER, OLIVE OIL CILANTRO, POMEGRANATE SEEDS COLD MEAT STATERS COLD FISH STARTES MEAT PLATTER FISH PLATTER LIGHTLY SALTED SALMON, BAKED VEAL, BEEF TONGUE, BUTTER FISH, CHICKEN ROLL, CREAMY HOT-SMOKED STURGEON, SAUCE WITH HORSERADISH SALMON CAVIAR 300/50/80 g 300/30 g -1150- -1650- HERRING 120/120 g 320- SALMON 150/50/50 g 790- FRANCOIS ROLL 220 g 460- CHICKEN ROLL 100/30 g 390- CHICKEN SATSIVI 200 g 320- WITH BOILED POTATOES CAVIAR WITH TOAST PHILADELPHIA CHEESE, LIGHTLY SALTED HERRING, BOILED POTATOES, RED ONIONS, AND BUTTER SALMON, SUN-DRIED TOMATOES, MIX VEGETABLE OIL, DILL OF GREENS, CHERRY TOMATOES, LAVASH BASTURMA 100/30 g 450- BOILED BEEF 100/50 -

Wine from Ethiopia, Ukraine . . . Where Next? | Financial Times
4-5-2021 Wine from Ethiopia, Ukraine . where next? | Financial Times FT Magazine Wine Wine from Ethiopia, Ukraine . where next? ‘Every time I encounter a new wine-producing region or country, I see it as proof of how widely my wonder and excitement are shared’ Jancis Robinson MAY 1 2021 The most admired classic wines are great but, heavens, life would be boring if they were the only wines available. I love making discoveries. Unfamiliar names remind me just how miraculous it is that the fermented juice of a single fruit can offer such variety and stimulation. Every time I encounter a new wine-producing region or country, I see it as proof of how widely my wonder and excitement are shared. I had heard that Ethiopia (along with at least another 11 African countries) produced wine but had never tasted it until someone, who seemed to be a coffee trader judging by his email address, offered to send me some last month. Six bottles of Rift Valley wine eventually made their way through the obstacle course that wine samples have to navigate post-Brexit. They were all made from familiar international grape varieties, which somewhat diminished their mystique, but the fact that two of them carried no vintage year, while the rest were labelled 2018 and seemed rather younger than that, was certainly unusual. As was the odour of dirty dishcloths I picked up on one or two of the reds. But the two Ethiopian Chardonnays were excellent by any measure. They all come from an operation run by Castel, which established vineyards and a winery south of Addis Ababa in 2007. -

Biodiversity of Grapevine in Azerbaijan ABSTRACT
Biodiversity of grapevine in Azerbaijan International Journal of Minor Fruits, Medicinal and Aromatic Plants Vol. 2 No. 1, 2016 (28 - 31) Biodiversity of grapevine in Azerbaijan M. Musayev1 and T. Huseynova Genetic Resources Institute of the Azerbaijan, National Academy of Sciences, 155 Azadlig Ave - 1106, Baku, Azerbaijan 1Email: [email protected] ABSTRACT Results of studies of the genetic diversity of grapes in Azerbaijan are discussed. The large distribution of local varieties and their wild relatives in the republic is presented. The main bio-morphological and economic characteristics of the samples are determined. The essential differences between varieties and wild samples were is defined. As a result their areal was determined, mechanical and chemical composition of fruits, biological- agricultural traits of collected varieties and wild forms were evaluated. Results indicated that in Azerbaijan wild grape samples are spread widely in large areas and along the banks and shores of river, lake and sea, and on mountain slopes. There are two kinds of wild grape in Azerbaijan: typica Negr. (with hairs) and aberrans Negr. (hairless). At present more than 600 local and introduced grape varieties are spread in Azerbaijan, of which more than 100 varieties are threatened. White, red, black and pink coloured table, technical and universal grape varieties are cultivated. Salt and drought tolerant varieties also reported. Most of the local threatened varieties are conserved for utilizing them in future improvement programme. Keywords: Biodiversity, genetic resources of grapes, local varieties and wild grapes. INTRODUCTION grape in this area (approximately 500, 000 years ago) Azerbaijan is considered one of evolution was proved by stoned grape leave found in centers of cultivated plants. -

City Pub Food&Drinks Menu
L. SIERRA GOLD ....................................1 65.00 M L. M XIRDALAN......................................0.4 3.00 SIERRA GOLD ..................................0.04 6.00 M XIRDALAN FİLTR OLUNMAMIŞ ....................0.4 4.00 M OLMECA BLANCO ................................1 75.00 M HOEGAARDEN FİLTR OLUNMAMIŞ.................0.5 7.00 M OLMECA BLANCO ...............................0.04 6.00 M M HOEGAARDEN FİLTR OLUNMAMIŞ.................0.3 6.00 L. L. M M GREY CARDINAL ................................0.05 11.00 REMY MARTIN VSOP ..............................1 180.00 M PAULANER .....................................0.5 7.00 M OLMECA GOLD ...................................1 75.00 M GREY GOOSE ....................................1 130.00 REMY MARTIN VSOP .............................0.04 M PAULANER FİLTR OLUNMAMIŞ ....................0.5 7.00 M 14.00 OLMECA GOLD .................................0.04 6.00 M GREY GOOSE ..................................0.5 100.00 M PAULANER .....................................0.3 6.00 M PATRON .........................................1 130.00 M GREY GOOSE ..................................0.05 11.00 M PAULANER FİLTR OLUNMAMIŞ ....................0.3 6.00 M M BELUGA .........................................1 130.00 PATRON .......................................0.04 10.00 M ERDINGER QARA................................0.5 7.00 M L. BELUGA .......................................0.5 100.00 M BAILEYS .........................................1 70.00 M ERDINGER FİLTR OLUNMAMIŞ ....................0.5 7.00 -

The Study of Resource Saving Technologies in the Processing Of
Research Article iMedPub Journals Advances in Applied Science Research 2020 www.imedpub.com Vol.11 No.3:2 DOI: 10.36648/0976-8610.11.3.2 The Study of Resource Saving Technologies in Kamaladdin FH1*, 1 1 the Processing of Grapes Mecid MS , Mahir IM , Sefer QN2, Telman IM1, Elman HE1 and Musa MT3 1 Department of Food Engineering, Abstract Expertise of the Azerbaijan State Agrarian On average, about 160 thousand tons of grapes are produced annually in University, Faculty of Technical Sciences, Azerbaijan. If you process all these grapes, you will get about 22 thousand tons Republic of Azerbaijan of seeds and about 6 thousand tons of brushes. These products, which have a 2 Department of Food Products & rich composition, are called second stocks of raw materials. But due to the lack of Technology, Azerbaijan State University cost-effective and affordable technologies that meet local conditions, thousands of of Economics (UNEC), Baku, Republic of tons of products are thrown away as waste every year. Although the research has Azerbaijan produced important results in the field of residue research and processing, it has 3 Department of Wine Processing and not been able to provide a fundamental solution to the problem for all regions. Production Technologies, Research In particular, there was no research or assessment of the composition of residues Institute of Viticulture, Ministry of generated during processing of some indigenous and introduced grape varieties Agriculture of Azerbaijan, Baku City, grown in local conditions. The study used bones obtained after processing native Republic of Azerbaijan (Madras and Bayanshiri) and introduced (Isabella and Merlot) grape varieties grown in local conditions. -

Salads Cold Snacks
SALADS COLD SNACKS Choban 5 Fresh vegetables and greens 8 Tomatoes, cucumbers, onions, greens dressed Tomatoes, cucumbers, peppers and greens with olive oil and lemon juice Pickled vegetables and fruits 5 Mangal 5 Marinated fruits and vegetables from Gabala Peeled eggplants, tomatoes, peppers and greens baked on coal and dressed with oil and onion Home-style meat plate 17 Roast beef, vegetable chicken roll, chicken roll Meat salad 12 with giblets, veal tongue Veal, narsharab sauce, cherry tomatoes, greens, bell peppers, new potatoes, olive oil Black beluga caviar 125 30 g Salmon salad 14 Salmon, tomatoes, olive oil, green mix Chicken lavangi 16 Chicken stuffed with walnuts, onions and dried Goat cheese salad 6 fruits Tomatoes, hot pepper, goat cheese, red onion, cornel sauce, olive oil Azerbaijani cheese platter 11 Local “Motal” cheese, goat cheese, sheep cheese, Tomato salad with red onions 5 bryndza, salty cottage cheese, grapes Tomatoes, red onion, greens, mint, cherry, cornel sauce Сhicken roll lavangi 4 Chicken fillet roll stuffed with walnuts and onions Warm chicken salad 5 with fresh vegetables Eggplant lavangi 4 Marinated chicken breast, red cabbage, lettuce, Eggplant stuffed with walnuts and onions tomatoes, cucumbers, chicken sauce Eggplant mousse 4 A mixture of walnut, sour cream and eggplant Kuku platter 6 Traditional Azerbaijani omelets with greens and walnuts Olives 4 Shaki suzma 3 Traditional dairy product with dill SOUPS FARINACEOUS DISHES Dushbara 6 Gutabs 1 Traditional Azerbaijani small dumplings stuffed With meat, greens, -
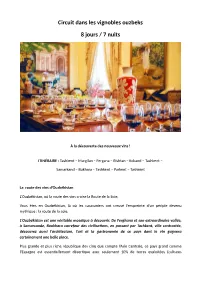
Circuits Dans Les Vignobles Ouzbeks
Circuit dans les vignobles ouzbeks 8 jours / 7 nuits À la découverte des nouveaux vins ! ITINÉRAIRE : Tashkent – Margilan – Fergana – Rishtan – Kokand – Tashkent – Samarkand – Bukhara – Tashkent – Parkent – Tashkent La route des vins d’Ouzbékistan L’Ouzbékistan, où la route des vins Croise la Route de la Soie. Vous êtes en Ouzbékistan, là où les Caravaniers ont Creusé l’empreinte d’un périple devenu mythique : la route de la soie. L’Ouzbékistan est une véritable mosaïque à découvrir. De Ferghana et son extraordinaire vallée, à Samarcande, Boukhara carrefour des civilisaDons, en passant par Tachkent, ville contrastée, découvrez aussi l’architecture, l’art et la gastronomie de ce pays dont le vin gagnera certainement une belle place. Plus grande et plus riChe république des Cinq que Compte l’Asie Centrale, Ce pays grand Comme l’Espagne est essenOellement déserOque aveC seulement 10% de terres exploitées (Cultures agriColes intensives et vallées irriguées), sous un Climat de type ConOnental très Contrasté, froid l’hiver (-10 à -30°) et très Chaud l’été (+35 à 40°), Ce qui protège naturellement la vigne. Depuis son indépendanCe en 1991, l’Ouzbékistan, à forte densité agriCole, a Considérablement développé son potenOel, essenOellement aveC le Coton, dont le pays est un des prinCipaux exportateurs mondiaux, ainsi qu’aveC les fruits et légumes. La vigne a Certainement été introduite en Ouzbékistan à l’époque romaine en liaison aveC la route de la soie. Le développement du seCteur viOCole est devenu une priorité naOonale depuis 2006 et prévoit une augmentaOon de la surface du vignoble. Aujourd’hui, il reste de nombreux Cépages indigènes de l’époque soviéOque qui sont également présents dans les pays du sud CauCase. -
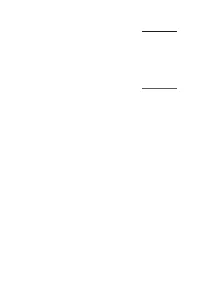
The Mediterranean Genetic Code - Grapevine and Olive
THE MEDITERRANEAN GENETIC CODE - GRAPEVINE AND OLIVE Edited by Danijela Poljuha and Barbara Sladonja The Mediterranean Genetic Code - Grapevine and Olive http://dx.doi.org/10.5772/3442 Edited by Danijela Poljuha and Barbara Sladonja Contributors Stefano Meneghetti, Zohreh Rabiei, Sattar Tahmasebi Enferadi, José Eiras-Dias, Jorge Cunha, Pedro Fevereiro, Margarida Teixeira-Santos, João Brazão, Massimo Muganu, Marco Paolocci, Mirza Musayev, Zeynal Akparov, Lidija Tomić, Branka Javornik, Nataša Štajner, Rosa Adela Arroyo-Garcia, Eugenio Revilla, Denis Rusjan, Jernej Jakše, Rotondi Annalisa, Catherine Marie Breton, André Berville, Anthony Ananga, Vasil Georgiev, Joel W. Ochieng, Bobby Phills, Violetka Tsolova, Devaiah Kambiranda Published by InTech Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia Copyright © 2013 InTech All chapters are Open Access distributed under the Creative Commons Attribution 3.0 license, which allows users to download, copy and build upon published articles even for commercial purposes, as long as the author and publisher are properly credited, which ensures maximum dissemination and a wider impact of our publications. However, users who aim to disseminate and distribute copies of this book as a whole must not seek monetary compensation for such service (excluded InTech representatives and agreed collaborations). After this work has been published by InTech, authors have the right to republish it, in whole or part, in any publication of which they are the author, and to make other personal use of the work. Any republication, referencing or personal use of the work must explicitly identify the original source. Notice Statements and opinions expressed in the chapters are these of the individual contributors and not necessarily those of the editors or publisher. -
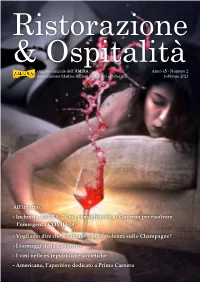
Febbraio 2021
Ristorazione & Ospitalità Organo ufficiale dell’AMIRA Anno 45 - Numero 2 Associazione Maîtres Italiani Ristoranti e Alberghi Febbraio 2021 All’interno: - Inchiesta AMIRA: “Cosa consigliereste al Governo per risolvere l’emergenza COVID-19?” - Vogliamo dire che il sabrage è pura violenza sullo Champagne? - I formaggi della Campania - I vini nelle ex repubbliche sovietiche - Americano, l’aperitivo dedicato a Primo Carnera Ristorazione Sommario & Ospitalità 6 Anno 45 n° 2 8 Febbraio 2021 Rivista di alimentazione, gastronomia, enologia e turismo 20 EDITORE AMIRA Associazione Maîtres Italiani Ristoranti e Alberghi 25 DIRETTORE RESPONSABILE L’EDITORIALE Diodato Buonora [email protected] Dobbiamo trovare una formula per 6 riaprire i ristoranti! - Valerio Beltrami DIRETTORE EDITORIALE Valerio Beltrami ULTIM’ORA Rinvio 65ª Assemblea Internazionale GRAFICA E IMPAGINAZIONE 7 A.M.I.R.A. - Giacomo Rubini Veronica Gatta ATTUALITÀ - INCHIESTA AMIRA CONTRIBUTI EDITORIALI Cosa consigliereste al Governo per Valerio Beltrami, Diodato Buonora, risolvere l’emergenza COVID-19? Gianni Cassanelli, Marisa Conte, 8 Marco Contursi, Giuseppe De Girolamo, Diodato Buonora Mario Di Cristina, Alessandro Dini, IN PRIMO PIANO Giovanni Favuzzi, Valentina Iatesta, Rodolfo Introzzi, Fabio Pinto, Vogliamo dirlo che il sabrage è pura violenza Michele Policelli, Claudio Recchia, 15 sullo Champagne? - Franco Ziliani Antonino Reginella, Giacomo Rubini, ATTUALITÀ don Beppe de Ruvo, Franco Ziliani. In un 2021 ancora non facile, vediamo la IN COPERTINA 19 luce in fondo al tunnel - Valerio Beltrami Foto di Stefan Keller da Pixabay VINI DAL MONDO SITO UFFICIALE La viticultura nelle ex repubbliche www.amira.it 20 sovietiche - Rodolfo Introzzi FILO DIRETTO CON AMIRA IL MAESTRO Tel. 02 49458768 Il Gran Maestro Antonino Scarpinato dalle 9 alle 12 si racconta.. -

Ampelographic Characteristics and Molecular Investigation of Azerbaijani Local Grape Varieties by Microsatellites
Albanian j. agric. sci. 2015;14 (4): 420-430 Agricultural University of Tirana RESEARCH ARTICLE (Open Access) Ampelographic Characteristics and Molecular Investigation of Azerbaijani Local Grape Varieties by Microsatellites VUGAR SALIMOV1, GABRIELLA DE LORENZIS2, RAUF ASADULLAYEV3* 1,3Scientific Research Institute of Viticulture and Winemaking, AZ 0118, Mehdiabad settl., Baku, Azerbaijan 2Dipartimento di Scienze Agrarie ed Ambientali, Università degli Studi di Milano, Via Celoria 2 - 20133, Milano, Italy Abstract The article aims at introducing of some local grapevine varieties cultivated in different areas of Azerbaijan. The cultivars are grown in the ampelographic collection of the Azerbaijani Scientific Research Institute of Viticulture and Wine-making. The description of their ampelographic specifications was based on the OIV list. Comparing cultivars, it has been found that, although there are similarities in various descriptor traits, most of the characteristics are distinctive of specific cultivars. A considerable polymorphism was found concerning the botanical features of leaves, clusters, berries, as well as considering some biological and technological characteristics. In more details, these genotypes differ each other by the morphological features of leaves; the shape, size and structure of clusters; the shape, color and flavor of berries; the productivity indices; the resistance to pests and diseases; the duration of their vegetative period; the sugar and acid contents; and the number of seeds in the berry. This study was carried out on nine grape cultivars grown in region Garabagh, Nakhchyvan and Absheron in 2008- 2012. Analyses of the ampelographic features of the studied grape varieties showed that the genotypes considerably differ by their main morphological, biological and technological characteristics. -
REPUBLIC of AZERBAIJAN on the Rights of the Manuscript ABSTRACT
REPUBLIC OF AZERBAIJAN On the rights of the manuscript ABSTRACT of the dissertation for the degree of Doctor of Philosophy DEVELOPMENT OF AN IMPROVED TECHNOLOGY FOR THE PRODUCTION OF SHERRY-TYPE WINES Specialty: 3309.01- Food production technology Field of science: Technical sciences Applicant: Azer Tapdig Taghiyev Ganja-2021 1 The work was performed at Azerbaijan State Agrarian University Scientific supervisor: doctor of technical sciences, professor Khasil Kamaladdin Fataliyev Official opponents: - doctor of technical sciences, professor Mikail Akbar Maharramov - doctor of philosophy in technical sciences, associate professor Eliza Madat Omarova - doctor of philosophy in technical sciences, Aygun Arif Hajiyeva Dissertation Council at FD 2.26 of the Supreme Attestation Commission under the President of The Republic of Azerbaijan operating at Azerbaijan State Agrarian University O.Orucov Chairman of the Dissertation: Council: doctor of technical sciences, associate professor ______________ Tariyel Mahammad Panahov Scientific secretary of the Dissertation council: doctor of philosophy in technical sciences, associate professor _______________ Vugar Tofig Aghayev Chairman of the scientific seminar: doctor of technical sciences, professor _______________ Sakit Gambay Verdiyev 2 GENERAL DESCRIPTION OF THE RESEARCH Relevance and degree of completion of the topic.. Currently, the main directions of the development of winemaking are to improve the quality, ensure the competitiveness, and export orientation of the products produced. It is planned to create a brand "Made in Azerbaijan", which will give preference to wine and wine products, as well as increase the export of wine from Azerbaijan up to 5 times by 2025. The area of the country's vineyards should be increased to 30 thousand hectares, the production of grapes - up to 500 thousand tons, and the production of wine-up to 30 million decaliters.