Introduction (Extrait)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Du Pont Du Gard Au Viaduc De Millau. Les Ponts
p a t r i m o i n e p r o t é g é Du pont du Gard au viaduc de Millau Les ponts protégés en Occitanie Culture Ministère de la Ministère Ouvrage sous la direction de Laurent Barrenechea Auteurs Sophie Asport-Mercier [SAM] Docteur en histoire de l’art et archéologue Claire Aubaret [CA] Chargée d’études documentaires, crmh, drac Occitanie Laurent Barrenechea [LB] Conservateur régional des Monuments historiques, crmh, drac Occitanie Jean-Marc Calmettes [JMC] Ingénieur du patrimoine, crmh, drac Occitanie Josette Clier [JC] Chargée d’études documentaires, crmh, drac Occitanie Marie-Ève Cortès [MEC] Directrice de la culture et du patrimoine, ville d’Albi Marie-Emmanuelle Desmoulins [MED] Chargée d’études documentaires, crmh, drac Occitanie Olivier Liardet [OL] Chargé d’études documentaires, crmh, drac Occitanie Marie-Laure Loizeau [MLL] Chargée d’études documentaires, crmh, drac Occitanie Manon Vidal [MV] Conservatrice des Monuments historiques, crmh, drac Occitanie avec les contributions de Michel Béziat Directeur d’opérations – sncf Réseau Occitanie Emmanuel Cachot Directeur général délégué, Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau Axel Letellier Architecte du patrimoine Samuel Vannier Chargé des archives et des projets culturels, Voies Navigables de France Couverture : Viaduc de Millau (12). Page précédente : Toulouse (31), Pont des Catalans. Du pont du Gard au viaduc de Millau Les ponts protégés en Occitanie p a t r i m o i n e protégé 4 Du pont du Gard au viaduc de Millau - Préface Préface - Du pont du Gard au viaduc de Millau 5 Infrastructures permettant le franchissement d’un escarpement ou Ornaisons (11), pont des États de d’un cours d’eau, les ponts peuvent aussi être, au-delà de leur simple Languedoc. -
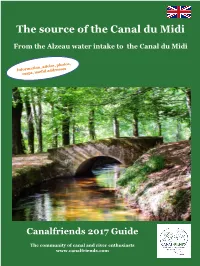
The Source of the Canal Du Midi
The source of the Canal du Midi From the Alzeau water intake to the Canal du Midi Canalfriends 2017 Guide The community of canal and river enthusiasts www.canalfriends.com This is YOUR guide The Canalfriends.com community platform was created in 2014 to share our passion for inland waterways with fellow enthusiasts, be they waterways professionals or tourists. In this spirit, we have created this collaborative guide for you to download for free. Having joined the "Acteur Canal du Midi" network in September 2016, the year of 350th anniversary of the canal du midi, we wanted to organise a special "Discovery Weekend " of the its channels and supply systems. The Acteur network and professionals (restaurant owners, accommodation providers, fish farmers) contributed to the success of this weekend. This digital guide, created in collaboration with Acampo association and the Museum & Gardens of the Canal du Midi, will assist you in discovering this magnificent territory, whether on your own, with family or friends. It will also be useful in planning your trip. The guide will be updated throughout the year to include suggestions, advice and useful addresses. For more in-depth information, download our free e-guide Garonne Canal and River available in French and English. Tell us the type of information you would like to find in this guide. Contact us to list your business, activity or accommodation. Once you have done the itineraries in the guide, do not hesitate to let us have your comments on your experience. Emails us on [email protected] and be kept informed of guide updates. -

A Wonderful Cruise Down the ‘Platane’ Lined Canal Du Midi Unesco World Heritage Site
I have been a practicing Francophile for over 30 years now. If only to persuade you to read on, let me reassure you that, as a Francophile, I am passionate about France and “things French” - be reassured that I have no abnormal feelings about ex Spanish dictators. I am also a canalaholic. These two admissions explain why my wife, Lesley, and I arrived in Calais on our barge, in October 1988, having left our “comfortable lives” in the City and our mooring on the Grand Union canal at Tring. For at least ten years prior to our arrival in France we had holidayed in France and on the canals. A wonderful cruise down the ‘platane’ lined Canal du Midi Unesco World Heritage site. Built by Pierre-Paul Riquet in the 17th century TEX T AND PHO T OGRA P HS MIKE GARDNER ROBER T S The vacation has become a vocation We loved the Midi. Steeped in history, bathed in sunshine So when we went through the sea-lock and on to the inland and with the Mediterranean beaches a stones-throw away, waterways it was the start of the realisation of our dream; it is a wonderful place to live. The entire Canal du Midi is our dream to take our own boat, our floating home, all the a UNESCO world heritage site. Built during the reign of way through French canal network from Calais to the Med. Louis XIV, in the 17th Century, by Pierre-Paul Riquet, it Initially, this dream was to be a sabbatical lasting a year. -

Le Grand Oeuvre De Pierre-Paul Riquet
Les textes et les illustrations de cette rubrique historique sont protégés par l’article L-111-1 du code de la propriété intellectuelle, pour toute utilisation nous contacter. © Studio Différemment PATRIMOINE Le grand œuvre de Pierre-Paul Riquet (1re partie) UN IMMENSE OUVRAGE POUR RELIER TOULOUSE À LA MÉDITERRANÉE Creusé à partir de 1667 au départ de Toulouse, le Canal royal de Languedoc, futur Canal du Midi, aurait dû passer bien plus près du centre ville. Mais les Capitouls en décidèrent autrement... agricoles) qui, autour de Toulouse, ne créèrent pas de problèmes, les in- demnisations étant élevées et payées par les États de Languedoc. Ensuite commence le chantier proprement dit avec le terrassement qui consiste Ci-dessus la à creuser le lit du canal à même le sol. Toulouse de la Les ouvriers sont nombreux car fi n du 17e siècle tout se fait à la main et faciles à trouver contournée par le car la paye est bonne. Sans compter Canal qui passait alors en pleine t si le Canal du Midi n’était pas d’abord le faire passer dans le fossé des les ouvrières, Riquet privilégiant leur campagne. passé par Toulouse ? Dans ses murailles, soit à peu près à l’emplace- embauche car elle lui coûtent moins premiers projets, au début des ment des actuels boulevards mais les cher : « Toutes les femmes qui me vien- années 1660, le biterrois Pier- Capitouls s’y opposent, offi ciellement dront, je les prendrai, écrit-il à Colbert Ere-Paul Riquet, s’il est assez précis sur par peur d’inondations dans la ville, en 1669, dans la pensée que ces femmes la portion techniquement stratégique en fait car ils sont fachés que le Canal travaillant à forfait feront autant de autour du seuil de Naurouze en Laura- échappe à leur juridiction, étant « fi ef » travail que les hommes qui travaillent gais, reste dans le fl ou pour le reste du de Riquet et ses descendants par ordre à journée, qu’il ne m’en coûtera pas tant trajet : son canal des deux mers pour- du Roi. -

Canal Infos 2017 11 No 27
Pour un meilleur cadre de vie, impliquez-vous dans votre associaon de quarer ! Réunions tous les 1 ers jeudis du mois à 20h30 MJC des Ponts Jumeaux - site des Amidonniers, 2, port de l’Embouchure N°27– Novembre 2017 31000 Toulouse ÉDITO : LETTRE AU PÈRE NOËL L’hiver approche à grands pas et il est déjà temps de penser aux fêtes de fin d’année ! L’ASBBA, qui veut encore croire au Père Noël, adresse donc ses demandes à Madame Ghislaine Delmond pour qu’elle intercède auprès du Maire et apporte dans nos souliers ce qu’on nous avait promis il y a parfois bien longtemps… La boîte à livres du Square Mady de la Girau- dière : L’ASBBA, qui fut paraît-il la première à imaginer et à demander cette boîte, les voit fleurir un peu partout, mais pas aux Amidonniers. C’était il y a plus de deux ans ! On nous avait promis une boîte personnalisée, REPAS DE QUARTIER 2017 artistique, en forme de poisson, etc. Nous n’en de- mandions pas tant ! Juste un cube qui permettrait à Comme chaque année, le repas de quartier s’est déroulé sur la Coulée chacun de déposer et de prendre librement des verte dans une ambiance conviviale, le 23 juin dernier. Tables et chaises livres suffirait… Avec ses bancs, ses jeux et sa tran- avaient été fournis par la Mairie. La canicule des semaines précédentes quillité, le square est l’endroit parfait pour lire : pour- ayant fait place à une température plus clémente, les habitants ont partagé quoi ne pas en faire un petit lieu d’échanges cultu- les plats de leur confection et l’apéritif, offert par l’ASBBA. -

El Canal Du Midi, En Busca De Un Proyecto Patrimonial Y Paisajístico
ID_ INVESTIGACIONES EL CANAL DU MIDI, EN BUSCA DE UN PROYECTO PATRIMONIAL Y PAISAJÍSTICO Paula Orduña Giró Geógrafa. Máster en Investigación en Urbanismo Director: Joaquin Sabaté Bel Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio (DUOT) UPC RESUMEN El Canal du Midi constituye un eje que atraviesa el sur de Francia, uniendo el océano Atlán- tico con el mar Mediterráneo. Desde 1996 está catalogado como patrimonio mundial por la Unesco. El artículo analiza el cambio de función y de usos de un canal donde, además de la función agrícola, a lo largo del siglo XX, se ha pasado del transporte comercial de mercan- cías al uso turístico y deportivo. Nos interesa examinar cómo se gestiona el valor patrimonial de esta obra de ingeniería hidráulica, así como los discursos, proyectos e instrumentos que han propiciado una nueva puesta en valor. Palabras clave: Obra de ingeniería hidráulica, eje patrimonial, mutación de usos, gestión del patrimonio. 13 ID_ INVESTIGACIONES ABSTRACT The Canal du Midi is an axis passing through the south of France, connecting the Atlantic Ocean with the Mediterranean Sea. Since 1996 it has been included in the World Heritage List by UNESCO. This article analyzes the changing role and uses of an hydraulic engineering project where, as well as its agricultural function, throughout the twentieth century it has also been used for the commercial transportation of goods and for tourist and sporting use. We are interested in examining how the heritage value of this hydraulic engineering work is managed, as well as the discourses, projects and instruments which have En la página anterior: Canal du Midi, Henri Matisse led to these new enhancements. -

Canal Du Midi
PROGRAMME - 1ère édition Retrouvez toute l’actualité 1666 - 2016, Toulouse fête des festivités autour du canal Canal du Midi, les 350 ans de l’édit royal sur toulouse.fr PATRIMOINE de Louis XIV autorisant les D’AVENIR au cœur de Toulouse travaux de construction du depuis 350 ans, canal du Midi, alors qualifié patrimoine mondial de de canal des Deux Mers. l’UNESCO depuis 20 ans. Nous fêtons cette année les 350 ans du canal du Midi. Pour Toulouse, le « canal » est un mar- queur très fort. Un patrimoine qui doit tout au cerveau et à la main de l’homme, initialement conçu comme voie de communication… mais qui cohabite magistralement avec son cadre actuel et ses nouveaux usages : modes de déplacement doux, promenade, plaisance, pêche, aviron… De fait, nous devons au canal du Midi la présence, au cœur de notre ville, de multiples bâtiments et ouvrages d’art remarquables (écluses, ponts, passerelles, maisons éclusières, bas-reliefs…), mais aussi de bassins, d’ateliers et de ports, un ensemble souvent méconnu… mais pourtant reconnu par l’UNESCO, qui l’a inscrit en 1996 à la liste du Patrimoine mondial. J’avais alors pris part à l’initiative locale qui avait permis ce classement. Sait-on encore que la première pierre du canal du Midi fut posée à Toulouse ? Que les édiles toulousains, Capitouls et archevêque, soutinrent le projet ? Que c’est aux Minimes qu’eurent lieu les premières expérimentations sur les écluses ? Il faut donc souhaiter au canal du Midi un excellent anniversaire, mais aussi s’attacher à 1996 - 2016, il y a 20 ans, préserver ce legs précieux et apprécié, que nos projets de développement urbain doivent impérativement prendre en considération et valoriser. -

Canal Du Midi Le Génie Fluvial À L'épreuve De L'histoire
LA CITÉ / JUILLET / AOÛT 2016 23 CANAL DU MIDI LE GÉNIE FLUVIAL À L’ÉPREUVE DE L’HISTOIRE En octobre 1666, Louis XIV ordonnait la construction du «Canal reliant les mers Océane et Méditerranée». 2016 célèbre les 350 ans de cet acte ouvrant une nouvelle ère dans l’utilisation des cours d’eau à des fins commerciales. PAR AURORE STAIGER CANAL LATERAL À LA GARONNE, PONTS JUMEAUX, PORT DE L'EMBOUCHURE DU CANAL DU MIDI, TOULOUSE. © STÉPHANE GAUTHIER / 2 MAI 2016 Versailles, parmi les peintures du pla- Carcassonne et Béziers, l’Agence de Dévelop- attire des adeptes du monde entier, et génère des chantiers du XVIIè siècle menés par Ri- fond de la galerie des Glaces, un médail- pement Touristique de l’Hérault planifie une aujourd’hui plus de deux mille emplois sur le quet et Vauban. Parmi les 65 écluses, cer- À lon signé Le Brun figure la rencontre fête et un marché de produits locaux. canal du Midi. Les retombées économiques di- taines ont été agrandies au début du XXe de la mer et de l’océan par le canal des Deux- Ce rendez-vous est fixé pour l’automne, car rectes et indirectes sont estimées par les VNF siècle pour correspondre au «gabarit Freyci- Mers. Et sur le grand tableau de Henri Testelin «l’idée est de faire vivre le canal toute l’année», à plus de 122 millions d’euros. net», permettant le transit de péniches lon- où Colbert présente à Louis XIV les membres avance le directeur marketing de l’ADT, Jean- gues de 38 mètres. -

Toulouse: Embracing the Knowledge Economy
Toulouse: Embracing the knowledge economy Pathways to creative and knowledge-based regions ISBN 978-90-75246-54-4 Printed in the Netherlands by Xerox Service Center, Amsterdam Edition: 2007 Cartography lay-out and cover: Puikang Chan, AMIDSt, University of Amsterdam All publications in this series are published on the ACRE-website http://www2.fmg.uva.nl/acre and most are available on paper at: Dr. Olga Gritsai, ACRE project manager University of Amsterdam Amsterdam institute for Metropolitan and International Development Studies (AMIDSt) Department of Geography, Planning and International Development Studies Nieuwe Prinsengracht 130 NL-1018 VZ Amsterdam The Netherlands Tel. +31 20 525 4044 +31 23 528 2955 Fax +31 20 525 4051 E-mail: [email protected] Copyright © Amsterdam institute for Metropolitan and International Development Studies (AMIDSt), University of Amsterdam 2007. All rights reserved. No part of this publication can be reproduced in any form, by print or photo print, microfilm or any other means, without written permission from the publisher. Toulouse: Embracing the knowledge economy Pathways to creative and knowledge-based regions ACRE report 2.11 Edited by Elisabeth Peyroux Denis Eckert Christiane Thouzellier Authors Elisabeth Peyroux Michel Grossetti Martine Azam Christiane Thouzellier Jean-Louis Coll Jean-Marc Zuliani Florence Laumière Mariette Sibertin-Blanc Samuel Balti Other contributors Corinne Siino, Françoise Desbordes, Frédéric Leriche Accommodating Creative Knowledge – Competitiveness of European Metropolitan Regions within the Enlarged Union Amsterdam 2007 AMIDSt, University of Amsterdam Acknowledgment We would like to thank all the members of the Toulouse Local Partnership (LOP) for their active contribution in this first research phase of the ACRE Programme. -

Écluses, Ponts, Ports Et Passerelles, Scandent Le Cours Du Canal Du Midi À Toulouse, Telle La Voix De Claude Nougaro Lorsqu'i
Écluses, ponts, ports et passerelles, scandent le cours du canal du Midi à Toulouse, telle la voix de Claude Nougaro lorsqu'il chante son eau verte dans l'hymne qu'il a dédié à Toulouse. Pour célébrer les 350 ans de l'édit de construction et les 20 ans de son inscription sur la liste du patrimoine de l'UNESCO, les Archives ont choisi 12 photos pour révéler 12 lieux symboliques de cet ouvrage et découvrir sa richesse historique et patrimoniale souvent méconnue. La Saison photo printemps/été 2016 a offert l'opportunité de découvrir une exposition dévoilant différents visages du canal sur les cent dernières années. Réalisée au 17e siècle, cette œuvre du génie créatif de Pierre-Paul Riquet a connu de profondes transformations au 20e. La concurrence du chemin de fer, puis de la voiture, ont amplifié son obsolescence économique. A tel point, qu'une voie rapide a failli le faire disparaître dans les années 1970. Le tourisme lui a donné un second souffle et la reconnaissance de sa valeur patrimoniale lui a permis de conserver toute sa place au cœur de la ville. La saison photo à Toulouse printemps – été 2016 2016, année anniversaire du canal du Midi 23 août > 18 septembre Photographies square du Général-Charles-de-Gaulle Emile Espy, Patrice Nin, Stéphanie Renard, Jean Ribière Métro Ligne - station Capitole Exposition des ARCHIVES MUNICIPALES Accès libre Commissariat d’exposition Catherine Bernard & Hélène Kemplaire www.archives.toulouse.fr Coordination DIRECTION DE LA COMMUNICATION / Emmanuelle Sapet Conception graphique No-Screen-Today, systèmes graphiques contact : Catherine Bernard Numérisation [email protected] Stéphanie Renard Impression et installation PICTO Des étapes clés Dès l'Antiquité, les Romains aspirent à créer une liaison entre Méditerranée et Atlantique Naissance du canal Révolution Riquet présente son projet à Colbert en 1662. -

{Download PDF} Midi-Pyrenees
MIDI-PYRENEES PDF, EPUB, EBOOK Michelin | none | 07 Mar 2008 | Michelin Travel Publications | 9782067135338 | English | Watford, United Kingdom Midi-Pyrenees PDF Book On fine days our round swimming pool is a delight to our guests. Spring's melted snows lure kayakers and rafting enthusiasts. Wikimedia Commons Wikivoyage. Mercure Albi Bastides Hotel. In the west it also connects with the Garonne Canal to create the Canal des Deux Mers, effectively spanning the Atlantic and Mediterranean coasts years ago! The regional channel France 3 broadcasts programs in Occitan but not its Gascon dialect a few hours per week. Aveyron Discover the destination. Pilgrims have flocked to Moissac for centuries, as they have to Conques in the north of the Aveyron. European data protection notice. This 14th-century bridge is a most evocative way to enter the city of Cahors, and can only be used by pedestrians. Passport to Europe. The punts turn around beneath the medieval village of Peyre, which clings to the rock face above a bend in the Tarn. Speakers of Gascon complain of the hegemony of Languedocian Occitan and its cultural center of Toulouse, and some followers of a self-proclaimed linguist, Lafitte, even reject the classification of Gascon as a dialect of Occitan. There are also airports at Lourdes, and Rodez with flights from the UK. See all photos. Melons for sale at a market in Tarn-et-Garonne. Since the region was created in the s, a certain sense of a "Midi-Pyrenean" identity has emerged. The Chateau de Foix, a monument historique since Religious buildings can be pretty dramatic too. -
Linssen Yachts
The Boating & Lifestyle Magazine from Linssen Yachts Volume 22, august 2009 • Nr. 34 Single issues: € 3,00 ISSN 1571-8832 Special jubilee edition "...60 years of style in steel..." The new Linssen Grand Sturdy 25.9 Sedan ... Simplicity is the ultimate sophistication... A trip from Merzig to Paris ... A fantastic round trip through five countries... The Linssen Grand Sturdy 45.9 1949 AC 2009Experience ... 45.9: Happy marriage of sturdiness and style... 1949 2009 1949 2009 1949 - 2009 1949 2009 Linssen Yachts: 60 years of style in steel Linssen Yachts Boat Show 2009 27, 28, 29 and 30 November 2009 Showroom Maasbracht (NL) MUST SEE Friday 27 November (noon - 6 PM) Saturday 28 November (10 AM - 6 PM) Sunday 29 November (10 AM - 6 PM) Monday 30 November (10 AM - 3 PM) location: Linssen Yachts B.V. Brouwersstraat 17, NL-6050 AD Maasbracht ATTENTION: You will only be admitted to the showroom if you are in possession of a FREE boarding pass. Request your FREE BOARDING PASS: www.linssenyachtsboatshow.com Serious Pleasure Volume 22 • October 2009 Travel & Boating Nr. 34 ISSN 1571-8832 16 A...A tripfantastic from round Merzig trip through to Paris five countries... 30 A... Unesco wonderful World cruise Heritage down site. the ‘platane’ lined Canal du Midi Built by Pierre-Paul Riquet in the 17th century... 42 ...“ThreeSailing Lakesin Switzerland Area”... 50 Lake... We know Constance Europe from – Viennathe motorway. – Paris (Part 1) Now we’re exploring it from the water... Special Features 4 Editorial “Linssen. A brand with a solid reputation!” 6 Winter...Linssen Yachtsmaritime Boat ambience Show: 1st Adventat Linssen weekend Yachts each year..