Recherche Sur Les Travaux Césariens Devant Gergovie. 1995-1999
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
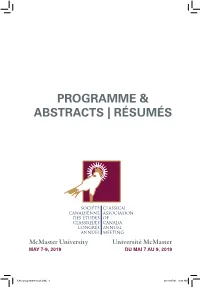
Programme & Abstracts
PROGRAMME & ABSTRACTS | RÉSUMÉS SOCIÉTÉ CLASSICAL CANADIENNE ASSOCIATION DES ÉTUDES OF CLASSIQUES CANADA CONGRÉS ANNUAL ANNUEL MEETING McMaster University Université McMaster MAY 7-9, 2019 DU MAI 7 AU 9, 2019 CAC-programme-book.indb 3 2019-05-01 9:22 AM CAC-programme-book.indb 4 2019-05-01 9:22 AM Contents Maps . 7 Food . 13 . Statement on Harassment | Déclaration sur le harcèlement . 14 Policy on Tweeting | Politiques concernant le « tweetage » . 15. Program | Programme . 17 Keynote Address | Conférence plénière . 37 . Abstracts | Résumés . 39 Index . .152 . CAC-programme-book.indb 5 2019-05-01 9:22 AM CAC-programme-book.indb 6 2019-05-01 9:22 AM Maps 7 CAC-programme-book.indb 7 2019-05-01 9:22 AM Campus Map Campus Map 8 9 CAC-programme-book.indb 8 2019-05-01 9:22 AM Campus Map Campus Map 8 9 CAC-programme-book.indb 9 2019-05-01 9:22 AM Hamilton Hall University Club (Alumni Memorial Bldg) Hamilton Hall 10 11 CAC-programme-book.indb 10 2019-05-01 9:22 AM Hamilton Hall University Club (Alumni Memorial Bldg) 10 11 CAC-programme-book.indb 11 2019-05-01 9:22 AM Burke Science Building 12 CAC-programme-book.indb 12 2019-05-01 9:39 AM Food On Campus Phoenix Bar & Grill ($$) McMaster University Student Center Food-court ($) Hamilton Restaurants Downtown Westdale Aberdeen Tavern ($$$) Delirious Burger ($) Berkeley North ($$$) Locke St. Born & Raised ($$$) Brux House ($$$) Hambrgr ($$) Cima ($$$) Merit Brewing Co. ($) Dundas The French ($$$) India Village ($) The Mule ($$) Quatrefoil ($$$$) The Ship ($$) Mezcal ($$) Saltlick Smokehouse ($) 13 CAC-programme-book.indb 13 2019-05-01 9:22 AM Statement on Harassment | Déclaration sur le harcèlement STATEMENT ON HARASSMENT The CAC does not tolerate prejudice, inequity, harassment, or related unethical behav- iour, and aspires to an academic culture that fosters professional courtesy, respect, equity, tolerance, and inclusion for all of its members, and for all people working in our related disciplines. -

1812; the War, and Its Moral : a Canadian Chronicle
'^^ **7tv»* ^^ / ^^^^T^\/ %*^-'%p^ ^<>.*^7^\/ ^o^*- "o /Vi^/\ co^i^^.% Atii^/^-^^ /.' .*'% y A-^ ; .O*^ . <f,r*^.o^" X'^'^^V %--f.T*\o^^ V^^^^\<^ •^ 4.^ tri * -0 a5 «4q il1 »"^^ 11E ^ ^ THE WAR, AND ITS MORAL CANADIAN CHRONICLE. BY WILLIAM F?"C0FFIN, Esquire, FORMERLT SHERIFF OF THE DISTRICT OF MONTREAI,, LIEUT.-COLONKL, STAFF, ACIITB POROB, CANADA, AND H. M. AGENT FOR THE MANAGEMENT OF THE ORDNANCE ESTATES, CANADA. PRINTED BY JOHN LOVELL, ST. NICHOLAS STREET. 1864. E354 C^y 2. Entered, according to the Act of the Provincial Parliament, in the year one thousand eight hundred and sixty-four, by William F. Coffin, in the OfBce of the Registrar of the Province of Canada. Ea t\}t J^igfjt pjonourable ^ir (SbmtmtJ SSalhtr f cab, iarond, ^er Pajtstg's Post '§ononmbk ^ribg Council, ^nU late ffiobernor ©cneral anli C0mmanKcr4tt=(H;fjicf of IBxitislj Nortfj America, ©Ws (jrattatlinw (!>Uv0uicU 0f the ^m of I8I2 is rcspcctftillp tirtitcatEU, fig fjis fattfjful anU grateful .Scrfaant, WILLIAM P. COFFIN. Ottawa, 2nd January, 1864, TO THE RIGHT HONORABLE SIR EDMUND WALKER HEAD, BARONET. My dear Sir,—^I venture to appeal to your respected name as the best introduction for the little work which I" do myself the honour to dedicate to you. To you, indeed, it owes its existence. You conferred upon me the appointment I have the honour to hold under the Crown in Canada, and that appointment has given life to an idea, long cherished in embryo. The management of the Ordnance Lands in this Province has thrown me upon the scenes of the most notable events of the late war. -
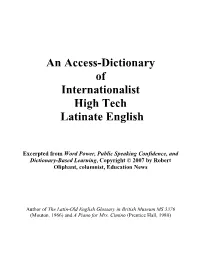
An Access-Dictionary of Internationalist High Tech Latinate English
An Access-Dictionary of Internationalist High Tech Latinate English Excerpted from Word Power, Public Speaking Confidence, and Dictionary-Based Learning, Copyright © 2007 by Robert Oliphant, columnist, Education News Author of The Latin-Old English Glossary in British Museum MS 3376 (Mouton, 1966) and A Piano for Mrs. Cimino (Prentice Hall, 1980) INTRODUCTION Strictly speaking, this is simply a list of technical terms: 30,680 of them presented in an alphabetical sequence of 52 professional subject fields ranging from Aeronautics to Zoology. Practically considered, though, every item on the list can be quickly accessed in the Random House Webster’s Unabridged Dictionary (RHU), updated second edition of 2007, or in its CD – ROM WordGenius® version. So what’s here is actually an in-depth learning tool for mastering the basic vocabularies of what today can fairly be called American-Pronunciation Internationalist High Tech Latinate English. Dictionary authority. This list, by virtue of its dictionary link, has far more authority than a conventional professional-subject glossary, even the one offered online by the University of Maryland Medical Center. American dictionaries, after all, have always assigned their technical terms to professional experts in specific fields, identified those experts in print, and in effect held them responsible for the accuracy and comprehensiveness of each entry. Even more important, the entries themselves offer learners a complete sketch of each target word (headword). Memorization. For professionals, memorization is a basic career requirement. Any physician will tell you how much of it is called for in medical school and how hard it is, thanks to thousands of strange, exotic shapes like <myocardium> that have to be taken apart in the mind and reassembled like pieces of an unpronounceable jigsaw puzzle. -
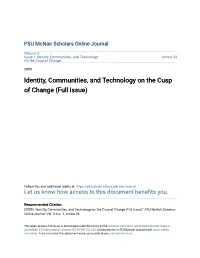
Identity, Communities, and Technology on the Cusp of Change (Full Issue)
PSU McNair Scholars Online Journal Volume 3 Issue 1 Identity, Communities, and Technology: Article 23 On the Cusp of Change 2009 Identity, Communities, and Technology on the Cusp of Change (Full Issue) Follow this and additional works at: https://pdxscholar.library.pdx.edu/mcnair Let us know how access to this document benefits ou.y Recommended Citation (2009) "Identity, Communities, and Technology on the Cusp of Change (Full Issue)," PSU McNair Scholars Online Journal: Vol. 3: Iss. 1, Article 23. This open access Full Issue is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0). All documents in PDXScholar should meet accessibility standards. If we can make this document more accessible to you, contact our team. I DENTITY, C OMMUNITIES AND T ECHNOLOGY O N THE C USP OF C HANGE 2009 McNair Scholars Online Journal The Ronald E. McNair Scholars Program at Portland State University (PSU) works with motivated and talented undergraduates who want to pursue PhDs. It introduces juniors and seniors who are first-generation and low-income, and/or members of under-represented groups to academic research and to effective strategies for getting into and graduating from PhD programs. The McNair Scholars Program has academic-year activities and a full-time summer research internship. Scholars take academic and skills-building seminars and workshops during the year, and each scholar works closely with a faculty mentor on original research in the summer. Scholars present their research findings at the McNair Summer Symposium and at other conferences, and are encouraged to publish their papers in the McNair Journal and other scholarly publications. -

© in This Web Service Cambridge University
Cambridge University Press 978-0-521-87756-5 - Headhunting and the Body in Iron Age Europe Ian Armit Index More information Index Abernethy, Perthshire Basel Gasworks, Germany, settlement, 196 Pictish monastery, 34 Beaucaire, Languedoc, 34, 79, 136 stone head, 34 Benôit, Fernand, 77–8, 92, 99, 144, 158, 173, 175 Acy-Romance, France, settlement, 218 Benton, Sylvia, 120, 123 Aldhouse Green, Miranda, 36–7 Berawan of Borneo, 1, 11–12, 30 Alexander, John, 51 Bernard, Loup, 167 Allariz, Spain, oppidum, 184 Billingborough, Lincolnshire, 8 All Cannings Cross, Wiltshire, 5–6, 8–9 birds, bird symbolism, 3, 77–8, 106, 130, 141–3, Allobroges, 168, 173, 191 145–7, 156–7, 161, 200, 206, 209–10, 212, 220 Amathus, 40 Boas, Franz, 49 Ambrussum, Languedoc, oppidum, 146, Boissinot, Philippe, 129, 131–2, 136–7, 140, 171, 210 142, 169 Ammianus Marcellinus, 23 Bouray, France, bronze sculpture, 34, 178 Anaximander, 13 Bouriège, France, statue, 171, 182–4 Appell, George, 59 Bradley, Richard, 14, 103 Arcelin, Patrice, 79, 84, 87, 96–7, 99, 133–4, 145, brain balls, 11 158, 160, 173, 183, 186–7, 190, 216 Bredon Hill, Gloucestershire, 7–8 Archer, W. G., 61, 69, 204 Breiddin, Powys, hillfort, 8 Arch of Constantine, Rome, 41 Brigantes, 7 Arcobriga, pottery vessel, 85, 106–7, 156–7 Bringasses, Provence, oppidum, 161, 171 Arens, William, 50 broch towers, 212, 225 Arles, Provence, 168, 174 Broxmouth, East Lothian, hillfort, 8 Armeá, Spain, oppidum, 184 Brun, Jean-Pierre, 84, 87 Arverni, 168, 191, 202 Brunaux, Jean-Louis, 198–201 Asmat, New Guinea, 59, 61 Bu, Orkney, broch, -

The Age of Wars of Religion, 1000-1650
THE AGE OF WARS OF RELIGION, 1000–1650 THE AGE OF WARS OF RELIGION, 1000–1650 AN ENCYCLOPEDIA OF GLOBAL WARFARE AND CIVILIZATION Volume 1, A–K Cathal J. Nolan Greenwood Encyclopedias of Modern World Wars GREENWOOD PRESS Westport, Connecticut London Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Nolan, Cathal J. The age of wars of religion, 1000–1650 : an encyclopedia of global warfare and civilization / Cathal J. Nolan. p. cm.—(Greenwood encyclopedias of modern world wars) Includes bibliographical references and index. ISBN 0–313–33045–X (set)—ISBN 0–313–33733–0 (vol. 1)— ISBN 0–313–33734–9 (vol. 2) 1. Middle Ages—History—Encyclopedias. 2. History, Modern—17th century— Encyclopedias. 3. Military history, Medieval—Encyclopedias. 4. Military history, Modern—17th century—Encyclopedias. 5. Biography—Middle Ages, 500–1500— Encyclopedias. 6. Biography—17th century—Encyclopedias. I. Title. D114.N66 2006 909.0703—dc22 2005031626 British Library Cataloguing in Publication Data is available. Copyright # 2006 by Cathal J. Nolan All rights reserved. No portion of this book may be reproduced, by any process or technique, without the express written consent of the publisher. Library of Congress Catalog Card Number: 2005031626 ISBN: 0–313–33045–X (set) 0–313–33733–0 (vol. I) 0–313–33734–9 (vol. II) First published in 2006 Greenwood Press, 88 Post Road West, Westport, CT 06881 An imprint of Greenwood Publishing Group, Inc. www.greenwood.com Printed in the United States of America The paper used in this book complies with the Permanent Paper Standard issued by the National Information Standards Organization (Z39.48–1984). -

Instrumentum D'hygiène Et De Médecine En Gaule Romaine
Université Lumière Lyon 2 École doctorale Sciences Sociales – ED483 Instrumentum d’hygiène et de médecine en Gaule romaine Élise VIGIER Archéologie Sous la direction de Mathieu POUX et de Bernadette CABOURET-LAURIOUX Thèse présentée et soutenue publiquement le 21 novembre 2018 Volume III : Listes, Annexes, Bibliographie Composition du jury : Véronique BOUDON-MILLOT Directrice de recherche CNRS Université de Paris IV – Sorbonne Bernadette CABOURET-LAURIOUX Professeure d’histoire romaine Université Jean Moulin – Lyon 3 Véronique DASEN Professeure d’archéologie classique Université de Fribourg Michel FEUGÈRE Chargé de recherche HC CNRS Université Lumière – Lyon 2 Mathieu POUX Professeur d’archéologie gallo-romaine Université Lumière - Lyon 2 Titre du chapitre LISTES DES ATTESTATIONS Cette partie fournit les listes d’attestations des objets identifiables enregistrés sur les fiches typo- logiques d’Artefacts, encyclopédie collaborative en ligne des objets archéologiques1 à la date du 10.09.2018. Elles résultent de la compilation de données effectuée soit par un, soit par plusieurs auteurs ayant contribué à chaque fiche. La création et l’alimentation de ces fiches ont constitué une part importante de ce travail dans la phase de documentation. Elles sont tenues à jour en permanence, enrichies au fil des découvertes et publications, et sont accessibles à tout utilisateur du site web sur inscription. Les listes d’objets sont organisées selon le principe développé par E. Riha de la tripartition des catégories fonctionnelles en trois sections : « hygiène, toilette », « mixte » et « médico-chirurgi- cal ». À l’intérieur de chacune des catégories fonctionnelles, les listes sont classées par ordre alphanumérique selon le numéro d’inventaire de la fiche existante sur le site Artefacts. -

Pres2016-0042.Pdf
+ + + 1- + , .. " •• I ! !'::' •I .t ALPHABETIOAL FRENOrt�EW{jJ.;.lSiIi:: I. I. II •• 't· ••• " '. ·'1', .. LIST OF TECHNICAL MILITARY TERMS ron MILITARY STUDENTS BY M. DESHUMBERT FORMERJ..Y PROFESSOR OF FRENCH AT THE STAFF COLLEGE, AND THE ROYAL MILITARY COLLEGE WITH A PREFACE BY MAJOR-GENERAL SIR F. MAURICE, K.C.B. LATE PROFESSOR OF MILITARY A.RT A:SD HISTORY AT THE STAFF COU,EGE SEYENTlI A.ND EIGHTH THOUSAND LONDON: DAVID NUTT 57-59 LONG ACRE 1908 �' . :: :•.••.••.•...: :.'.:: ...... • ...:: : r-. : •:..•• ..•.•.. ,.,. ... •!: -.' .:.:. ',,: :, . Prinred i.. HoI/tutti. PREFACE ::\10NSIEUR DESHUMBERT has asked me to give him a Preface for this little volume. I do so with the greatest pleasure; but I cannot help thinking that he makes a mistake. The books with which he has already supplied English Officers, to assist their knowledge of French, are so valuable that I cannot think that anything that I can say will add to the interest with which all those who desire to be intimately acquainted with the accurate rendering of French and English military terms from one language into the other will receive this new book. Tke Dictionary of Difficulties met witlt in French, in particular, supplied a want which no ordinary French dictionary or other work had met. The present list of corresponding terms is much more than a mere translation from one language into another. It required for its composition that the man who wrote it should not only be thoroughly acquainted with both languages, but that he should know well the regulations and organisations of both Armies. In many cases it is quite as necessary not to attempt a transla tion, but to show that there is no equivalent in the one Army for a term used in the other. -

Editor Associate Editors
VOLUME 27 / NUMBER 2B / 1985 Published by THE AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE Editor MINZE STUIVER Associate Editors To serve until January 1, 1989 STEPHEN C PORTER Seattle, Washington To serve until January 1, 1986 W G MOOK Groningen, The Netherlands HANS OESCHGER Bern, Switzerland To serve until January 1, 1987 RONALD B DAVIS Orono, Maine To serve until January 1, 1990 ANDREW MOORE Managing Editor RENEE S KRA Kline Geology Laboratory Yale University New Haven, Connecticut 06511 ISSN: 0033-8222 TWELFTH INTERNATIONAL RADIOCARBON CONFERENCE June 24-28, 1985 Trondheim, Norway The Twelfth International Radiocarbon Conference will be held from June 24 to 28, 1985 at the Norwegian Institute of Tech- nology, Trondheim, Norway. PROGRAM Natural 14C variations: time-scale calibrations climatic change cosmic ray flux The carbon cycle: anthropogenic 14C variations CO2 and other tracers Advances in dating techniques and overlapping dating methods Advances and applications in accelerator mass spectrome- try 14C in archaeology and natural sciences 14C data bases PAPERS Acceptance of papers will be based on extended summaries of approximately 200 words. Papers may be submitted for oral presentation or poster sessions. Papers will be selected for publication in a special proceedings issue of RADIOCAR- BON. For further information, write: The 12th International Radiocarbon Conference Attn: Pat Ueland Studies and Academic Administration The Norwegian Institute of Technology N-7034 Trondheim-NTH, Norway NOTICE TO READERS AND CONTRIBUTORS Since its inception, the basic purpose of Radiocarbon has been the publication of com- pilations of 14C dates produced by various laboratories. These lists are extremely useful for the dissemination of basic 14C information. -

Ofportuguese History Table of Contents Volume 14, Number 2, December 2016
Vol. 14 · n.º 2 · December 2016 e-journal ofPortuguese History Table of Contents Volume 14, number 2, December 2016 [ARTICLES] Procurators, Religious Orders and Cultural Circulation .......................................................................... 1 in the Early Modern Portuguese Empire: Printed Works, Images (and Relics) from Japan in António Cardim’s Journey to Rome (1644-1646) Federico Palomo Satirical Poetry and Religious Criticism in Portugal in the Late Eighteenth Century ................. 33 Rossana Agostinho Nunes Tradition and Modernity in Portuguese Liberal Political Culture ....................................................... 51 —On the Topic of the Constitution Sérgio Campos Matos Local Responses to a Global Invasive Species. ......................................................................................... 72 Varying Reasons for Controlling the Argentine Ant in the Madeira Archipelago (1850-2014) Ana Isabel Queiroz & Daniel Alves [SURVEYS & DEBATES] Two South Africans in the Portuguese Wars of Decolonization (1961-1975): .................................. 93 It Could Have Been Better, It Could Have Been Worse Bruno Cardoso Reis [BOOK REVIEWS] Marques, André Evangelista. Da Representação Documental à Materialidade do Espaço. ..... 104 Território da Diocese de Braga (séculos IX-XI) Santa Maria da Feira: Edições Afrontamento/CITCEM, 2014 ISBN: 978-972-36-1389-6 Maria João Branco Bethencourt, Francisco (ed.). Utopia in Portugal, Brazil and Lusophone African Countries .... 108 Bern: Peter Lang, 2015 ISBN: 978-3-0343-1871-6 Malyn Newitt Meneses, Filipe Ribeiro de. A Grande Guerra de Afonso Costa. ........................................................ 111 Alfragide: Dom Quixote, 2015 ISBN: 978-972-20-5877-3 David Castaño Martín Marcos, D.; Iñurritegui, J. M.; Cardim, P. (eds.). Repensar a Identidade: ....................... 115 O Mundo Ibérico nas Margens da Crise da Consciência Europeia Lisbon: CHAM, 2015 ISBN: 978-989-8492-28-9 Alexander Ponsen Feitler, Bruno. -
Expertise Effects: Literary Performance and Professionalization in the Age of Barnum
EXPERTISE EFFECTS: LITERARY PERFORMANCE AND PROFESSIONALIZATION IN THE AGE OF BARNUM By Doug Tye A dissertation submitted to the Johns Hopkins University in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Baltimore, Maryland February 2016 © 2016 Douglas Allen Tye All rights reserved. ABSTRACT This dissertation explores a set of antebellum authors’ ambivalent responses to the increasing specialization of intellectual labor, and the corresponding proliferation of professions and vocations, in the context of the ongoing market revolution. In chapters on Edgar Allan Poe, Herman Melville, and Martin Delany, I show how these writers engaged with, and critiqued, the intensifying specialization incubated by a splintering scientific discourse that militated against the new nation’s relative flattened social hierarchy. This crucial but gradual development in the antebellum division of labor – wherein the principle organizing social inequality shifted from the top-down model of mercantilism, to a liberal-individual market of entrepreneurs and aspirants – fostered, in knowledge-workers of all sorts, an imperative to appear institutionally legitimate in the eyes of the lay-public. The cultivation of this professional legitimacy depended on the creation of a perceived public need, and thereby a public market, for the specialist’s privileged information about some segment of reality that could be manipulated for the benefit of the non-professional, but not by the non-professional. As all three writers liked to point out, individual confidence (or gullibility) and tacit public consensus were all that distinguished legitimate experts from humbugs and hucksters. As a qualified rejection and partial appropriation of professional ideology, I argue, Poe, Melville, and Delany endeavored to generate what I call “expertise effects,” following Roland Barthes’s concept of the “reality effect,” those descriptive superfluities in French realist novels that create the illusion of reference, of connection to the real. -

Seasonal Roads Lynn K
Northern Michigan University NMU Commons All NMU Master's Theses Student Works 8-2014 Seasonal Roads Lynn K. Fay Northern Michigan University, [email protected] Follow this and additional works at: https://commons.nmu.edu/theses Part of the Fiction Commons Recommended Citation Fay, Lynn K., "Seasonal Roads" (2014). All NMU Master's Theses. 34. https://commons.nmu.edu/theses/34 This Open Access is brought to you for free and open access by the Student Works at NMU Commons. It has been accepted for inclusion in All NMU Master's Theses by an authorized administrator of NMU Commons. For more information, please contact [email protected],[email protected]. SEASONAL ROADS By Lynn Kimball Fay THESIS Submitted To Northern Michigan University In partial fulfillment of the Requirements For the degree Of MASTER OF FINE ARTS Office of Graduate Education and Research 2014 SIGNATURE APPROVAL FORM Title of Thesis: Seasonal Roads This thesis by Lynn Kimball Fay is recommended for approval by the student’s Thesis Committee and Department Head in the Department of English and by the Assistant Provost of Graduate Education and Research. Committee Chair: Associate Professor Jennifer A. Howard Date First Reader: Professor John Smolens Date Second Reader: Assistant Professor Matthew Bell Date Department Head: Dr. Ray Ventre Date Dr. Brian D. Cherry Date Assistant Provost of Graduate Education and Research ABSTRACT SEASONAL ROADS By Lynn Kimball Fay (L. E. Kimball) Lynn Kimball Fay has been publishing for twenty-five years under the pen-name L. E. Kimball. As a writer, I’m interested in the way Truth seems to me—intuitively—nonlinea.