Charles Journet Et Vatican II
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Mariology of Cardinal Journet
Marian Studies Volume 54 The Marian Dimension of Christian Article 5 Spirituality, III. The 19th and 20th Centuries 2003 The aM riology of Cardinal Journet (1891-1975) and its Influence on Some Marian Magisterial Statements Thomas Buffer Follow this and additional works at: https://ecommons.udayton.edu/marian_studies Part of the Religion Commons Recommended Citation Buffer, Thomas (2003) "The aM riology of Cardinal Journet (1891-1975) and its Influence on Some Marian Magisterial Statements," Marian Studies: Vol. 54, Article 5. Available at: https://ecommons.udayton.edu/marian_studies/vol54/iss1/5 This Article is brought to you for free and open access by the Marian Library Publications at eCommons. It has been accepted for inclusion in Marian Studies by an authorized editor of eCommons. For more information, please contact [email protected], [email protected]. Buffer: Mariology of Cardinal Journet THE MARIOLOGY OF CARDINALJOURNET (1891-1975) AND ITS INFLUENCE ON SOME MARIAN MAGISTERIAL STATEMENTS Thomas Buffer, S.T.D. * Charles Journet was born in 1891, just outside of Geneva. He died in 1975, having taught ftfty-six years at the Grande Seminaire in Fribourg. During that time he co-founded the journal Nova et Vetera, 1 became a personal friend of Jacques Maritain, 2 and gained fame as a theologian of the Church. In 1965, in recognition of his theological achievements, Pope Paul VI named him cardinal.3 As a theologian of the Church, Journet is best known for his monumental L'Eglise du Verbe Incarne (The Church of the Word Incarnate; hereafter EVI), 4 which Congar called the most profound ecclesiological work of the first half of the twentieth •Father Thomas Buffer is a member of the faculty of the Pontifical College ]osephinum (7625 N. -

Chronique Fribourgeoise 1996
1 CHRONIQUE FRIBOURGEOISE 1996 Elaborée par un groupe de travail de la SOCIETE D’HISTOIRE DU CANTON DE FRIBOURG Publiée par LA BIBLIOTHEQUE CANTONALE ET UNIVERSITAIRE FRIBOURG DIE KANTONS- UND UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK FREIBURG Rédacteur responsable : Marius Michaud Edition électronique: 2008 Plan des chapitres et rédacteurs de la Chronique fribourgeoise 1996 Chapitres Rédacteurs I. Faits divers marquants Michel Charrière II. Politique – Justice Marius Michaud et Cédric Krattinger III. Economie Christophe Schaller IV. Vie sociale - Santé publique Anne Philipona V. Vie religieuse Frédéric Yerly VI. Enseignement François Genoud VII. Culture Jean Dubas VIII. Sports Jean-Pierre Uldry Nécrologies Sigles des journaux Evangile et Mission EM Freiburger Nachrichten FN Fribourg Illustré FI Feuille officielle FO La Gruyère G La Liberté L Der Murtenbieter M L’Objectif O Le Républicain R © Bibliothèque cantonale et universitaire – Fribourg, 2008 Notice introductive La Chronique fribourgeoise recense les principaux événements de l’actualité fribourgeoise sous toutes ses formes : politique, économique, sociale et culturelle. Vu le foisonnement des événements à retenir, elle est inévitablement sélective et non exhaustive. Les lecteurs sont donc invités à se reporter aussi à d’autres sources imprimées telles la Freiburger Chronik (1) ou encore la Bibliographie fribourgeoise (2). Les journaux fribourgeois constituent la source par excellence de la Chronique fribourgeoise, le choix d’un journal de référence n’excluant pas pour autant les autres journaux (3). Afin de faciliter la répartition de la matière entre les chroniqueurs et aussi dans le but d’introduire un élément de lisibilité dans la masse des événements, nous avons renoncé à une seule chronologie au profit de huit chapitres thématiques : Faits divers marquants, Politique-Justice, Economie, Vie sociale-Santé publique, Vie religieuse, Enseignement, Vie culturelle, Sports. -
Carter Backs Court's Medicaid Abortion Ruling
^VOICE VOL. XIX No. 18 PRICE 25c JULY 15, 1977 Two boys enjoy the gifts of nature on a warm summer day, too young to will we remember in time that we are truly stewards of this beautiful be concerned about a world where hay, grass, and trees may be in earth?" This question is asked by Alma Roberts Giordan in this week's danger. "Will man destroy this beautiful earth with his technology? Or Know Your Faith exploration of the theology of ecology. Pages 11-14. INSIDE Carter backs court's ABP. LEFEBVRE'S traditionalist movement still in conflict with Rome, criticized by Cdl. Medeiros. Page 8. Medicaid abortion ruling POLISH LEADER in the American Revolution...the 200th anniversary of his arrival WASHINGTON-(NC)- opportunities exactly equal, prevent unwanted pregnancies in America is celebrated by Polish-Americans of President Jimmy Carter particularly when there is a with education and with the which there are 80,000 in Florida. Page 15. concedes it is "not fair" that moral factor involved." availability of contraceptives rich women can have abortions "I know, as well as anyone and other devices when they while many poor women will be in the country, having faced believe in their use as an denied Medicaid abortions. this issue during a long alternative to abortion." MIAMIAN as envoy to Vatican opposed by But he said he still believes campaign, about the intense The Carter Administration Protestant group. Page 3. the states and the federal feelings on both sides of the also has offered a plan to make government should not be abortion issue," Carter said. -
ATHOLIC Circulation PITTSBURGH M M
O479B0O Pennsylvania's DUQUESNE UNIVERSITY largest weekly LIBRARIAN „ t o c f t S LOCUST & COLBERT STRE ^ ATHOLIC circulation PITTSBURGH m m 140th Year, c x l No. 15 15 cents Established in 1844: America’s Oldest Catholic Newspaper in Continuous Publication Friday, June 22, 1984 In s id e Diocesan post to aid homeless established Fr. James W. Garvey, parochial is vital that we do all we can to help poor economic conditions in this residents lor nearly live years. vicar of St. Ursula parish in the homeless and assist those who area," Msgr. McCarren said. The establishment ol the Allison Park, has been appointed do not have adequate shelter." Fr. Garvey, 46, is a McKees diocesan coordinator for the to the newly established position A June 15 statement said that Rocks native and attended St. homeless is one of many services of diocesan coordinator for the Bishop Bevilacqua established the Francis DeSales Elementary and provided by the diocese to serve homeless. Bishop Bevilacqua position in response to the High Schools there. He graduated those in need. Through Catholic announced the appointment increased media attention given Fr. James W. from the University of Pittsburgh, Charities, under the bishop's effective immediately. the homeless shortly after his Garvey magna cum laude, and belorc leadership, monies Iront the According to Msgr. John coming to Pittsburgh in entering St. Francis Seminary in Federal Emergency Management McCarren, executive director ol December, 1983. Further evidence Loretto, Pa., in 1972, he was Administration are distributed to the Department for Social and of their plight was demonstrated coordinator of the Allegheny agency offices in Allegheny, Community Development of the through studies conducted by County Anti-Poverty Program in Butler, Beaver and Washington Diocese of Pittsburgh, Fr. -

1011 – 2011 Mille Ans – Mille Questions – Mille Et Une Réponses
NEUCHÂTELJEAN-PIERRE JELMINI 1011 – 2011 MILLE ANS – MILLE QUESTIONS – MILLE ET UNE RÉPONSES NEUCHÂTELJEAN-PIERRE JELMINI 1011 – 2011 MILLE ANS – MILLE QUESTIONS – MILLE ET UNE RÉPONSES VILLE DE NEUCHÂTEL EDITIONS ATTINGER – HAUTERIVE L’illustration de la couverture a été réalisée par Catherine Gfeller © Pro Litteris © 2010, Editions Attinger SA – Hauterive (NE), Suisse Ville de Neuchâtel – Suisse ISBN 978-2-940418-17-6 Droits de reproduction pour le texte et pour l’illustration strictement réservés. Cet ouvrage ne peut être reproduit, même partiellement, sous quelque forme que ce soit (photo- copie, microfilm, Internet ou autre type de numérisation) sans l’autorisation écrite expresse de l’auteur et de l’éditeur. Entièrement produit en Suisse PRÉFACE En cette année 2011, à l’heure où nous nous symbolique la première pierre de la construc- apprêtons à célébrer tous ensemble les mille ans tion du deuxième millénaire de Neuchâtel. de la ville de Neuchâtel, le Conseil communal Nous déclarons vouloir faire de notre mieux en exercice tient à exprimer tout le plaisir et la pour construire la ville de demain et jeter les fierté qu’il ressent à présider aux destinées fondements de son développement durable. d’une cité riche d’un passé millénaire. A l’image Elu pour la deuxième fois dans l’histoire de de Rodolphe III de Bourgogne, qui a offert la République et Canton de Neuchâtel direc- le 24 avril 1011 cette terre entre lac et forêt tement par le peuple, le Conseil communal à son épouse Irmengarde comme gage de son affirme, au moment d’entrer dans le deuxième amour, nous déclarons notre flamme à notre millénaire de notre cité, sa pleine confiance en ville, en notre nom et en celui des quelque l’avenir. -

ARCHBISHOP” LEFEBVRE’S SATAN-INSPIRED, “TRADITIONALIST” IMPOSTURE by the DETECTION of the INVALIDITY of HIS OWN ORDERS No
LEFEBVRE The Final Unmasking Hugo Maria Kellner [We received this article recently. Mr. Kellner, a former seminarian from Austria, died years ago, so he can’t object to the large cuts, which little concerned the main argument. We received none of the exhibits to which he refers, but he quoted some of them in his own text. He sometimes expresses wonder at the lack of effective confrontations between Lefebvre and Montini. We can conclude that he had not realized that they were on the same side; they both sought the death of the Catholic Church. All their battles were sham.] THE FINAL UNMASKING OF “ARCHBISHOP” LEFEBVRE’S SATAN-INSPIRED, “TRADITIONALIST” IMPOSTURE BY THE DETECTION OF THE INVALIDITY OF HIS OWN ORDERS No. 72, issued July 1977 By Hugo Maria Kellner As I have proved in my article No. 70 of January 15, 1976, the apostasy of the almost complete Catholic Church “organization from true God-centeredness and God-centered morality following Vatican II was the concluding stage of the apostasy of mankind. This apostasy started on a worldwide basis with the Protestant “Reformation” in the sixteenth century and will end according to the prophecies of Holy Scripture, with the annihilation of mankind.. This annihilation is already ominously heralded by the nuclear weapons which are stocked by the military superpowers in quantities sufficient to destroy mankind hundreds of times at any time. Chapter 11 of the Apocalypse is of particular interest in our days, because it indicates that, after the apostasy of the overwhelming part of the Catholic Church in the aftermath of Vatican II, Christ’s Church will be revived. -
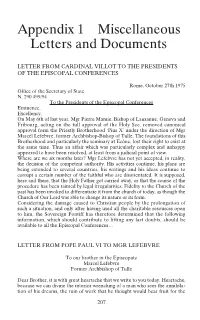
Appendix 1 Miscellaneous Letters and Documents
Appendix 1 Miscellaneous Letters and Documents LETTER FROM CARDINAL VILLOT TO THE PRESIDENTS OF THE EPISCOPAL CONFERENCES Rome, October 27th 1975 Office of the Secretary of State N. 290 499/94 To the Presidents of the Episcopal Conferences Eminence, Excellency, On May 6th of last year, Mgr Pierre Mamie, Bishop of Lausanne, Geneva and Fribourg, acting on the full approval of the Holy See, removed canonical approval form the Priestly Brotherhood ‘Pius X’ under the direction of Mgr Marcel Lefebvre, former Archbishop-Bishop of Tulle. The foundations of this Brotherhood and particularly the seminary at Ecône, lost their right to exist at the same time. Thus an affair which was particularly complex and unhappy appeared to have been resolved, at least from a judicial point of view. Where are we six months later? Mgr Lefebvre has not yet accepted, in reality, the decision of the competent authority. His activities continue, his plans are being extended to several countries, his writings and his ideas continue to corrupt a certain number of the faithful who are disorientated. It is supposed, here and there, that the Holy Father got carried away, or that the course of the procedure has been tainted by legal irregularities. Fidelity to the Church of the past has been invoked to differentiate it from the church of today, as though the Church of Our Lord was able to change its nature or its form. Considering the damage caused to Christian people by the prolongation of such a situation, and only after having used all the charitable resources open to him, the Sovereign Pontiff has therefore determined that the following information, which should contribute to lifting any last doubts, should be available to all the Episcopal Conferences… LETTER FROM POPE PAUL VI TO MGR LEFEBVRE To our brother in the Episcopate Marcel Lefebvre Former Archbishop of Tulle Dear Brother, it is with great heartache that we write to you today. -

Arriving at the Juridic Status of the Priestly Fraternity of Saint Pius X By
Arriving at the Juridic Status of the Priestly Fraternity of Saint Pius X by Fr. John G. LESSARD-THIBODEAU Research Seminar – DCA 6395 Prof. Chad GLENDINNING Faculty of Canon Law Saint Paul University Ottawa 2018 © John Lessard-Thibodeau_ 2018 CONTENTS Abbreviations 3 General Introduction 5 Chapter 1: Findings of Facts 6 1.1 Development of the SSPX 6 1.1.1 Founding and Expansion 6 1.1.2 Suppression 8 1.2 Suspensio a divinis of Mgr. Lefebvre 10 1.3 Resolution and Denunciation 12 1.4 Excommunication and Remission 16 Chapter 2: The Law 19 2.1 Communio 19 2.1.1 Plene in communio 20 2.1.2 Communio imperfecta: Non-Catholic Christian Churches and Ecclesial Communities 25 2.2 Specific Juridic Acts 26 2.2.1 Suppression of a Religious Institute 26 2.2.2 Schism, Suspensio a divinis and Related Penalties 27 2.2.3 Episcopal Consecrations, Excommunication and Remission 31 Chapter 3: Conclusions of Law 33 3.1 Specific Juridic Acts 33 3.1.1 Suppression of the SSPX 33 3.1.2 Suspensio a divinis and Related Penalties 36 3.1.3 Excommunication 38 3.2 Condition of the SSPX 40 3.2.1 The SSPX as a Church sui iuris or Particular Church 40 3.2.2 The SSPX as a non-Catholic Christian Church or Ecclesial Community 41 General Conclusion 43 Bibliography 46 2 ABBREVIATIONS AAS Acta Apostolicae Sedis, Rome, 1909- Abbott ABBOTT, W., (gen. ed.), The Documents of Vatican II, 1966. c. or cc. A canon or canons of the 1983 Code of Canon Law: Codex iuris canonici, auctoritate Ioannis Pauli PP. -

I Nostri Ragazzi Crescono!
Missione Cattolica Italiana · rue Orient-Ville 16 · 1005 Lausanne Missione Cattolica Italiana · rue Orient-Ville JAB 1000 Lausanne 1 45o anno · No 3 · Maggio-Giugno 2008 Periodico della Missione Cattolica Italiana di Losanna “I nostri ragazzi crescono!” “Testimoni del nostro tempo” Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari o Opera di Maria, MISSIONE CATTOLICA è deceduta serenamente all’età di 88 anni, nella notte del 14 marzo, ITALIANA nella sua residenza Mariapoli di Rocca di Papa vicino a Roma. Pioniera Sede centrale: della carità, ha lavorato senza sosta per lo sviluppo del Movimento Rue Orient-Ville 16 ricevendo visite di parenti, amici e personalità. CH-1005 Lausanne Nata il 22 gennaio nel 1920 a Trento, battezzata con il nome di Silvia, Tel. 021 351 22 90 il 7 dicembre 1943 emette i voti privati e prende il nome di Chiara. Nel Fax 021 351 22 91 1964 fonda la cittadella di Loppiano, Firenze: fu la prima di una lunga Ccp 10-10240-8 serie. Grande figura di spiritualità del nostro tempo, in tutta la sua vita ha MISSIONARI lavorato per “allargare” le frontiere dell’Unità dei cristiani e della famiglia uma- Don Luigi Agazzi na, impegnandosi in numerose attività civili, politiche e religiose. Il suo funerale si Don Lorenzo Flori è svolto a Roma nella Basilica di San Paolo fuori le mura presieduto dal cardinale SEGRETARIATO LOSANNA Tarcisio Bertone. Siamo convinti che dal Paradiso continuerà questa sua vocazione Giorgio Lecci, per il bene della Chiesa e di ogni uomo e donna che cerca la verità ... tel. 021 351 22 90 Aperto da lunedì a venerdì 9.00-12.00 / 14.30-18.00 Monsignor Paulos Faraj Rahho, Arcivescovo Cattolico Caldeo di Mo- soul in Iraq rapito da un commando di uomini sconosciuti il 29 feb- SEGRETARIATO RENENS Rosa Tomaselli Carbonara braio - che uccisero in quel momento altre tre persone - nonostante i Av. -

CCJR ANNUAL MEETING PROCEEDING Eschatology and The
Studies in Christian-Jewish Relations CCJR ANNUAL MEETING PROCEEDING Eschatology and the Ideology of Anti-Judaism John Connelly, University of California at Berkeley This talk grows out of a lengthy study about the path the Catholic Church took to undo the ideology of anti- Judaism.1 At its heart are a small group of Catholic intellectu- als, mostly converts, who pushed forward this change, beginning in the 1930s and extending to the Second Vatican Council, which concluded in 1965. Ideology is a coordinated system of ideas that acts to shape as well as limit thought. People adhere to ideology with- out full awareness of its elements and their interrelation.2 Ideology can develop power beyond their conscious control. I will have more to say about its precise contours below, but an- ti-Judaism featured a central assumption that Jews had lost touch with God and were destined to suffer a history of pun- ishment until, at the end of time, they finally turned to Christ, the “Jewish Messiah.” I am not saying that all Christians con- sciously assented to these ideas; from the little research that has been done on Catholic anti-Judaism across borders, it would seem to have varied from region to region. The idea that Jews had “killed God,” for instance appears to have been much stronger in East Central Europe in the interwar period than it was in North America. Still, as exemplified by the anti- racist Jesuit John LaFarge, when Catholics did turn their mind to the “Jewish question” in the 1930s, anti-Judaism is what 1 John Connelly, From Enemy to Brother: The Revolution in Catholic Teaching on the Jews (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2012), 2 For general guidance on the subject, see Terry Eagleton, Ideology: An Introduction (London: Verson, 1991). -

Charles Journet: Un Prêtre Intellectuel Dans La Suisse Romande De L'entre
Jacques Rime Charles Journet : un prêtre intellectuel dans la Suisse romande de l’entre-deux-guerres Thèse présentée à la Faculté de théologie de l’Université de Fribourg (Suisse) pour obtenir le grade de docteur - 2 - Approuvé par la Faculté de théologie sur la proposition des Professeurs Guy Bedouelle (premier rapporteur) et Philippe Chenaux, Rome (deuxième rapporteur). Fribourg, le 6 décembre 2005. Prof. Barbara Hallensleben, doyenne. - 3 - SIGLES ET ABREVIATIONS AEvF Archives de l’Evêché de Fribourg A.F. Action française ALS Archives littéraires suisses (à la Bibliothèque nationale, Berne) A.P.P. Amis de la pensée protestante AVic Archives du Vicariat général de Genève BCU Bibliothèque cantonale et universitaire (Fribourg) CG Courrier de Genève CIC 1917 Codex juris canonici (Code de droit canonique, promulgué en 1917) CJM I, II, III, IV, V Correspondance Journet – Maritain (5 volumes publiés) Colloque de Genève (1991) Philippe CHENAUX (éd.), Charles Journet (1891-1975), un théologien en son siècle, actes du colloque de Genève (1991), Editions universitaires – Editions MAME, Fribourg – Paris, 1992 cop. copie(s) d(d) double(s) EVI L’Eglise du Verbe incarné FCJ Fondation du Cardinal Journet (Villars-sur-Glâne) Hg. Herausgeber (éditeur) intr. introduction n.s. nouvelle série NV Nova et vetera OC Œuvres complètes de Jacques et Raïssa Maritain (16 vol. publiés) ph photocopie SC La Semaine catholique de la Suisse française Semaine théologique de Fribourg (2002) Marta ROSSIGNOTTI JAEGGI – Guy BOISSARD (éd.), Charles Journet, un témoin du XXe siècle, actes de la semaine théologique de l’Université de Fribourg, 8-12 avril 2002, Parole et Silence, Paris – Les Plans, 2003 Lorsque les études ont plus de trois auteurs, ces derniers ne sont généralement pas mentionnés. -

Bibliothèque Cantonale Et Universitaire Fribourg Kantons- Und Universitätsbibliothek Freiburg
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by RERO DOC Digital Library Bibliothèque cantonale et universitaire Fribourg Kantons- und Universitätsbibliothek Freiburg FONDS LÉON BARBEY (1905-1992) Inventaire dressé par Joseph Leisibach 2e édition revue et corrigée Fribourg Bibliothèque cantonale et universitaire 2015 2 Table des matières Introduction ....................................................................................................................................... 5 A) Monographies et collaborations ................................................................................................ 11 B) Articles de revues scientifiques et journaux isolés ................................................................... 21 C) Contributions à la presse ............................................................................................................ 41 D) Traductions ................................................................................................................................ 54 E) Comptes rendus .......................................................................................................................... 58 F) Conférences ................................................................................................................................ 86 G) Sermons et retraites, activités pastorales, allocutions ............................................................. 104 H) Dossiers de travail et de documentation.................................................................................