PROGRAMME RELATIF AU CRIQUET PÈLERIN Noagp/DL/TS/ 31
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Rapport D'evaluation
RAPPORT D’EVALUATION Projet « Assurer l’accès aux services adéquats en eau potable, hygiène et assainissement dans la Moughataa de Koubenni, Hodh el Gharbi » (2014-2018) Rapport Final OCTOBRE 2018 Marie Claire Durand – Consultante Indépendante En collaboration avec L’équipe du Bureau d’études SISTA Evaluation du projet WASH à Koubenni TABLE DES MATIERES 1 Résumé Exécutif ........................................................................................................................................... 9 2 Introduction ................................................................................................................................................ 16 2.1 Contexte ............................................................................................................................................. 16 2.2 Justification de l’action ..................................................................................................................... 18 3 Description du projet – Objet de l’évaluation ....................................................................................... 19 3.1 Objectifs du projet ............................................................................................................................. 19 3.2 Logique d’intervention du projet ................................................................................................... 21 3.2.1 Lien avec le cadre conceptuel des causes de la malnutrition ........................................... 21 3.2.2 Lien avec le cadre d’amélioration -
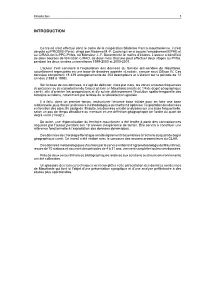
Introduction 1
Introduction 1 INTRODUCTION Ce travail s'est effectué dans le cadre de la coopération bilatérale franco-mauritanienne, il s'est déroulé au PRODIG (Paris), dirigé par Madame M.-F. Courel qui en a assure l’encadrement EPHE et au CIRAD-Amis-PPC-Prifas, où Monsieur J.-F. Duranton fut le maître d’études. L’auteur a bénéficié de deux bourses de formation CIRAD, de deux mois chacune pour effectuer deux stages au Prifas, pendant les deux années universitaires 1999-2000 et 2000-2001. L’auteur s'est consacré à l’exploitation des données du Service anti-acridien de Mauritanie, actuellement regroupées en une base de données appelée «Locdat», conçue sous DBase IV. Ces données comportent 18 429 enregistrements de 253 descripteurs et s’étalent sur la période de 12 années (1988 à 1999). Sur la base de ces données, il s’agit de délimiter, mois par mois, les zones à hautes fréquences de présence ou de reproduction du Criquet pèlerin en Mauritanie (maille de 1/4 de degré géographique carré), afin d’orienter les prospections et d'y suivre ultérieurement l'évolution spatio-temporelle des biotopes acridiens, notamment par le biais de la télédétection spatiale. Il a fallu, dans un premier temps, restructurer l’énorme base initiale pour en faire une base relationnelle, puis choisir un itinéraire méthodologique permettant d’optimiser l’exploitation des données en fonction des objectifs assignés. Ensuite, les données ont été analysées sur une base fréquentielle, selon un pas de temps décadaire ou mensuel et une définition géographique de l’ordre du quart de degré carré (1/4dg²). -

2. Arrêté N°R2089/06/MIPT/DGCL/ Du 24 Août 2006 Fixant Le Nombre De Conseillers Au Niveau De Chaque Commune
2. Arrêté n°R2089/06/MIPT/DGCL/ du 24 août 2006 fixant le nombre de conseillers au niveau de chaque commune Article Premier: Le nombre de conseillers municipaux des deux cent seize (216) Communes de Mauritanie est fixé conformément aux indications du tableau en annexe. Article 2 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles relatives à l’arrêté n° 1011 du 06 Septembre 1990 fixant le nombre des conseillers des communes. Article 3 : Les Walis et les Hakems sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel. Annexe N° dénomination nombre de conseillers H.Chargui 101 Nema 10101 Nema 19 10102 Achemim 15 10103 Jreif 15 10104 Bangou 17 10105 Hassi Atile 17 10106 Oum Avnadech 19 10107 Mabrouk 15 10108 Beribavat 15 10109 Noual 11 10110 Agoueinit 17 102 Amourj 10201 Amourj 17 10202 Adel Bagrou 21 10203 Bougadoum 21 103 Bassiknou 10301 Bassiknou 17 10302 El Megve 17 10303 Fassala - Nere 19 10304 Dhar 17 104 Djigueni 10401 Djiguenni 19 10402 MBROUK 2 17 10403 Feireni 17 10404 Beneamane 15 10405 Aoueinat Zbel 17 10406 Ghlig Ehel Boye 15 Recueil des Textes 2017/DGCT avec l’appui de la Coopération française 81 10407 Ksar El Barka 17 105 Timbedra 10501 Timbedra 19 10502 Twil 19 10503 Koumbi Saleh 17 10504 Bousteila 19 10505 Hassi M'Hadi 19 106 Oualata 10601 Oualata 19 2 H.Gharbi 201 Aioun 20101 Aioun 19 20102 Oum Lahyadh 17 20103 Doueirare 17 20104 Ten Hemad 11 20105 N'saveni 17 20106 Beneamane 15 20107 Egjert 17 202 Tamchekett 20201 Tamchekett 11 20202 Radhi -

Receveur Domaines Recettes Minière2016
Liste des candidats définitivement acceptés pour le concours de recrutement de 20 unités pour le compte du Ministère de l’Agriculture selon les options suivantes : Ces candidats sont convoqués à l’ENI, le dimanche 10 juin à 08 heures, pour subir le concours 1. Option Agronomes Bac +4 N Date et lieu de اﻹﺳﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ Noms et Prénoms NNI / ﺗﺎ.م . اﻟﻤﯿﻼد Officiel naissance ﷴ ﻓﺎل ﻣﺤﻔﻮظ ﺧﺮاﺷﻲ Med Vall Mahfoudh Kharachi 31/12/1986 Boutilimit 3360613501 20 اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﯿﻌﻘﻮﺑﻲ Cheikh Abdelkader EL Yacoubi 31/12/1993 Teyarett 1942418890 63 ﷴ ﻣﺎدي ﻧﻔﻊ Mohamed Mady Nefaa 30/11/1980 Lybie 1513759012 66 اﻟﺴﺎﻟﻤﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ اطﻮﯾﻠﺐ Salma Taleb Toueileb 04/02/1991 T. Zeina 6063300833 70 ﺷﯿﺨﻨﺎ ﺳﯿﺪ اﻟﻤﺨﺘﺎر اﺳﺤﺎق CheikhnaSid’El Moctar Ishagh 08/10/1988 ElbAderess 4488698281 156 ﷴ اﻟﺤﺎﻓﻆ ﺳﯿﺪي Med EL HafedHafed Sidi 21/12/1988 Teyarett 5171845516 160 ﷴ ﺳﯿﺪي ﻓﺮج Mohamed Sidi Varaj 03/04/1991 Dar Naim 3088165915 177 ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎﻟﯿﺪو اﻧﻜﯿﺪ Abderrahmane Khalidou N’Gaide 28/11/1978 Sebkha 6461738518 221 ﯾﺴﻠﻢ اﻓﻜﻮ ﺣﻤﻮد YeslemIvekouHamoud 31/12/1985 Ouad Naga 3880350074 270 ﯾﺐ ﺑﺪﯾﻦ آﻣﯿﻦ YoubaBedine Amine 25/08/1984 à Tidjikja 4310763227 295 ﷴ ﺣﺴﻨﻲ ﺣﺴﻨﻲ Mohamed HacenyHaceny 31/12/1978à Aleg 9069315701 298 ﻣﺎدﯾﺎﻧﻲ آﻣﺎدو ﺳﻲ Madani amadou Sy 30/05/1980 au Ksar 7130547213 311 ام ﻛﻠﺜﻮم آﻻﺳﺎن ﺳﻲ Oumou Kelthoum AlassaneSy 27//05/1979 6380207981 365 ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻨﺎﺟﻲ ﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ Moustapha Naji Med Abderrahmane 15/12/1992 Boutilimit 3505931432 59 2. Option Ingénieurs Topographes/cartographes Bac +4 N Date et lieu de اﻹﺳﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ Noms et Prénoms NNI / ﺗﺎ.م . -

Biogeography and Phylogenetic Position of a Sahara-Sahel Mountain Endemic, Felovia Vae (Ctenodactylidae)
Biogeography and phylogenetic position of a Sahara-Sahel mountain endemic, Felovia vae (Ctenodactylidae) Fábio Alberto Vieira Sousa Mestrado em Biodiversidade, Genética e Evolução Departamento de Biologia 2015 Orientador Zbyszek Boratyński, Post-doc, University of Jyväskylä Coorientador José Carlos Brito, Senior Scientist, Assoc. Researcher, FCUP/CIBIO Todas as correções determinadas pelo júri, e só essas, foram efetuadas. O Presidente do Júri, Porto, ______/______/_________ FCUP i Biogeography and phylogenetic position of a Sahara-Sahel mountain endemic, Felovia vae (Ctenodactylidae) Agradecimentos Em primeiro lugar gostaria de agradecer aos meus orientadores, Zbyszek Boratyński e José Carlos Brito, por todo o apoio prestado durante este trabalho. Um especial obrigado á Teresa Silva pela sua enorme paciência e ajuda no laboratório. Um obrigado ao Duarte Gonçalves e Paulo Pereira pela disponibilidade e prontidão em ajudar. Um obrigado a todos os membros dos Biodeserts, pelo ambiente descontraido do grupo, que ajuda bastante a troca de conhecimento e que muito contribuiu para a minha aprendizagem. Mais uma de muitas metas alcançadas ao lado das minha grandes amigas Filipa e Sara. Venham as próximas! Não poderia faltar o agradecimento á minha familia por todo o seu apoio incondicional, bem como á Carolina pelos seus preciosos conselhos nos bons e maus momentos deste percurso. FCUP ii Biogeography and phylogenetic position of a Sahara-Sahel mountain endemic, Felovia vae (Ctenodactylidae) Resumo A região do Saara-Sael é composta de um mosaico de habitats, montanhas, rios sazonais, áreas rochosas e extensas dunas de areia, que em conjunto definem a distribuição das espécies e a sua estrutura genética. Estas variáveis foram intensamente moldadas pelas flutuações climáticas durante o Pleistoceno, sendo normalmente possível recuperar tal efeito nos padrãos genéticos das espécies. -

THÈSE De DOCTORAT
MINISTÈRE DE LA JEUNESSE, DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES Systèmes intégrés, environnement et biodiversité THÈSE de DOCTORAT présentée par Mohamed Abdallahi BABAH EBBE pour l’obtention du grade de Docteur de l’École Pratique des Hautes Études Biogéographie du Criquet pèlerin, Schistocerca gregaria Forskål, 1775 : identification, caractérisation et originalité d'un foyer grégarigène en Mauritanie centrale Soutenue le 7 novembre 2008 à Paris Devant le jury composé de : Pr Alexandre LATCHININSKY, Université du Wyoming Dr Jean-François VOISIN, Muséum National d’Histoire Naturelle Pr Jeffrey LOCKWOOD, Université du Wyoming Dr Annie MONARD, FAO Pr Marie-Françoise COUREL, École Pratique des Hautes Études Dr Jean-François DURANTON, CIRAD-Acridologie Thèse préparée à l’École Pratique des Hautes Études de Paris • Directeur de thèse : Marie-Françoise COUREL, Directeur d’Études, École Pratique des Hautes Études, 46 rue de Lille, 75007 Paris. • Co-directeur de thèse : Jean-François DURANTON, Écobotaniste-acridologue, CIRAD- Acridologie, TA A-50/D, 34398 Montpellier Cedex 5. MINISTÈRE DE LA JEUNESSE, DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES Systèmes intégrés, environnement et biodiversité THÈSE de DOCTORAT présentée par Mohamed Abdallahi BABAH EBBE pour l’obtention du grade de Docteur de l’École Pratique des Hautes Études Biogéographie du Criquet pèlerin, Schistocerca gregaria Forskål, 1775 : identification, caractérisation et originalité d'un foyer grégarigène en Mauritanie -

Rapport Général Et Financier 2015
Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation Direction Générale des Collectivités Territoriales Rapport général et financier 2016 sur l’utilisation des crédits d’équipement du Fonds Régional de Développement (FRD) 2015 Observatoire des Finances Locales Comité Technique National de suivi-évaluation du FRD RAPPORT GÉNÉRAL ET FINANCIER 2016 SUR L’UTILISATION DES CRÉDITS D’ÉQUIPEMENT DU FONDS RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT (FRD) EXERCICE 2015 SOMMAIRE Introduction Page 3 Bilan national Page 7 Constats et recommandations Page 23 Bilan communal – Tableaux de synthèse Page 27 2 INTRODUCTION Le rapport général et financier 2016 retrace principalement l’utilisation par les 218 communes mauritaniennes des crédits d’équipement du Fonds Régional de Développement (FRD) attribué au titre de l’exercice 2015, conformément au décret n°2011-059 du 14 février 2011 portant création du Fonds Régional de Développement (FRD). Institué en 1980, réorganisé en 1994, 2003 et en 2011 par le décret N° 2011-59 sus mentionné, le Fonds Régional de Développement a pour objectif de contribuer à renforcer les transferts financiers de l’État aux communes en vue d’améliorer les ressources mises à leur disposition et promouvoir l’accès de leurs populations à des services de base, en application de la Déclaration de politique de décentralisation et de développement adoptée par le Gouvernement le 22 avril 2010. Le décret du 14 février 2011 prévoit en outre la mise en place d’un Comité Technique National (CTN) de suivi-évaluation du FRD. Les arrêtés conjoints MIDEC/MF n°592 et 593 du 6 avril 2011 ont permis l’opérationnalisation de ce CTN au moyen d’un dispositif rendant compte de l’utilisation des crédits d’équipement FRD sur la base duquel est rédigé le rapport général et financier annuel présenté en Conseil des Ministres. -

I) Les Admis Au Session Des Examants De Permis De Conduire Dans La Wilaya Du Trarza Du 26/06 Au 07/07/2011
www.fr.alakhbar.info I) LES ADMIS AU SESSION DES EXAMANTS DE PERMIS DE CONDUIRE DANS LA WILAYA DU TRARZA DU 26/06 AU 07/07/2011 N° Noms et prénoms Date et lieu de naissance Catégorie Code Conduite G S 1 LIMAM MED LEMINE 1970 ATAR B APTE APTE O+ 3 ALIOUNE MBARECK 1991 R KIZ B APTE APTE O+ 4 SAMBA MAATALA 1982 SEBKHA B,C APTE APTE O+ 5 HAMAHOULLAH MOKHTAR 1979 ROSSO D APTE APTE O+ 6 ABDERRAHMANE DEHMANE 1985 BTT B APTE APTE O+ 7 MED LEHBIB TEHMANE 1987 BTT B APTE APTE O+ 8 MED LEMINE BOUYE 1968 TIMBEDRA B APTE APTE 9 AMAR MED 1971 MEDERDRA D APTE APTE 10 AMINATA HABI SOW 1977 NKTT B APTE APTE A+ 11 OUMAR KHALIDOU 1970 NKTT B APTE APTE 12 OUSMANE SAMBA 1978 DJEWEL D APTE APTE O+ 13 EL JEILANI SOUEILEM 1989 NKTT B APTE APTE 22 MED ABDEL GHADER SEDATT 1992 NKTT B APTE APTE O+ 23 KHADIJETOU BOUDE 1978 NDB B APTE APTE 24 FATIMETOU MED 1988 NKTT B APTE APTE 26 MED NAJI 1978 ALEG B,C APTE APTE A+ 27 BRAHIM MED 1971 ALEG B APTE APTE 30 HAMIDOU SAIDOU 1969 ROSSO D APTE APTE 33 HOUSSEIN AHMED 1990 ROSSO B APTE APTE O- 34 CHEIKH ABDELLAHI MED ABASS 1980 BTT B APTE APTE 35 AHMEDOU AHMED 1970 MEDERDRA D APTE APTE A+ 36 EL BEYA SID'AHMED 1980 ROSSO D APTE APTE 37 BAH MED 1987 ROSSO B APTE APTE 38 YACOUB MED 1975 ROSSO B APTE APTE 39 BRAHIM MALOUM 1969 MEDERDRA B APTE APTE A+ www.fr.alakhbar.info 41 EL HADI MED SALEM BIH IZID 1980 ROSSO D APTE APTE A+ 50 CHEIKH EBEVALL 1979 TZ B APTE APTE A+ 52 BERI EL GHASSOUM 1977 NKTT B APTE APTE 54 NOUMANE AHMED 1980 BOGHE B APTE APTE A+ 55 ABDELLAHI BABA ABDELLAHI 1968 AKJOUJT B APTE APTE 56 TEKBER SOUDANI 1989 NKTT -

Subject Index
Subject Index A Allochthons of Bou Agri Archaean 31-46, 107, 108, Azlaf Group 70 A-type granitoid 99 248 114, 116, 120, 148, 189, Azrou 236, 237 Abda/Sarihef Unit 242 Alpine 197, 199, 204, 205, 296, - foreland basin 258 Abolag 66 - allochthonous units 250 301, 371 Acado-Baltic affinities 342, - basement 245,267, - granite-greenstone terra- 8 361 307-313 ne 127, 142 Bab-Azhar Zone 248 Acari Granite 381, 382, - Rif 230 - greenstones 144 Back-arc 95,287,298,299, 386 Alps 299, 300 - proto lith 125 300 Accraian Series 109 A1tamaha-Brunswick - suture hypothesis 145, Badajoz-Cordoba shear Achaikar 66, 68, 73 magnetic anomaly 357 147 zone 270,272,274,276, Acritarch 165,269,270, Alto allochthon 334, 339, Arg Faults 244, 245 278, 279 281 346 Argillite 153,154,157, 159, Badiar Hill 163 Actinote 172 Amane Jssougri microrift 160, 161, 162, 166, 169, Bafata Group 165, 166 Adoudounian 231, 252 251 172 Bahamas fracture zone 357, Adrar 70, 189, 192, 193, Amasine Group 69 Armorica 268,312,353 362 194, 195, 196, 197,201, Amizmis fault zone 244, Armorican Bakel 187, 197 204 245 - Massif 295, 302 - area 197, 199,212 - des Jforas 108 Amour Unit 213 - Quartzite Formation 276, - quartzites 221 - Soutouf Range 199 Amphibolite 279 - series 184 Adrer-Guinea Line 18,20, - facies 107,108,114,172, Asbill Pond Formation 342, Bakoye Group 69 24 198, 199,203,206,208 350 Balkan 312 Adriatic microplate 307 - -gneiss association Assaba 194,195,200, Baltic affinities 342 Afacora schist belt 110, 112, 307-311 201 Baltimore terrane 334, 113,117 Anambra Basin 112 - Plateau 195,200 -

«Evaluation Finale »
Direction des Projets Education/Formation AGENCE ESPAGNOLE DE COOPERATION INTERNATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT «EVALUATION FINALE » DECEMBRE 2015 Ext NOT MOD K N° 96 (après le Ministère des Affaires Economiques et du Développement) Tél. : (222) 4529 00 2 9 - Fax : (222) 4529 85 40 BP : 4205 - Nouakchott - Mauritanie www.binorassocies.com - E-mail : [email protected]. « EVALUATION FINALE DU PROJET D’APPUI AU PNDSE » - RAPPORT PROVISOIRE TABLE DES MATIERES Table des illustrations ............................................................................................................. I Liste des abréviations, acronymes et sigles ............................................................................ II 1 Introduction : Portée et objectifs .....................................................................................1 2 PRESENTATION PADP ................................................................................................3 2.1 Objectifs ...................................................................................................................3 2.2 Composantes et activités ..........................................................................................3 2.3 Schéma de mise en œuvre .........................................................................................6 2.4 Financement .............................................................................................................7 3 Approche méthodologique ..............................................................................................8 -

J.O. 1440F DU 30..06.2019.Pdf
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE BIMENSUEL Paraissant les 15 et 30 de chaque mois 30 Juin 2019 61ème année N°1440 SOMMAIRE I– LOIS & ORDONNANCES 14 Juin 2019 Loi n° 2019-027 autorisant la ratification de la Convention n°143 sur les migrations dans des conditions abusives et sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants adoptée à la 60ème session de la Conférence Internationale du Travail (24 juin 1975)…………………….561 14 Juin 2019 Loi n° 2019-028 autorisant la ratification de la Convention n°144 concernant les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail adoptée à la 61ème session de la Conférence Internationale du Travail (21 juin 1976)……………………………… …...561 557 Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Juin 2019 1440 II- DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Actes Réglementaires 24 Mai 2019 Décret n°233-2019 abrogeant et remplaçant le décret n°623-2018 du 19 décembre 2018 portant organisation et fonctionnement de l’Inspection Générale d’Etat…………………………………………………..…..561 Actes Divers 11 Mars 2019 Décret n°2019-043 portant nomination des membres de la Commission pour la Transparence Financière de la Vie Publique…………….…..564 12 Mars 2019 Décret n°090-2019 portant attribution de la médaille de la valeur militaire à l’occasion du 28 Novembre 2018……………………..…565 Ministère de la Justice Actes Réglementaires 10 Avril 2019 Décret n° 2019-066 portant modification de certaines dispositions -

Rapport Général Et Financier 2016
Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation Direction Générale des Collectivités Territoriales Rapport général et financier sur l’utilisation du Fonds Régional de Développement (FRD) 2016 Observatoire des Finances Locales Comité Technique National de suivi-évaluation du FRD RAPPORT GÉNÉRAL ET FINANCIER SUR L’UTILISATION DU FONDS RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT (FRD) EXERCICE 2016 SOMMAIRE Introduction Page 3 Bilan national Page 6 Conclusion & Recommandations Page 26 Décret n°2011.59 du 14 février 2011 (version consolidée) Page 30 Bilan communal – Tableaux de synthèse Page 32 2 INTRODUCTION Institué en 1980, réorganisé en 1994, 2003 et par le décret N° 2011-59 du 14 février 2011, le Fonds Régional de Développement (FRD) connaît en 2016 de nouvelles dispositions quant à son mode de répartition figurant dans le décret n°2016-094 du 10 mai 2016, lesquelles modifient le précédent décret en ses articles 4, 6 et 10 et en abrogent l’article 5, et prévoient que : - Article 4 – nouveau : « Le FRD est réparti comme suit : 98% au profit des communes et 2% réservé au suivi-évaluation, au renforcement des capacités en matière de maitrise d’ouvrage et de gestion notamment, la réalisation des audits techniques et financiers annuels, les inspections des projets réalisés et les frais liés au fonctionnement du Comité Technique National (CTN). Les 98% au profit des communes se décomposent comme suit : 60% en dotation au fonctionnement et 40% en dotation à la maintenance et à l’entretien des infrastructures de base, entrant dans le cadre des compétences de la commune. » - Article 6 – nouveau : « La répartition des crédits du FRD est basée sur les critères suivants : (i) le facteur démographique à raison de 50% ; (ii) le taux de pauvreté à raison de 30% ; (iii) une part forfaitaire à raison de 20% est répartie de manière égale entre les communes afin d’assurer une juste péréquation.