Rapport D'evaluation
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Famine Early Warning Systems Network Mauritania
FAMINE EARLY WARNING SYSTEMS NETWORK MAURITANIA A USAID project managed by Chemonics International Inc. TEL: (222) 25 39 18 FAX: (222) 25 39 18 E-mail: [email protected] MONTHLY REPORT FOR APRIL 2002 RAPPORT MENSUEL DU MOIS D’AVRIL 2002 This report covers the period from March 28 to April 25, 2002 Summary FEWS NET/Mauritania conducted a fact-finding mission April 8-22 to gather information on food security conditions in crop and livestock-farming areas of the country. Available data on this year's grain harvests and on trends in conditions in livestock-raising areas point to a country- wide deterioration in food security. The local population and agricultural agencies in the regions visited by the mission agree that, on the whole, this year's grain harvests are down from last year, despite higher yields from certain types of crops and farming systems in specific grain-producing areas. Distribution of food aid is inadequate and, in general, the local population is finding it increasingly difficult to manage its food security with this year's lean period (soudure) beginning two months earlier than usual. There is a visible deterioration in the condition of natural vegetation and in grazing conditions around the country due to natural and man-made factors, depriving people of the basis of their strategy for coping with yearly grain deficits. Mass migration has intensified, particularly from Aftout and the southern portions of Hodh El Chargui and Hodh El Gharbi. The early migration of animal herds to Guidimakha and into Mali first noticed in March intensified during April, while vast tracts of grazing lands in Trarza and Brakna are unusually empty for this time of year. -

RAPPORT DE LA VERIFICATION COMMUNAUTAIRE T3 &T4 2019
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE Honneur-Fraternité-Justice MINISTERE DE LA SANTE UNITE NATIONALE DU FINANCEMENT BASE SUR LES RESULTATS RAPPORT DE LA VERIFICATION COMMUNAUTAIRE T3 &t4 2019 Avril 2020 Table des matières Sigles et abréviations ............................................................................................................................... 2 Introduction ............................................................................................................................................. 3 I. But, cadre, acteurs impliqués dans la vérification communautaire ............................................. 4 1.1 But de la vérification communautaire ..................................................................................... 4 1.2 Cadre de la vérification communautaire .................................................................................. 4 1.3 Les acteurs impliqués .............................................................................................................. 4 II. Phase préparatoire de la vérification communautaire .................................................................. 5 2.1 Elaboration du budget de la Vérification communautaire ................................................... 5 2.2 Amélioration du questionnaire de la vérification communautaire ...................................... 5 2.3 Amélioration du masque de saisie des données issues de l’enquête communautaire .......... 5 2.4 Mise à Jour des guides d’instructions ................................................................................ -

World Bank Document
Public Disclosure Authorized Rapport initial du projet Public Disclosure Authorized Amélioration de la Résilience des Communautés et de leur Sécurité Alimentaire face aux effets néfastes du Changement Climatique en Mauritanie Ministère de l’Environnement et du Développement Durable ID Projet 200609 Date de démarrage 15/08/2014 Public Disclosure Authorized Date de fin 14/08/2018 Budget total 7 803 605 USD (Fonds pour l’Adaptation) Modalité de mise en œuvre Entité Multilatérale (PAM) Public Disclosure Authorized Septembre 2014 Rapport initial du projet Table des matières Liste des figures ........................................................................................................................................... 2 Liste des tableaux ........................................................................................................................................ 2 Liste des acronymes ................................................................................................................................... 3 Résumé exécutif ........................................................................................................................................... 4 1. Introduction .......................................................................................................................................... 5 1.1. Historique du projet ......................................................................................................................... 6 1.2. Concept du montage du projet .................................................................................................. -
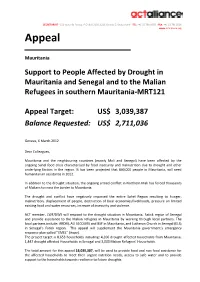
Text Begins Here
SECRETARIAT - 150 route de Ferney, P.O. Box 2100, 1211 Geneva 2, Switzerland - TEL: +41 22 791 6033 - FAX: +41 22 791 6506 www.actalliance.org Appeal Mauritania Support to People Affected by Drought in Mauritania and Senegal and to the Malian Refugees in southern Mauritania-MRT121 Appeal Target: US$ 3,039,387 Balance Requested: US$ 2,711,036 Geneva, 6 March 2012 Dear Colleagues, Mauritania and the neighbouring countries (mainly Mali and Senegal) have been affected by the ongoing Sahel food crisis characterised by food insecurity and malnutrition due to drought and other underlying factors in the region. It has been projected that 800,000 people in Mauritania, will need humanitarian assistance in 2012. In addition to the drought situation, the ongoing armed conflict in Northern Mali has forced thousands of Malians to cross the border to Mauritania. The drought and conflict have negatively impacted the entire Sahel Region resulting to hunger, malnutrition, displacement of people, destruction of local economies/livelihoods, pressure on limited existing food and water resources, increase of insecurity and violence. ACT member, LWF/DWS will respond to the drought situation in Mauritania, Fatick region of Senegal and provide assistance to the Malian refugees in Mauritania by working through local partners. The local partners include: ARDM, AU SECOURS and BSF in Mauritania, and Lutheran Church in Senegal (ELS) in Senegal’s Fatick region. This appeal will supplement the Mauritania government’s emergency response plan called ‘’EMEL’’ (hope). The project target is 8,653 households including: 4,206 drought affected households from Mauritania, 1,447 drought affected Households in Senegal and 3,000 Malian Refugees’ Households. -
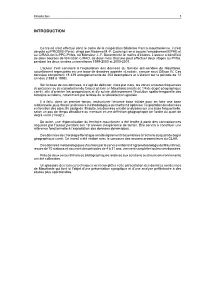
Introduction 1
Introduction 1 INTRODUCTION Ce travail s'est effectué dans le cadre de la coopération bilatérale franco-mauritanienne, il s'est déroulé au PRODIG (Paris), dirigé par Madame M.-F. Courel qui en a assure l’encadrement EPHE et au CIRAD-Amis-PPC-Prifas, où Monsieur J.-F. Duranton fut le maître d’études. L’auteur a bénéficié de deux bourses de formation CIRAD, de deux mois chacune pour effectuer deux stages au Prifas, pendant les deux années universitaires 1999-2000 et 2000-2001. L’auteur s'est consacré à l’exploitation des données du Service anti-acridien de Mauritanie, actuellement regroupées en une base de données appelée «Locdat», conçue sous DBase IV. Ces données comportent 18 429 enregistrements de 253 descripteurs et s’étalent sur la période de 12 années (1988 à 1999). Sur la base de ces données, il s’agit de délimiter, mois par mois, les zones à hautes fréquences de présence ou de reproduction du Criquet pèlerin en Mauritanie (maille de 1/4 de degré géographique carré), afin d’orienter les prospections et d'y suivre ultérieurement l'évolution spatio-temporelle des biotopes acridiens, notamment par le biais de la télédétection spatiale. Il a fallu, dans un premier temps, restructurer l’énorme base initiale pour en faire une base relationnelle, puis choisir un itinéraire méthodologique permettant d’optimiser l’exploitation des données en fonction des objectifs assignés. Ensuite, les données ont été analysées sur une base fréquentielle, selon un pas de temps décadaire ou mensuel et une définition géographique de l’ordre du quart de degré carré (1/4dg²). -

2. Arrêté N°R2089/06/MIPT/DGCL/ Du 24 Août 2006 Fixant Le Nombre De Conseillers Au Niveau De Chaque Commune
2. Arrêté n°R2089/06/MIPT/DGCL/ du 24 août 2006 fixant le nombre de conseillers au niveau de chaque commune Article Premier: Le nombre de conseillers municipaux des deux cent seize (216) Communes de Mauritanie est fixé conformément aux indications du tableau en annexe. Article 2 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles relatives à l’arrêté n° 1011 du 06 Septembre 1990 fixant le nombre des conseillers des communes. Article 3 : Les Walis et les Hakems sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel. Annexe N° dénomination nombre de conseillers H.Chargui 101 Nema 10101 Nema 19 10102 Achemim 15 10103 Jreif 15 10104 Bangou 17 10105 Hassi Atile 17 10106 Oum Avnadech 19 10107 Mabrouk 15 10108 Beribavat 15 10109 Noual 11 10110 Agoueinit 17 102 Amourj 10201 Amourj 17 10202 Adel Bagrou 21 10203 Bougadoum 21 103 Bassiknou 10301 Bassiknou 17 10302 El Megve 17 10303 Fassala - Nere 19 10304 Dhar 17 104 Djigueni 10401 Djiguenni 19 10402 MBROUK 2 17 10403 Feireni 17 10404 Beneamane 15 10405 Aoueinat Zbel 17 10406 Ghlig Ehel Boye 15 Recueil des Textes 2017/DGCT avec l’appui de la Coopération française 81 10407 Ksar El Barka 17 105 Timbedra 10501 Timbedra 19 10502 Twil 19 10503 Koumbi Saleh 17 10504 Bousteila 19 10505 Hassi M'Hadi 19 106 Oualata 10601 Oualata 19 2 H.Gharbi 201 Aioun 20101 Aioun 19 20102 Oum Lahyadh 17 20103 Doueirare 17 20104 Ten Hemad 11 20105 N'saveni 17 20106 Beneamane 15 20107 Egjert 17 202 Tamchekett 20201 Tamchekett 11 20202 Radhi -

Mauritanie, Pour
16°O LAS PALMAS 12° O vers TAN-TAN vers GUELMIM 8° O vers BÉCHAR vers BÉCHAR 4° O Cap Juby Gomera Tenerife Grande Canarie MAURITANIE TARFAYA MASPALOMAS M A R O C TINDOUF Hierro EL MHABAS 20° O Î l e s C a n a r i e s JDIRIYA LA'YOUN E (ESPAGNE) s S GARA DJEBILET a amr . m e qia el H a 449 ( in s) SMARA TFARITI BOUJDOUR E BOU KRA' Chenachane 'Aïn Ben Tili Z E M M O U R I g u î d i U Bîr Bel g Chegga Bîr Aïdiat Guerdâne Sebkhet ' E r A L G É R I E Dâya . Q Agmar Iguetti 'Ayoûn 'Abd el Khadra 347 GUELTAT ZEMMOUR Bîr Mogreïn el Mâlek I El Mzereb K Tourassine ÎR R E T T IS ZEMMOU N N A c h M A e 24° 24° N SAHARA Sebkhet Oumm ed Droûs A Sebkha h L Oued el Ma Zednes H OCCIDENTAL L C A ED DAKHLA 460 Cancer A El Mreïti Tropique du H g L Gleïb Dbâq G L 574 i Ti-n-Bessaïs m Tenoûmer r Agâraktem Zouérat â 370 E T ê E Fd rik a m m r Bîr 'Amrâne ' TAOUDENNI AOUSSERD ï (salines) Kediet ej Jill 915 l H e Mejaouda A E Tourîne t vers TESSA AGHOUINIT Touîjinjert q â îl BIR Tou j Aghreïjît a GANDOUZ TICHLA ZOUG M 330 e L I EL GARGARAT Châr 647 Zemlet Toffal Bir Ounâne T El Ghallâouîya n El Beyyed Cheïrîk â Nouâdhibou û â Aghoueyyît âl Ch ûm Aghouedir r N Bo Lanou r In Tmeïmîchât o Guelb er Rîchât a LAGOUIRA A 485 u Cansado Ntalfa Ahmeyim D Ouadâne O Râs Nouâdhibou â R A Azougui At r A M A L I (Cap Blanc) DAKHLET R Tiberguent 4° vers ARAOUANE NOUÂDHIBOU A z e f f â l 855 Chinguetti ADRAR É Terjît 20° 20° PARC NATIONAL Châmi DU BANC D'ARGUIN î A k c h â r Oujeft Capitale d'État Iou k Akjoujt 501 Et Tîdra Far 'aoun (plus de 750 000 hab.) C ÎR INCH I E Râs Timirist l M r e y Plus de 50 000 hab. -

Etudes Techniques Du Reseau Cible
ETUDES TECHNIQUES DU RESEAU CIBLE Mauritanie: Plan directeur de production et transport de l'énergie électrique en Mauritanie entre 2011 et 2030 - Rapport final Table des Matières Page 7. Etude technique du réseau cible 1 7.1 Contexte 1 7.2 Objectifs 1 7.3 Contexte actuel, contexte engagé (moyen terme) du système de transport et choix techniques en vigueur 1 7.3.1 Objectifs et critères d’analyse 1 7.3.1.1 Objectifs 1 7.3.1.2 Critères 2 7.3.2 Analyse de la situation existante 2 7.3.2.1 Lignes 3 7.3.2.2 Calculs de répartition à la pointe de charge 6 7.3.2.3 Calculs de court-circuit 9 7.3.2.4 Calculs de stabilité transitoire 10 7.3.2.5 Situation au creux de charge 14 7.3.2.6 Conclusion 15 7.4 Projets annoncés (projets SOMELEC et OMVS) 15 7.4.1 Projets supposés engagés 15 7.4.1.1 Projets d’extension de réseau 15 7.4.1.2 Projets de production d’électricité 16 7.4.2 Projets moins certains 16 7.5 Rappels du contexte futur: Prévisions de la demande et plan de production long terme 17 7.5.1 Prévisions de la demande 17 7.5.1.1 Charge des localités des Réseaux Autonomes (RA ou "Réseaux Araignées") 17 7.5.1.2 Charge des localités du Réseau Interconnecté (RI) 18 7.5.1.3 Charge de Nouakchott et Nouadhibou 18 7.5.2 Année de raccordement des autres grandes localités 19 7.5.3 Plan de production 19 7.6 Projets "Plan Directeur" : calculs de répartition 20 7.6.1 Variantes envisageables 20 7.6.2 Plan de tension et compensation de la puissance réactive 22 7.6.3 Niveau de charge des lignes et transformateurs 25 7.6.4 Pertes à la pointe en 2030 25 7.6.5 Introduction -

N° N° Bac Nom Fr Date Naiss Lieu De Naiss A. Bac M. Bac M
N° N°BAC NOMFR DATENAISS LIEUDENAISS A.BAC M.BAC M.Class. Série Filière Sess Sexe 1 11047 MohamedVadelSidiThvagha 31/12/1994 Tintane 14 10.91 13.761429 D MEDECINE 1 G 2 11636 MalhaIbrahimaNiang 25/03/1995 Ksar 14 12.37 13.841429 D MEDECINE 1 F 3 11719 MeimineMohamedSalemBedde 26/06/1996 Teyaret 14 10.88 14.472857 D MEDECINE 1 F 4 11790 MohamedBoudineAhmedouYacine 31/12/1995 Arafat 14 12.14 13.77 C MEDECINE 1 G 5 12585 HasnyGahZeiny 02/08/1995 Bangou 14 12.13 14.324286 C MEDECINE 1 G 6 12686 YahyaAbatnaLimam 04/11/1995 TimbeSNra 14 11.9 13.415714 C MEDECINE 1 G 7 12707 MohamedYahefdhouCheikhnaAhmedBoubaca21/12/1995 Néma 14 12.03 13.932857 C MEDECINE 1 G 8 12710 MariemIsselmouTedih 31/10/1995 Toujounine 14 11.91 14.398571 C MEDECINE 1 F 9 12758 MohamedLemineDatyElMoustapha 31/05/1996 Sebkha 14 11.82 14.974286 D MEDECINE 1 G 10 13451 NessibeMoustaphaLekleib 02/12/1995 Boghé 14 10.86 14.515714 D MEDECINE 1 F 11 13567 ElDehDidiBaba 28/12/1995 N'Beike 14 12.88 14.725714 D MEDECINE 1 G 12 14275 BambiMohamedCamara 14/04/1993 SNafort 14 11.06 13.562857 D MEDECINE 1 F 13 15008 AichetouMokhtarHamed 10/12/1993 SNarNaim 14 10.8 13.564286 D MEDECINE 0 F 14 15016 MohamedElMoustaphaNagiAhmedMahmoud10/03/1995 Toujounine 14 10.78 13.861429 D MEDECINE 1 G 15 15408 AichetouMohamedElMoustaphaJedou 12/06/1993 Bareine 14 10.92 13.491429 D MEDECINE 1 F 16 15585 MohamedSalemMohamedMahmoudSidiLehss30/12/1994 TevraghZein 14 12.28 13.575714 D MEDECINE 1 G 17 15602 SidiMohamedAhmedMohamedSaid 31/07/1994 Ksar 14 11.48 14.247143 D MEDECINE 1 G 18 16354 ElHacenMohamedElHadramy -

Conservation Et Utilisation Des Zones Humides Dans Le Hodh El Gharbi Mauritanien
Programme Gestion des Ressources Naturelles (ProGRN) Conservation et utilisation des zones humides dans le Hodh El Gharbi mauritanien pour ordre du République Islamique de Mauritanie Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement Secrétariat d’Etat auprès du Premier Ministre chargé de l’Environnement Conservation et utilisation des Zones Humides dans le Hodh El Gharbi mauritanien Secrétariat d’Etat auprès du Premier Ministre chargé de l’Environnement (SEE) Coopération Technique Allemande (GTZ) Programme Gestion des Ressources Naturelles (ProGRN) Conservation et utilisation des Zones Humides dans le Hodh El Gharbi mauritanien Nouakchott, février 2007 1 Conservation et utilisation des zones humides dans le Hodh El Gharbi mauritanien Éditeurs République Islamique de Mauritanie Secrétariat d'Etat auprès du Premier Ministre chargé de l'Environnement B.P. 170, Nouakchott. MAURITANIE. Tél. : +222 529 01 15 Coopération Technique Allemande (GTZ) B.P. 5217, Nouakchott. MAURITANIE. Tél. : +222 525 55 11 Email : [email protected] Responsable Karl P. Kirsch-Jung Rédacteurs Karl P. Kirsch-Jung et Dah Ould Khtour Auteurs Marie Fayein (Association Française des Volontaires du Progrès) Etienne Mouchard, stagiaire (Centre d’Etude et de Recherche sur le Développement International) Layout Jamil Abada, Nouakchott. Impression Les photos de cette brochure ont été prises par différents collaborateurs et consultants de la GTZ. Nouakchott, février 2007. 2 Préface Préface e Hodh El Gharbi constitue une vaste zone pastorale de l'Est mauritanien. Deux éléments en par- ticulier sont à l'origine de cette vocation : des étendues importantes de pâturages sur sols sableux, Lainsi que de nombreux plans d'eau temporaires à permanents rendant accessibles ces pâturages pendant une grande partie de la saison sèche. -

Convención Internacional Sobre La Eliminación De Todas Las Formas De Discriminación Racial
Naciones Unidas CERD/C/MRT/8-14 Convención Internacional sobre Distr. general 20 de febrero de 2017 la Eliminación de Todas las Formas Español de Discriminación Racial Original: francés Español, francés e inglés únicamente Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 9 de la Convención Informes periódicos 8º a 14º que los Estados partes debían presentar en 2008 Mauritania* [Fecha de recepción: 7 de febrero de 2017] * El presente documento se publica sin haber sido objeto de revisión editorial oficial. GE.17-02680 (S) 060417 120417 CERD/C/MRT/8-14 Índice Página Siglas y abreviaturas...................................................................................................................... 3 Introducción .................................................................................................................................. 4 Parte I. Presentación general de la República Islámica de Mauritania – Datos generales ............. 4 A. Características demográficas y socioeconómicas ......................................................... 4 B. Estructuras constitucionales y judiciales ...................................................................... 6 C. Marco General de Promoción y Protección de los Derechos Humanos ....................... 9 D. Factores que dificultan el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos ................................................................................. -

RAPPORT DE LA VERIFICATION COMMUNAUTAIRE T1&T2 2019
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE Honneur-Fraternité-Justice MINISTERE DE LA SANTE UNITE NATIONALE DU FINANCEMENT BASE SUR LES RESULTATS RAPPORT DE LA VERIFICATION COMMUNAUTAIRE T1&t2 2019 Septembre 2019 Table des matières Sigles et abréviations ............................................................................................................................... 2 Introduction ............................................................................................................................................. 3 I. But, cadre, acteurs impliqués dans la vérification communautaire ............................................. 4 1.1 But de la vérification communautaire ..................................................................................... 4 1.2 Cadre de la vérification communautaire .................................................................................. 4 1.3 Les acteurs impliqués .............................................................................................................. 4 II. Phase préparatoire de la vérification communautaire .................................................................. 5 2.1 Elaboration du budget de la Vérification communautaire ................................................... 5 2.2 Conception du questionnaire de la vérification communautaire ......................................... 5 2.3 Conception du masque de saisie des données issues de l’enquête communautaire ............. 5 2.4 Conception des guides d’instructions ................................................................................