Le Sang Jaune De Bombardier
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Canada's Aviation Hall of Fame
Volume 31, No. 2 THE Spring 2013 Canada’s Aviation Hall of Fame Canada’s Aviation Hall of Fame Panthéon de l’Aviation du Canada Dodds Finland Curtis Fraser Christensen Greenaway Burke Hitchins Boffa Floyd Fullerton Davoud Dowling Bazalgette Clarke Grossmith Capreol Hobbs Baker, A.W. Boggs Garneau Forester Deluce Collishaw Beaudoin Hadfield Agar Dunlap Carr Hollick-Kenyon Baker, R.F. Bradford Garratt Fowler, R. Bell Halton Archibald Hopson Baker, R.J. Brintnell Gilbert Fowler, W. Berry Hamilton Armstrong Balchen Hornell Bristol Dyment Godfrey Cavadias Fox Beurling Hartman Audette Dickins Baldwin Cooke Hotson Brown Graham Edwards Caywood Foy Birchall Hayter Austin Dilworth Bannock Cooper-Slipper Howe Buller Grandy Fallow Franks Chamberlin Bishop Heaslip Bjornson Dobbin Barker Crichton Hutt Burbidge Gray Fauquier Fraser-Harris Blakey Chmela Hiscocks Bain 1 Canada’s Aviation Hall of Fame Panthéon de l’Aviation du Canada CONTACT INFORMATION: OFFICE HOURS: STAFF: Tuesday - Friday: 9 am - 4:30 pm Executive Director - Rosella Bjornson Canada’s Aviation Hall of Fame Closed Mondays Administrator - Dawn Lindgren * NEW - PO Box 6090 Wetaskiwin AB Acting Curator - Robert Porter * NEW - T9A 2E8 CAHF DISPLAYS (HANGAR) HOURS: Phone: 780.361.1351 Tuesday to Sunday: 10 am - 5 pm Fax: 780.361.1239 Closed Mondays BOARD OF DIRECTORS: Website: www.cahf.ca Winter Hours: 1 pm - 4 pm Email: [email protected] Please call to confirm opening times. Tom Appleton, ON, Chairman James Morrison, ON, Secretary, Treasurer Barry Marsden, BC, Vice-Chairman Denis Chagnon, QC -

Proxy2019 (NEXTGEN)
BOMBARDIER INC. NOTICE OF ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020 YOUR VOTE IS IMPORTANT As used in this management proxy circular, all references to Bombardier, the Corporation, we, us or similar terms are to Bombardier Inc. Date: Thursday, June 18, 2020 Time: 10:30 a.m. (Montréal time) By order of the Board of Directors, Place: Espace Mansfield 1230 Mansfield Street Montréal, Québec, Canada H3B 2Y3 The holders of Class A shares (multiple voting) and/or Class B shares (subordinate voting) of Bombardier Inc. whose names Steeve Robitaille appear on the list of shareholders of Bombardier Inc. on Senior Vice President, General Counsel Wednesday, May 6, 2020, at 5:00 p.m. (Montréal time) will be and Corporate Secretary entitled to receive this notice of the meeting of shareholders Montréal, Québec, Canada, May 6, 2020 and to vote at the meeting. BUSINESS ON THE AGENDA OF THE MEETING: In light of the ongoing public health concerns related to the spread of COVID-19 and in order to mitigate potential risks to 1. Receipt of the consolidated financial statements of the health and safety of its shareholders, employees, Bombardier Inc. for the financial year ended communities and other stakeholders, the Corporation is December 31, 2019 and the auditors’ report thereon; providing facilities to allow its shareholders to participate in a 2. Election of the directors of Bombardier Inc.; hybrid meeting format whereby registered shareholders and duly appointed proxyholders may attend and participate in the 3. Appointment of the auditors of Bombardier Inc. and meeting via live webcast. The legal requirements of the authorization to the directors of Bombardier Inc. -

Bombardier's Mass Production of the Snowmobile: the Canadian Exception? Christian De Bresson and Joseph Lampel
Document generated on 09/25/2021 6:35 a.m. Scientia Canadensis Canadian Journal of the History of Science, Technology and Medicine Revue canadienne d'histoire des sciences, des techniques et de la médecine Bombardier's Mass Production of the Snowmobile: The Canadian Exception? Christian De Bresson and Joseph Lampel Volume 9, Number 2 (29), décembre–December 1985 URI: https://id.erudit.org/iderudit/800214ar DOI: https://doi.org/10.7202/800214ar See table of contents Publisher(s) CSTHA/AHSTC ISSN 0829-2507 (print) 1918-7750 (digital) Explore this journal Cite this article De Bresson, C. & Lampel, J. (1985). Bombardier's Mass Production of the Snowmobile: The Canadian Exception? Scientia Canadensis, 9(2), 133–149. https://doi.org/10.7202/800214ar Tout droit réservé © Canadian Science and Technology Historical Association / This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit Association pour l'histoire de la science et de la technologie au Canada, 1985 (including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be viewed online. https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/ This article is disseminated and preserved by Érudit. Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal, Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to promote and disseminate research. https://www.erudit.org/en/ 133 BOMBARDIER'S MASS PRODUCTION OF THE SNOWMOBILE: THE CANADIAN EXCEPTION? Chris DeBresson* and Joseph Lampe1** (Although) the Canadian record in innovation is not quite as dismal as popularly supposed ... a high proportion of innovative products are custom made for one or two customers, and fail to grow into mass produced standardized products.1 A disjunction seems to have beset Canadian industrial and econ omic development in the last forty years. -

Annual Report Year Ended January 31 2004
Annual Report Year Ended January 31 2004 We’ve made alotof progress MESSAGES TO SHAREHOLDERS 20 CORPORATE GOVERNANCE 24 AEROSPACE 26 TRANSPORTATION 34 SOCIAL RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY 36 FINANCIAL HIGHLIGHTS 38 FINANCIAL SECTION 39 MAIN BUSINESS LOCATIONS 136 BOARD OF DIRECTORS AND OFFICERS 137 SHAREHOLDER INFORMATION 138 read more on our rigorous action plan but on page there’s 20 still alotof progress TO BE MADE. PAUL M. TELLIER PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER Bringing in new leadership was critical, but that was just THE FIRST STEP. read more on our spirit and vision on page 22 LAURENT BEAUDOIN, FCA EXECUTIVE CHAIRMAN OF THE BOARD PIERRE ALARY SENIOR VICE PRESIDENT AND CHIEF FINANCIAL OFFICER read more on our financials starting on page 39 Recapitalization was very important. It gave us breathing space for a while. RÉJEAN BOURQUE VICE PRESIDENT, INVESTOR RELATIONS And a new share issue was oversubscribed by $400 MILLION. Encouraging. FRANÇOIS LEMARCHAND SENIOR VICE PRESIDENT AND TREASURER We promised to reduce the risk profile at Bombardier Capital and concentrate on our most vital portfolios. And we did just that. MICHAEL DENHAM SENIOR VICE PRESIDENT, STRATEGY We divested ourselves of certain assets to concentrate on trains and planes. Focus is everything. FRANÇOIS THIBAULT VICE PRESIDENT, ACQUISITIONS Trains, where we’re number ONE in the world read more on initiatives at Transportation on page 34 WOLFGANG TOELSNER ANDRÉ NAVARRI CHIEF OPERATING OFFICER, BOMBARDIER TRANSPORTATION PRESIDENT, BOMBARDIER TRANSPORTATION read more on Aerospace’s achievements and challenges on page 26 PIERRE BEAUDOIN PRESIDENT AND CHIEF OPERATING OFFICER, BOMBARDIER AEROSPACE and planes, where we’reaworld LEADER in regional aircraft and business jets. -
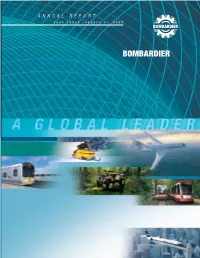
View Annual Report
ANNUAL REPORT YEAR ENDED JANUARY 31, 2000 2000 y 31, ear ended Januar Year ended January 31, 2000 ended January 31, Year Y T AL REPOR ANNUAL REPORT ANNUAL ANNU Printed in Canada - ISBN 2-921393-45-X Legal Deposit, BibliothBibliothèqueèque nanationaletionale du QuQuébecébec 81 a TABLE OF CONTENTS a SHAREHOLDER INFORMATION 2 Highlights 4 Report to Shareholders 8 Management’s Discussion and Analysis 10 Bombardier Aerospace 18 Bombardier Transportation A Record Year 24 Bombardier Recreational Products 29 Bombardier Capital 31 Bombardier International 32 Six Sigma 34 Social Responsibility 36 Environment Share Capital Authorized and Issued as at January 31, 2000 37 Liquidity and Capital Resources 41 Financial Section Authorized Issued Class A shares 896,000,000 175,797,064 76 Main Business Locations Class B shares 896,000,000 513,011,944 78 Activities Preferred shares, Series 2 12,000,000 12,000,000 80 Board of Directors and Corporate Officers At the special and annual meeting to be held on June 20, 2000, the shareholders of Bombardier will Fiscal be asked to approve a split of both class A and class B shares on a two-for-one basis. Upon shareholders’ 81 Shareholder Information approval, the split will be effective for shareholders of record at the close of business, Montréal time, 1999-2000 on Friday, July 7, 2000. Net Income: $718.8 million Stock Exchange Listings Class A and B shares Toronto (Canada) Preferred shares, Series 2 Toronto (Canada) Class B shares Brussels (Belgium) and Frankfurt (Germany) Stock listing codes BBD (Toronto) BOM (Brussels) BBDd.F (Frankfurt) Incorporation Corporate Secretary SHAREHOLDER Media Relations The Corporation was Bombardier Inc. -

Bombardier 2008-09 Annual Report
OUR WAY AnnualReport,2009 EndedJanuary Year 31, FORWARD ANNUAL REPORT, YEAR ENDED JANUARY 31, 2009 www.bombardier.com FINANCIAL HIGHLIGHTS (in millions of U.S. dollars, except per share and backlog amounts) For the fiscal years ended January 31 2009 2008 Revenues $ 19,721 $ 17,506 EBIT before special item $ 1,411 $ 902 EBT before special item $ 1,273 $ 601 Income taxes $ 265 $ 122 Net income $ 1,008 $ 317 Earnings per share before special item (in dollars): Basic $ 0.57 $ 0.26 Diluted $ 0.56 $ 0.26 Earnings per share (in dollars): Basic $ 0.57 $ 0.17 Diluted $ 0.56 $ 0.16 Dividend per common share (in Cdn dollars) Class A $ 0.08 $ – Class B $ 0.08 $ – As at January 31 2009 2008 Total assets $ 21,306 $ 22,120 Shareholders’ equity $ 2,544 $ 3,118 We take pride in our employees’ engagement. We sincerely thank all Net additions to property, plant and equipment and intangible assets $ 567 $ 417 of our employees who agreed to participate in this annual report. Total backlog (in billions of dollars) $ 48.2 $ 53.6 Book value per common share (in dollars) $ 1.27 $ 1.60 Number of common shares Class A 316,582,537 316,961,957 Class B 1,413,866,601 1,413,700,636 STOCK MARKET PRicE RANGES BOMBARDIER’S STOCK PERFORMANCE (in Cdn dollars) January 31, 2006 to January 31, 2009 For the years 300 ended January 31 2009 2008 Class A 200 BiLevel, Bombardier, Bombardier 415, Challenger, Challenger 300, Challenger 604, Challenger 605, Challenger 800, CL-215, CONTESSA, CRJ, CRJ200, CRJ700, CRJ705, CRJ900, CRJ1000, High $ 9.00 $ 7.00 CS100, CS300, CSeries, CITYFLO, CX-100, EBI, ECO4, ELECTROSTAR, EnerGplan, FLEXITY, Flexjet, FLEXX, Global, Global 5000, Global Express, Global Vision, INNOVIA, INTERFLO, Learjet, *100 Learjet 40, Learjet 45, Learjet 60, Learjet 85, MITRAC, MOVIA, NextGen, ORBITA, PartsExpress, PRIMOVE, Q200, Q300, Q400, Q-Series, REGINA, Skyjet, Skyjet International, Smart Services, Low $ 3.25 $ 4.10 SPACIUM, TALENT, The climate is right for trains, TRAXX, TURBOSTAR, XR, XRS and ZEFIRO are trademarks of Bombardier Inc. -

The Rise and Fall of Bombardier
THE HARTMANN PAPERS: The Rise and Fall of Bombardier The first report of the expected CSeries aircraft purchase by Delta Airlines appeared in public media in mid-April 2016, and the extremely high degree of confidence with which this order was predicted pointed to the only obvious source - Bombardier. In the next two weeks until Delta actually made it official, a media circus was unleashed that had all the hallmarks of a good American TV infomercial sponsored by, again, Bombardier. It was, and still is, a well coordinated corporate marketing campaign with grossly misleading statements, buzz words from Bombardier’s junior marketing guy’s dictionary, and a focus concentrated on very few narrow and specific issues to the total exclusion of hard true facts. To this day the media repeat the “$5.6 billion value” of the Delta deal, even though Bombardier itself tacitly acknowledged - and never disputed - the reported 75% discount which brings the deal down to a mere $1.4 billion. Bombardier already announced a $500 million write-off on this “onerous deal”, acknowledged that it is not going to make profit on its CSeries aircraft until 2021, and the Airbus sales chief, who is the one who ought to know, claims that Bombardier is losing $7 million on each Delta aircraft. So when will Bombardier start making profit, and how will it pay off the accumulated multi-billion $ loses with single-digit-millions of profits made on aircraft in 5 or 10 years? The CSeries is being presented as a “game changer” and a sort of revolutionary aircraft that guarantees Bombardier’s great future. -

2015 Proxy Circular, Including Notice of Annual Meeting of Shareholders
BRP INC. NOTICE OF ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND MANAGEMENT PROXY CIRCULAR Annual meeting of shareholders will be held at 11:00 a.m. (Eastern time) on June 11, 2015 at the Laurent Beaudoin Design & Innovation Centre THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK Letter from the Chairman of the Board of Directors and the President and Chief Executive Officer April 27, 2015 Dear Shareholders: January 31 marked the end of BRP’s second fiscal year since the company became public in May 2013. Although this second year was more complex than we anticipated, we still succeeded in increasing our revenues by 10% compared to prior year and reporting a record normalized net income thanks to the effort and engagement of our 7,600 employees. As shareholders of our company, you are cordially invited to attend the annual meeting of shareholders of BRP Inc. on June 11, 2015 at 11 a.m. EDT, at the Laurent Beaudoin Design & Innovation Centre, 754 St- Joseph Street, Valcourt, Québec, J0E 2L0. The enclosed notice of the annual meeting of shareholders and management proxy circular provides information on all matters to be acted upon by the shareholders, including information on directors nominated for election and the appointment of the Company’s auditors. The management proxy circular also provides information on our corporate governance system and compensation of our senior management. For more information about the activities offered prior to the meeting and the shuttle service to Valcourt, please visit our website at brp.com. Select the Event Calendar tab in the Investor Relations section. Your vote and participation are very important to us. -

ANNUAL INFORMATION FORM for the Year Ended December 31, 2015
ANNUAL INFORMATION FORM For the year ended December 31, 2015 February 17, 2016 NOTES (1) In this Annual Information Form, all monetary amounts are expressed in U.S. dollars, unless otherwise indicated. Certain totals, subtotals and percentages may not agree due to rounding. (2) Bombardier, Challenger, Challenger 300, Challenger 350, Challenger 605, Challenger 650, CRJ, CRJ700, CRJ900, CRJ1000, CS100, CS300, C Series, FlexCare, FLEXITY, Global, Global 5000, Global 6000, Global 7000, Global 8000, INNOVIA, Q400, Learjet, Learjet 75, Learjet 85, MOVIA, OMNEO, PRIMOVE, TALENT, TRAXX and The Evolution of Mobility are trademarks belonging to Bombardier Inc. or its subsidiaries. (3) This Annual Information Form contains references to trademarks of third parties for the purpose of describing Bombardier’s competitive environment and the development of its business. (4) In this Annual Information Form, the term “Bombardier” means, as required by the context, the Corporation and its subsidiaries on a consolidated basis or the Corporation or one or more of its subsidiaries. The term “Transportation” refers to the Corporation’s transportation reportable segment, the term "Business Aircraft" refers to the Corporation’s business aircraft reportable segment, the term “Commercial Aircraft” refers to the Corporation’s commercial aircraft reportable segment, the term “Aerostructures and Engineering Services” refers to the Corporation’s aerostructures and engineering services reportable segment and the term “Aerospace” refers, as the context may require prior to January 1, 2015, to the Corporation's prior aerospace reportable segment, or since, January 1, 2015, collectively to Business Aircraft, Commercial Aircraft and Aerostructures and Engineering Services. (5) Information is as at December 31, 2015, unless otherwise noted. -

Brp Inc. Annual Information Form April 9, 2020 Fiscal Year Ended January 31, 2020
BRP INC. ANNUAL INFORMATION FORM APRIL 9, 2020 FISCAL YEAR ENDED JANUARY 31, 2020 TABLE OF CONTENTS EXPLANATORY NOTES .............................................................................................................................. 1 CORPORATE STRUCTURE ........................................................................................................................ 4 GENERAL DEVELOPMENT OF THE BUSINESS ...................................................................................... 5 BUSINESS OF THE COMPANY AND ITS INDUSTRY ............................................................................... 7 RISK FACTORS ......................................................................................................................................... 27 DIVIDENDS ................................................................................................................................................. 48 DESCRIPTION OF THE CAPITAL STRUCTURE ..................................................................................... 49 MARKET FOR SECURITIES AND TRADING PRICE AND VOLUME ...................................................... 55 DIRECTORS AND OFFICERS ................................................................................................................... 56 LEGAL PROCEEDINGS AND REGULATORY ACTIONS ........................................................................ 66 INTEREST OF MANAGEMENT AND OTHERS IN MATERIAL TRANSACTIONS .................................. 67 INDEPENDENT AUDITOR, -
Bombardier's Mass Production of the Snowmobile: the Canadian Exception? Christian De Bresson Et Joseph Lampel
Document généré le 30 sept. 2021 04:45 Scientia Canadensis Canadian Journal of the History of Science, Technology and Medicine Revue canadienne d'histoire des sciences, des techniques et de la médecine Bombardier's Mass Production of the Snowmobile: The Canadian Exception? Christian De Bresson et Joseph Lampel Volume 9, numéro 2 (29), décembre–december 1985 URI : https://id.erudit.org/iderudit/800214ar DOI : https://doi.org/10.7202/800214ar Aller au sommaire du numéro Éditeur(s) CSTHA/AHSTC ISSN 0829-2507 (imprimé) 1918-7750 (numérique) Découvrir la revue Citer cet article De Bresson, C. & Lampel, J. (1985). Bombardier's Mass Production of the Snowmobile: The Canadian Exception? Scientia Canadensis, 9(2), 133–149. https://doi.org/10.7202/800214ar Tout droit réservé © Canadian Science and Technology Historical Association / Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des Association pour l'histoire de la science et de la technologie au Canada, 1985 services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne. https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/ Cet article est diffusé et préservé par Érudit. Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. https://www.erudit.org/fr/ 133 BOMBARDIER'S MASS PRODUCTION OF THE SNOWMOBILE: THE CANADIAN EXCEPTION? Chris DeBresson* and Joseph Lampe1** (Although) the Canadian record in innovation is not quite as dismal as popularly supposed .. -
Karl James Moore
KARL JAMES MOORE Office: Faculty of Management McGill University 1001 Sherbrooke West Montreal, Canada, H3A 1G5 (514) 398-4138 [email protected] EDUCATION 1995 York University, Toronto Schulich School of Business Ph.D. in Marketing, minor in Strategy Dissertation: Title: "Global Mandates/CEOs and Subsidiary Specific Advantages." 1979 University of Southern California, Los Angeles Master of Business Administration Major in Managerial Decision Systems. Dean’s Honour List Graduated Magma Cum Laude 1977 Ambassador University, Pasadena, California Bachelor of Science in Business Dean’s Honour List and Magma Cum Laude PROFESSIONAL Certification in Product and Inventory Management, QUALIFICATION 1989 ACADEMIC POSITIONS Sept. 2000-Present McGill University Associate Professor (2003 - Present) Visiting Professor Desautels Faculty of Management Associate Professor (2005 – Present) Department of Neurology & Neurosurgery Faculty of Medicine Notable Initiatives: • Teach strategy and leadership in the M.B.A., B.Com and Executive programs. • Cycle Director for the Advanced Leadership Program with Henry Mintzberg • Module Director for the International Masters in Practicing Management. 1 • Co-Module Director of the International Masters for Health Leadership. • Founding Member of the MD Lead group for physician management training. • Member of the Operating Committee (2003-2004) • Member of the Senate (2004-2006) 1995-Present Green Templeton College, Oxford University Associate Fellow Fellow in Strategy Taught strategy and marketing in executive programs, MBA, MPhil and doctoral programs. REFEREED ARTICLES – + 3400 Google Scholar citations 2017 Moore, Karl, “Review of The Code Economy: A Forty-Thousand History,” Business History Review, Volume 92, Issue 4, pages 601-03. 2015 Reid, Susan, Deborah Roberts and Karl Moore, “The Impact of Technology Vision on Early Success: The Case for Radically New, High-Tech Products”, Journal of Product Innovation Management, Volume 32, Issue 4, pages 593- 609.