Extrait De La Publication Extrait De La Publication Extrait De La Publication
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Anna De Noailles (1876-1933) Marie-Lise Allard
Document generated on 09/28/2021 1 a.m. Nuit blanche, le magazine du livre Anna de Noailles (1876-1933) Marie-Lise Allard Réjean Ducharme Number 124, Fall 2011 URI: https://id.erudit.org/iderudit/65130ac See table of contents Publisher(s) Nuit blanche, le magazine du livre ISSN 0823-2490 (print) 1923-3191 (digital) Explore this journal Cite this article Allard, M.-L. (2011). Anna de Noailles (1876-1933). Nuit blanche, le magazine du livre, (124), 72–76. Tous droits réservés © Nuit blanche, le magazine du livre, 2011 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit (including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be viewed online. https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/ This article is disseminated and preserved by Érudit. Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal, Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to promote and disseminate research. https://www.erudit.org/en/ NB_No124_P1_a_P80.qxd:*NB_103_P1 à P72_final_v2.1.qxd 25/09/11 23:41 Page 72 Anna de Noailles Par Marie-Lise Allard* La vie d’Anna de Noailles ressemble à un conte de fées qui commencerait Par Anna de Noailles « il était une fois… » est effectivement une princesse, merveilleux. Dès lors, Amphion a toujours symbolisé d’ascendance roumaine par son père et l’éden terrestre : « Oui, ce fut là le paradis2 ». Par turque par sa mère, qui vit le jour à conséquent, la nature devint l’un des thèmes de C’ Paris le 15 novembre 1876. -

Writing and Modernity: Colette's Feminist Fiction. Lezlie Hart Stivale Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College
Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Historical Dissertations and Theses Graduate School 1991 Writing and Modernity: Colette's Feminist Fiction. Lezlie Hart Stivale Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_disstheses Recommended Citation Stivale, Lezlie Hart, "Writing and Modernity: Colette's Feminist Fiction." (1991). LSU Historical Dissertations and Theses. 5211. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_disstheses/5211 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Historical Dissertations and Theses by an authorized administrator of LSU Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. INFORMATION TO USERS This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMI films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand corner and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. -

Bales 1970 1802768.Pdf
MARCEL PROUST AND REYNALDO HAHN II . \,_,1f' ,( Richard M~ Bales B.A. University of 11 Exeter, 1969 Submitted to the Department of ·French and Italian and the Faculty of the Graduate School of the University of Kansas in partial fulfillment of the . requirements for the degree of Master of Arts. Redacted Signature / ---instr.uct~-in_:_c arge V__/~-~ . /_CA .. __ . - /'1 _- -- .,, .' Redacted Signature rr the ./I.apartment 0 • R00105 7190b ] .,; ACKNOWLEDGMENT. I wish to express my sincerest thanks to Professor J. Theodore Johnson, Jr. for his kind help.in the preparation of this thesis, and especially for his having allowed me ready access ·to his vast Proustian bibliography and library. April 30, 1970. TABLE OF CONTENTS. Introduction •..•...............................•. 1 Chapter I: The Historical Picture ••••••••••••••• 6 Chapter II: Hahn in Proust•a Works ••••••••••••• 24 Chapter III: Proust's Correspondence with Hahn. 33 Chapter IV: Music for Proust ••••••••••••••••••• 5o Chapter V: :Music for Hahn.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 61• Conclusion •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 76 Appendix I: Hahn's Life and Works •••••••••••••• Bo App~ndix II: Index to the more important com- posers (other than Hahn) in the Proust/ Hahn Correspondence •••••••••••••••••••••••• 83 Selective Bibliography••••••••••·••••••••••••••• 84 INTRODUCTION. The question of Proust and music .is a large one, for here, more than with perhaps any other author, the subject is particularly pregnant. Not only is there extended dis- cussion of music in Proust's works, but also the fictional Vinteuil in A la recherche du temps perdu is elevated to the rank .of an artistic "hero," a ."phare" in the Baudelairian sense. It is no accident that Vinteuil 1 s music is more of a revelation for the narrator than the works-of Bergotte the writer or Elstir the painter, for Proust virtually raised music to the highest art-foz,n, or, rather, it is th~ art-form which came closest to his own idea of "essence," the medium by.which souls can communicate. -

Catalog Cu Rezumatele Lucrarilor Inscrise La Simpozionul International UNIVERSUL STIINTELOR
1 Institu ţii implicate în organizare Universitatea „Al. I. Cuza” din Ia şi ● Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor ● Facultatea de Fizic ă Universitatea de Stat din Moldova ● Facultatea de Drept Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere” din Republica Moldova ● Facultatea de Drept Asocia ţia Cultural – Ştiin ţific ă „Vasile Pogor” din Ia şi 2 Simpozionul Interna țional “UNIVERSUL ŞTIIN ŢELOR” – Edi ția a V-a din 7 septembrie 2014 FACULTATEA DE ECONOMIE Ş I ADMINISTRAREA AFACERILOR 1 Prof. Univ. Dr. Dinu AIRINEI Decan al Facult ăţ ii de Economie şi Administrarea Afacerilor Mesajul Decanului Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din cadrul Universit ăţ ii „Al. I. Cuza” din Ia şi este una din cele mai dinamice facult ăţ i, din punctul de vedere al programelor educa ţionale, al num ărului de studen ţi, al perfec ţion ării cadrelor didactice şi al moderniz ării spa ţiilor de înv ăţă mânt. De şi facultatea apare în structura Universit ăţ ii „Al. I. Cuza” în 1962, tradi ţia înv ăţă mântului economic la nivel academic a început la Ia şi în 1843, odat ă cu primul curs de economie politic ă predat de Ion Ghica la Academia Mih ăilean ă. Înfiin ţarea, în 1962, a Facult ăţ ii de Ştiin ţe Economice sub auspiciile Universit ăţ ii „Al. I. Cuza” din Ia şi a marcat începuturile consacr ării „ şcolii ie şene de economie”. Dup ă 1990, programele educa ţionale şi structura facult ăţ ii au fost integral reformulate bazându-se pe urm ătoarele direc ţii prioritare: - recuperarea veritabilelor principii prin restructurarea planurilor de înv ăţă mânt, - restructurarea activit ăţ ii didactice şi de cercetare ştiin ţific ă, accentuându-se deopotriv ă importan ţa form ării spiritului critic, a gândirii creative şi formarea de competen ţe profesionale la studen ţi, - sincronizarea activit ăţ ii de educa ţie şi de cercetare din facultate cu cea din şcolile occidentale similare prin dezvoltarea unor programe de cooperare interna ţional ă. -

Proust Booklet
Neville Jason NON- The Life FICTION and Work of BIOGRAPHY Marcel Proust Read by Neville Jason NA325212D 1 Reynaldo Hahn sings Offrande, 1909 8:00 2 Three fictional creative artists: 6:52 3 Proust’s episodes of ‘involuntary memory’ 3:53 4 The Franco-Prussian War 2:06 5 The birth of Marcel Proust, 10 January 1871 6:30 6 The goodnight kiss 11:47 7 Military service 5:50 8 The first short story 4:30 9 Influential drawing rooms 3:49 10 Comte Robert de Montesquiou-Fezensac 8:08 11 Reynaldo Hahn 13:43 12 Lucien Daudet 2:05 13 The Dreyfus Case 2:16 14 The Dreyfus Case (cont.) 3:53 15 Pleasures and Days 6:31 16 Jean Santeuil, the early, autobiographical novel 6:34 17 Anna de Noailles 3:30 18 Marcel Proust and John Ruskin 7:55 19 More work: Ruskin’s The Bible of Amiens 5:01 20 The move to 102 Boulevard Haussmann 5:12 2 21 Time Lost, Time Regained, involuntary memory 5:35 22 Alfred Agostinelli 7:36 23 Sergei Diaghilev, Jean Cocteau, Pablo Picasso 9:20 24 Looking for a publisher 8:23 25 The manuscript is delivered to Grasset 4:47 26 Proust and Agostinelli 4:47 27 Proust and Agostinelli (cont.) 1:27 28 The publication of Swann’s Way 9:57 29 The First World War begins, 3 August 1914 7:50 30 The year of 1915 7:56 31 The poet Paul Morand 3:07 32 Proust begins to go out again into the world 4:58 33 Proust changes publishers 6:00 34 The Armistice 2:34 35 Within a Budding Grove published in 1919, 6:22 36 The meeting with James Joyce 2:15 37 Proust and Music 6:30 38 The Guermantes Way Part II 4:09 39 Colette remembers 1:22 40 People and characters 7:47 41 Worsening health and death 7:07 Total time: 3:58:18 3 Neville Jason The Life and Work of Marcel Proust Few authors have attracted as many masterpiece, Remembrance of Things Past. -
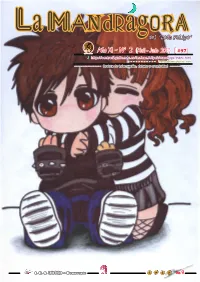
Año XI ~ Nº 2 (Abril
L Mandr ora a agdel 'León Felipe' El sueño de la razón produce monstruos Año XI ~ Nº 2 (Abril - Junio 2011) [#97] http://centros5.pntic.mec.es/ies.leon.felipe2/mandrago/index.html ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ [email protected] ~~~~~~~~~~~~~~~~ Revista de información, debate y creatividad ~~~~~~~~~~~~~ I. E. S. León Felipe – Benavente Pág. 1 L M a a andragor Año XI ~ Nº 2 ~ Abril - Junio, 2011 [ # 9 7 ] sumario: Pág. 1 ~ PORTADA Para Noelia Glez., por Julia Mielgo Sánchez (4º de ESO) 2-5 ~ EDITORIAL, PARADOJA, BENAVENTE por por Es la hora Es la hora, Salustiano Fdez. / La cara y la cruz, Redacción / La Cátedra de Gramática de Benavente, por J.C. de la Mata Es hora de irse con la cha- y patear áspides remotos queta al hombro, despreo- o cercanos. Es la hora, di- 6-11 ~ SOUVENIRS, DIBUJOS, FÚTBOL Souvenirs, por Patricia Ramos, Clara Miguélez, Amanda Jiménez y Nazaret Rubio / Carpe Diem, por Mónica Anta / cupadamente, imaginando el cen, pero el camino sigue ahí Dibujos, por Beatriz Rabanales, Esaú Fdez. ... / 3er. Cam- peonato de Futbito para el 1er.Ciclo de la ESO azul como suele hacerlo como si nada pasara, como 12-19 ~ DEBATE, VIDEOJUEGOS, LIBROS, RELATO quien lleva amor en los bol- si nadie pasara, como si nadie Rostros de la Inmigración, por Arantza Salsón / Cambiar el mundo, por Diego Gutiérrez / Videojuegos, por Alejandro sillos y en cualquier lugar lo pisara. ¿Dónde iremos con Méndez, Pablo Mielgo e Iván García / +Libros = +Libres / Dibujos, por Diana Stoica / El olor de los números, por José hace su casa. Es la hora de el reventón de gozo que por- Mª Huerga Carracedo dejar atrás otro curso, otro tamos? ¿Acabará en el pozo? 20-27 ~ GAUDÍ, ENTREVISTA, DIBUJOS, HISTORIA número de La Mandrágora, De eso nada, monada, que con La Sagrada Familia y Gaudí, por Beatriz Rabanales / Entrevista a Gabino Diego, por Beatriz Rabanales y Mercedes / Dibujos por Nerea Álvarez y Esaú Fdez. -

Anna De Noailles Le Passioni Traduzione Giuliano Brenna
Anna de Noailles traduzione di Giuliano Brenna Le Passioni Ritratto della contessa Anna de Noailles, 1913 Ignacio Zuloaga y Zabaleta, olio su tela 152 x 195,5 cm (Foto: Bilbao, Museo di belle arti) www. LaRecherche.it eBook n. 153 Pubblicato da LaRecherche.it [ Poesia/traduzioni ] Poesie tratte da Les Vivants et les Morts I capitolo, Les Passions Arthème Fayard & C IE , Éditeurs (Paris, 1913) Traduzione di Giuliano Brenna Anna de Noailles – Le Passioni (traduzione di Giuliano Brenna) 1 www. LaRecherche.it SOMMARIO TU VIS, JE BOIS L’AZUR... TU VIVI, IO BEVO L’AZZURRO J’AI TANT RÊVE PAR VOUS... HO TANTO SOGNATO DI TE… L’AMITIE L’AMICIZIA TU T’ELOIGNES, CHER ÊTRE... T’ALLONTANI, CARO ESSERE… J’ESPÈRE DE MOURIR... SPERO DI MORIRE… QUE M’IMPORTE AUJOURD’HUI... CHE MI IMPORTA OGGI… JE DORMAIS, JE M’EVEILLE... DORMIVO, MI SVEGLIO… ON NE PEUT RIEN VOULOIR... SI PUÒ VOLER NULLA UN JOUR, ON AVAIT TANT SOUFFERT... UN GIORNO, AVEVAMO TANTO SOFFERTO… JE ME DEFENDS DE TOI... MI DIFENDO DA TE… NOTE SU ANNA DE NOAILLES BIBLIOGRAFIA NOTE SUL TRADUTTORE COLLANA LIBRI LIBERI [ EBOOK ] AUTORIZZAZIONI Anna de Noailles – Le Passioni (traduzione di Giuliano Brenna) 2 www. LaRecherche.it Dedicato a Rosetta Signorini Anna de Noailles – Le Passioni (traduzione di Giuliano Brenna) 3 www. LaRecherche.it Solitaire, nomade et toujours étonnée, Je n’ai pas d’avenir et je n’ai pas de toit, J’ai peur de la maison, de l’heure et de l’année Où je devrai souffrir de toi. Anna de Noailles Anna de Noailles – Le Passioni (traduzione di Giuliano Brenna) 4 www. -

Anna De Noailles. Un Mystère En Pleine Lumière
« BIOGRAPHIES SANS MASQUE » Collection dirigée par Laurent Laffont et Pierre Sipriot FRANÇOIS BROCHE ANNA DE NOAILLES Un mystère en pleine lumière ÉDITIONS ROBERT LAFFONT PARIS û Éditions Robert Laffont, S.A., Paris, 1989 ISBN 2-221-05682-5 Pour Alice. Avant-propos UNE RACE EN VOIE DE DISPARITION La race des femmes d'esprit et de cœur, et, pour la plupart d'entre elles, de lettres, qui ne se contentaient pas de plaire ou de séduire, mais exerçaient une influence profonde sur leurs contempo- rains, est probablement en voie de disparition. Ce furent parfois des maîtresses, souvent des conseillères, toujours des inspiratrices, et il arrivait que, par commodité, on les désignât d'un mot auquel, depuis la plus haute antiquité, s'attache un parfum d'érotisme et de frivo- lité : égéries. Elles illuminèrent les grandes périodes de la civilisation occiden- tale - pour ne s'occuper que de celle-ci, mais les orientales n 'en furent pas moins prodigues. Immortelles, Marie de France, Christine de Pisan, Marguerite de Navarre, Louise Labé, Mme de La Fayette, Mlle de Scudéry, Mme de Sévigné, Mme du Deffand, Julie de Lespi- nasse, Mme de Staël, Marceline Desbordes-Valmore, George Sand, Louise Ackermann, Juliette Adam, Gérard d'Houville, Renée Vivien, Colette, Louise de Vilmorin, Louise Weiss et quelques autres. Immortelle aussi et surtout, Anna de Noailles, la plus brillante de toutes peut-être, la plus irritante aussi, sans nul doute la plus mysté- rieuse. Jamais, on le verra, le mot « génie » ne fut employé avec plus d'insistance à propos d'une femme. Mais quel mystère pourrait se qualifier d'un mot ? Anna de Noailles ne fut pas seulement un grand écrivain clas- sique (poète mais aussi prosateur de très grande qualité), une amou- reuse subtile (qui connut des aventures passionnées et malheureuses) ou encore une simple « égérie ». -

Handbook for the Final Honours Course in FRENCH
Final Honours School Handbook FRENCH For students who start their FHS course in October 2008 and expect to be taking the FHS examination in Trinity Term 2011 FACULTY OF MEDIEVAL AND MODERN LANGUAGES Handbook for the Final Honours Course in FRENCH Trinity Term 2008 This handbook is for those students who start their FHS course in October 2008 and therefore wil l normally be examined in June 2011 . 2 FINAL HONOURS SCHOOL IN FRENCH Language After the Preliminary Examination a variety of approaches are used in the language teaching offered to you. Language classes will usually be arranged by your college and there will be opportunities for improving the whole range of skills: reading, listening, writing, and speaking. Developing your skills in translation will also encourage you to write accurately and acquire a feel for style and register, and there will be opportunities to develop oral and aural skills with native speakers. Communicative skills will be developed in preparation for the Essay paper and the Oral examination. Classes using authentic material (videos, newspapers and magazine articles) frequently provide a basis both for language exercises and for information on current affairs, politics and other aspects of modern society. Such classes prove especially useful for students who know little about the country and who need guidance for making the most of their year abroad; they also keep Final Year students up to date. Formal classes apart, undergraduates are urged to make use of the well-resourced Language Centre with abundant video and printed material and facilities for computer-assisted learning and self-taught courses. -

The Novels, Romances and Writings of Alphonse Daudet
fyxmll Uttivmitg ptavg BOUGHT WITH THE INCOME FROM THE SAGE ENDOWMENT FUND THE GIFT OF Stletirg W. Sage X891 4,.4ifcy4j.i iirnliL The original of this book is in the Cornell University Library. There are no known copyright restrictions in the United States on the use of the text. http://www.archive.org/details/cu31924088382761 Alphonse Daudet and his Secretary. THE NOVELS, ROMANCES AND WRITINGS OF ALPHONSE DAUDET THIRTY YEARS IN PARIS ULTIMA • NEW YORK THE ATHENAEUM SOCIETY Copyright, 1899, 1900, By Little, Brown, and Company. AU righis reserved. CONTENTS. P»BB INTRODUCTORY NOTE ii Pages from My Life and My Books; I. The Arrival t II. Villemessant . 15 III. My First Coat 29 IV. History of My Books. — " Little What's-His- Name" 42 V. The Literary Salons 57 VI. My Drummer 74 VII. History of My Books. — Tartarin of Tarascon . 90 VIII. History of My Books. — Letters From My Mill . 103 IX. My First Play 117 X. Henri Rochefort 125 XI. Henry Monnier 143 XII. The End of a Mountebank and of Murger's Bohemia 149 XIII. History of My Books. — Jack 165 XIV. lie des Moineaux. — A Meeting on the Seine . 186 XV. History of My Books. — Fromont and Risler . 192 XVI. Turg^nieff 207 Ultima. Ultima ^^3 INTRODUCTORY NOTE. When this volume of fugitive articles, mainly reminiscent, was given to the public, in 1888, almost exactly thirty years had passed since the epoch-marking incident in Daudet's life to which the opening article is devoted. Ernest Daudet fixes for us the time of his brother's arrival in Paris as the early part of November 1857, when he ^ was about seventeen and a half years old ; and his first appearance in print — the publication of Les Amoureuses, the volume of verses many of which he had brought with him from the provinces — did not take place until the following year. -

Anna De Noailles Oui Et Non: the Countess, the Critics, and La Poésie Féminine
Cleveland State University EngagedScholarship@CSU World Languages, Literatures, and Cultures Department of World Languages, Literatures, Faculty Publications and Cultures 3-1994 Anna de Noailles Oui et Non: The Countess, the Critics, and la poésie féminine Tama L. Engelking Cleveland State University, [email protected] Follow this and additional works at: https://engagedscholarship.csuohio.edu/clmlang_facpub Part of the Arts and Humanities Commons How does access to this work benefit ou?y Let us know! Publisher's Statement (c) 1994 Taylor & Francis Recommended Citation Tama Lea Engelking. (1994). Anna de Noailles Oui et Non: The Countess, the Critics, and la poésie féminine. Women's Studies: An Interdisciplinary Journal, 23(2), 95-111, doi: 10.1080/ 00497878.1994.9979014. This Article is brought to you for free and open access by the Department of World Languages, Literatures, and Cultures at EngagedScholarship@CSU. It has been accepted for inclusion in World Languages, Literatures, and Cultures Faculty Publications by an authorized administrator of EngagedScholarship@CSU. For more information, please contact [email protected]. LA COMTESSE DE NOAILLES OUI ET NON: This is the curious title of Jean Cocteau's last book, written to pay homage to an idol of his youth, the early twentieth-century poet Anna de Noailles. It was not that Cocteau could not make up his mind about the countess, but that many of her contemporaries could not, and Cocteau frequently found himself defending the poetic genius of his friend.(1) Anna de Noailles has the dubious distinction of being the most written about femme de lettres of her day, because although she was by far the star woman poet of her generation, the quality of her poetry was a hotly debated topic, as were the reasons for her enormous popularity.(2) Reaction to her writing was mixture of oui and non, determined in part by the various biases and expectations of her readers. -
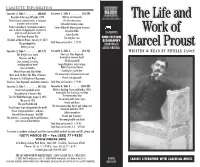
Marcel Proust
C ASSETTE I NFORMATION Cassette 1, Side 1. (40:48) Cassette 1, Side 2 . (38:59) Reynaldo Hahn sings Offrande, 1909 Military service (cont) The Life and Three fictional creative artists: a composer, The first short story a painter and an author Influential drawing rooms Proust’s episodes of ‘involuntary memory’ Comte Robert de Montesquiou-Fezensac were a means of digging into sensation in Reynaldo Hahn Work of order to reach the heart of it 3 CASSETTES Lucien Daudet The Franco-Prussian War The Dreyfus Case NON-FICTION The birth of Marcel Proust, January 10, 1871 Total Time on Cassette 1: 1:19:47 BIOGRAPHY The goodnight kiss UNABRIDGED Marcel Proust Military service AUDIO-ORIGINAL Cassette 2, Side 1. (41:17) Cassette 2, Side 2. (38:15) W RITTEN & READ BY N EVILLE J ASON The Dreyfus Case (cont) Time Lost, Time Regained; Pleasures and Days involuntary memory (cont) Jean Santeuil, the early, Alfred Agostinelli autobiographical novel Sergei Diaghilev, Jean Cocteau, Anna de Noailles Pablo Picasso and friends Marcel Proust and John Ruskin Looking for a publisher More work: Ruskin’s The Bible of Amiens The manuscript is delivered to Grasset The move to 102 Boulevard Haussmann Proust and Agostinelli Time Lost, Time Regained; involuntary memory Total Time on Cassette 2: 1:19:32 Cassette 3, Side 1. (41:28) Cassette 3, Side 2 . ((38:17) Proust and Agostinelli (cont) Within a Budding Grove published in 1919, The publication of Swann’s Way winning the Prix Goncourt, and then The Guermantes Way The First World War begins, August 3, 1914 The meeting with