Phèdre, Tragédie
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Marins Sous La Coupole
Marins sous la Coupole Le 22 juin 1989 dans son discours d’accueil de Jacques-Yves COUSTEAU à l’Académie française l’académicien Bertrand Poirot-Delpech déclarait : "Vous voilà le septième officier de la Royale à prendre le Quai Conti à l’abordage, après l’amiral d’Estrées en 1715, l’amiral de la Gravière en 1888, Pierre Loti en 1891, Maurice de Broglie en 1934, Claude Farrère en 1935, et, en 1936, l’amiral Lacaze, ministre de la Marine pendant la Grande Guerre, cet amiral un peu coléreux, à qui Henri Mondor, en bon médecin, lança un jour, pour prévenir un coup de sang : « Amiral, attention à vos vaisseaux ! » Il avait omis l’amiral Jean-Baptiste-Henri de VALINCOUR élu en 1699 et il faut rajouter Michel Serres élu académicien en 1990 ce qui porte à neuf le nombre d’officiers de marine "Immortels". http://www.academie-francaise.fr 1699 Jean-Baptiste-Henri de VALINCOUR (1653-1730) Historiographe, amiral Élu en 1699 au fauteuil 13 Prédécesseur : Jean RACINE Successeur : Jean-François LERIGET de LA FAYE Né à Paris, le 1er mars 1653. Secrétaire des commandements du comte de Toulouse, prince du sang et grand amiral, il fut historiographe de France. Écrivain et poète de peu de valeur, il fut l’ami fidèle de Racine et de Boileau : il était dépositaire du manuscrit de la Vie de Louis XIV par Racine ; cette pièce précieuse fut brûlée, en 1726, dans l’incendie qui dévora les sept ou huit mille volumes formant la bibliothèque de Valincour. Élu le 30 mai 1699 en remplacement de Racine, il fut reçu par La Chapelle le 27 juin suivant, et harangua, comme directeur, le roi Louis XV lorsqu’il visita l’Académie le 22 juillet 1719. -

Bérénice, Tragédie
BÉRÉNICE TRAGÉDIE RACINE, Jean 1671 Publié par Gwénola, Ernest et Paul Fièvre, Septembre 2015 - 1 - - 2 - BÉRÉNICE TRAGÉDIE PAR M. RACINE À PARIS Chez CLAUDE BARBIN, au Palais, sur le second perron de la Sainte-Chapelle. M. DC. LXXI. AVEC PRIVILÈGE DU ROI. - 3 - À Monseigneur COLBERT. SECRÉTAIRE D'ÉTAT, Contrôleur général des finances, Surintendant des bâtiments, grand Trésorier des Ordres du roi, Marquis de Seignelay, etc. MONSEIGNEUR, Quelque juste défiance que j'aie de moi-même et de mes ouvrages, j'ose espérer que vous ne condamnerez pas la liberté que je prends de vous dédier cette tragédie. Vous ne l'avez pas jugée tout à fait indigne de votre approbation. Mais ce qui fait son plus grand mérite auprès de vous, c'est, MONSEIGNEUR, que vous avez été témoin du bonheur qu'elle a eu de ne pas déplaire à Sa Majesté. L'on sait que les moindres choses vous deviennent considérables, pour peu qu'elles puissent servir ou à sa gloire ou à son plaisir. Et c'est ce qui fait qu'au milieu de tant d'importantes occupations, où le zèle de votre prince et le bien public vous tiennent continuellement attaché, vous ne dédaignez pas quelquefois de descendre jusqu'à nous, pour nous demander compte de notre loisir. J'aurais ici une belle occasion de m'étendre sur vos louanges, si vous me permettiez de vous louer. Et que ne dirais-je point de tant de rares qualités qui vous ont attiré l'admiration de toute la France, de cette pénétration à laquelle rien n'échappe, de cet esprit vaste qui embrasse, qui exécute tout à la fois tant de grandes choses, de cette âme que rien n'étonne, que rien ne fatigue ? Mais, MONSEIGNEUR, il faut être plus retenu à vous parler de vous-même et je craindrais de m'exposer, par un éloge importun, à vous faire repentir de l'attention favorable dont vous m'avez honoré ; il vaut mieux que je songe à la mériter par quelques nouveaux ouvrages : aussi bien c'est le plus agréable remerciement qu'on vous puisse faire. -
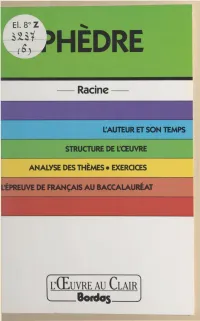
Phèdre, Racine
PHEDRE Racine par Christian GAMBOTTI Ancien élève de l'E.N.S. de Saint-Cloud Agrégé de Lettres modernes L'ŒUVRE AU CLAIR Bordas Maquette de couverture : Michel Méline. Maquette intérieure : Jean-Louis Couturier. Document de la page 3 : portrait de Racine, gravure de Edelinck, XVIIe siècle. Musée Carnavalet, Paris. Ph. © Bulloz-Archives Photeb. "Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur, ou de ses ayants-droit, ou ayants-cause, est illicite (loi du 11 mars 1957, alinéa le' de l'article 40) Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait une contrefaçon sanction- née par les articles 425 et suivants du Code pénal. La loi du 1 1 mars 1957 n'autorise, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, que les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective d'une part, et d'autre part, que les analyses et les courtes cita- tions dans un but d'exemple et d'illustration" @ Bordas, Paris, 1989. ISBN 2-04-018278-0 ISSN 0993-6297 RACINE 1639 - 1699 DRAMATURGE 1677 - Phèdre de 1664 à 1691 - Onze tragédies 1668 - Une comédie Les Plaideurs La faiblesse aux humains n'est que trop naturelle. (Racine, Phèdre, Acte IV, scène 6). Racine ET SON TEMPS Points de repère M Racine est un dramaturge du XVIIe siècle, auteur essentiellement de tragédies*. Son œuvre théâtrale ne comprend que douze pièces, ce qui est peu par rapport à Corneille (33 pièces) ou Molière (34 pièces). -

Tragedy Syllabus
ENG 339 Tragedy T/Th 11:30am-12:50pm Merrill 403 Instructor: Professor Daniel Sack Office: Johnson Chapel, Room 30C Hours: Tuesday 1-3pm (and by appointment) Contact: [email protected] Course Description A survey of some of the many lives and deaths of tragedy as a theatrical form, this course considers representative plays in the genre from its origins in Ancient Greece through to the crisis of the form in the 20th and 21st century. This is not a seminar in Classics; it is an investigation of a genre as a mode of thought and artistic production. However, all tragedy to follow revolves around the initial statements in the Classical period, so we will ground our discussions here. Signal moments in other times and traditions inform subsequent readings, but our primary focus will be upon the way in which modern and contemporary artists in the English language have revised, rehearsed, and rejected the oldest genre of Western theatrical production. One could certainly speak of a broader tragic vision or sensibility extending into other forms of artistic production (novels and films, for eXample) or even into everyday life as in the newscaster’s daily lament about whatever catastrophe or downfall. In this course we are concerned with how tragedy is performed in the theatre and what its location there promises for its audiences. In addition to the plays we read, theory and philosophy on the nature of the tragic will help guide our conversation. Performance thinks differently than literature, differently than philosophy. Play scripts presuppose a staged performance and represent but one facet of a larger artistic whole, so too our readings of plays and theory will always refer to what is possible or expected upon the stage. -

Jean Racine (1639-1699)
Jean Racine (1639-1699) Biographie ean Racine (22 décembre 1639 à 21 avril 1699) naquit à la Ferté Milon, dans l'Aisne. Issu d'un milieu bourgeois plutôt, il fut orphelin de mère à 2 ans et de père à 4 ans. Il fut alors J (1643) recueilli par ses grands-parents maternels. Les relations avec l'abbaye janséniste de Port-Royal imprégnèrent toute la vie de Racine. Il y subit l'influence profonde des «solitaires» et de leur doctrine exigeante. L'une de ses tantes y fut religieuse ; sa grand-mère s'y retint à la mort de son mari (1649). L'enfant fut alors admis aux Petites Écoles à titre gracieux. Deux séjours dans des collèges complétèrent sa formation : le collège de Beauvais (1653-1654) et le collège d'Harcourt, à Paris, où il fit sa philosophie (1658). À 20 ans, nantis d'une formation solide mais démuni de biens, Racine fut introduit dans le monde par son cousin Nicolas Vitart (1624-1683), intendant du duc de Luynes. Il noua ses premières relations littéraires (La Fontaine) et donna ses premiers essais poétiques. En 1660, son ode la Nymphe de la Seine à la Reine, composée à l'occasion du mariage de Louis XIV, retint l'attention de Charles Perrault. Mais, pour assurer sa subsistance, il entreprit de rechercher un bénéfice ecclésiastique et séjourna à Uzès (1661-1663) auprès de son oncle, le vicaire général Antoine Sconin. Rentré à Paris en 1663, il se lança dans la carrière des lettres. 140101 Bibliotheca Alexandrina Établi par Alaa Mahmoud, Mahi Rabie et Salma Hamza Rejetant la morale austère de Port-Royal et soucieux de considération mondaine et de gloire officielle, Racine s'orienta d'abord vers la poésie de cour : une maladie que contracta Louis XIV lui inspira une Ode sur la convalescence du Roi (1663). -

Three Different Jocastas by Racine, Cocteau and Cixous
University of Central Florida STARS Electronic Theses and Dissertations, 2004-2019 2010 Three Different Jocastas By Racine, Cocteau And Cixous Kyung Mee Joo University of Central Florida Part of the Theatre and Performance Studies Commons Find similar works at: https://stars.library.ucf.edu/etd University of Central Florida Libraries http://library.ucf.edu This Masters Thesis (Open Access) is brought to you for free and open access by STARS. It has been accepted for inclusion in Electronic Theses and Dissertations, 2004-2019 by an authorized administrator of STARS. For more information, please contact [email protected]. STARS Citation Joo, Kyung Mee, "Three Different Jocastas By Racine, Cocteau And Cixous" (2010). Electronic Theses and Dissertations, 2004-2019. 1623. https://stars.library.ucf.edu/etd/1623 THREE DIFFERENT JOCASTAS BY RACINE, COCTEAU, AND CIXOUS by KYUNG MEE JOO A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in the Department of Theatre in the College of Arts and Humanities at the University of Central Florida Orlando, Florida Fall Term 2010 Major Professor: Julia Listengarten ©2010 Kyung Mee Joo ii ABSTRACT This study is about three French plays in which Jocasta, the mother and wife of Oedipus, is shared as a main character: La Thébaïde (The Theban Brothers) by Jean Racine, La Machine Infernale (The Infernal Machine) by Jean Cocteau, and Le Nom d’Oedipe (The Name of Oedipus) by Hélène Cixous. Jocasta has always been overshadowed by the tragic destiny of Oedipus since the onset of Sophocles’ works. Although these three plays commonly focus on describing the character of Jocasta, there are some remarkable differences among them in terms of theme, style, and stage directions. -

H-France Review Vol. 19 (September 2019), No. 188 Jennifer Tamas, Le
H-France Review Volume 19 (2019) Page 1 H-France Review Vol. 19 (September 2019), No. 188 Jennifer Tamas, Le Silence trahi. Racine ou la déclaration tragique. Collection Travaux du Grand Siècle no. 47. Geneva: Librairie Droz S.A., 2018. 261 pp. Bibliography, indices (proper names, plays, and characters in Racine, plays other than by Racine), table of contents. €41.15 (pb). ISBN 978-2-600-05870-4; €39.21 (pdf). ISBN PDF: 978-2-600-15870. Review by Juliette Cherbuliez, University of Minnesota. Jennifer Tamas’s Le Silence trahi. Racine ou la déclaration tragique demands a certain kind of reading: the patient, suspensive kind. Offering an anatomy of verbal silence in the writing of this best-known of the major seventeenth-century playwrights Jean Racine, Le Silence trahi explores how the unsaid becomes for Racine a dramaturgical ordering principle. Whereas traditional scholarship treats silence as a product of the lack of speech, or as the failure of speech, Tamas teases out a dynamic relationship between speech and its impossibility, whose tense logic creates the essence of Racinian tragedy. This synopsis might suggest that Tamas’s work is of greatest concern to a narrow group of readers--those well-versed in seventeenth-century French tragedy and its critical legacy, and specifically readers of Racine. And many readers of H-France may not immediately see the significance of Tamas’s work for research questions beyond those exploring the rhetoric and poetics of the highest genre in the canon of the so-called “grand siècle.” Le Silence trahi nevertheless has specific application to scholars interested, from any philosophical or methodological register, in what words can and cannot do. -

Claudel Pour Racine, Les Raisons D'un Revirement
Article paru dans le Bulletin de la Société Paul Claudel n°2019 -1, n°227 Reproduit avec l'aimable autorisation des éditions Classiques Garnier et de l'auteur. CLAUDEL POUR RACINE, LES RAISONS D’UN REVIREMENT Claudel vivant, Racine mort, le premier ne craint pas de batailler avec le second dans le cours d’un va-et-vient entre art de dire et art d’aimer que traduit à merveille sa Conversation sur Jean Racine. En février 1935, le dramaturge alors âgé de 67 ans assiste à une repré- sentation de Bérénice à la Comédie-Française. Voici ce qu’il note dans son Journal : Assisté à Bérénice […] avec un ennui écrasant. Ce marivaudage sentimental, cette casuistique inépuisable sur l’amour, est ce que je déteste le plus dans la littérature française. Le tout dans un ronron élégant et gris, aussi éloigné de notre français vulgaire et gaillard que du turc et de l’abyssin. C’est distingué et assommant. On parle toujours de la fameuse mesure classique et racinienne, mais tirer 5 actes de cette anecdote, c’est tout de même trop. Le rouet iné- puisable des phrases, des alexandrins et des dissertations. Tout se passe en faux départs et en assaut de sentiments nobles et artificiels développés dans l’abstrait. Penser qu’on donne Racine comme base de l’instruction littéraire de nos pauvres enfants ! C’est extravagant1. La mauvaise humeur du spectateur exacerbe son point de vue négatif, signalé de façon intermittente par son Journal, et auquel son essai de 1925 sur le vers français a offert l’espace nécessaire à une plus ample explica- tion. -

Le « Parlé-Chanté » Dans Phèdre De Jean Racine Et Partage De Midi De Paul Claudel
Quêtes litt éraires nº 6, 2016 Marine Deregnoncourt Université Catholique de Louvain Louvain-la-Neuve Le « parlé-chanté » dans Phèdre de Jean Racine et Partage de midi de Paul Claudel Introduction Les Anciens [...] distinguaient trois sortes de chants, qu’ils nommaient voix continue quand on parle, voix intermédiaire, quand on lit des vers héroïques ou quand on déclame, voix séparée par des intervalles, quand on chante, ce qui s’appelle encore unité mélodique (Tack, 2001 : 111). Comment la forme hybride du « parlé-chanté » apparaît-elle spécifiquement dans Phèdre de Jean Racine et Partage de midi de Paul Claudel ? Telle est la problématique que nous nous proposons d’aborder dans cet article. Pour ce faire, notre réflexion se divisera en trois parties. Tout d’abord, il s’agira, dans la première partie, de définir ce qu’il faut précisément entendre par le « parlé-chanté ». À quoi cette notion renvoie-t-elle précisément et est-elle liée au Sprechgesang schön- bergien ? Tandis que la deuxième partie concernera Phèdre de Jean Racine, la troi- sième et dernière partie se focalisera sur Partage de midi de Paul Claudel. Comment les protagonistes de la tragédie racinienne et du drame claudélien se trouvent-ils à la lisière du parlé et chanté ? Comment ces deux dramaturges se positionnent-ils face aux discours de leur temps ? Telles sont les questions que nous nous posons et auxquelles nous allons tenter de répondre. Marine Deregnoncourt – candidate à l’École Doctorale en Langues et Lettres de l’Université Catholique de Louvain. Adresse pour correspondance : B. – Place Blaise Pascal, 1, 1348 Louvain-la Neuve (Belgique) ; e-mail : [email protected] 46 Marine Deregnoncourt 1. -

Seminar Demonstration Files
Demonstration of overlays (i) 1 Seminar demonstration files Overlays (I) Denis Girou June 2002 With Acroread, CTRL-L switch between full screen and window mode Seminar demonstration files – Overlays (I) Version 1.0 – June 2002 Denis Girou Demonstration of overlays (i) 2 1 – Introduction . 3 2 – Cumulative overlays . 8 3 – Cumulative overlays with PSTricks nodes . 16 4 – Progressive overlays . 17 5 – Progressive overlays with PSTricks nodes . 18 6 – External files inclusion . 19 Seminar demonstration files – Overlays (I) Version 1.0 – June 2002 Denis Girou Demonstration of overlays (i) 3 1 – Introduction ☞ Overlays are a key feature for interactive screen presentations ☞ Seminar implement since it beginning a powerful mechanism for the management of overlays (in fact, it is only an encapsulation of the general PSTricks mechanism for overlays, implemented in the PostScript language – but such a mechanism is really useful only for slides!) ☞ It was written to be able to generate several plastic slides which will be superimposed on a projector. Nevertheless, exactly the same mechanism work too for screen oriented presentations. ☞ The overlays also allow to compose animated graphics, if the PDF file viewver allow to show the slides automatically (as Acrobat Reader does) – see sem-dem6.pdf ☞ The only change that we made concern the total number of overlays allowed on the same slide: we increase the limit from 10, which is clearly not enough for screen presentations, and specially for 2 animated graphics, to 676 (26 ) Seminar demonstration files – -

ATHALIE, TRAGÉDIE Tirée De L'écriture Sainte
ATHALIE TRAGÉDIE tirée de l'écriture sainte. Jean RACINE (1639-1699) Jean-Baptiste MOREAU (1656?-1733) (musique) 1691 - 1 - Texte établi par Paul FIEVRE, Mai 2002, revu novembre 2016 Publié par Ernest et Paul Fièvre pour Théâtre-Classique.fr, Mai 2020. Pour une utilisation personnelle ou pédagogique uniquement. - 2 - ATHALIE TRAGÉDIE tirée de l'écriture sainte. Jean Racine À PARIS, chez Denys Thierry, rue Saint-Jacque, à la ville de Paris. M. DC. XCI Avec Privilège de sa Majesté. - 3 - Préface Tout le monde sait que le royaume de Juda était composé de deux tribus, de Juda et de Benjamin, et que les dix autres tribus qui se révoltèrent contre Roboam composaient le royaume d'Israël. Comme les rois de Juda étaient de la maison de David, et qu'ils avaient dans leur partage la ville et le temple de Jérusalem, tout ce qu'il y avait de prêtres et de lévites se retirèrent auprès d'eux, et leur demeurèrent toujours attachés. Car, depuis que le temple de Salomon fut bâti, il n'était plus permis de sacrifier ailleurs, et tous ces autres autels qu'on élevait à Dieu sur des montagnes, appelés par cette raison dans l'Ecriture les hauts lieux, ne lui étaient point agréables. Ainsi le culte légitime ne subsistait plus que dans Juda. Les dix tribus, excepté un très petit nombre de personnes, étaient ou idolâtres ou schismatiques. Au reste, ces prêtres et ces lévites faisaient eux-mêmes une tribu fort nombreuse. Ils furent partagés en diverses classes pour servir tour à tour dans le temple, d'un jour de sabbat à l'autre. -

Introduction to Friz's Analyses of Racine's Plays
Introduction to Friz’s Analyses of Racine’s Plays The famous French playwright Jean Racine (1639–1700) was an important mod- el for Andreas Friz. His role in Friz’s letter on tragedies has already been dis- cussed in the general introduction to this book. The current appendix will elucidate Friz’s analysis of the dramatic works of the French-Classicist play- wright. Friz’s Analysis tragaediarum Racini takes up the first part (f. 1r–74v) of manuscript ms 938, in which also the letter on tragedies is included. It analyses most of Racine’s plays: La Thébaïde ou Les Frères Ennemis (1664), Alexandre Le Grand (1665), Andromaque (1667), Britannicus (1669), Bérénice (1670), Bajazet (1672), Mithridate (1673), Iphigénie (1674), Phèdre (1677), Esther (1689) and Athalie (1691). Only the comedy Les Plaideurs (The Litigants, 1668) is missing, which can be explained by the fact that it was a farce, while the others are all tragedies. From Friz’s letter on tragedies, his aversion of the genre of the farce is clear. Esther is discussed in the original 5-act version that Racine wrote for the girls’ school of Saint Cyr, and not the now more famous 3-act version. This 5-act version was also included in contemporary editions of Racine’s collection of works, which were Friz’s source for these plays. In the following introduction, the structure, contents and sources of these analyses will be discussed, taking a closer look at the example of one of Racine’s most famous plays, Phèdre, and comparing this to the other anal- yses.