Histoires D' Amélioration
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
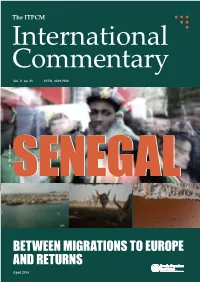
Senegal, Between Migrations to Europe and Returns
The ITPCM International Commentary Vol. X no. 35 ISSN. 2239-7949 in this issue: in this issue: SENEGALSENEGAL BETWEEN MIGRATIONS TO EUROPE AND RETURNS April 2014 1 ITPCM International Commentary April 2014 ISSN. 2239-7949 International Training Programme for Conflict Management ITPCM International Commentary April 2014 ISSN. 2239-7949 The ITPCM International Commentary SENEGAL BETWEEN MIGRATIONS TO EUROPE AND RETURNS April 2014 ITPCM International Commentary April 2014 ISSN. 2239-7949 Table of Contents For an Introduction - Senegalese Street Vendors and the Migration and Development Nexus by Michele Gonnelli, p. 8 The Senegalese Transnational The Policy Fallacy of promoting Diaspora and its role back Home Return migration among by Sebastiano Ceschi & Petra Mezzetti, p. 13 Senegalese Transnationals by Alpha Diedhiou, p. 53 Imagining Europe: being willing to go does not necessarily result The PAISD: an adaptive learning in taking the necessary Steps process to the Migration & by Papa Demba Fall, p. 21 Development nexus by Francesca Datola, p. 59 EU Migration Policies and the Criminalisation of the Senegalese The local-to-local dimension of Irregular Migration flows the Migration & Development by Lanre Olusegun Ikuteyijo, p. 29 nexus by Amadou Lamine Cissé and Reframing Senegalese Youth and Jo-Lind Roberts, p. 67 Clandestine Migration to a utopian Europe Fondazioni4Africa promotes co- by Jayne O. Ifekwunigwe, p. 35 development by partnering Migrant Associations Senegalese Values and other by Marzia Sica & Ilaria Caramia, p. 73 cultural Push Pull Factors behind migration and return Switching Perspectives: South- by Ndioro Ndiaye, p. 41 South Migration and Human Development in Senegal Returns and Reintegrations in by Jette Christiansen & Livia Manente, p. -

Road Travel Report: Senegal
ROAD TRAVEL REPORT: SENEGAL KNOW BEFORE YOU GO… Road crashes are the greatest danger to travelers in Dakar, especially at night. Traffic seems chaotic to many U.S. drivers, especially in Dakar. Driving defensively is strongly recommended. Be alert for cyclists, motorcyclists, pedestrians, livestock and animal-drawn carts in both urban and rural areas. The government is gradually upgrading existing roads and constructing new roads. Road crashes are one of the leading causes of injury and An average of 9,600 road crashes involving injury to death in Senegal. persons occur annually, almost half of which take place in urban areas. There are 42.7 fatalities per 10,000 vehicles in Senegal, compared to 1.9 in the United States and 1.4 in the United Kingdom. ROAD REALITIES DRIVER BEHAVIORS There are 15,000 km of roads in Senegal, of which 4, Drivers often drive aggressively, speed, tailgate, make 555 km are paved. About 28% of paved roads are in fair unexpected maneuvers, disregard road markings and to good condition. pass recklessly even in the face of oncoming traffic. Most roads are two-lane, narrow and lack shoulders. Many drivers do not obey road signs, traffic signals, or Paved roads linking major cities are generally in fair to other traffic rules. good condition for daytime travel. Night travel is risky Drivers commonly try to fit two or more lanes of traffic due to inadequate lighting, variable road conditions and into one lane. the many pedestrians and non-motorized vehicles sharing the roads. Drivers commonly drive on wider sidewalks. Be alert for motorcyclists and moped riders on narrow Secondary roads may be in poor condition, especially sidewalks. -

Communauté Rurale OULAMPANE
République du Sénégal Un peuple – Un but – Une foi MINISTERE DE L’HABITAT, DE LA MINISTERE DE L’URBANISME ET DE CONSTRUCTION ET DE L’HYDRAULIQUE L’ASSAINISSEMENT Région de ZIGUINCHOR PLAN LOCAL D’HYDRAULIQUE ET D’ASSAINISSEMENT -PLHA Communauté rurale OULAMPANE (Version finale) JUILLET 2010 Ce document est réalisé sur financement de l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID) dans le cadre de son appui au Gouvernement du Sénégal 1 USAID/PEPAM Millennium Water and Sanitation Program Programme d’Eau Potable et d’Assainissement du Millénaire Cooperative Agreement No 685-A-00-09-00006-00 Accord de cooperation n°685-A-00-09-00006-00 PREPARED FOR / PRÉPARÉ À L’ATTENTION DE Prepared by / Préparé par Agathe Sector RTI International Agreement Officer’s Representative 3040 Cornwallis Road Office of Economic Growth Post Office Box 12194 USAID/Senegal Research Triangle Park, NC 27709-2194 Route des Almadies Phone: 919.541.6000 Almadies BP 49 Dakar, Senegal http://www.rti.org SOMMAIRE SOMMAIRE ........................................................................................................................................................... 2 LISTE DES ABREVIATIONS ............................................................................................................................. 4 FICHE DE SYNTHESE PLHA............................................................................................................................ 5 I. PRÉSENTATION DE LA COMMUNAUTÉ RURALE ................................................................................ -
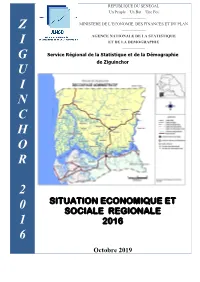
Z I G U I N C H O R 2 0
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------ MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN Z ------------------ AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE I ET DE LA DEMOGRAPHIE ----------------- G Service Régional de la Statistique et de la Démographie de Ziguinchor U I N C H O R 2 0 SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE REGIONALE 1 2016 6 Octobre 2019 COMITE DE DIRECTION Directeur Général BABACAR NDIR Directeur Général Adjoint ALLÉ NAR DIOP Conseiller à l’Action Régionale MAMADOU DIENG Président du CLV SECKENE SENE COMITE DE REDACTION Chef du Service Régional Jean Rodrigue MALOU Adjoint au Chef du Service Régional Alassane AW Le point focal du siège qui a aidé à la rédaction de Bintou Diack Ly la SESR COMITE DE LECTURE ET DE VALIDATION SECKENE SENE DIRECTION GENERALE AMADOU FALL DIOUF CPCCI SERGE MANEL DSDS IDRISSA DIAGNE ENSAE MAMADOU BALDE ENSAE OMAR SENE ENSAE AWA CISSOKHO FAYE DSDS MM. RAMLATOU DIALLO DSECN MANDY DANSOKHO ENSAE MAMADOU DIENG CAR NDEYE BINTA DIEME COLY DSDS MAMADOU AMOUZOU OPCV ADJIBOU OPPAH BARRY OPCV BINTOU DIACK LY DSECN MAMADOU BAH DMIS EL HADJI MALICK GUEYE DMIS ABDOULAYE TALL OPCV MOMATH CISSE CGP MAHMOUTH DIOUF DSDS MORY DIOUSS DSDS ATOUMANE FALL DSDS ALAIN FRANCOIS DIATTA DMIS SES de Ziguinchor, Ed. 2016 AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE Rocade Fann –Bel-air–Cerf-volant – Dakar Sénégal. B.P. 116 Dakar R.P. - Sénégal Téléphone (221) 33 869 21 39 - Fax (221) 33 824 36 15 Site web : www.ansd.sn ; Email: [email protected] Distribution : Division de la Documentation, de la Diffusion et des Relations avec les Usagers Service Régional de la Statistique et de la Démographie de Ziguinchor Adresse : Tilene Complémentaire Tél : 33 991 12 58 B.P. -
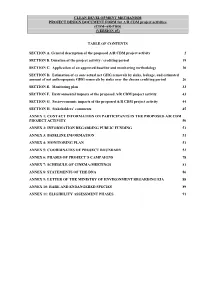
Cdm-Ar-Pdd) (Version 05)
CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM PROJECT DESIGN DOCUMENT FORM for A/R CDM project activities (CDM-AR-PDD) (VERSION 05) TABLE OF CONTENTS SECTION A. General description of the proposed A/R CDM project activity 2 SECTION B. Duration of the project activity / crediting period 19 SECTION C. Application of an approved baseline and monitoring methodology 20 SECTION D. Estimation of ex ante actual net GHG removals by sinks, leakage, and estimated amount of net anthropogenic GHG removals by sinks over the chosen crediting period 26 SECTION E. Monitoring plan 33 SECTION F. Environmental impacts of the proposed A/R CDM project activity 43 SECTION G. Socio-economic impacts of the proposed A/R CDM project activity 44 SECTION H. Stakeholders’ comments 45 ANNEX 1: CONTACT INFORMATION ON PARTICIPANTS IN THE PROPOSED A/R CDM PROJECT ACTIVITY 50 ANNEX 2: INFORMATION REGARDING PUBLIC FUNDING 51 ANNEX 3: BASELINE INFORMATION 51 ANNEX 4: MONITORING PLAN 51 ANNEX 5: COORDINATES OF PROJECT BOUNDARY 52 ANNEX 6: PHASES OF PROJECT´S CAMPAIGNS 78 ANNEX 7: SCHEDULE OF CINEMA-MEETINGS 81 ANNEX 8: STATEMENTS OF THE DNA 86 ANNEX 9: LETTER OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT REGARDING EIA 88 ANNEX 10: RARE AND ENDANGERED SPECIES 89 ANNEX 11: ELIGIBILITY ASSESSMENT PHASES 91 SECTION A. General description of the proposed A/R CDM project activity A.1. Title of the proposed A/R CDM project activity: >> Title: Oceanium mangrove restoration project Version of the document: 01 Date of the document: November 10 2010. A.2. Description of the proposed A/R CDM project activity: >> The proposed A/R CDM project activity plans to establish 1700 ha of mangrove plantations on currently degraded wetlands in the Sine Saloum and Casamance deltas, Senegal. -

FY20 – Work Plan
FY20 – Work Plan Work Plan Year 3 Feed the Future Senegal Kawolor Originally Submitted September 2, 2019 Revised Submission November 4, 2019 Final Revision 30 January 2020 Cooperative Agreement No. 72068518CA00001 The National Cooperative Business Association • CLUSA International About Feed the Future Senegal Kawolor Feed the Future Sénégal Kawolor is a five-year USAID-funded cooperative agreement to increase the consumption of nutritious and safe diets within the Feed the Future Zone of Influence in Senegal. The National Cooperative Business Association, CLUSA International (NCBA CLUSA) and its partners, Dimagi Inc., Helen Keller International (HKI), JSI Research and Training Institute (JSI), and Sheladia Associates, Inc., are implementing the five-year cooperative agreement from November 2, 2017 through November 1, 2022. Disclaimer This report is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID) under the terms of the Cooperative Agreement 72068518CA00001, managed by NCBA CLUSA. The contents are the responsibility of NCBA CLUSA and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government. NCBA CLUSA 1775 Eye Street NW 8th Floor Washington, DC 20006 [email protected] www.ncbaclusa.coop Feed the Future Senegal Kawolor, FY20 Work Plan 2 List of Acronyms AIP Annual Investment Plans AMELP Activity Monitoring, Evaluation and Learning Plan CSP CultiVert Solution Provider CDP Communal Development Plans CLA Collaborating Learning and Adapting -

The Mouvement Des Forces Démocratiques De Casamance: the Illusion of Separatism in Senegal? Vincent Foucher
The Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance: The Illusion of Separatism in Senegal? Vincent Foucher To cite this version: Vincent Foucher. The Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance: The Illusion of Sepa- ratism in Senegal?. Lotje de Vries; Pierre Englebert; Mareike Schomerus. Secessionism in African Politics, Palgrave Macmillan, pp.265-292, 2018, Palgrave Series in African Borderlands Studies, 978- 3-319-90206-7. 10.1007/978-3-319-90206-7_10. halshs-02479100 HAL Id: halshs-02479100 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02479100 Submitted on 12 Mar 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. CHAPTER 10 The Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance: The Illusion of Separatism in Senegal? Vincent Foucher INTRODUCTiON On December 26, 1982, the Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance (MFDC) voiced for the first time its demand for the indepen- dence of Casamance, the southern region of Senegal. This demand launched the longest, currently running violent conflict in Africa. The MFDC can thus lay claim to having led Africa’s second “secessionist moment”1 of the 1980s, after the first secessionist phase of the 1960s. Over the years, the Casamance conflict has killed several thousand people. -

Senegal- Researched and Compiled by the Refugee Documentation Centre of Ireland on 10 February 2011
Senegal- Researched and compiled by the Refugee Documentation Centre of Ireland on 10 February 2011 Information on heavy fighting in Casamance area of Senegal from December 2010 to present. Information on MFDC rebels and government soldiers fighting in Bignona which is close to Gambian border. An Agence France Presse report on clashes in the Casamance region of Senegal in December 2010 states: “Suspected separatist rebels on Monday killed five soldiers during clashes in southern Senegal's troubled Casamance region, the army's public relations wing said. This is the heaviest toll suffered by Senegalese troops since six soldiers were killed in October 2009 by suspected rebels waging one of Africa's longest running insurgencies in a bid for independence. ‘There were indeed losses. Five soldiers died following clashes this morning’ in the Bignona area, near the border with Gambia, an official at the military's public relations department told AFP.” (Agence France Presse (27 December 2010) Suspected rebels kill five Senegalese troops: military) See also Agence France Presse report which states: “The Senegalese army pressed on with search operations in the southern Casamance region Tuesday, a day after losing seven soldiers in clashes with suspected separatist rebels. ‘We are continuing our search operations on the ground,’ said an officer in Bignona, in northern Casamance, where firefights took place Sunday and Monday between the Senegalese army and suspected members of the MFDC (Movement of Democratic Forces of Casamance). Monday, military sources said the soldiers were ambushed by the rebels. But the army's public relations wing said Tuesday four of those killed were involved in a car accident, without giving further details. -

IOM Senegal COVID-19 Response
IOM Senegal COVID-19 Response Activity Report: Migration Health Department – March to September 2020 60 points of entry (PoEs) were reinforced to scale up The Warning Team of the Ministry of Health and Social surveillance, prevention and communication of risks Action and Blaise Diagne International Airport (AIBD) about COVID-19. Border Epidemiological Surveillance Centre were rein- 60 PoEs were assessed to identify their public health forced and supported in staffing. needs and capacities related to the COVID-19 re- Financial support: XOF 104,000,000 or $ 185,000 sponse. 1,295 agents received training in health control and preventive measures against COVID-19 at 56 terrestri- al PoEs and 4 other priority sites. 15,000 materials and equipment were distributed at PoEs (including hand-washing stations, thermoflashs, face masks and hygiene items). Point d’entrée de Rosso, Saint-Louis © OIM, 07.20 54 community radio programmes, 1 awareness- raising caravan, 1 awareness-raising campaign were conducted in border health districts. 160 community relays were supported to conduct health control at PoEs and home visits in border health districts. Training at the PoE of Doumbé Diabé (Saint-Louis) © IOM, 09.07.20 COVID-19 Situation Overview in Senegal On 2nd March 2020, Senegal reported its first case of COVID-19. After closing Blaise Diagne International Airport (AIBD) on 13 As of 30 September 2020, the official toll included 14,982 con- March 2020, priority was given to terrestrial PoEs to prevent firmed cases, 2,233 still under treatment, 12,437 recovered, 311 the spread of the COVID-19 through travellers’ movement. -

Communauté Rurale De MLOMP (Bignona)
République du Sénégal Un peuple – Un but – Une foi MINISTERE DE L’URBANISME ET MINISTERE DE L’HABITAT, DE LA DE L’ASSAINISSEMENT CONSTRUCTION ET DE L’HYDRAULIQUE REGION DE ZIGUINCHOR PLAN LOCAL D’HYDRAULIQUE ET D’ASSAINISSEMENT -PLHA Communauté rurale de MLOMP (Bignona) (Version Finale) JUILLET 2010 Ce document est réalisé sur financement de l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID) dans le cadre de son appui au Gouvernement du Sénégal 1 USAID/PEPAM Millennium Water and Sanitation Program Programme d’Eau Potable et d’Assainissement du Millénaire Cooperative Agreement No 685-A-00-09-00006-00 Accord de cooperation n°685-A-00-09-00006-00 PREPARED FOR / PRÉPARÉ À L’ATTENTION DE Prepared by / Préparé par Agathe Sector RTI International Agreement Officer’s Representative 3040 Cornwallis Road Office of Economic Growth Post Office Box 12194 USAID/Senegal Research Triangle Park, NC 27709-2194 Route des Almadies Phone: 919.541.6000 Almadies BP 49 Dakar, Senegal http://www.rti.org SOMMAIRE I. PRÉSENTATION DE LA COMMUNAUTÉ RURALE .............................................. 6 1.1. CARACTERISTIQUES GENERALES .......................................................................... 6 1.1.1. Situation géographique .............................................................................. 6 1.1.2. Climat ........................................................................................................ 7 1.2. DEMOGRAPHIE .................................................................................................. -
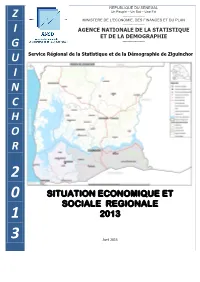
Z I G U I N C H
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi Z ------------------ MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN ------------------ I AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE G ------------------ Service Régional de la Statistique et de la Démographie de Ziguinchor U I N C H O R 2 0 SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE REGIONALE 1 2013 3 Avril 2015 ANNEXES ANNEXE 1 : Structure de la population de Ziguinchor gage ZIGUINCHOR Masculin Féminin Total 0-4 36,671 34,917 71,588 5-9 37,766 35,320 73,087 10-14 38,805 35,004 73,808 15-19 37,194 31,069 68,263 20-24 27,524 23,384 50,908 25-29 21,194 19,116 40,310 30-34 17,012 16,077 33,090 35-39 14,425 13,391 27,815 40-44 11,574 11,409 22,983 45-49 9,264 10,241 19,505 50-54 8,015 8,938 16,953 55-59 6,676 7,362 14,038 60-64 5,124 6,390 11,513 64-69 3,655 4,839 8,494 70-74 2,985 3,976 6,960 75-79 1,898 2,685 4,582 80-84 1,187 1,866 3,052 85-89 505 746 1,251 90-94 211 375 584 95 et plus 128 233 367 ND TOTAL 281,813 267,338 549,151 Source : ANSD ANSD/SRSD Ziguinchor : Situation Economique et Sociale régionale - 2013 116 ANNEXE 1’ : POPULATION DE ZIGUINCHOR EN 2013/ (RGPHAE/2013) SELON LES LOCALITES ET PAR SEXE Homme Femme Totale REGION ZIGUINCHOR 281 814 267 338 549 152 ZONE URBAINE 127 747 124 510 252 257 ZONE RURALE 154 067 142 828 296 895 DEPARTEMENT BIGNONA 130 880 121 676 252 556 COMMUNE 21 101 21 034 42 135 Commune BIGNONA 13 853 13 973 27 826 Commune THIONK-ESSYL 4 193 4 196 8 389 Commune DIOULOULOU 3 055 2 865 5 920 ARRONDISSEMENT KATABA 1 39 418 34 922 74 340 Commune Rurale -

Ending Rural Hunger: the Case of Senegal
ENDING RURAL HUNGER The case of Senegal October 2017 www.endingruralhunger.org Ibrahima Hathie, Boubacar Seydi, Lamine Samaké, and Souadou Sakho- Jimbira Dr. Ibrahima Hathie is the Research Director at the Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR) in Senegal. Boubacar Seydi is a statistician at IPAR. Lamine Samaké is a research assistant at IPAR. Souadou Sakho-Jimbira is a senior researcher at IPAR. Author’s note and acknowledgements This report was prepared by Dr. Ibrahima Hathie, Boubacar Seydi, Lamine Samaké, and Souadou Sakho- Jimbira of the Initiative Prospective Agricole et Rurale as part of the Ending Rural Hunger project led by Homi Kharas. The team at the Africa Growth Initiative within the Global Economy and Development program of the Brookings Institution, led by Eyerusalem Siba and comprising Amy Copley, Christina Golubski, Mariama Sow, and Amadou Sy, oversaw the production of the report. Christina Golubski provided design and editorial assistance. John McArthur provided invaluable feedback on the report. Data support was provided by Lorenz Noe, Krista Rasmussen, and Sinead Mowlds. The authors wish to thank Mariama Kesso Sow, Isseu Dieye, Yacor Ndione, Ahmadou Ly, Ndeye Mbayang Kébé and Mayoro Diop for their support in data collection and in interviews with key stakeholders. We are also grateful to many people (civil servants, donors, technical assistance) who have graciously accepted to share their views. This study was supported by a grant from Brookings. This paper reflects the views of the author only and not those of the Africa Growth Initiative. The Brookings Institution is a nonprofit organization devoted to independent research and policy solutions.