ALS 1992 31 1.Pdf (2.5
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Korrekturen Und Ergänzungen Zur Mikrolepidopterenfauna Baden-Württembergs Und Angrenzender Gebiete - 2
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart Jahr/Year: 2009 Band/Volume: 44_2009 Autor(en)/Author(s): Hausenblas Dietger Artikel/Article: Korrekturen und Ergänzungen zur Mikrolepidopterenfauna Baden-Württembergs und angrenzender Gebiete - 2. Beitrag. 81-107 © Entomologischer Verein Stuttgart e.V.;download www.zobodat.at 81 Korrekturen und Ergänzungen zur Mikrolepidopterenfauna Baden-Württembergs und angrenzender Gebiete - 2. Beitrag Dietger Hausenblas, Stuttgart Abstract This paper is the author’s second contribution to the microlepidoptera fauna of Baden-Wuerttemberg and neighbouring regions. As a result of recent collecting and of a review of historical specimens in the mu- seums of Karlsruhe and Stuttgart several species are reported as new to the fauna of Baden- Wuerttemberg whereas some others have to be deleted from the faunal list. Two species - Metalampra italica Baldizzone , 1977 and Stenoptilia mariaeluisae B igot & P icard , 2002 - are new for Germany. In an appendix the geographical colour-code-system of the labels in the C. Reutti collection is elucidated. Zusammenfassung In diesem zweiten Beitrag des Autors zur Microlepidopterenfauna von Baden-Württemberg und benachbarter Regionen sind erneut Ergebnisse sowohl aktueller Aufsammlungen als auch von Nachuntersuchung historischen Materials in den beiden großen Naturkundemu seen des Landes in Verbindung mit der Auswertung von Literaturmeldungen zusammenge stellt. Zahlreiche Arten können der Fauna hinzugefügt, während andere Meldungen korrigiert werden. Zwei Arten - Metalampra italica Baldizzone , 1977 und Stenoptilia mariaeluisae Bigot & P icard, 2002 - sind neu für Deutschland. Zusätzlich erfolgt in einem Anhang die Auflistung von Fundorten der Sammlungsetiketten von C. Reutti in Verbindung mit der von ihm verwendeten Farbcodierung. -

Sborník SM 2013.Indb
Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec, 31: 67–168, 2013 ISBN 978-80-87266-13-7 Příspěvek k fauně motýlů (Lepidoptera) severních Čech – I On the lepidopteran fauna (Lepidoptera) of northern Bohemia – I Jan Šumpich1), Miroslav Žemlička2) & Ivo Dvořák3) 1) CZ-582 61 Česká Bělá 212; e-mail: [email protected] 2) Družstevní 34/8, CZ-412 01 Litoměřice 3) Vrchlického 29, CZ-586 01 Jihlava; e-mail: [email protected] Abstract. Faunistic records of butterflies and moths (Lepidoptera) found at nine localities of northern Bohemia (Czech Republic) are presented. In total, 1258 species were found, of which 527 species were recorded in Želiňský meandr (Kadaň environs), 884 species in the Oblík National Nature Reserve (Raná environs), 313 species in the Velký vrch National Nature Monument (Louny environs), 367 species in the Třtěnské stráně Nature Monument (Třtěno environs), 575 species in Eváňská rokle (Eváň environs), 332 species in Údolí Podbrádeckého potoka (Mšené-lázně environs), 376 species in Vrbka (Budyně nad Ohří environs), 467 species in Holý vrch (Encovany environs) and 289 species in Skalky u Třebutiček (Encovany environs). The records of Triaxomasia caprimulgella (Stainton, 1851), Cephimallota praetoriella (Christoph, 1872), Niphonympha dealbatella (Zeller, 1847), Oegoconia caradjai Popescu- Gorj & Capuse, 1965, Fabiola pokornyi (Nickerl, 1864), Hypercallia citrinalis (Scopoli, 1763), Pelochrista obscura Kuznetsov, 1978, Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775), Satyrium spini (Denis & Schiffermüller, 1775), Pseudo- philotes vicrama (Moore, 1865), Polyommatus damon (Denis & Schiffermüller, 1775), Melitaea aurelia Nickerl, 1850, Hipparchia semele (Linnaeus, 1758), Chazara briseis (Linnaeus, 1764), Pyralis perversalis (Herrich-Schäffer, 1849), Gnophos dumetata Treitschke, 1827, Watsonarctia casta (Esper, 1785), Euchalcia consona (Fabricius, 1787), Oria musculosa (Hübner, 1808) and Oligia fasciuncula (Haworth, 1809) are exceptionally significant in a broader context, not only in terms of the fauna of northern Bohemia. -

Állattani Közlemények 78. (1992)
o r h ALLATTANI KÖZLEMÉNYEK A MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG ÁLLATTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA SZERKESZTI ANDRÁSSY ISTVÁN 78. KÖTET A Magvai riidománvns \kadcima cs a Pro Kcnovaiula Cultura llungariac Alapítvány ininogutásaval kiadja a MAC! YAK IIIOI (X II Al IAKSASÁC! IW2 ALLATTANI KÖZLEMÉNYEK A MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG ÁLLATTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA SZERKESZTI ANDRÁSSY ISTVÁN A szerkesztőbizottság tagjai: BAKONYI GÁBOR (a szerkesztő munkatársa), DELY OLIVÉR GYÖRGY, DÓZSA-FARKAS KLÁRA, KORSÓS ZOLTÁN, PONYI JENŐ 78. KÖTET Szedés: S&S Sopron Készült: Soproni Nyomda Az Állattani Közlemények a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztályának folyóirata. Elsősor- ban azokat a tanulmányokat közli, amelyek az Állattani Szakosztály ülésein elhangzottak. A szerkesztő kéri a szerzőket, hogy közlésre szánt kéziratukat az illető előadás elhangzása után lehetőle nyomban juttassák el a címére: DR. ANDRÁSSY ISTVÁN ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék Budapest. VIII. Puskin u. 3. 1088 A kéziratokat két gépelt példányban, oldalanként 25-30 sorral (ritka sorközzel gépelve), tipizálás (aláhúzás) nélkül kérjük benyújtani. Az esetleges megjegyzéseket, kívánalmakat külön lapon kell mellékelni. Az egyes cikkek terjedelme általában az egy nyomtatott ívet nem haladhatja meg. Az ábrák lehetnek fehér kartonra vagy pauszpapírra készített vonalas tusrajzok, illetve éles pozitív (fekete-fehér) fényképek. Az irodalomjegyzék összeállítására nézve a jelen kötet irodalomjegyzékei az irányadók. Minden kézirathoz rövid összefoglalást kérünk az idegen nyelvű kivonat számára. A szerzők cikkeikről 60 különlenyomatot kapnak. Állattani Közlemények, 78, 1992 Dr. Loksa Imre (1923-1992) írta: DÓZSA-FARKAS KLÁRA (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék, Budapest) Szomorú szívvel tudatjuk, hogy DR. LOKSA IMRE, a Magyar Biológiai Társaság tttani Szakosztályának elnöke, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állatrendszertani Ökológiai Tanszékének docense, volt tanszékvezető, 1992. június 21-én váratlanul ahúnyt. -
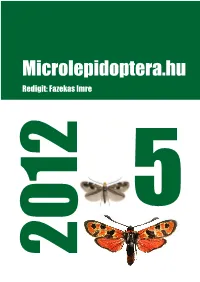
Microlepidoptera.Hu Redigit: Fazekas Imre
Microlepidoptera.hu Redigit: Fazekas Imre 5 2012 Microlepidoptera.hu A magyar Microlepidoptera kutatások hírei Hungarian Microlepidoptera News A journal focussed on Hungarian Microlepidopterology Kiadó—Publisher: Regiograf Intézet – Regiograf Institute Szerkesztő – Editor: Fazekas Imre, e‐mail: [email protected] Társszerkesztők – Co‐editors: Pastorális Gábor, e‐mail: [email protected]; Szeőke Kálmán, e‐mail: [email protected] HU ISSN 2062–6738 Microlepidoptera.hu 5: 1–146. http://www.microlepidoptera.hu 2012.12.20. Tartalom – Contents Elterjedés, biológia, Magyarország – Distribution, biology, Hungary Buschmann F.: Kiegészítő adatok Magyarország Zygaenidae faunájához – Additional data Zygaenidae fauna of Hungary (Lepidoptera: Zygaenidae) ............................... 3–7 Buschmann F.: Két új Tineidae faj Magyarországról – Two new Tineidae from Hungary (Lepidoptera: Tineidae) ......................................................... 9–12 Buschmann F.: Új adatok az Asalebria geminella (Eversmann, 1844) magyarországi előfordulásához – New data Asalebria geminella (Eversmann, 1844) the occurrence of Hungary (Lepidoptera: Pyralidae, Phycitinae) .................................................................................................. 13–18 Fazekas I.: Adatok Magyarország Pterophoridae faunájának ismeretéhez (12.) Capperia, Gillmeria és Stenoptila fajok új adatai – Data to knowledge of Hungary Pterophoridae Fauna, No. 12. New occurrence of Capperia, Gillmeria and Stenoptilia species (Lepidoptera: Pterophoridae) ………………………. -

DOCOB Pelouses Calcaires Du Gâtinais
DOCUMENT D ’O BJECTIFS DU SITE NATURA 2000 FR 1100802 « PELOUSES CALCAIRES DU GATINAIS » DOCUMENT DE COMPILATION PRO NATURA Ile-de-France S/C NaturEssonne 6, route de Montlhéry Octobre 2006 91310 Longpont-sur-Orge Tel : 01 69 01 50 23 – e mail : [email protected] Directive Habitats Ile-de-France – Site des Pelouses calcaires du Gâtinais Document d’Objectifs – Opérateur : Pro Natura Ile-de-France, s/c NaturEssonne DOCUMENT D 'O BJECTIFS DU SITE NATURA 2000 N° FR 1100802 PELOUSES CALCAIRES DU GATINAIS Comité de Pilotage (constitué par arrêté préfectoral n° 2003/PREF-DCL /0271 du 15 décembre 2003) : Représentants de l'Etat et des Le Préfet de l’Essonne, représenté par le Sous-Préfet d’Etampes services déconcentrés Le Directeur Régional de l'Environnement d'Ile-de-France Le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt Représentants des collectivités Le Président du Conseil Régional d’Ile-de-France territoriales et de leurs groupements Le Président du Conseil Général de l'Essonne Le Maire de la commune de Champmotteux Le Maire de la commune de Gironville-sur-Essonne Le Maire de la commune de Maisse Le Maire de la commune de Puiselet-Le-Marais Le Maire de la commune de Valpuiseaux Le Président du Parc Naturel Régional du Gâtinais français Représentants des propriétaires et Le Président de la Chambre Interdépartementale exploitants de biens ruraux situés sur d'Agriculture d'Ile-de-France le site et usagers du site Le Président de la Fédération Interdépartementale des Chasseurs de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines Le Président -

Gortania 30.Indd
GORTANIA - Atti Museo Friul. di Storia Nat. 30 (2008) 221-254 Udine, 31.VII.2009 ISSN: 0391-5859 P. HUEMER, C. MORANDINI BIODIVERSITY OF LEPIDOPTERA WITHIN THE AREA OF VALLE VECCHIA (CAORLE, VENEZIA) WITH SPECIAL REGARD TO NATURE CONSERVATION ASPECTS !"#$%&'($")*++*)!"#",!-#.*)/-&)+-0&/"$$-%&)/-++1*%-*)/& 2*++-)2-!!3&*)4!*"%+-5)2-#-.&*6)!"#)0*%$&!"+*%-)%&7(*%/")*7+& *,0-$$&)!"#,-%2*.&"#&,$&!& Abstract)8)684 species of butter! ies and moths are recorded from the area of Valle Vecchia (Caorle, Venezia). The species inventory includes two probably undescribed species: *9:;<;=>? sp. n. and a species of the Crambidae subfamily Odontiinae. 9 species are newly recorded from Italy: 0@ABBCDC=AE;<=) E<9@:B:=>:<, !C?F>C;<?)?;:G>B<BB:, !C?FC9;<=>H)9:=:=IJ<BB:, -IB:F9=C;<?)>FF:EIB:;<BB:, ,E=CG>9:B9:) D>;<D;<BB:, -9@A?;<=>?)>D?IB<BB:, 7ADD>KCFC=9@:)BI=>K:D:, !B:L>M<?;:)9I=K<A> and *??:=:);I=E><BB:. Several species are extremely rare and/or scattered in Italy or even restricted to Valle Vecchia, e.g. NABCFC>:)?;:DM<BF:><=>. The importance of the area is furthermore underlined by the occurrence of +AE:<D:) K>?9:= and -I9B:M>:) OI:K=>9IDE;:=>:, two species protected by the Fauna-Flora-Habitat directive of the EU. An ecological analysis underlines the particular importance of the sandy dune system and halophytic depression for Lepidoptera. Bed of reeds and hygrophilous to xerophilous grassland add to the overall diversity. Recent afforestations probably will improve the importance of woody plants. Biogeographically, species which are widely distributed in Eurasia and/or North America or which are even cosmopolitan cover about 72% of the inventory. -

Insecta: Lepidoptera) 4
Thüringer Faunistische Abhandlungen XII 2007 S. 165 -189 Die Kleinschmetterlingsfauna Nordwestthüringens (Insecta: Lepidoptera) 4. Beitrag : Familien Depressariidae (Flachleibmotten), Alucitidae (Fächerflügler), Pterophoridae (Federmotten) und Pyralidae (Unterfamilien: Scopariinae, Schoenobiinae, Acentropinae) Rolf-Peter Rommel, Ammern & Helmut Platt, Mühlhausen Zusammenfassung In Nordwestthüringen wurden im Zeitraum von 1986 bis 2007 durch Lichtfang, Tagbeobachtung und Zucht 29 Arten der Familie Depressariidae, 2 Arten der Familie Alucitidae, 25 Arten der Familie Pterophoridae und 13 Arten der Familie Pyralidae (Unterfamilien Scopariinae, Schoenobiinae, Acentropinae) nachgewiesen. Die Nachweismethoden werden beschrieben und neben einer zusammenfassenden Liste der Nachweise von den Lichtfangorten werden Anmerkungen zu 12 ausgewählten Arten gegeben. Für Thüringen konnten mit Agonopterix curvipunctosa, Scoparia conicella und Karsholtia marianii als Nachtrag für die Familie Tineidae drei noch nicht nachgewiesene Arten dokumentiert werden. S u m m a r y The fauna of M icrolepidoptera of Northwestern Thuringia (Insecta: Lepidoptera) Part 4.: Families Depressariidae, Alucitidae, Pterophoridae and Pyralidae (subfamilies: Scopariinae, Schoenobiinae, Acentropinae) Between 1986 and 2007, 29 species of the family Depressariidae, 2 species of Alucitidae, 25 species of Pterophoridae, and 13 species of family Pyralidae (subfamilies Scopariinae, Schoenobiinae, Acentropinae) were sampled in Northwestern Thuringia by light trapping, observation in the -

Der GEO-Tag Der Artenvielfalt 2008 Am Albulapass
Jber. Natf. Ges. Graubünden 116 (2010), Seiten 5 – 58 Der GEO-Tag der Artenvielfalt 2008 am Albulapass Eine 24-Stunden-Aktion zur Erfassung der Biodiversität: Methoden und Resultate von Marion Schmid und Jürg Paul Müller Adresse: Bündner Naturmuseum Masanserstrasse 31 CH-7000 Chur [email protected] [email protected] Unter Mitarbeit von Insgesamt wurden 1535 Arten festgestellt, dar- unter drei Erstnachweise für die Schweiz, elf Erst- Felix Amiet, Ariel Bergamini, Thomas Briner, nachweise für Graubünden und weitere faunisti- Martin Camenisch, Armin Coray, Regula Cornu, sche und floristische Besonderheiten. Ein Vergleich Holger Frick, Michael Geiser, Christoph Germann, mit der Artenvielfalt auf der Alp Flix, die acht Jahre Jean-Paul Haenni, Peter Herger, Martin Kemler, Se- zuvor mit der gleichen Methodik bearbeitet wurde, raina Klopfstein, Matthias Lutz, Jani Marka, Chris- zeigt, dass die Artenzahlen in ähnlichen Bereichen toph Meier-Zwicky, Bruno Peter, Jürg Schmid, Hans liegen. Auf der Alp Flix ist das Mosaik der Lebens- Schmocker, Ulrich E. Schneppat, Norbert Schnyder, räume jedoch noch kleinräumiger und verzahnter, Arno Schwarzer, Eva Sprecher was eine ähnliche Artenzahl auf einer kleineren Fläche ergibt. In beiden Untersuchungsgebieten konnte aber im Vergleich zu Aktionen in Tieflagen Zusammenfassung eine erstaunlich hohe Artenzahl ermittelt werden, was wiederum beweist, dass die Artenzahl im Ge- Am 3. Juni 2008 führten die Stiftung Sammlung birge erst deutlich oberhalb des Waldgrenzenöko- Bündner Naturmuseum, das Management des Parc tons abnimmt. Ela und Bergün-Filisur Tourismus gemeinsam ei- Der GEO-Tag der Artenvielfalt am Albulapass bot nen Tag der Artenvielfalt durch. Das Konzept ba- eine willkommene Gelegenheit, um nicht nur die sierte auf der 24-Stunden-Aktion zur Erfassung ei- Wissenschaft, sondern auch die Bevölkerung auf die ner möglichst grossen Zahl von Pilz-, Pflanzen- und Bedeutung der Biodiversität und deren Erforschung Tierarten, wie sie die Zeitschrift GEO seit 1999 in hinzuweisen. -

Check List of Slovenian Microlepidoptera
Prejeto / Received: 14.6.2010 Sprejeto / Accepted: 19.8.2010 Check list of Slovenian Microlepidoptera Tone LESAR(†), Marijan GOVEDIČ1 1 Center za kartografijo favne in flore, Klunova 3, SI-1000 Ljubljana; e-mail: [email protected] Abstract. A checklist of the Microlepidoptera species recorded in Slovenia is presented. Each entry is accompanied by complete references, and remarks where appropriate. Until now, the data on Microlepidopteran fauna of Slovenia have not been compiled, with the existing information scattered in literature, museums and private collections throughout Europe. The present checklist is based on records extracted from 290 literature sources published from 1763 (Scopoli) to present. In total, 1645 species from 56 families are listed. Keywords: Microlepidoptera, checklist, Slovenia, fauna Izvleček. SEZNAM METULJČKOV (MICROLEPIDOPTERA) SLOVENIJE – Predstavljen je seznam vrst metuljčkov, zabeleženih v Sloveniji. Za vsako vrsto so podane reference, kjer je bilo smiselno, pa tudi komentar. Do sedaj podatki o metuljčkih Slovenije še niso bili zbrani, obstoječi podatki pa so bili razpršeni v različnih pisnih virih, muzejskih in zasebnih zbirkah po Evropi. Predstavljeni seznam temelji na podatkih iz 290 pisnih virov, objavljenih od 1763 (Scopoli) do danes. Skupaj je navedenih 1645 vrst iz 56 družin. Ključne besede: Microlepidoptera, seznam vrst, Slovenija, živalstvo NATURA SLOVENIAE 12(1): 35-125 ZOTKS Gibanje znanost mladini, Ljubljana, 2010 36 Tone LESAR & Marijan GOVEDIČ: Check List of Slovenian Microlepidoptera / SCIENTIFIC PAPER Introduction Along with beetles (Coleoptera), butterflies and moths (Lepidoptera) are one of the most attractive groups for the amateur insect collectors, although the number of researchers professionally engaged in these two groups is relatively high as well. -

DNA Barcode Bibliothek Der Schmetterlinge Südtirols Und Tirols (Italien, Österreich) – Impetus Für Integrative Artdifferenzierung Im 21
Peter Huemer & Paul D. N. Hebert DNA Barcode Bibliothek der Schmetterlinge Südtirols und Tirols (Italien, Österreich) – Impetus für integrative Artdifferenzierung im 21. Jahrhundert Abstract DNA barcode library for Lepidoptera from South Tyrol and Tyrol (Italy, Austria) – Impetus for integrative species discrimination in the 21st Century The present study presents a DNA barcode library for 2565 Lepidoptera species (70 families) from an alpine transect covering the provinces of South Tyrol (Italy) and Tyrol (Austria). Sequences from the 648bp barcode region of the mitochondrial COI gene were recovered from 9964 specimens and 9443 were fully barcode compliant. Species differ on average from their Nearest Neighbor by a minimum 6.38% while mean intraspecific divergence is only 0.45%. A successful, unequivocal barcode based identification was determined by comparison with barcode records obtained in other studies, pooled in Barcode Index Numbers (BIN) in BOLD (Barcode of Life Data Systems) for 2442 species, representing 95.2% of the sequenced species with BINs (2565 spp.). Identical or overlapping barcodes were found in 84 species, with all cases involving closely related or taxonomically uncertain species complexes. Deep intraspecific splits (>3%) were detected in 72 species, with these cases likely due to varied factors including Keywords: Lepidoptera, cryptic diversity, introgression and phylogeographic divergence. Finally, the impor- DNA barcoding, alpine transect, tance of DNA barcoding for advancing understanding of the Tyrolean fauna is revealed Tyrol, Italy, Austria through the discovery of 97 new records for the county. Adresse der Autoren: Mag. Dr. Peter Huemer Tiroler Landesmuseen Betriebsges.m.b.H. Naturwissenschaftliche Sammlungen Feldstr. 11a Einleitung A-6020 Innsbruck, Schmetterlinge zählen mit etwa 3200 bekannten Arten in Südtirol und 2700 Arten Österreich e-mail: p.huemer@tiroler- im Bundesland Tirol zu den artenreichsten Tiergruppen (HUEMER 1996, 2013). -

Lepidoptera) Na Území Kraje Vysočina: PR Údolí Brtnice Ekologie, Diverzita, Ochrana
Synekologické hodnocení motýlí fauny (Lepidoptera) na území kraje Vysočina: PR Údolí Brtnice ekologie, diverzita, ochrana Jan Šumpich 2010 Údolí Brtnice lze právem považovat za „hot spot“ biodiverzity Jihlavska. Charakter zaříznutého údolí s bočními skalnatými stráněmi jednoznačně představuje lokální fenomén a v řadě ohledů převyšuje význam tohoto území hranice Jihlavska nebo dokonce kraje Vysočina. Pokládám si za čest, že jsem mohl v tomto území aktivně působit nejen jako entomolog, ale i zásadním způsobem přispět k územní ochraně tohoto krásného koutu přírody. Zatímco počátkem 90. let jsme se snažili řešit záchranu cenných přírodních objektů především fyzickým zachováním údolí (v území byla plánována výstavba vodní nádrže), v současné době jsou ta přírodně nejcennější společenstva vystavena jinému nebezpečí, a to expanzi křovin a neuvážené výsadbě na stráních a nevhodnému hospodaření na údolních loukách, popřípadě důsledkům těchto kroků v minulosti. Vymírání nejcitlivějších motýlích druhů je zde více než alarmující. Neméně bolestným problémem je však zmenšování populací druhů i obecně hojných. Je tudíž zcela nezbytné přistupovat k péči o toto území s nejvyšší naléhavostí. Věřím, že předložené výsledky nového inventarizačního průzkumu, ale především moje postřehy a srovnání současných poměrů se stavem před cca 15 – 17 lety též přispějí k postupnému zlepšování současného neutěšeného stavu. autor - 2 - ÚVOD Předkládaná zpráva sumarizuje výsledky průzkumu motýlů (Lepidoptera) v přírodní rezervaci (dále PR) Údolí Brtnice nedaleko obce Střížov (okres Jihlava). Cílem průzkumů bylo přispět k poznání lepidopterologických poměrů v tomto území a detekovat výskyt ochranářsky významných druhů motýlů. PR Údolí Brtnice byla vyhlášena 20.7.2001 Okresním úřadem Jihlava a jedním z podstatných odborných podkladů pro vyhlášení se staly výsledky průzkumu motýlí fauny z let 1993 až 1997 (Šumpich & Dvořák 1995, 1998, Šumpich 1998, Liška et al. -

Liste Taxonomique Et Synonymique Des Pterophoridae De France (Lepidoptera)
oreina n° 22 – juin 2013 ACTUALITÉ 5 Liste taxonomique et synonymique des Pterophoridae de France (Lepidoptera) ALAIN CAMA Résumé : Un groupe de travail s’est constitué en 2012 afin d’éta- nent obsolètes ; pour preuve : Léon Lhomme a proposé blir la liste des microlépidoptères de France. Un bref historique de 1923 à 1949 un catalogue des espèces françaises introductif relate leur étude depuis Linné jusqu’aux séquençages de lépidoptères, incluant la Belgique, totalisant alors du génome. Le programme Taxref, mis en œuvre par le Muséum 4339 taxons. Chaque espèce reçut un numéro d’ordre national d’Histoire naturelle, constitue une base de données adap- reflétant la phylogénie du moment. Devant les progrès tée et évolutive. Le choix de la première famille d’étude s’est porté nomenclaturaux de la science entomologique et la dé- sur les Pterophoridae. La liste systématique et synonymique de couverte d’un nombre non négligeable de nouvelles cette famille est établie en tenant compte des derniers travaux pu- espèces, il fallut élaborer de nouvelles listes, ce que bliés. Les 145 espèces sont classées avec un numérotation Taxref. fit Leraut en 1980 et 1997, donnant ainsi le coup d’en- Seules sont traitées les espèces françaises du domaine paléarctique voi des listes nationales en Europe. Entre ces deux (Corse comprise). dates d’éditions, 400 espèces sont venues s’ajouter à la faune de France ! Il faut savoir qu’une dizaine de Summary: A working group was set up in 2012 with a view to nouveaux taxons vient accroître chaque année cette built the list of French microlepidoptera.