Insaniyat / إنسانيات, 51-52
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
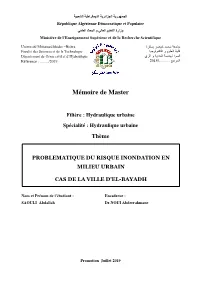
Mémoire De Master
الجمهىريت الجسائريت الديمقراطيت الشعبيت République Algérienne Démocratique et Populaire وزارة التعليم العالي و البحث العلمي Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique جامعة محمد خيضر بسكرة Université Mohamed khider –Biskra كلية العلوم و التكنولوجيا Faculté des Sciences et de la Technologie قسم ا لهندسة المدنية و الري Département de Génie civil et d’Hydraulique المرجع .........../Référence : ........./2019 2019 Mémoire de Master Filière : Hydraulique urbaine Spécialité : Hydraulique urbaine Thème PROBLEMATIQUE DU RISQUE INONDATION EN MILIEU URBAIN CAS DE LA VILLE D’EL-BAYADH Nom et Prénom de l’étudiant : Encadreur : SAOULI Abdallah Dr.NOUI Abderrahmane Promotion Juillet 2019 INTRODUCTION GENERALE 1 INTRODUCTION GENERALE Les risques naturels (inondation, séisme, glissement de terrain, éruption volcanique,...) s'inscrivent, aujourd'hui d'une façon fréquente, à travers tout le globe terrestre, menaçant en permanence l'existence humaine, et provoquant des dégâts matériels immenses, ce qui handicape toutes les opérations de développement. Sous l’effet des changements climatiques, Il est prévu que le réchauffement climatique entraînera une augmentation des précipitations intenses et donc produire un cycle hydrologique plus actif (Bates et al., 2008; Trenberth et al., 2003; Trenberth 1999). L’Afrique risque d'être gravement touchée (Ipcc 2007). Similairement aux autre pays du monde, le passif de l’Algérie a été marqué par des nombreuses inondations catastrophiques. La mémoire des Algériens garde la trace des crues souvent pénibles, parfois angoissantes ; celles du 12 octobre 1971 à Tizi-Ouzou, l’inondation du 11 novembre 1982 à Annaba, ou même celle du 10 novembre 2001 à Bab l’oued et au mois d’août 1997 à Batna. -

Journal Officiel = De La Republique Algerienne Democratique Et Populaire Conventions Et Accords Internationaux - Lois Et Decrets
No 22 ~ Mercredi 14 Moharram 1421 ~ . 39 ANNEE correspondant au 19 avril 2000 Pee nls 43 Ub! sess Sbykelig bte é yr celyly S\,\n JOURNAL OFFICIEL = DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS. ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANCAISE) Algérie ; ER DIRECTION ET REDACTION: Tunisie ETRANGER SECRETARIAT GENERAL ABONNEMENT Maroc (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libyeye que le Maghreb) ” , Mauritanie Abonnement et publicité: : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An- 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 a 17 - C.C.P. 3200-50 | Edition originale.....ccccsesseeees 856,00 D.A| 2140,00 D.A _ ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ . BADR: 060.300.0007 68/KG Edition originale et sa traduction}1712,00 D.A|. .4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d'expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 10,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 20,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant baréme. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Priére de joindre la derniére bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22.14 Moharram 1421 19 avril 2000 SOMMAIRE | | ; ARRETES, DECISIONS ET AVIS | MINISTERE DES FINANCES Arrété du 13 Ramadhan 1420 correspondant au 21 décembre 1999 modifiant et complétant l'arrété du 26 Rajab 1416 -correspondant au 19 décembre 1995 portant création des inspections des impéts dans les wilayas relevant de la _,direction régionale des imp6ts de Chlef... -
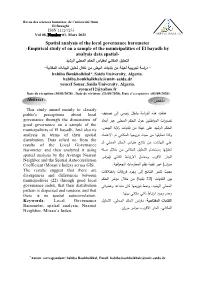
Spatial Analysis of the Local Governance Barometer
Revue des sciences humaines de l’université Oum El Bouaghi ISSN 1112-9255 Vol 08, Number 01, Mars 2021 OEB Univ. Publish. Co. Spatial analysis of the local governance barometer -Empirical study of on a sample of the municipalities of El bayadh by analysis data spatial- التحليل المكاني لمقياس الحكم المحلي الرشيد - دراسة تجريبية لعينة من بلديات البيض من خﻻل تحليل البيانات المكانية- habiba Boukholkhal*, Saida University, Algeria. [email protected] youcef Souar, Saida University, Algeria. [email protected] Date de réception:(30/03/2020) , Date de révision: (23/08/2020), Date d’acceptation :(03/09/2020) Abstract : ملخص : This study aimed mainly to classify هدفت هذه الدراسة بشكل رئيسي إلى تصنيف public's perceptions about local تصورات المواطنين حول الحكم المحلي عبر أبعاد governance through the dimensions of good governance on a sample of the الحكم الرشيد على عينة من بلديات وﻻية البيض، municipalities of El bayadh, And also its وكذا تحليلها من حيث توزيعها المكاني تم اﻻعتماد analysis in terms of their spatial distribution. Data relied on from the على البيانات من نتائج مقياس الحكم المحلي ثم results of the Local Governance تحليلها باستخدام التحليل المكاني من خﻻل صلة Barometer and then analyzed it using spatial analysis by the Average Nearest الجار اﻻقرب ومعامل اﻻرتباط الذاتي )مؤشر Neighbor and the Spatial Autocorrelation موران( عبر تقنية نظم المعلومات الجغرافية. .Coefficient (Moran’s Index) across GIS The results suggest that there are بحيث تشير النتائج إلى وجود فروقات واختﻻفات divergences and differences between بين البلديات )22 بلدية( من خﻻل مؤشر الحكم municipalities (22) through good local المحلي الرشيد، ونمط توزيعها كان متباعد وعشوائي governance index, that their distribution pattern is dispersed and random, and that وعدم وجود ارتباط ذاتي مكاني بينها. -

La Couverture Sanitaire De La Wilaya D'el Bayadh
La couverture sanitaire de la wilaya d’El Bayadh Pr. Larbi ABID La Wilaya d’El Bayadh est limitée au Nord par les wilayas de Saida et Tiaret, à l’Est et Sud Est par Laghouat, Ghardaïa et Adrar ; à l’Ouest et Sud Ouest par Sidi Bel Abbes, Naâma et Bechar. Occupant une superficie de 71 697 km², soit 3% du territoire national, elle s’étend du Chott Echergui à l’Erg Occidental et est dominée par les monts du djebel Amour de la chaîne Atlas Saharien. Cette wilaya est constituée de 03 zones distinctes qui sont : La zone des Hautes Plaines (8778 Km2) composées de 06 communes. Cette zone se caractérise par la faiblesse et l'irrégularité des précipitations, la gelée (40 à 60 jour) et la présence de vents chaux (sirocco) avec des périodes sèches. Sur le plan bioclimatique, cette zone fait partie de l’étage aride frais. La Zone de l’Atlas Saharien (11846 Km2) composé de 13 communes. Elle présente une situation bioclimatique (semi aride froid) et bénéficie de l'apport en eau et alluvions provenant des sommets et versants des reliefs montagneux. Les précipitations sont relativement plus importantes par rapport aux autres zones. La Zone Pré- Saharienne (51073 Km2) constituée 03 communes, est la partie la plus désavantagée. Elle représente la superficie la plus importante de la Wilaya (71 % de la superficie totale). Les altitudes décroissent du Nord au Sud de 1 000 à 500 m environ à la partie extrême Sud de la Wilaya où en note la présence de l’Erg Occidental qui renforce l'aspect désertique de cette zone avec une période estivale plus longue et plus chaude. -

Mémoire De Fin D'études Année Universitaire : 2016/2017
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’ENSEGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIETIFIQUE UNIVERSITE ABDELHAMID IBN BADIS MOSTAGANEM Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie Département d’agronomie Mémoire de fin d’études En vue de l’obtention du diplôme de master Spécialité: Gestion conservatoire des eaux,des sols et de l’environnement Intitulé : Appréciation des risques d’érosion hydrique dans le bassin versant dans la région d’El bayadh (cas d’oued Deffa ) par la télédétection Réalisé par SEHLI Hadjer Devant le jury : Président : M rHADDAD.A Pr U.Mostaganem Examinateur: M r BOUALEM .A.E.K MCB U. Mostaganem Encadreur : M r HARTANI.A MAA U.Mostaganem Année universitaire : 2016/2017 Remerciements Avant tous, je remercie allah tout puissant qui m’a guidé tout au long de ma vie, qui m’a permis de m’instruire et d’arriver aussi loin dans mes études, qui m’a donné courage et pour passer tous les moments difficiles, et qui m’a permis d’achever ce travail. Je tiens à présenter mes humbles et sincères remerciements ainsi que toute ma reconnaissance et ma profonde gratitude à mon promoteur Monsieur M HARTANI AHMED, pour tout son dévouement lors de mon encadrement, pour tout son aide et ses précieux conseils et ses encouragements incessants, et surtout pour sa patience et sa compréhension. Je tiens aussi à remercier les membres de jury M. HADDAD, pour avoir Accepté de présider le jury et M. BOUALEM pour avoir bien voulu me faire Honneur d’examiner mon mémoire. Ma reconnaissance et gratitude envers tous les enseignants, les responsables et les agents du Département d'Agronomie de l’Université Abd El hamide Ibn Badis de Mostaganem sans exception. -

Les Infrastructures Hydrauliques Et Utilisation De L'eau En Milieu
Les infrastructures hydrauliques et utilisation de l’eau en milieu steppique et atlasique : abondance et sous-utilisation. Mohamed HADEID * Sid Ahmed BELLAL ** Résumé L’espace steppique est un ensemble géographique bien distinct par rapport aux autres régions du pays. Par sa situation intermédiaire entre la zone tellienne et le Sahara, cet espace est caractérisé par une contrainte naturelle majeure qui est celle de l’aridité. En conséquence, l’eau est un élément rare, précieux et sujet de convoitise entre plusieurs secteurs dont l’élevage (principale activité de la région), l’agriculture, sans oublier les besoins domestiques d’une population en constante augmentation. Afin d’alimenter ces différents secteurs en eau, l’Etat a consenti beaucoup d’efforts pour équiper en infrastructures hydrauliques, cet espace vaste et contraignant : grand barrage, petits barrages, puits, réservoirs, châteaux d’eau,… Ces équipements s’inscrivent dans le cadre de plusieurs programmes d’investissements : sectoriels, fonds du Sud ; fonds de la Steppe, FNRDA (Fonds National de Régulation et du Développement Agricole). Cette diversité dans les sources de financement a permis durant cette dernière décennie, d’acquérir un certain nombre d’infrastructures hydrauliques. Toutefois, l’utilisation de certaines d’entre elles est compromise, rendant parfois, ces équipements inutilisables malgré leurs coûts conséquents. Cette sous-utilisation marquante est le résultat d’une politique d’équipement inadéquate avec les potentialités naturelles et humaines d’une région assez particulière dans son fonctionnement : Grand barrage sans terres à irriguer, des bassins de stockage d’eau sans mise en valeur des terres, des systèmes goutte à goutte installés sans résultat apparent… Mots-clés : Espace steppique, aridité, eau, infrastructures hydrauliques, élevage, agriculture, mise en valeur, APFA, FNRDA, société pastorale. -

The Influence of Soil, Hydrology, Vegetation and Climate On
Desalination and Water Treatment 52 (2014) 2144–2150 www.deswater.com February doi: 10.1080/19443994.2013.782571 The influence of soil, hydrology, vegetation and climate on desertification in El-Bayadh region (Algeria) Karima Belaroui*, Houria Djediai, Hanane Megdad Laboratoire des Sciences, Technologie et Ge´nie des Proce´de´s (LSTGP), Universite´ des Sciences et de la Technologie, Med-BOUDIAF d’Oran, B.P. 1505, EL M’nouer, Oran, Algeria Tel./Fax: +213 41500056; email: [email protected] Received 17 December 2012; Accepted 1 March 2013 ABSTRACT There has always been a link between water and desertification. Water, whether from rain or other sources, provides the ground moisture needed for the growth of vegetation cover. The availability of water resources directly affects the distribution of vegetation cover. Any dam- age to the vegetation cover is almost always accompanied by silting, which accelerates the desertification process. The phenomenon of desertification affects the arid and semi-arid areas of all continents. Its expansion is one of the major environmental problems of our times. According to the United Nations Convention to Combat Desertification, the term desertification signifies ‘‘land degradation resulting from various factors including climatic variations and human activities”. The problem of desertification, which is known as being the process of land degradation resulting principally from anthropogenic factors (plowing of steppe, overgrazing, land clearing, fires, deforestation (illegal logging), etc.) and leading to often irreversible repercussions, is a particular and urgent problem in the arid and semi-arid bioclimatic zones of the Tell Atlas. This work is part of the monitoring of desertification and of the impact of natural factors (soils, hydrology, vegetation and climate) in an area in the heart of south Oran’s high steppe plains, in the El Bayadh region of Algeria. -

La Politique De Mise En Valeur Agricole En Milieu Steppique Algérien : Un Essai De Bilan Dans Les Hautes Plaines Sud Oranaises (Algérie)
Insaniyat n°s 51-52, janvier - juin 2011, pp. 99-118 La politique de mise en valeur agricole en milieu steppique algérien : un essai de bilan dans les Hautes Plaines sud oranaises (Algérie) Mohamed HADEID∗ En Algérie, la politique de mise en valeur agricole a été lancée essentiellement depuis la promulgation de la Loi portant « Accession à la propriété foncière agricole » en 1983. Elle consiste à céder pour un dinar symbolique une portion de terrain en vue de la cultiver et la mettre en valeur principalement par l’irrigation ; le bénéficiaire qui réussit à exploiter cette terre devient propriétaire après cinq ans de travail. Cette politique, appliquée dans des zones aux compétences agro-pédologiques convenables, peut réussir facilement, mais dans la zone steppique à vocation pastorale, n’est-il pas risqué de généraliser cette opération sur ce type d’espace ? Certes, la céréaliculture a été toujours pratiquée dans la steppe, mais dans des zones exploitables sur le plan agricole (bas fond des vallées, daïas...). Aujourd’hui, les mises en valeur agricoles dans la steppe sont présentes dans plusieurs endroits, notamment dans les zones de parcours, sans se soucier de leurs aptitudes culturales. De ce fait, cette opération a suscité l’intérêt d’un grand nombre de personnes, nomades essentiellement, dans un but d’acquérir la propriété du terrain. Pour l’État, l’objectif de cette action, outre la création d’emplois, est l’amélioration des revenus ruraux. Quelles sont donc les contraintes que rencontre l’application de cette politique de mise en valeur agricole dans un espace steppique connu pour sa vocation pastorale, en particulier les Hautes Plaines sud oranaises ? ∗ Enseignant, géographie et aménagement, Université d’Oran, EGEAT (Laboratoire des espaces géographiques et de l’aménagement du territoire), chercheur associé au CRASC, Oran. -

Journal Officiel
N° 47 Mercredi 19 Dhou El Kaada 1434 52ème ANNEE Correspondant au 25 septembre 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION Algérie ETRANGER SECRETARIAT GENERAL Tunisie (Pays autres DU GOUVERNEMENT ABONNEMENT Maroc que le Maghreb) ANNUEL Libye WWW. JORADP. DZ Mauritanie Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 Edition originale….........….........…… 1070,00 D.A 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 Edition originale et sa traduction....... 2140,00 D.A 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d'expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG sus) ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 19 Dhou El Kaada 1434 2 25 septembre 2013 S O M M A I R E DECRETS Décret exécutif n° 13-319 du 10 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 16 septembre 2013 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l'agriculture et du développement rural...................................................... -

Algérie : 10 DA
Horaire des prières Fajr : 04h19 Dohr : 12h47 Asr : 16h31 Maghreb : 19h34 Isha : 21h02 DK NEWS MÉTÉO Alger : 20° 10° Oran : 23° 10° Annaba : 22° 12° QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION Béjaïa : 18° 10° Tamanrasset: 36° 24° Mercredi 24 avril 2019 - 19 Chaâbane 1440 - N° 2198 - 6e année - Prix : Algérie : 10 DA. France : 1€ www.dknews-dz.com ALGÉRIE-ETATS UNIS ALGÉRIE-PALESTINE Etablir des partenariats avec l’Algérie, «une Sabri Boukadoum reçoit le nouvel des priorités des Etats-Unis d’Amérique» ambassadeur de Palestine en Algérie P. 2 4 P. 2 4 EN VISITE DE TRAVAIL ET D’INSPECTION EN 1RE RM À BLIDA Gaïd Salah appelle le peuple à faire preuve de ‘’sagesse’’ pour déjouer ‘’les conspirations’’ contre l'Algérie Le Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP) a appelé mardi le peuple algérien à faire preuve de «davantage de sagesse» pour «mettre en échec toutes les conspirations» fomentées contre l'Algérie, réitérant la «détermination» de l'armée à l'accompagner «jusqu’à la concrétisation de ses attentes légitimes». P. 3 PRÉSIDENTIELLE DU 4 JUILLET : FLN : OUVERTURE HIER DE LA SESSION CONTRÔLE DE LA QUALITÉ IMPORTATION : EXTRAORDINAIRE DU CC DES PRODUITS INDUSTRIELS: Fin de l'opération Des membres du comité central Entrée Une centaine de révision appellent à l'élection d'un en service du de produits exceptionnelle des homme deconsensus à la tête 1er laboratoire exclus du DAPS listes électorales du Secrétariat général national P. 6 P. 3 P. 4 MDN TRANSPORTS -

Tribune Des Lecteurs
GRAVE ACCIDENT DE LA ROUTE À MOSTAGANEM Dossier UN MORT ET 24 BLESSÉS TRASHTAG CHALLENGE . Un grave accident de la de Chee Guevarra, alors que les circulation routière, s'est déroulé ce blessés, ont été dirigés vers les CITOYENS, AU lundi, en plein centre urbain de la Urgences Médicales de Kharrouba TRIBUNE ville de Mostaganem. Le bilan de ce Mostaganem.une enquête a été TRIBUNE drame s'est soldé par la mort du diligentée par les services de Des Lecteurs SENS " PROPRE " chauffeur du bus alors que 23 sécurité, pour déterminer les Des Lecteurs passagers ont été blessés. La tenants et aboutissants de ce Quotidien national d’information dépouille du chauffeur a été tragique accident. ÈME DU TERME Quotidien national d’information transférer à la morgue de l'hôpital SALAH EDDINE. 11 ANNÉE - N° 3093 - JEUDI 2 MAI 2019 - PRIX 15 DA. PAGE 7 ÈME 11 ANNÉE - N° 3093 - JEUDI 2 MAI 2019 - PRIX 15 DA. www.tribunelecteurs.com SITUATION AU SOUDAN PROCÉDURE DE L'EMPREINTE BIOMÉTRIQUE OUYAHIA QUI CARESSAIT LE RÊVE D'UN DESTIN PRÉSIDENTIEL POUR LE HADJ FLN UNE NOUVELLE MARCHE A COMPARU DEVANT LE JUGE POUR DES FAITS DE CORRUPTION SÉPARÉE SALE TEMPS POUR L'HOMME MOHAMED POUR FAIRE PLIER LA JUNTE DU DOSSIER DJEMIAI NOUVEAU SG Le mouvement de contestation au Soudan a DES… SALES BESOGNES PAGE 4 appelé ce mardi à une marche d'un million de DE VISA PAGE 5 manifestants jeudi afin de réclamer une L'Office national du nouvelle fois l'instauration d'un pouvoir civil, Pèlerinage et de la Omra (ONPO) a fait savoir ce mardi dans un GAID SALAH PRÔNE LE DIALOGUE AVEC LES INSTITUTIONS après des désaccords avec les militaires au communiqué, que les autorités pouvoir sur la création d'un conseil conjoint. -

MEMOIRE DE MAGISTER Présenté Par Mr Dellaoui Boualem
République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université Djillali Liabès de Sidi Bel Abbés Département des Sciences de l’Environnement Faculté des Sciences de la nature et de la vie MEMOIRE DE MAGISTER Présenté par Mr Dellaoui Boualem Spécialité : Environnement Option : Biodiversité et Conservation des Zones Humides Intitulé Cartographie et inventaire de l’herpétofaune du chott Chergui (Région d’El Bayadh : Sud-ouest algérien) Soutenu le 29/11/2016 Devant le jury composé de : Président : Pr. MOUEDDENE Kada Pr, UDL de Sidi Bel Abbés Examinateur : Dr BACHIR BOUIADJRA Salah Eddine MCA UDL DE SIDI Bel Abbés Encadreur : Pr. KOUDACHE .Fatiha. Pr, UDL de Sidi Bel Abbés 2015 - 2016 2 Remerciements Je remercie tout d’abord Dieu, le tout puissant, pour m’avoir soutenu lors du développement de ce travail, en particulier lors des moments où je crois seul. Je remercie chaleureusement mon encadreur Melle la Pr : Fatiha KOUDACHE, d’avoir accepté de diriger ce travail. Son aide et sa pleine disponibilité m’ont été très bénéfiques. Je désire aussi à exprimer mes remerciement à Mr Kada MOUEDDENE, Professeur à UDL/SBA, qui m’a fait l’honneur de présider ma jury de projet de fin d’étude. Mes plus vifs remerciements à Mr Salah Eddine BACHIR BOUIADJRA, Maitre de conférences, à UDL/SBA d’avoir bien voulu examiner mon travail. J’exprime ma gratitude et tout mon respect à Mr Tayeb AMARI, de la DGF d’El Bayadh, pour ces précieux conseils et de m’avoir fourni la documentation que j’en avais besoin.