Touristique. « Ongi Etorri
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

PDF Osoa Deskargatu
Euskaltzainak Bilduma Euskaltzainak izeneko bilduma berrian euskaltzain Argitaratuak: izan direnen eta direnen obrak eta eurei buruzko GRATIEN GRATIEN ADEMA ADEMA 1. Gratien Adema. Zaldubi azterketak argitaratuko dira, Akademiaren ZALDUBI ZALDUBI Saindu batzuen biziaz. 2007 historiarako esanguratsu gertatu diren egileetatik hainbaten lanak ere alboratu gabe. 2. Pierre Charritton Pierre Broussain. 2007 HENRI DUHAU Beskoitzen sortua 1942an. 21 urtetan, lur berri egiten Donapaleutik, teknikari gisa. 1968an Senpererat ezkondurik 3. Pierre Lhande ARTZAIN BELTXAREN merkataritzan erretretarat heldu arte. Lehen artikulua euskaraz, Yolanda eta beste euskarazko idazlanak. 1961eko urtarrilean Gazte kazetan. Beti jarraitu du idazten: Herria astekarian, Otoizlari, Dantzariak, Ekaina, Denak Argian, eta bereziki 2007 NEURTITZAK Enbatan. Liburuak: lehena Hasian-hasi (1993, sorterriko euskara); Euskal aditz batua (1996); Aupa batasuna! (2000); Hasian-hasi Argitalpenaren paratzailea: Henri Duhau (bigarrena, 2002); Hortzak izerdi (artikulu bilduma, 2005); Dufau 4. Gratien Adema. Zaldubi bi anaiak (2006); Saindu batzuen biziaz. (G. Adema) (2007). Artzain beltxaren neurtitzak. 2008 ISBN: 978-84-95438-37-9 Euskaltzaindia Real academia de la lengua vasca Académie de la langue basque EUSKALTZAINAK BILDUMA Laguntzaileak: EUSKALTZAINDIA ARTZAIN BELTXAREN NEURTITZAK BELTXAREN ARTZAIN SENPEREKO UDALA EUSKALTZALEEN BILTZARRA 4 GRATIEN ADEMA “ZALDUBI” ARTZAIN BELTXAREN NEURTITZAK Adema, Gratien (1828-1907) Artzain beltxaren neurtitzak / Gratien Adema “Zaldubi” ; argitalpenaren -
![Lapurdum, 7 | 2002, « Numéro VII » [Linean], Sarean Emana----An 01 Juillet 2009, Kontsultatu 25 Novembre 2020](https://docslib.b-cdn.net/cover/9368/lapurdum-7-2002-%C2%AB-num%C3%A9ro-vii-%C2%BB-linean-sarean-emana-an-01-juillet-2009-kontsultatu-25-novembre-2020-569368.webp)
Lapurdum, 7 | 2002, « Numéro VII » [Linean], Sarean Emana----An 01 Juillet 2009, Kontsultatu 25 Novembre 2020
Lapurdum Euskal ikerketen aldizkaria | Revue d'études basques | Revista de estudios vascos | Basque studies review 7 | 2002 Numéro VII Aurélie Arcocha-Scarcia (dir.) Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/lapurdum/946 DOI : 10.4000/lapurdum.946 ISSN : 1965-0655 Éditeur IKER Édition imprimée Date de publication : 1 octobre 2002 ISBN : 2-86781-321-2 ISSN : 1273-3830 Référence électronique Aurélie Arcocha-Scarcia (dir.), Lapurdum, 7 | 2002, « Numéro VII » [Linean], Sarean emana----an 01 juillet 2009, kontsultatu 25 novembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/lapurdum/946 ; DOI : https://doi.org/10.4000/lapurdum.946 Ce document a été généré automatiquement le 25 novembre 2020. Propriété intellectuelle IKER UMR 5478 1 SOMMAIRE Articles -- Idazlanak Thématique maritime et variations transtextuelles sur le motif de la tempête en mer dans les lettres basques des XVI - XVIIIe siècles Aurélie Arcocha-Scarcia Les héritières de la maison au Pays Basque au XIXe siècle Marie-Pierre Arrizabalaga Joannes Etxeberriren Manual devotionezcoa- z Isaac Atutxa Bernardo Atxaga : un escritor cautivador Gorka Aulestia Aménagement linguistique et vitalité des communautés francophone et anglophone du Québec Richard Y. Bourhis et Dominique Lepicq L'écho des représentations de la femme musulmane en Navarre Yvette Cardaillac-Hermosilla Etxahun-Barkoxe (1786 -1862) Du poète populaire au mythe littéraire Jean Casenave Zubereraren idazkeraz : ortografia, fonetika eta fonologia Jean-Baptiste Coyos Zubereraren herskariak : azterketa akustikoa Iñaki Gaminde, José Ignacio Hualde et Jasone Salaberria Ezkonduien Koplak (Etxepare, 1545) Jean Haritschelhar Articles en basque parus en 1843, dans Le Patriote Français de Montevideo Claude Méhats Oharmenaz ohartu eta muga galdu Miren Lourdes Oñederra Kausazio aldizkatzea euskal aditzetan Bernard Oyharçabal L'antipassif basque et l’hypothèse de Levin Rudolf P.G. -

The Role of the Basque Woman As Etxeko-Andrea: “The Mistress of the House”
Roslyn M. Frank The remarkable role of women in 16th century French Basque law codes The Remarkable Role of Women in 16th Century French Basque Law Codes This file consists of three lightly revised versions of papers published originally in 1977, along with responses to them by Rachel Bard, Tacoma Community College, Jon Bilbao, University of Nevada, Reno, and Eugene Goyheneche, Université de Pau (France), respectively. The text includes an Appendix with a transcription of the “Doléances du sexes de st. Jean de luz et cibour au roi”, dating from 1789 and which originally appeared in print in 1922. Paper # 1. The role of the Basque woman and Etxeko-andrea: “The mistress of the house”. Proceedings of the Western Society for French History, Vol. IV, 14-21. Santa Barbara, California, 1977. Paper # 2. Inheritance, marriage and dowry rights in the Navarrese and French Basque law codes, Proceedings of the Western Society for French History, Vol. IV, 22-31. Santa Barbara, California; Paper #3. Women's rights and the 'Doléances du Sexe de St. Jean de Luz et Cibour au Roi', Proceedings of the Western Society for French History, Vol. IV, 32-39. Santa Barbara, California. The Role of the Basque Woman as Etxeko-Andrea: “The Mistress of the House” Roslyn M. Frank and Shelley Lowenberg Department of Spanish and Portuguese University of Iowa In the first paper of this three-part presentation entitled "Research on the Role of Women in French Basque Culture," we shall limit ourselves to describing the role of the Basque woman as it was portrayed by the law codes of the three Basque provinces of Labourd, Basse-Navarre and Soule.1 Although we shall be utilizing the French text of these codes in this presentation, in all cases where the original Bearnaise texts were available, the French translations were checked for accuracy against the originals. -
![[Artxibo-00347039, V1] Iie Partie : Formation, Origine Et Signification Des Noms De Lieux, De Personnes Et De Famille Recensés](https://docslib.b-cdn.net/cover/9397/artxibo-00347039-v1-iie-partie-formation-origine-et-signification-des-noms-de-lieux-de-personnes-et-de-famille-recens%C3%A9s-1749397.webp)
[Artxibo-00347039, V1] Iie Partie : Formation, Origine Et Signification Des Noms De Lieux, De Personnes Et De Famille Recensés
Manuscrit auteur, publié dans "Noms de lieux et de personnes a Bayonne, Anglet et Biarritz au XVIIIe siècle : origine, signification, localisation, proportion et fréquence des noms recensés (2000) 200 orrialde" CHAPITRE III NOMS DE BAPTÊME ET NOMS DE MAISONS , DE QUARTIERS ET DE LIEUX-DITS D’ORIGINE ANTHROPONYMIQUE Hector IGLESIAS [email protected] « Je ne veux oublier qu’en Labourt les villageois & villageoises les plus gueux se font appeler sieurs & dames d’une telle maison, qui sont les maisons que chacun d’eux a en son village, quand ce ne seroit qu’un parc à pourceaux. Or, aucunes de ces maisons sont rangées dans la rue du village, d’autres estant un peu excartées & hors de ranc & ordre ont quelques petites terres & labourage à l’entour : si bien qu’ils laissent ordinairement leur cognom, & le nom de leurs familles, & mesmes les femmes les noms de leurs maris, pour prendre celui de leurs maisons » Pierre de LANCRE, 1610 Les anthroponymes artxibo-00347039, version 1 - 13 Dec 2008 Outre les noms de baptême utilisés par les habitants de la région bayonnaise au XVIII e siècle, la plupart des noms de maisons et domaines ruraux sont dans cette région d’origine anthroponymique 1. Il s’agit la plupart du temps de noms romans récents. Ces derniers ont imprégné la micro-toponymie de ce secteur, parfois d’une manière un peu complexe. Ils apparaissent parfois accompagnés d’un adjectif exprimant une particularité physique ou bien une qualité morale ou sociale : ce sont souvent des sobriquets. La plupart du temps, ils sont formés avec un suffixe diminutif ou affectif : ces noms sont alors des hypocoristiques. -

Basque Literary History
Center for Basque Studies Occasional Papers Series, No. 21 Basque Literary History Edited and with a preface by Mari Jose Olaziregi Introduction by Jesús María Lasagabaster Translated by Amaia Gabantxo Center for Basque Studies University of Nevada, Reno Reno, Nevada This book was published with generous financial support from the Basque government. Center for Basque Studies Occasional Papers Series, No. 21 Series Editor: Joseba Zulaika and Cameron J. Watson Center for Basque Studies University of Nevada, Reno Reno, Nevada 89557 http://basque.unr.edu Copyright © 2012 by the Center for Basque Studies All rights reserved. Printed in the United States of America. Cover and Series design © 2012 Jose Luis Agote. Cover Illustration: Juan Azpeitia Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Basque literary history / edited by Mari Jose Olaziregi ; translated by Amaia Gabantxo. p. cm. -- (Occasional papers series ; no. 21) Includes bibliographical references and index. Summary: “This book presents the history of Basque literature from its oral origins to present-day fiction, poetry, essay, and children’s literature”--Provided by publisher. ISBN 978-1-935709-19-0 (pbk.) 1. Basque literature--History and criticism. I. Olaziregi, Mari Jose. II. Gabantxo, Amaia. PH5281.B37 2012 899’.9209--dc23 2012030338 Contents Preface . 7 MARI JOSE OLAZIREGI Introduction: Basque Literary History . 13 JESÚS MARÍA LASAGABASTER Part 1 Oral Basque Literature 1. Basque Oral Literature . 25 IGONE ETXEBARRIA 2. The History of Bertsolaritza . 43 JOXERRA GARZIA Part 2 Classic Basque Literature of the Sixteenth to Nineteenth Centuries 3. The Sixteenth Century: The First Fruits of Basque Literature . -

La Tradition Carnavalesque De Zan Pantzar (Saint Pansart) En Pays Basque
FICHE D’INVENTAIRE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL LA TRADITION CARNAVALESQUE DE ZAN PANTZAR (SAINT PANSART) EN PAYS BASQUE Fig. 1. Les deux représentations de Fig. 2. Jugement de Zan Pantzar, à Fig. 3. Crémation de Zan Pantzar, Zan Pantzar, à Ustaritz (Pyrénées- Bardos (Pyrénées-Atlantiques). au collège Jean-Errecart de Saint- Atlantiques). © Thierry Truffaut, © Thierry Truffaut, 2004. Palais (Pyrénées-Atlantiques). 2019. © Thierry Truffaut, 2019. Description sommaire Depuis au moins 1587, la tradition de Saint Pansart (Zan Pantzar en basque ; San Pançar en gascon bayonnais) est une forme de théâtralisation de la période où se jouent les règlements de comptes, la mort, le deuil de l’année écoulée. Le passage du Carnaval au Carême, de l’ancienne année à la nouvelle, de l’hiver au printemps, de la jeunesse à l’état d’homme est ainsi honoré. Organisée un samedi de la période grasse, comme à Bayonne, Tardets et Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), cette tradition annonce la fin des festivités « carnavalesques ». Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques) est l’une des rares communes où la fête a lieu, comme autrefois, le soir du Mardi gras. L’organisation est généralement dévolue à la jeunesse et aux associations locales, mais des établissements scolaires, voire des municipalités, peuvent aussi en être les instigateurs. Dans certaines localités, c’est l’occasion d’un véritable spectacle, apparenté à une grande farce avec de nombreux acteurs. Le plus élaboré est actuellement celui d’Ustaritz. Dans la plupart des communes, telle Saint-Palais, c’est aussi une sortie familiale, un moment de socialisation et d’expression des liens intergénérationnels. -
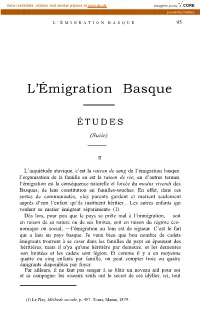
L' Émigration Basque
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Hedatuz L'ÉMIGRATION BASQUE 95 L’Émigration Basque ÉTUDES (Suite) II L’inquiétude atavique, c’est la raison de sang de l’émigration basque: l’organisation de la famille en est la raison de vie; en d’autres termes, l’émigration est la conséquence naturelle et forcée du modus vivendi des Basques, de leur constitution en familles-souches. En effet, dans ces sortes de communautés, «les parents gardent et marient seulement auprès d’eux l’enfant qu’ils instituent héritier... Les autres enfants qui veulent se marier émigrent séparément» (1). Dès lors, pour peu que le pays se prête mal à l’immigration, —soit en raison de sa nature ou de ses limites, soit en raison du régime éco- nomique ou social; —l’émigration au loin est de rigueur. C’est le fait qui a lieu en pays basque. Je veux bien que bon nombre de cadets émigrants trouvent à se caser dans les familles du pays en épousant des héritières, mais il n'ya qu'une héritière par demeure, et les demeures son limitées et les cadets sont légion. Et comme il y a en moyenne quatre ou cinq enfants par famille, on peut compter trois ou quatre émigrants disponibles par foyer. Par ailleurs, il ne faut pas songer à se bâtir un noveau nid pour soi et sa campagne: les oiseaux seuls ont le secret de ces idylles; ici, tout (1) Le Play, Méthode sociale, p. 457. Tours, Mame, 1879. 96 REVUE INTERNATIONALE DES ÉTUDES BASQUES le monde est propriétaire et tout le pays est déjà réparti: tous les champs, tous les bois, tous les prés sont rattachés à un domaine, un domaine séculaire, cent fois rebâti et jamais fractionné. -

LIVRES BASQUES Et BÉARNAIS (2Ème Vente) VENDREDI 13 Septembre 2019 À 10H30 Et 14H30 1 - «EMBATA» - «ENBATA» 7 - AFFICHES - VARIA Journal Politique Basque
LIVRES BASQUES ET BÉARNAIS (2ème VENTE) VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2019 à 10H30 et 14H30 1 - «EMBATA» - «ENBATA» 7 - AFFICHES - VARIA Journal politique basque. Paraît en septembre 1960, n°1, sous le Réunion de 12 affiches modernes en couleurs. Tableaux d’Arteta, titre «Embata» comme une nouvelle version du bulletin de l’Asso- Ramon de Zubiaurre, Juan de Echevarria, Loyato, R. Panisello ciation des étudiants basques de Bordeaux. Devient «Enbata» en Izaro et 4 affiches par Tarrieu. février-mars 1961 et la numérotation reprend à partir du n°1. 80/120 € Réunion des 4 fascicules «Embata» et de la tête de collection «Enba- ta», du no1 (février-mars 1961) au n°19 (octobre 1962) [17 fascicules, le 8 - AFFICHES TAUROMACHIE PAYS BASQUE - ARRUE n°17-18 est double]. Réunion de 3 petites affiches anciennes : «Bilbao 1919 - Corridas Toile moderne à la Bradel (atelier Laurenchet), dates et titre «Embata» de toros - Ortega». Sur soie, illustrée par José ARRUE - «Bilbao 1930 dorés sur pièce noire. - Corridas generales - Ortega». Sur soie, contrecollée sur carton sou- On joint : Aberri Eguna 1932. Reprint 1976. Le premier feuillet por- ple. Illustrée en couleurs par Alberto ARRUE. La même affichette sur te : «Hendaye, Imprimerie Mugalde, 3 rue du Cdt Passicot (DL, 4ème papier (avec détails pratiques de la manifestation au dos). Petites restaurations au papier Japon aux coins. HÔTEL DES VENTES BOrdeauX SAINTE - CROIX trimestre 1976)». Édition non paginée. Ensemble de 3 affiches. Elle ressemble furieusement à son aînée de 1932 ! 70/100 € 60/80 € 12-14, rue Peyronnet - 33800 Bordeaux Biarritz - Thermalisme S.A.S. BRISCADIEU BORDEAUX Lettre manuscrite 9 - AFFRE (Pierre-Romain) (Agrément 2002 304) 2 - 1ère GUERRE CARLISTE Manuel du baignant ou notice médicale sur les bains de mer de Lettre manuscrite de 4 pages du Lt Général Evans au Lt Général Biarritz. -

The Historiograpical and Methodological Scope of Basque
2013 Instituto de Estudios Internacionales y Europeos Francisco de Vitoria THE HISTORIOGRAPHICAL AND METHODOLOGICAL SCOPE OF BASQUE AND NAVARRE EMIGRATION TO AMERICA LA ACCIÓN EXTERIOR DE LA UE EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS JOSÉ MANUEL AZCONA ANA MANERO SALVADOR (Coordinadora ) Carolina Reyes Kahansky COLECCION ELECTRÓNICA [Escribir el nombre de la compañía] [Seleccionar fecha] INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y EUROPEOS FRANCISCO DE VITORIA Nº 6 1 Año 2015 COLECCION ELECTRÓNICA Dirección de la colección: Carlos R. Fernández Liesa Montserrat Huguet Santos ISBN: 978-84-606-5531-2 Depósito legal: M-4465-2015 Instituto Universitario de Estudios Internacionales y Europeos “Francisco de Vitoria” c. Madrid, 126. Edificio Luis Vives 28903 Getafe. Madrid. España Despachos 11.1.19/11.1.18/11.1.23 Tel.: +34 91 624 98 43 Fax: +34 91 624 97 99 [email protected] 2 THE HISTORIOGRAPHICAL AND METHODOLOGICAL SCOPE OF BASQUE AND NAVARRE EMIGRATION TO AMERICA José Manuel Azcona Pastor Professor of Contemporary History Rey Juan Carlos University, Madrid The publishing of this book has been evaluated and reviewed by experts in the field. Translated by Eugenio García Pérez 3 PRESENTATION…………………………………………………………………..5 PURPOSE AND PRELIMINARIES..………………………………………..8 THE LACK OF A SPECIFIC AND UNIVERSAL METHOD ..……….12 HISTORIOGRAPHICAL ASSESSMENTS…………………..…………..20 THE EARLY PUBLISHERS AND THE NINETEENTH CENTURY …………………………………………………………….……………35 FROM 1900 TO 1975……………………………………………………………40 THE ILLUMINATING TRAIL OF AMERIKANUAK …………….. …. 46 GOING TO AMERICA. -

Ekintzen Bilduma Bilan D’Activités 2015 Euskal Kultur Erakundearen Biltzar Nagusia 2016Ko Martxoaren 19A Assemblée Générale De L'institut Culturel Basque 19 Mars 2016
25 urte ans Ekintzen bilduma Bilan d’activités 2015 Euskal kultur erakundearen biltzar nagusia 2016ko martxoaren 19a Assemblée générale de l'Institut culturel basque 19 mars 2016 SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE SOUTIEN A LA CULTURE BASQUE SOMMAIRE Organisation interne de l’Institut culturel basque ................................ page 3 Actions menées par l’Institut culturel basque : 1. Conseiller pour la définition des politiques culturelles publiques ........................... page 5 1.1 Prédéfinir la place de la culture basque dans la nouvelle gouvernance PB .............. page 5 1.2 Accompagner les intercommunalités dans la définition de leur polit. cult ............... page 6 1.3 Poursuivre la mission d’AMO pour le Département 64 ............................................. page 6 1.4 Développer la lecture publique.......................... ....................................................... page 7 2. Renforcer le pôle patrimoine de l’Institut culturel basque ..................................... page 12 2.1 Piloter l’obtention du pôle « Ethnopôle » ................................................................ page 12 2.2 Pérenniser des espaces d’échange et de formation autour de la cult. basque ....... page 13 2.3 Poursuivre la collecte du patrimoine oral et le traitement des archives sonores ... page 13 2.4 Engager des actions de valorisation du programme de collecte « Eleketa » .......... page 14 3. Sensibiliser et éduquer à la culture basque........................................... .................. page 16 3.1 Etre -
Lapurdum, 2 | 1997, « Numéro II » [Linean], Sarean Emana----An 01 Mai 2008, Kontsultatu 20 Mars 2020
Lapurdum Euskal ikerketen aldizkaria | Revue d'études basques | Revista de estudios vascos | Basque studies review 2 | 1997 Numéro II Jean-Baptiste Orpustan (dir.) Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/lapurdum/1769 DOI : 10.4000/lapurdum.1769 ISSN : 1965-0655 Éditeur IKER Édition imprimée Date de publication : 1 octobre 1997 ISBN : 2-84127-142-0 ISSN : 1273-3830 Référence électronique Jean-Baptiste Orpustan (dir.), Lapurdum, 2 | 1997, « Numéro II » [Linean], Sarean emana----an 01 mai 2008, kontsultatu 20 mars 2020. URL : http://journals.openedition.org/lapurdum/1769 ; DOI : https:// doi.org/10.4000/lapurdum.1769 Ce document a été généré automatiquement le 20 mars 2020. Propriété intellectuelle IKER UMR 5478 1 SOMMAIRE A propos de quelques noms de lieux d'Anglet et de Biarritz Hector Iglesias Problèmes de substrat (suite) Michel Morvan La situation de la langue basque en Pays Basque Nord Bernard Oyharçabal Hiru aditz aurrizki zahar 16. mendeko testuetan. Bernard Oyharçabal Remarques sur le pronom Haina Georges Rebuschi L'orient comme virtualite dans le carnet de 1835 d'Antoine d'Abbadie Aurélie Arcocha-Scarcia Le magicien-guérisseur du carnet de voyage de 1835 d'Antoine d'Abbadie Yvette Cardaillac-Hermosilla L'irrintzina : de la valeur emblématique à la désaffection Jean Casenave L'identité basque dans l'œuvre de M. de Larramendi, S.J. (1690-1766) Txomin Peillen Joañes Castet-en-Kantu Kahierra (Oztibarre, 1936) Charles Videgain Histoire et onomastique médiévales.L'enquête de 1249 sur la guerre de Thibaud I de Navarre en Labourd Jean-Baptiste Orpustan Structures familiales et destins migratoires à Sare au XIXe siècle Marie-Pierre Arrizabalaga Wascones in plana descendunt.. -
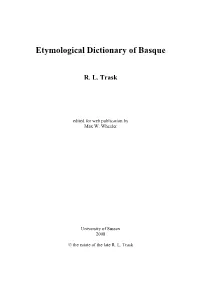
Etymological Dictionary of Basque
Etymological Dictionary of Basque R. L. Trask edited for web publication by Max W. Wheeler University of Sussex 2008 © the estate of the late R. L. Trask {Contents} {Editor’s preface} 3 Guide to the dictionary 1. General introduction a. The language and its external history 6 b. Documentation and texts 7 c. Historical work 9 d. The modern language 11 2. The phonemes of Pre-Basque 14 3. The aspiration 16 4. {Phonotactics and} morpheme structure {in} Pre-Basque 18 5. The structure of verbs in Pre-Basque 21 6. Phonological changes 25 7. {Rules applying in} word-formation 39 8. Some morphological {observations and} problems 44 9. The sources of the Basque lexicon 49 10. {Phonological} treatment of loan words 52 11. Expressive forms {caret} 12. Ghost words 55 13. The structure of entries 59 14. List of abbreviations {and symbols} 63 The Dictionary 70 {Morphemes cross-referred to but not listed in The Dictionary} 384 The native lexicon {1. English−Basque} 385 {2. Basque−English} 391 {Supplementary native lexicon} {3. English-Basque} 396 {4. Basque-English} 398 Bibliography 400 Basque index {caret} English index {caret} Index of botanical names {stub only} 415 Index of zoological names {caret} Subject index 417 Etymological Dictionary of Basque 3 {Editor’s preface R. L. (Larry) Trask died in March 2004 at the age of 59, leaving unfinished his Etymological Dictionary of Basque. In 2000 he had been awarded a Major Research Fellowship by the Leverhulme Trust to support this project, to which he devoted much of his time between October 2001 and his death.