Y a T-Il Eu Un Chef D'orchestre Historiographique En Alsace Après 1945
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Jewish Presence in Soufflenheim
THE JEWISH PRESENCE IN SOUFFLENHEIM By Robert Wideen : 2018 Soufflenheim Genealogy Research and History www.soufflenheimgenealogy.com Jews are first mentioned in Alsace in the 12th century. There were 522 families in 1689 and 3,910 families in 1784, including four families totaling 19 people in Soufflenheim. By 1790, the Jewish population in Alsace had grown to approximately 22,500, about 3% of the population. They maintained their own customs, spoke Yiddish, and followed Talmudic laws enforced by their Rabbis. There was a Jewish presence in Soufflenheim since the 15th century, and probably earlier. By the late 1700’s there was a Jewish street in the village, a Jewish lane on the outskirts, a district known as Juden Weeg, and a Jewish path in the Judenweg area of the Haguenau Forest leading to the Jewish Forest Road. Their influence on the local dialect is documented in Yiddish in the Speech of Soufflenheim. Jewish Communities of Alsace, Including those of the Middle Ages. Encyclopaedia Judaica (1971) CONTENTS The Jewish Presence in Soufflenheim .......................................................................................................... 1 Soufflenheim Jews ........................................................................................................................................ 3 Their History .................................................................................................................................................. 5 The Earliest Jews ..................................................................................................................................... -

Download Download
ART NOUVEAU AND THE RESISTANCE TO GERMANIZATION IN ALSACE-LORRAINE, CA. 1898-1914 Peter Clericuzio University of Pennsylvania Between August of 1870 and May of 1871, the French and the Germans fought each other in a conflict whose effects reverberated for the next fifty years. The Franco-Prussian War, sometimes known as the “war that split France and united Germany,”1 had its most long-lasting consequences in the region of Alsace-Lorraine (Fig. 1). Grudgingly handed over to the Germans by the French as one of the spoils of victory, Alsace-Lorraine became the focus of a complex cultural debate that continued at least until the end of World War II. Alsace-Lorraine was returned to France in 1919 (and—except for a brief re-annexation by the Nazis—has remained French territory ever since), but the legacy of its precarious geopolitical situation still can be seen today in the unique sets of laws, customs, and traditions that survive.2 In the decade and a half preceding World War I, the debate over the identity of Alsace- Lorraine and its ties to both France and Germany intensified with the appearance of the style known as Art Nouveau, particularly around the city of Nancy that was located barely thirty kilometres from the post-1871 border established by the Treaty of Frankfort. In Nancy, Art Nouveau became at once an emblem of defiance of the political reality that Alsace-Lorraine was now a German province and a rallying point for the hope that France might someday recapture these “lost provinces.” As the new rulers systematically began to physically and culturally rebuild Alsace-Lorraine after 1871 with a more recognizably German cultural character—bringing it in line with the rest of the Second Reich—many of the regionʼs residents resisted their efforts. -
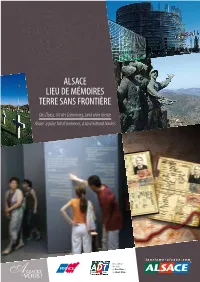
Alsace Lieu De Mémoires Terre Sans Frontière
ALSACE LIEU DE MÉMOIRES TERRE SANS FRONTIÈRE Das Elsass, Ort der Erinnerung, Land ohne Grenze Alsace: a place full of memories, a land without borders Une édition des ADT du Bas-Rhin et du Haut-Rhin [A] [B] [C] [D] 1 1 6 2 3 4 5 8 7 11 9 12 13 10 2 14 15 16 17 3 18 22 19 20 21 23 24 25 26 29 27 32 30 31 28 4 34 33 35 36 5 39 37 38 41 40 6 45 42 44 43 46 7 49 47 48 51 8 50 KdfWhYekhi fWii_eddWdj |igVkZghaÉ]^hid^gZ gXZciZYZaÉ6ahVXZ ;_d_dj[h[iiWdj[hIjh[_\pk]ZkhY^ Y^Z_c\ZgZ<ZhX]^X]iZYZh:ahVhh 7\WiY_dWj_d]`ekhd[o^cidi]ZgZXZci]^hidgnd[6ahVXZ Eg[VXZ$Kdgldgi$EgZ[VXZ 44 Monument des «Diables Rouges» 31 Centre européen du résistant déporté (Denkmal) ........................................................... p.12 ...[B6] (Europäisches Zentrum der deportierten Widerstands- 35 Musée «Hansi» (Museum) ................................ p.5 .....[B5] kämpfer / European centre for deported resistance 42 Monument des «Diables Bleus» (Denkmal) .. p.12 ...[B6] fighters) .............................................................. p.21 ...[B4] 34 Patrimoine du Val d’Argent (Naturerbe 32 Sentier des Passeurs (Weg der Fluchthelfer / AV\jZggZYZ&-,% vom Silbertal / Heritage of Val d’Argent) ....... p.13 ...[B5] Smuggler’s Trail) ............................................... p.21 ...[B-A4] 9Zg@g^Z\kdc&-,% 36 «Tête des Faux» (Buchenkopf) ...................... p.13 ...[B5] 51 Monument «Groupe Mobile d’Alsace» I]Z;gVcXd"Egjhh^VcLVgd[&-,% 39 Mémorial du Linge (Gedenkstätte (Denkmal) .......................................................... p.21 ...[B8] am Lingekopf / Linge memorial) .................... p.14 ...[B5] 50 Ferme des «Ebourbettes» (Hof / Farm) ........ p.22 ...[B8] 1 Champs de bataille du «Geisberg» 41 Circuit historique (Historischer (Schlachtfelder / Battlefields) ......................... -

Presskit Mulhouse 2019 .Pdf
PRESS KIT 2019 Office de Tourisme et des Congrès de Mulhouse et sa région Clémence Saycocie Communications and Press Officer Tel: +33 (0)3 89 35 47 43 - +33 (0) 6 18 35 47 43 [email protected] 1 P 5 Help with your report You have the idea ? We might have the key! P 6 10 “must sees” in Mulhouse Alsace So many things to see and do in Mulhouse ! Let’s start with 10! P 8 What’s new? Everything you have to know about Mulhouse and the surrounding region at a glance! P 12 Mulhouse, living Alsace in a creative way Culture is everywhere in Mulhouse. Street scenes, urban art, Mulhouse is creative and attractive. P 14 Mulhouse, the most typical districts P 18 Mulhouse, it’s all about art! P 20 Exceptional Museums TABLE OF Mulhouse and Southern Alsace are home to Europe’s number 1 cluster of industrial museums. P 26 Take a breath of fresh air... CONTENT Mulhouse and its region provide a wonderfully green environment for holiday makers. P 28 Shopping in Mulhouse P30 Mulhouse, for food lovers P 32 It’s all happening here, in Mulhouse! What will happen? and when? Here are the events! P 34 3 ways to visit Mulhouse P 36 Shall we explore a little further? Mulhouse et sa région sont le point de départ pour de chouettes excursions ! P38 Websites & Social Media P39 Groups & Business Tourism 2 Strasbourg Freiburg MULHOUSE Basel 3 4 The Tourist Office and Convention Bureau of Mulhouse and its region can provide all the ser- vices you need to help organise your reports: A dedicated team: Marie Garcin-Zaiter, Director, and Clémence Saycocie, Press Officer, will be happy to help you for all types of press coverage. -

Nazi Charity: Giving, Belonging, and Morality in the Third Reich
University of Tennessee, Knoxville TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange Doctoral Dissertations Graduate School 5-2018 Nazi Charity: Giving, Belonging, and Morality in the Third Reich John William Rall University of Tennessee Follow this and additional works at: https://trace.tennessee.edu/utk_graddiss Recommended Citation Rall, John William, "Nazi Charity: Giving, Belonging, and Morality in the Third Reich. " PhD diss., University of Tennessee, 2018. https://trace.tennessee.edu/utk_graddiss/4942 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange. It has been accepted for inclusion in Doctoral Dissertations by an authorized administrator of TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange. For more information, please contact [email protected]. To the Graduate Council: I am submitting herewith a dissertation written by John William Rall entitled "Nazi Charity: Giving, Belonging, and Morality in the Third Reich." I have examined the final electronic copy of this dissertation for form and content and recommend that it be accepted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, with a major in History. Monica A. Black, Major Professor We have read this dissertation and recommend its acceptance: Vejas G. Liulevicius, Daniel H. Magilow, Denise Phillips Accepted for the Council: Dixie L. Thompson Vice Provost and Dean of the Graduate School (Original signatures are on file with official studentecor r ds.) Nazi Charity: Giving, Belonging, and Morality in the Third Reich A Dissertation Presented for the Doctor of Philosophy Degree The University of Tennessee, Knoxville John William Rall May 2018 ii Copyright © 2018 by John William Rall. -
Document D'information Communal Sur Les Risques Majeurs
D.I.C.R.I.M. Document d’information communal sur les risques majeurs Commune d’Ebersheim MAIRIE D’EBERSHEIM 1, Place de la Mairie 67600 EBERSHEIM Tél. : 03 88 85 72 11 Fax : 03 88 85 79 00 E-mail : [email protected] Risques identifiés : Inondation ; Séisme ; Tempête ; Transport de matières dangereuses (route & rail) ; Incendie (habitations & forêt) ; Canalisation de Gaz ; Industriel ; Neige & Froid; Canicule. Mis à jour le : 20/09/2018 page - 1 - / 22 Sommaire Le mot du Maire page 3 Présentation de la commune page 4 Carte des risques sur la commune page 6 Rappels règlementaires page 7 Etat d’alerte page 8 Principales consignes à respecter page 9 Les risques naturels page 10 Risque tempête page 12 Risque inondation et coulée de boue page 13 Risque sismique page 14 Risque feux de forêt et habitation page 15 Risque transport de matières dangereuses page 16 Risque industriel page 17 Risque neige et grand froid page 18 Risque canicule page 19 Numéros de téléphones utiles page 20 Lexique page 21 Mis à jour le : 20/09/2018 page - 2 - / 22 Le mot du Maire Vous vous demandez probablement ce qu’est un risque majeur. Disons que le risque majeur concerne des phénomènes naturels de grandes ampleurs qui risquent d’atteindre notre Commune. On appelle cela en langage courant…… une CATASTROPHE Le DICRIM (document d’information Communal sur les Risques Majeurs) est un document réalisé par le Maire et son conseil municipal dans le but d’informer les habitants de sa Commune sur les risques naturels et technologiques qui les concernent, sur les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mise en œuvre ainsi que sur les moyens d’alerte en cas de survenance d’un tel risque. -

THE POTASH DEPOSITS of ALSACE. by HOYT S
THE POTASH DEPOSITS OF ALSACE. By HOYT S. INTRODUCTION. When potash was discovered in Alsace in 1904 the monopoly of the potash industry that had rested with the owners of the great deposits in north-central Germany since 1860 was broken. The new field, although less extensive than that of Germany, was very soon recog nized as having several important advantages over the older developed field. The Alsatian deposits underlie a large area in exceedingly regular beds, and the salts are on the average remarkably rich in potash. The deposits consist of a simple mixture of potassium and sodium chlorides, known as sylvinite, with very little other soluble material. This mixture of crude salts requires only the simplest chemi cal treatment in order to purify it into the higher grades of potash salts. The field itself is somewhat farther from ocean ports than the north-central German region, but as it lies in a well-developed part of the Rhine Valley, directly on the routes of main-line water and rail transportation, this difference is not a serious handicap. It is natural, therefore, that the first mine opened in the new Alsatian field at once took third or fourth rank as a producer with all the older Ger man mines, a position it has since been well able to maintain. It has seemed a strange coincidence that the only two really large deposits of soluble potash salts that have been found in the whole world should have been opened within .the domain controlled by a single empire. The return of Alsace to France now divides the monopoly of this important natural resource, and general interest in the details of the Alsatian field and its prospects for the future has increased. -

Mapping the Third Republic, Online Appendix
Mapping the Third Republic A Geographic Information System of France (1870–1940) Online Appendix Victor Gay∗ Forthcoming at Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History List of Appendix Figures A.1 Construction Logic of the TRF-GIS.......................4 A.2 Missing Territories During the Third Republic.................5 A.3 Number of Communes in TRF-GIS Commune-Level Nomenclatures.....5 A.4 Number of Départements, Arrondissements, and Cantons (1870–1940)....6 A.5 Number of Military Constituencies (1870–1940)................6 A.6 Military Constituencies in 1870, 1874, 1919, and 1940.............7 A.7 Number of Judicial (1870–1940) and Penitentiary Constituencies (1871–1940)8 A.8 Judicial Constituencies in 1870, 1871, 1926, and 1940.............9 A.9 Penitentiary Constituencies in 1871, 1888, 1909, and 1940........... 10 A.10 Number of Electoral, Academic, Labor inspection, and Ecclesiastical Con- stituencies..................................... 11 A.11 Electoral Constituencies (Circonscriptions) in 1876, 1889, 1919, and 1928.. 12 A.12 Academic, Labor Inspection, and Ecclesiastical Constituencies in 1919.... 13 A.13 Département-Level Abstention Rates in Legislative Elections 1914...... 14 A.14 Circonscription-Level Abstention Rates in Legislative Elections 1914..... 15 ∗Toulouse School of Economics (TSE) and Institute for Advanced Study in Toulouse (IAST), University of Toulouse Capitole, Toulouse, France (email: [email protected]). List of Appendix Tables A.1 Composition of Annexed Territories of Alsace-Lorraine (1871)........ 16 A.2 Reconfiguration of Territories of Alsace-Lorraine that Remained in France (1871–1873).................................... 17 A.3 Reconfiguration of Territories of Alsace-Lorraine within the German Empire (1871–1918).................................... 18 A.4 Arrondissements Reform of 1926........................ -

Texas Alsatian: Henri Castro's Legacy
Copyright by Karen Ann Roesch 2009 The Dissertation Committee for Karen Ann Roesch Certifies that this is the approved version of the following dissertation: Texas Alsatian: Henri Castro’s Legacy Committee: Hans. C. Boas, Supervisor Marc Pierce Robert King Patience Epps Lars Hinrichs Texas Alsatian: Henri Castro’s Legacy by Karen Ann Roesch, B.A.; M.A. Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Austin in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy The University of Texas at Austin December 2009 Dedication To my paternal grandmother, Rosa Lee Hawkins Collins, a Texas-German speaker, and My mother, Joanne Powell Collins, who set an example for me in her achievement of high academic goals Acknowledgements First and foremost, I express my deep appreciation and thanks to the communities of Castroville, D’Hanis, and LaCoste for their participation in and support of my efforts to document the Alsatian language in Texas, which they have so treasured and ardently preserved. Many people in the Alsace also supported me and facilitated my work, even welcoming me into their homes, for which I am deeply thankful. Without their help and encouragement, I would not have been able to achieve my goal. I equally thank my husband and best friend, who lovingly encouraged me and unfailingly gave me both technical and emotional support in the undertaking of this monumental task to its completion, even when it meant weekly separation over a period of several years. Special appreciation goes to my daughter, Cara, who tolerated me in her apartment during the week, lifted my spirits when I was overwhelmed, and made me eat breakfast every day before I left for the courses which prepared me for this task. -

Histoire De L'alsace
NOTES: Histoire de l’Alsace Tome VI Maison de Ribeaupierre Kevin Smith 2017 268 i NOTES: Printing / Binding Instructions 1. Print document double sided on letter size paper 2. Cut the entire printed document in half 3. Fold over making sure the page numbering is continuous 4. For the cover: Print just the first page on card stock paper Cut the cover in half as well 5. Assemble the covers on the document 6. Punch the left side for a binding, spiral or comb as desired http://www.lessmiths.com/~kjsmith/html/main.shtml KJ Smith ii 267 NOTES: 266 iii satellite. A cette date, vers 1608, les adversaires comptent leurs troupes - Strasbourg adhère à l`union évangélique. Les grandes manœuvres qui annoncent la Guerre de Trente ans sont lancées. Mémoire écorchée Prise en tenaille entre Habsbourg et Lorraine, l'Alsace de la fin du XVI* siècle occupe une place singulière dans la géopolitique de l'Europe. Sa situation d'avant poste de l`Allemagne l`expose d'autant plus qu'elle a été promue frontière militaire de l`Empire depuis Marignan et, surtout, depuis la chevauchée d'Austrasie d`Henri II en 1552. Mais elle n`est plus seulement un observatoire ou un bastion: elle joue un rôle actif dans les événements français, accumulant les témoignages, faisant circuler les nouvelles, nourrissant sa mémoire, de là, s`appropriant Lme histoire familière. I-Ienri IV est l`ami des cités de Strasbourg, de Bâle et de Mulhouse - comme il est, d'ailleurs, l'amj des Genevois ou des princes protestants. Il est, par conséquent, une garantie contre l'empereur qui règne de Vienne ou de Prague. -

Alsace-Lorraine from Wikipedia, the Free Encyclopedia Coordinates: 48°40′N 7°00′E
Create account Log in Article Talk Read Edit View history Alsace-Lorraine From Wikipedia, the free encyclopedia Coordinates: 48°40′N 7°00′E Navigation This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed. (June 2011) Main page Contents The Imperial territory of Alsace-Lorraine (German: Reichsland Elsass-Lothringen or Reichsland Elsass-Lothringen Featured content Elsass-Lothringen), was a territory created by the German Empire in 1871 after it Imperial territory of Alsace-Lorraine Current events annexed most of Alsace and the Moselle region of Lorraine following its victory in the Random article Franco-Prussian War. The Alsatian part lay in the Rhine Valley on the west bank of the Province of the German Empire Donate to Wikipedia Rhine River and east of the Vosges Mountains. The Lorraine section was in the upper ← 1871–1918 → Moselle valley to the north of the Vosges Mountains. Interaction The Imperial territory of Alsace-Lorraine was made up of 93% of Alsace (7% remained French) and 26% of Lorraine (74% remained French). For historical reasons, specific Help legal dispositions are still applied in the territory in form of a local law. In relation to its About Wikipedia special legal status, since its reversion to France following World War I, the territory Community portal has been referred to administratively as Alsace-Moselle.[1] Recent changes Contact page Contents Flag Imperial Coat of arms 1 Geography Anthem -

Als Ce the Guide to Your Stay Nature and Activities, Gastronomy and Traditions, History and Heritage
Als ce The guide to your stay Nature and activities, gastronomy and traditions, history and heritage Eguisheim DISCOVERY TRADITION HISTORY Hunawihr Folkloric group D’Kochloeffel Hohlandsbourg Castle The guide to your stay in Alsace estled between the Vosges and the Rhine, Alsace is a charming little region with a big reputation. At the crossroads of the Germanic and Latin worlds, it is Npassionate about its History, yet firmly anchored in modern Europe and open to the world. Rated as among the most beautiful in France, the Alsatian towns and cities take home national “Towns in Bloom” awards each year. Through their festivals and their traditions, they have managed to preserve a strong identity based on a particular way of living. World famous cuisine, a remarkably rich history, welcoming and friendly people: in this jewel of a region there really is something for everyone. TO DISCOVER ALSACE AT YOUR OWN PACE, YOU SIMPLY HAVE TO LET YOURSELF BE INSPIRED: SURPRISES AWAIT YOU AT EVERY TURN OF THE PAGE. 2 Easy to reach by TGV 4 to 7 Strasbourg, Sélestat, Saverne, Colmar and Mulhouse Escape into a natural paradise! 8 to 16 The Vosges Mountains Contents Rhineland environment Parks and gardens Hiking Well-being and health resorts Wildlife parks and theme parks Cycle touring, mountain biking High wire adventure parks, climbing Horseback riding Golfing River tourism Watersports, swimming Airborne sports Fishing Winter sports Multi-activity holidays Local gastronomy and traditions 17 to 19 - 22 to 25 Gourmet Alsace Dinner is served! Cooking classes,