Les Hallucinés
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
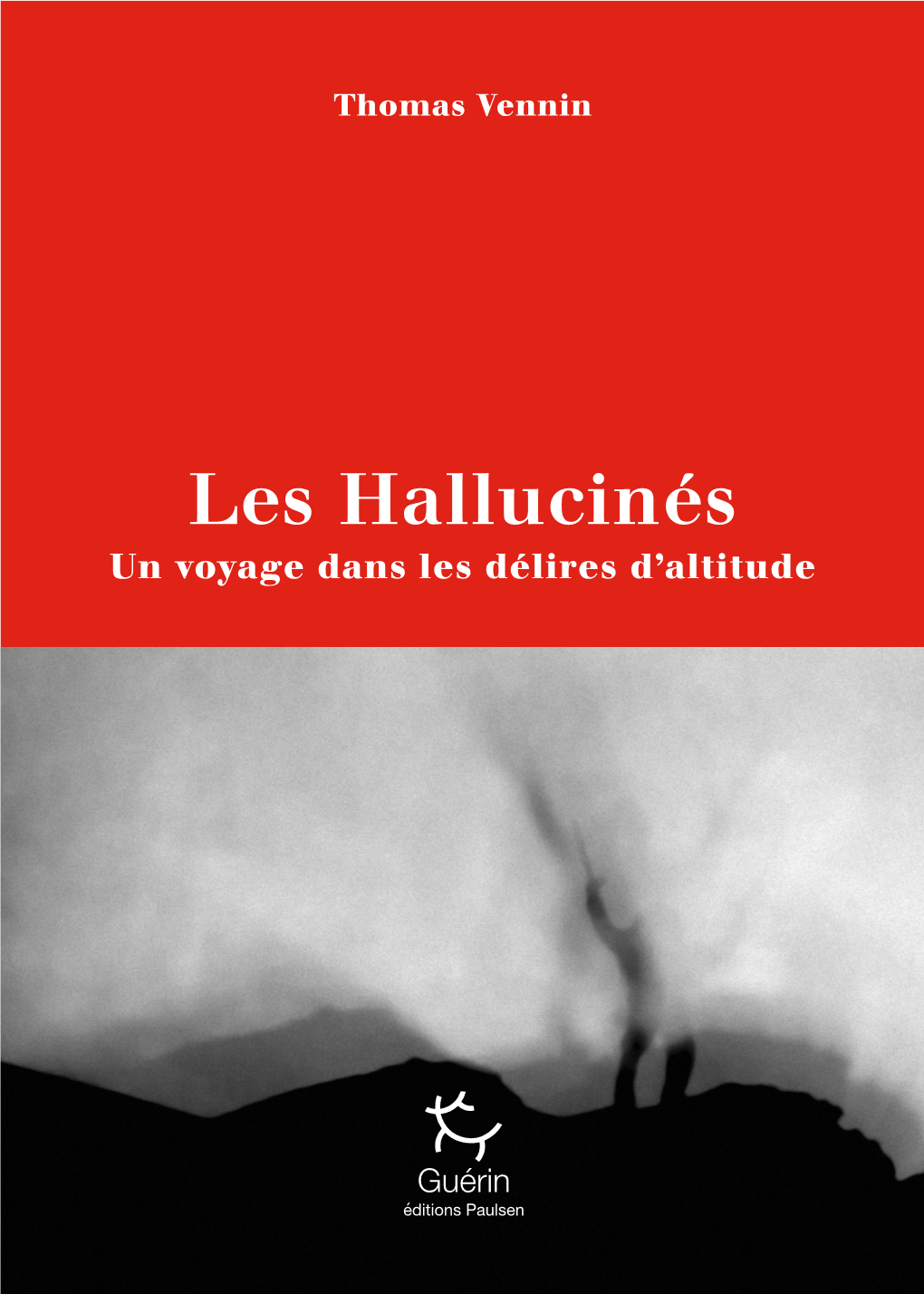
Load more
Recommended publications
-

Annapurna I, East Ridge, Third Ascent. One of the Most Nota
C LIMBS A ND E XP E DITIONS : N E PA L 375 Nepal ANNAPURNA HIMAL Annapurna I, east ridge, third ascent. One of the most nota- ble accomplishments of the season was the second two- way traverse of the east ridge of Annapurna I (8,091m). When the well-known Pol- ish climber, Piotr Pustelnik, organized his four-man team for this task, he was well aware of the difficulties they would confront on this huge ridge, which starts from Tarke Kang (a.k.a. Glacier Dome, 7,193m) in the east and runs westward over Roc Noir to the three 8,000m summits of Annapurna. However, he did not anticipate the addition of two not-so-highly skilled Tibetans on his permit and the problems one of them would present. The first ascent of the east ridge, which resulted in an elegant traverse of Annapurna, ranks with some of the most significant events in the history of Himalayan climbing. The ridge was first attempted by Germans in 1969, and again in 1981 by a Swedish team, the latter getting as far as the East Summit of Annapurna. Both approached via the West Annapurna Glacier and the east side of the col north of Fluted Peak. In September and October 1984 a six-man expedition entirely formed of Swiss guides, established four camps from the South Annapurna Glacier, climbing to the col between Fluted Peak and Tarke Kang from the more difficult but less dangerous west side, then, in common with the Germans and Swedes, up the ridge above to Tarke Kang itself. -

La Montagne C'est Mon Rêve
Ski- statt Kriegsbilder aus Afghanistan Jahresbericht Mehr dazu auf Seite 7 Rapport annuel 2014 Schritt für Schritt auf Seite 2 «La montagne c’est mon rêve» à la page 3 Vorbilder oder lebensmüde Spinner? auf Seite 4 Jahresrückblick in Bildern ab Seite 9 Vorschau aufs Programm 2015 auf Seite 24 Editorial 2 Beat Hächler, Direktor Alpines Museum der Schweiz [email protected] Schritt für Schritt «Du gehst zu schnell. Geh langsamer!» Mein Vater hat mich auf Bergwanderungen öfters ermahnt, den Schritt etwas zu mässigen. Der Weg sei weit, die Kräfte müssten bis oben und wieder zurück reichen. Des- halb ging er langsam. Schritt für Schritt, wie ein Uhrwerk. Drei Jahre nach dem Neustart des Alpinen Museums sind mir seine Ratschläge noch im Ohr. Der Weg ist steil. Es gibt stotzige und rutschige Partien, die ein Vorwärts- kommen erschweren. Aber es hat auch Stufen, die plötz- lich auf festen Boden führen, oder Wegbiegungen, PASÀ PAS «Tu marches trop vite. Ralentis!» Lors die einen neuen Blick freigeben. Das Jahr 2014 war ein de nos randonnées alpines, mon père m’a souvent recommandé d’adopter solches Wegstück. Das Museum erreichte weniger un rythme de marche plus calme: il fal- lait garder en réserve les forces néces- saires à l’atteinte du but de l’excursion Ausstellungsbesucher als im Vorjahr, gewann aber viele et à l’effort du retour. C’est pourquoi il marchait lentement. Pas à pas, comme un mécanisme horloger. Trois ans Begeisterte dazu. Das Museum hatte mehr Mühe, après le redémarrage du Musée Alpin, j’entends encore ces recommanda- Drittmittel für die Ausstellungen zu finden, aber die reali- tions. -

In Memoriam 2010, However Most of the Books Shortlisted Have Been Reviewed in Either This Volume Or 2009
402 T h e A l p i n e J o u r n A l 2 0 1 0 / 1 1 The Boardman Tasker Prize for Mountain Literature Space constraints in this two-year volume of the AJ prevent us following recent practice and reproducing the speeches of jury chairmen for 2009 or In Memoriam 2010, however most of the books shortlisted have been reviewed in either this volume or 2009. The prize of £3000 commemorates the lives of Peter Boardman and Joe Tasker and is given to the author or co-authors of an original work that has made an outstanding contribution to mountain liter- ature. On 17 May 1982 Boardman and Tasker were last seen on Mount The Alpine Club Obituary Year of Election Everest attempting to traverse The Pinnacles on the unclimbed north-east (including to ACG) ridge at around 8250m. Their deaths marked the end of a remarkable era Chris Astill 1985 in British mountaineering. Patrick (Paddy) Boulter 1972 The winners, shortlists and judges for 2009 and 2010 were as follows: Roger Childs 1997 Robert (Bob) Creswell 2007 2009 Robin Day 1968 John Edwards 1982 Winner: Beyond the Mountain by Steve House, Patagonia Books, USA Nawang Gombu Hon 1998 (Vertebrate Publishing in UK) Alistair Gordon 1993 Alfred Gregory 1952 (Hon 2004) Others shortlisted: Eileen Healey LAC 1947 Cairngorm John by John Allen, Sandstone Press Mike Hewson 1994 Hooker & Brown by Jerry Auld, Brindle & Glass, Canada Frederick Hill 1975 The Longest Climb by Dominic Faulkner, Virgin Books Peter Hodgkiss 1988 Revelations by Jerry Moffatt, Vertebrate Publishing John Kempe 1952 Deep Powder and Steep Rock -

23Fbl (Download Free Pdf) the Will to Climb: Obsession and Commitment and the Quest to Climb Annapurna--The World's Deadliest Peak Online
23fbl (Download free pdf) The Will to Climb: Obsession and Commitment and the Quest to Climb Annapurna--the World's Deadliest Peak Online [23fbl.ebook] The Will to Climb: Obsession and Commitment and the Quest to Climb Annapurna--the World's Deadliest Peak Pdf Free Par Ed Viesturs, David Roberts DOC | *audiobook | ebooks | Download PDF | ePub Download Now Free Download Here Download eBook Détails sur le produit Rang parmi les ventes : #254078 dans eBooksPublié le: 2011-10-04Sorti le: 2011-10- 04Format: Ebook Kindle | File size: 60.Mb Par Ed Viesturs, David Roberts : The Will to Climb: Obsession and Commitment and the Quest to Climb Annapurna--the World's Deadliest Peak before purchasing it in order to gage whether or not it would be worth my time, and all praised The Will to Climb: Obsession and Commitment and the Quest to Climb Annapurna--the World's Deadliest Peak: Commentaires clientsCommentaires clients les plus utiles0 internautes sur 0 ont trouvé ce commentaire utile. Great history of the Annapurna climbing, especially first ascent of the East RidgePar Jerome RyanAmerica's first mountaineer to climb all 14 8000m peaks and twelfth overall, all without oxygen, Viesturs describes the major events on Annapurna along with his own three attempts featuring his diary entries. You should buy this book first and foremost for Viesturs account of the first ascent of the East Ridge by Swiss Erhard Loretan and Norbert Joos in 1984, second for the miraculous survival of Simone Moro and tragic death of Anatoli Bookreev on Christmas Day 1997, third for his own three attempts and eventual success, and finally as a history of the main events in Annapurna's history including the first ascent by Maurice Herzog and Louis Lachenal in 1950, the first ascent of the south face by Dougal Haston and Don Willans on a Chris Bonington British expedition in 1970, the first ascent of the northwest face by Reinhold Messner and Hans Kammerlander in 1985, the first winter ascent by Jerzy Kukuczka and Artur Hajzer in 1987, and the second ascent of the east ridge by J.-C. -

309 the AMERICAN ALPINE JOURNAL, 1996 Japanese And
309 THE AMERICAN ALPINE JOURNAL, 1996 Japanese and American Tony Tonsing). German, 20-strong commercial expedition led by Hans Eitel (who left soon) and guide Peter Kowalzik: sum- mit reached on August 16 by Peter Kowalzik, Wolfgang Angermeier and Marla Putz, Germans, and Heinz Wohlwent from Leichtenstein. Gasherbrum I (Hidden Peak). Detail missing from page 25 1: The Swiss expedition led by Norbert Joos included 12 members who proceeded up the northwest face, to the left of Messner’s line. The summit was reached on June 7 by Norbert Joos, Hans Bomann and Martin Stoller, all Swiss (they were the only sum- mitters of Gasherbrum I in 1993). The Germans led by Peter Geyer gave up at the Gasherbrum La (6670 meters). The Spanish Basques were led by Pedro Angulo. Broad Peak (page 251): Regarding the group led by Faust0 De Stefani, the summit was reached on July 6 by Italians Christian Kuntner and Marco Bianchi. And on July 7. by Albert Brugger. Faust0 De Stefani and Serio De Leo, Italians, and Tabyas Heymann who is German. Nanga Parbat: One expedition report is missin g from pages 262-265. An eight-member South Korean expedition led by Choi Hyung-Duk suffered the loss of one of their climbers, Ahn Chun-Moon, who died on July 7. He had reached 8050 meters by the Kinshofer route when he turned back. never to be seen again. This was witnessed by the two Basque climbers who summitted the same day. XAVIER EGUSKITZA, Pyenaica, Bilboa, Spain CHINA, Tien Shan P 5445 Attempt and Ascents c?fJianshier Feng. -

Alone on Annapurna
AAC Publications Alone on Annapurna In 1984, Swiss alpinists Norbert Joos and Erhard Loretan ventured with a small team up the seven- kilometer-long east ridge of Annapurna, which borders the south face in a rippling line of subpeaks and summits. For the final four days on the crest, the two men continued alone in alpine style through squalls of wind, committing themselves to total solitude between heaven and earth. In Les 8000 Rugissants, Loretan wrote, “I’ve never felt as far away from the living and as close to the dead.” Loretan became my idol. He helped bring a revolutionary approach to the Himalaya, achieving the best results by moving remarkably fast and light across vast stretches of terrain. In 1986 he and Jean Troillet climbed and descended the north face of Everest in a mere 43 hours. Years later, Loretan and I went to the Himalaya together, and I pestered him with questions about Everest. He was very clever: Because they’d free-soloed through the darkness, he and Troillet didn’t have to bring ropes or a tent: They only stopped climbing during the day, when the temperatures were warm. With less time up high, they felt they had less risk of objective hazards and altitude sickness. It was a simple, efficient, and intelligent solution. The Polish alpinist Voytek Kurtyka proposed that such ultra-minimalism could change everything. But the 1986 Everest climb baffled most climbers, and no one has managed to replicate it. Then, in 1992, two French climbers, Pierre Béghin and Jean-Christophe Lafaille, envisioned another beautiful ascent: a direct path up the south face of Annapurna that could be climbed in lightweight style. -

Ueli Steck, Shisha Pangma Southwest Face, Girona Corredor, 17 April 2011 by Rodolphe Popier
Ueli Steck, Shisha Pangma southwest face, Girona Corredor, 17 April 2011 By Rodolphe Popier 1/ The routes of the southwest face The main routes on the Southwest Face of Shisha Pangma (variants excluded. Credit : GMHM 2014), from left to right: Indigo: Spanish route to the West summit, 2000, by E.Sanchez. & E.Callado. Red: Swiss Polish route to the Central summit, 1990, by E.Loretan, J.Troillet & Voytek Kurtyka. Pink: South Korean route, 2001, by Park Jun-Hun & Kang Yeon-Ryoung. Blue: Slovenian route, 1989, by A. Štremfelj& P.Kozjek. Green: British route, 1983, by D.Scott, A.MacIntyre, R.Baxter-Jones. Brown: Wielicki route, 1993, by K.Wielicki. Yellow: Ueli Steck routes combination in 2011. Purple: Spanish route, 1995, by C.Figueras & J.Permanyer. Steck said that he arrived at the foot of the mountain without a topoguide, he and his teammates deciding however, after a while, (when considering Bowie was not enough acclimatized) that he would try for the summit via the British route (at least they knew that one). At 6800m on the night of the 16 to 17 April 2011, Steck changed his mind due to rock fall that he heard somewhere in the Pea Pod, he turned right into the Wielicki route, then exited from the face by the Girona Corredor. For descent, he would use the classic British descent route. 2/ The highest shot of Steck on the mountain Discovering the reports on his Shisha climb, I first saw a picture of Steck in the following report with this special caption "Ueli Steck before summit ridge." http://www.wengerna.com/success-on-shisha-pangma-4-21-2011 It is a capture screen from a short movie shown on the official website of the expedition: http://www.himalayaspeed.com I found the caption strange as Steck obviously seemed still to be on the face itself and significantly below the ridge. -

CLIMBS and EXPEDITIONS, I992 251 Cantalamessa, Franc0
CLIMBS AND EXPEDITIONS, I992 251 Cantalamessa, Franc0 Giansanti, Andrea and Stefano Di Lello climbed to the summit. LUCIANO GHIGO, Centro Italian0 Studio Documentazione Alpinism0 Italiano India-Eastern Karakoram Mamostong Kungri. This high peak continues to attract climbing teams. An Indian ladies’ team, led by Bachendri Pal, climbed the normal route from the Mamostong Glacier, crossing the 5885-meter Mamostong col and up the east ridge. The summit (7516 meters, 24,650 feet) was reached from Camp IV at 6700 meters by I5 climbers, all on August 15, in three groups. The first summit party consisting of Deepu Sharma, Kunga Bhutia, Anita Devi and Harsha Panwar was accompanied by instructor Rajeev Sharma and Sherpas Kushang and Nadre. They reached the top at one P.M. Sarla Negi, Radha Devi, Dickey Dolma, Bimla Negi and instructor Baldev Kanwargot to the summit at two P.M. Suman Kutiyal and Savita Martolia summited at 2:30 P.M. with porter Vijay Singh. A fourth attempt was thwarted by bad weather. The All-Women Pre- Everest Expedition had I7 members and a doctor. This is the second expedition in preparation for the 1993 Indo-Nepalese Women’s Expedition to Everest. HARISH KAPADIA, Editor, Himalayan Journal Teram Kungri. Teram Kangri (7433 meters, 24,485 feet) rises near the junction of the Teram Shehr and the Siachen Glaciers. It was climbed in 1992 by and Indian army team led by Colonel M.S. Gill. More details are awaited. HARISH KAPADIA, Editor, Himalayan Journal Pakistan Gasherbrum I Attempt and Tragedy. Our international expedition had as members Americans Barbara Shelonzek, Errol Altay, German Gerhard Schnass, Italians Marco Bianchi, Paolo Bemascone, Giorgio Passino, Kurt Walde, Poles Mariusz Sprutta, Dr. -

Seasonal Stories for the Nepalese Himalaya 1985-2014
Seasonal Stories for the Nepalese Himalaya 1985-2014 by Elizabeth Hawley © 1985-2014 by Elizabeth Hawley 3 Contents Spring 1985: A Very Successful Season ......................................................................... 5 Autumn 1985: An Unpropitious Mountaineering Season ............................................ 8 Winter 1985-86: Several First Winter Ascents ........................................................... 11 Spring 1986: A Season of Mixed Results ..................................................................... 14 Autumn 1986: The Himalayan Race Is Won ............................................................... 17 Winter 1986-87: First Winter Ascent of Annapurna I ................................................ 22 Spring 1987: High Tension on Cho Oyu ...................................................................... 25 Autumn 1987: “It Was Either Snowing or Blowing” ................................................... 29 Winter 1987-88: Some Historic Ascents ...................................................................... 33 Spring 1988: A Contrast in Everest Climbing Styles ................................................. 36 Autumn 1988: Dramas in the Highest Himalaya ....................................................... 44 Winter 1988-89: Two Notable Achievements, ............................................................. 51 Spring 1989: A Dramatic Soviet Conquest .................................................................. 56 Autumn 1989: A Tragic Death on Lhotse ................................................................... -

204 the AMERICAN ALPINE JOURNAL 1994 That I Am the Only Person Over 80 Years of Age to Reach the Lake
204 THE AMERICAN ALPINE JOURNAL 1994 that I am the only person over 80 years of age to reach the lake. The climbers crossed to Nepal Gap Glacier, on which they placed Camps I and II at 5200 and 5800 meters on September 25 and 27. Camp III was on the ridge between Gimmigela II and Sugarloaf at 6500 meters. Camp IV was placed just below the top of Gimmigela II at 6900 meters on October 9. Japanese Hideo Koike, Masanori Sato, Taroh Tanigawa and Indian Sherpas Phurba, Chuldin and Pasang Nima reached the summit of the east peak, Gemmigela II, (7005 meters, 22,982 feet) on October 13. At five A.M. on October 18, the final assault team left Camp V on the ridge between the main and east peaks for the main peak, Gemmigela I (7350 meters, 24,144 feet). A 7:30 A.M., the climbing leader, Masanori Sato, fell 35 meters into a hidden crevasse and was instantly killed. Despite all efforts, the others could not recover the body. Out of consideration for our lost friend, the expedition was terminated. The expedition leader was Tsuguyasu Itami. Ko YOSHIDA, Japanese Alpine Club Kokthang Attempt. An Indian team led by Dilip Kolhatkar had the dubious distinction of being the first Indian expedition to run into trouble with the new Government of Sikkim rules for mountaineers. They were stopped at a local police check point and extra payment was demanded even though they had full clearance from the Government of India and the Indian Mountaineering Foundation. The authorities in Sikkim were highly uncooperative and they lost too many days there to make progress. -

Shisha Pangma, 8027 M Erkundung, Erstbesteigung, Erstbegehungen, Ereignisse
Shisha Pangma, 8027 m Erkundung, Erstbesteigung, Erstbegehungen, Ereignisse (von Günter Seyfferth, www.himalaya-info.org) 1990 Eröffnung einer neuen Route in der Südwestwand zum Mittelgipfel durch Loretan, Troillet, Kurtyka (ohne Hauptgipfel) Südwestwand des Shisha Pangma Die beiden Schweizer Erhard Loretan und Jean Troillet sowie der Pole Wojciech Kurtyka haben gerade erst am 21. Sept. erstmals die Südwestwand des Cho Oyu bezwungen und befinden sich bereits am 30. Sept. im Basislager unter der Südwestwand des Shisha Pangma. Am Abend des 2. Okt. steigen sie ohne Biwakausrüstung in das Couloir links des Hauptgipfels ein, das in Richtung Mittelgipfel führt. Bereits um 10 Uhr des folgenden Morgens ( 3. Okt.) stehen Loretan und Troillet auf dem Mittelgipfel; sie verzichten auf den Übergang zum Hauptgipfel. Beim Abstieg treffen sie auf den zurückgebliebenen Kurtyka, der alleine weiter zum Mittelgipfel steigt. Um 16 Uhr befinden sich Loretan und Troillet wieder am Beginn des Einstiegs, um 23.30 Uhr sind sie im Basislager und bereiten sich die erste Mahlzeit seit Beginn der Kletterei. Voll Sorge um Kurtyka verbringen sie den 4. Okt. im Lager. Als auch am Morgen des 5. Okt. noch kein Zeichen von Kurtyka zu sehen ist, mach sich die beiden Schweizer auf die Suche. Unter- wegs finden sie Abstiegsspuren, die nur von dem Polen stammen können. Sie haben ihn ver- passt und finden ihn schlafend im Basislager. Dort war er vierzig Stunden nach den Schweizern eingetroffen, mehr tot als lebendig. Copyright: Günter Seyfferth, 09.12.2011 Seite 1 Erhard Loretan besteigt den Shisha Pangma nochmals am 29.04.1995, dieses Mal aber den Hauptgipfel. Am 5. -

Jean Troillet Ou Lesprit De L'aventure
MONTAGNES MAGAZINE HORS SERIE Date : MAI 16 Pays : France Journaliste : Jean-Michel Asselin Périodicité : Annuel Page 1/6 interview ; L JeanTroillet JEAN TROILLET OU LESPRIT DE L'AVENTURE Avant d interviewer Jean Troillet j ai mis la mam sur ce livre que j avais conserve Jean Troillet, L'aventure absolue* Jean me I avait dedicace avec cette belle pensée « Bons reves et bons vents sur ces c/mes ou tes souvenirs rejoindront certainement 'es miens amicalement1 » Propos recueillis par Jean-Michel Asselin e tous ces souvenirs,j'ai garde cette n'arrêtait pas de me poser des questions Aujourd'hui, Jean a soixante-huit ans, il est rencontre apres son ascension de sur cette ascension A dire vrai, cela a ete né le lOmars 1948 à La Fouly en Suisse. Je lui Dla face nord de l'Everest avec un grand moment J'ai eu le sentiment ai demande si, comme il l'avait écrit dans un Erhard Loretan Une course folle qui I avait avec Erhard que nous touchions I au-delà livre, « à quatre-vingts ans, j'irai encore sur mené au sommet du toit du monde dans un Nous avions la conscience d'approcher un huit mille»! aller retour express de quarante-trois quelque chose qui nous dépassait, e était Non, c'est une aventure qui est désormais heures Même Pierre Béghin n'avait pu tres mystique » derrière moi Je suis pere de famille, ma fille suivre le rythme etfrene des Justine a quinze ans, mes deux Suisses Je reverrai jumeaux Jules et Alice en ont toujours ce grand geant aux onze et j'ai promis a ma femme, yeux bleus qui me racontait Mireille, apres mon accident les hallucinations