Bibliothèque De L'assemblée Nationale
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more
Recommended publications
-
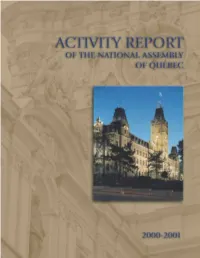
Rapport AN-2001
ACTIVITY REPORT OF THE NATIONAL ASSEMBLY 2000-2001 This publication was accomplished with the collaboration of the executive personnel and staff from all administrative branches of the National Assembly. Unless otherwise indicated, the data provided in this report concerns the activities of the National Assembly from 1 April 2000 to 31 March 2001. Director Cécilia Tremblay Coordinator Jean Bédard Supervisory Committee Jean Bédard Michel Bonsaint Hélène Galarneau Johanne Lapointe Patricia Rousseau Cécilia Tremblay Editor Johanne Lapointe assisted by Lise St-Hilaire Translator Sylvia Ford Revisors Nancy Ford Denise Léonard Design Joan Deraîche Page layout Robert Bédard Manon Dallaire Joan Deraîche Printing National Assembly Press Photographs Front cover: Eugen Kedl Luc Antoine Couturier Photographs of the Members of the 36th Legislature: Daniel Lessard Éric Lajeunesse Jacques Pontbriand Legal deposit - 2nd Quarter 2001 Bibliothèque nationale du Québec Bibliothèque nationale du Canada ISBN 2-550-37742-7 ISSN 1492-9023 2 TABLE OF CONTENTS Preface .............................................................................................................. 5 Foreword ........................................................................................................... 6 The National Assembly ......................................................................... 7 its mission ...................................................................................................... 9 the Members ................................................................................................. -

Procès-Verbal 1Er Octobre-Drummondville
CONSEIL NATIONAL XVI-5 1er OCTOBRE 2011 DRUMMONDVILLE XVI-5-1 MOT DE BIENVENUE PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL EXÉCUTIF NATIONAL.……………………………………………….………………………………2 XVI-5-2 OUVERTURE DU CONSEIL NATIONAL ET NOMINATION À LA PRÉSIDENCE ET AU SECRÉTARIAT D’ASSEMBLÉE..........................................………………………2 XVI-5-3 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR………………………………………..............…2 XVI-5-4 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL NATIONAL DES 23 ET 24 OCTOBRE 2010............................................................................... 3 XVI-5-5 PRÉSENTATION DES POSTES DE VICE-PRÉSIDENTE, DE VICE-PRÉSIDENT À L’ORGANISATION, À LA MOBILISATION ET À LA FORMATION, DE SECRÉTAIRE NATIONALE ET DE TRÉSORIÈRE NATIONALE AU CONSEIL EXÉCUTIF NATIONAL……..………………………….…………………..………………..…….....3 XVI-5-6 ADOPTION DES STATUTS DU PARTI QUÉBÉCOIS………………………………….3 XVI-5-7 ADOPTION DU PROGRAMME DU PARTI QUÉBÉCOIS ........................................ 3 XVI-5-8 PRÉSENTATION DU DÉROULEMENT DES ÉLECTIONS À LA COMMISSION POLITIQUE PAR LA PRÉSIDENCE D’ÉLECTION ..................................................... 3 XVI-5-9 RAPPORTS............................................................................................................. 3 XVI-5-9-1 RAPPORT DU COMITÉ NATIONAL DES JEUNES.…………………………………...3 XVI-5-9-2 RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2011…...……3 XVI-5-9-3 RAPPORT DU LEADER DE L’AILE PARLEMENTAIRE ET PRÉSENTATION DU COMITÉ DES DÉPUTÉS SUR LE RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE……………..…...4 XVI-5-10 DISCOURS……………………………………………………………….……………….4 XVI-5-10-1 DISCOURS -

AQLPA Trente Ans De Luttes Victorieuses
AQLPA Trente ans de luttes victorieuses Par André Bélisle, Président et cofondateur de L’Association québécoise de lutte contre pollution atmosphérique (AQLPA) TEXTE PUBLIÉ DANS LA REVUE L’ACTION NATIONALE, FÉVRIER 2012, DOSSIER ENVIRONNEMENT www.action-nationale.qc.ca AQLPA Trente ans de luttes victorieuses. André Bélisle livre ici une vision personnelle des trente années de l’AQLPA dont les luttes victorieuses forcent l’admiration. Aujourd’hui, en ce début d’année 2012, je commence la rédaction des mémoires de l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA). J’entreprends, en fait, de revisiter sommairement trente ans d’histoire extraordinaire et particulièrement intense. C’est à titre de cofondateur de l’AQLPA et président depuis vingt-neuf ans que j’entreprends ce voyage éclair dans le temps et ce retour dans des dossiers parmi les plus importants et les plus déterminants, à mon avis, de l’histoire environnementale du Québec. J’affirme ceci résolument, mais aussi, et surtout, avec grande modestie. Cette incroyable histoire me dépasse tellement que j’éprouve un vertige certain devant la responsabilité de rendre fidèlement et honnêtement compte de ce qui m’apparaît encore comme un conte de fées ou un appel de Mère Nature. Rien, mais absolument rien, ne m’avait préparé à ce surprenant virage dans ma vie et encore moins à être régulièrement à l’origine et au centre de ce bouillonnement d’énergie de changement et de progrès vert. La naissance de l’AQLPA arrive en juillet 1982 au moment où je suis assembleur de pylônes de ligne à haute tension au Québec et à la Baie-James, donc plutôt loin de l’écologie. -

Report of the National Assembly of Québec 2011 2012
activity report of the National Assembly of Québec 2011 2012 national assembly oF Québec Parliament building Québec (Québec) G1a 1a3 assnat.qc.ca [email protected] 1 866 DéPUTÉS assnat.qc.ca Front cover: The bell tower rises above the coats of arms sculpted in high relief on the facade of the Parliament Building. Photo: Christian Chevalier, National Assembly Collection activity report of the National Assembly of Québec 2011 2012 assnat.qc.ca This publication was prepared in collaboration with the senior management and the personnel of all the administrative units of the National Assembly. Unless otherwise specified, the information in this activity report covers the National Assembly’s activities from 1 April 2011 to 31 March 2012. Supervision Jean Dumas Coordination and Editing Laurie Comtois Drafting Committee Louisette Cameron Catherine Durepos Mario Gagnon Lucie Laliberté Suzanne Langevin Revision Éliane de Nicolini Translation Sylvia Ford Indexing Rénald Buteau Graphic Design Manon Paré Page Layout Catherine Houle Photography National Assembly Collection Clément Allard, photographer Christian Chevalier, photographer Marc-André Grenier, photographer Renaud Philippe, photographer Roch Théroux, photographer With the participation of: French National Assembly (p. 65) Parliamentary Assembly of the Francophonie (p. 54) Debates Broadcasting and Publishing Directorate (p. 43, 44, 47) Education in Parliamentary Democracy Directorate (p. 84, 89) Guy Rainville, photographer (p. 52) Maynor Solís Calderón, photographer (p. 59) Organisation -
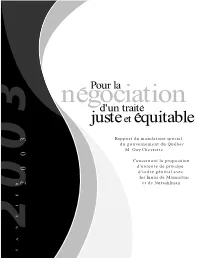
Justeet Equitable
Pour la negociationd'un traite juste et equitable Rapport du mandataire spécial du gouvernement du Québec M. Guy Chevrette Concernant la proposition d'entente de principe d'ordre général avec les Innus de Mamuitun 2003 et de Nutashkuan JANVIER Pour la négociation d'un traité juste et équitable Table des matières 1. PRÉAMBULE. 5 2. LES GRANDS CONSTATS . 7 3. LES TERRITOIRES EN CAUSE ET LES PRINCIPES ET MODALITÉS QUI S’Y APPLIQUERAIENT. 11 3.1 Le Nitassinan. 11 3.1.1 La propriété . 11 3.1.2 L’étendue. 11 3.1.3 Les activités traditionnelles de chasse, de pêche, de trappe et de cueillette (Innu Aitun) . 12 3.1.4 La participation au développement. 14 a) Forêt, mines et pourvoiries. 14 b) Parcs, réserve faunique et aires d’aménagement et de développement. 15 3.1.5 La participation aux processus gouvernementaux de la gestion du territoire . 16 3.1.6 Les redevances. 16 3.2 L’Innu Assi . 16 3.2.1 L’autonomie gouvernementale. 17 3.2.2 L’autonomie financière. 17 3.2.3 Les droits des tiers sur l’Innu Assi . 18 3.2.4 Les cas particuliers de Nutashkuan et d’Essipit . 19 4. LE PROCESSUS DE NÉGOCIATION ET AUTRES CONSIDÉRATIONS . 21 4.1 La participation au processus de négociation et d’information. 21 4.2 La participation aux processus postnégociation . 22 4.3 Le cas de Sept-Îles et de Uashat-Maliotenam . 22 4.4 La clause concernant la Constitution de 1982 . 22 4.5 Référendum ou consultation . 23 CONCLUSION . 25 RECOMMANDATIONS . 27 ANNEXES A. -
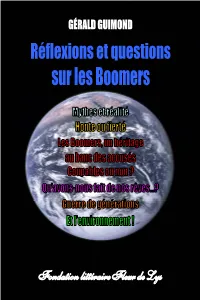
N.Gerald-Guimond.1.Pdf
Mythes et réalité Honte ou fierté Les Boomers, un héritage au banc des accusés Coupables ou non ? Qu’avons-nous fait de nos rêves…? Guerre de générations Et l’environnement ! Réflexions et questions sur les Boomers, Essai, Gérald Guimond, Fondation littéraire Fleur de Lys, Laval, Québec, 2009, 490 pages. Édité par la Fondation littéraire Fleur de Lys, organisme à but non lucratif, éditeur libraire québécois en ligne sur Internet. Adresse électronique : [email protected] Site Internet : www.manuscritdepot.com Tous droits réservés. Toute reproduction de ce livre, en totalité ou en partie, par quelque moyen que ce soit, est interdite sans l’autorisation écrite de l’auteur. Tous droits de traduction et d’adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous les pays. La reproduction d’un extrait quelconque de ce livre, par quelque moyen que ce soit, tant électronique que mécanique, et en particulier par photocopie et par microfilm, est interdite sans l’auto- risation écrite de l’auteur. Disponible en version numérique et papier ISBN 978-2-89612-289-9 ©Copyright 2008 Gérald Guimond Illustration en couverture : La Bille bleue, photo prise par l'équipage d'Apollo 17 le 7 décembre 1972 © NASA. Dépôt légal – 2e trimestre 2009 Bibliothèque et archives nationales du Québec Bibliothèque et archives nationales du Canada Imprimé à la demande au Québec. Dédicace À mes enfants Céline et Denis, à mes neveux et nièces, à tous ces jeunes côtoyés dans l’enseignement, espérant que vous y puiserez un goût de changer des choses dans ce monde marqué par le no future. 9 La recherche et l’écriture de ce livre ont été faites de mars 2005 à juin 2008, avant la crise financière des papiers commerciaux et les scandales qui y sont reliés. -

Le Temps De Parole
VOLUME 19, NUMÉRO 2, JUIN 2018 LE TEMPS DE PAROLE 50e anniversaire du Parti québécois L’assemblée générale annuelle du 16 mai 2018 Le mandat d’initiative sur la place des femmes en politique TABLE DES MATIÈRES LES PREMIERS MINISTRES PÉQUISTES 3 Mot du rédacteur DU QUÉBEC L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 4 Conseil d’administration 2018-2019 René Lévesque, 1976-1985 5 Rapport du président Fonds Assemblée nationale du Québec 9 Rapports des comités Photographe : Kedl 12 Prix de l’Amicale 17 Sous l’œil des photographes 50E ANNIVERSAIRE DU PARTI QUÉBÉCOIS 22 Le Parti québécois : un demi-siècle d’existence 27 Le gouvernement Lévesque : la deuxième phase Pierre Marc Johnson, 1985 de la Révolution tranquille Fonds Assemblée nationale du Québec Photographe : Kedl 31 Le gouvernement Parizeau propose la souveraineté du Québec 35 Le gouvernement Bouchard : redressement économique et progrès social 38 Le gouvernement Landry : miser sur le développement économique et la justice sociale 41 Le gouvernement Marois : un mandat bref, un bilan étoffé Jacques Parizeau, 1994-1996 Fonds Assemblée nationale du Québec AFFAIRES COURANTES Photographe : Daniel Lessard 45 La place des femmes en politique JE ME SOUVIENS 48 Le cimetière de la guerre de Sept Ans 51 Coups de crayon! La satire politique en dessins Lucien Bouchard, 1996-2001 EN PREMIÈRE LECTURE Fonds Assemblée nationale du Québec 52 En première lecture Photographe : Daniel Lessard EN DEUXIÈME LECTURE 55 Les Prix du livre politique de l’Assemblée nationale À L’ÉCRAN 56 Mémoires de députés Bernard Landry, 2001-2003 Fonds Assemblée nationale du Québec ANCIENS ET ANCIENNES PARLEMENTAIRES EN ACTION Photographe : Daniel Lessard 58 Anciens parlementaires en action 63 Songhaï : une Afrique qui relève la tête SOUVENONS-NOUS DE .. -

COMPOSITION RÉCENTE DU CORPS POLITIQUE 895 Ministre
COMPOSITION RÉCENTE DU CORPS POLITIQUE 895 Ministre délégué à l'Aménagement et au Développement Ministre de l'Industrie et du Commerce, l'hon. Frank S. régional et président du Comité ministériel permanent de Miller l'aménagement et du développement régional, l'hon. Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, l'hon. François Gendron Dennis R. Timbrell Ministre des Relations internationales et ministre du Ministre de l'Éducation et ministre des Collèges et des Commerce extérieur, l'hon. Bernard Landry Universités, l'hon. Bette Stephenson, M.D. Ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu Procureur général, l'hon. Roy McMurtry, CR. et vice-présidente du Conseil du Trésor, l'hon. Pauline Marois Ministre de la Santé, l'hon. Keith C. Norton, CR. Ministre de l'Énergie et des Ressources, l'hon. Yves Ministre des Services sociaux et communautaires, l'hon. Duhaime Frank Drea Ministre délégué aux Relations avec les citoyens, l'hon. Trésorier provincial et ministre de l'Économie, l'hon. Denis Lazure Larry Grossman, CR. Ministre des Transports, l'hon. Jacques Léonard Président du conseil d'administration du Cabinet et président du Cabinet, l'hon. George McCague Ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, l'hon. Jean Garon Ministre du Tourisme et des Loisirs, l'hon. Reuben Baetz Ministre de l'Habitation et de la Protection du Ministre de la Consommafion et du Commerce, l'hon. consommateur, l'hon. Guy Tardif Robert G. Elgie, M.D. Ministre des Affaires culturelles, l'hon. Clément Richard Secrétaire provincial à la Justice, l'hon. -

Rebuilding Relations: Hydro-Québec and the Cree Nation (1994–2015)
Éthique publique vol.18, n° 1 (2016) Controverse et acceptabilité sociale des projets de développement économique Original text written in French. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Sofiane Baba, Emmanuel Raufflet, John Paul Murdoch and Réal Courcelles Rebuilding Relations: Hydro-Québec and the Cree Nation (1994–2015) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Warning The content of this site is under the control of French legislation respecting intellectual property and is the exclusive property of the editor. The works on this site may be consulted and reproduced as hard or soft copies, on condition that such documents be strictly reserved for personal, scientific or pedagogical purposes, excluding any commercial use. All reproductions must include the names of the publisher, journal and author, and the document reference information. All other reproduction is prohibited without the prior consent of the publisher, except in cases where it is permitted under applicable legislation in France. Revues.org is an online portal for humanities and social -
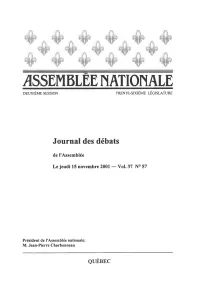
Assemblee Nationale Deuxième Session Trente-Sixième Législature
ASSEMBLEE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Journal des débats de l'Assemblée Le jeudi 15 novembre 2001 — Vol. 37 N° 57 Président de l'Assemblée nationale: M. Jean-Pierre Charbonneau QUÉBEC Abonnement annuel (TPS et TVQ en sus): Débats de l'Assemblée 145,00 $ Débats des commissions parlementaires 500,00 $ Pour une commission en particulier: Commission de l'administration publique 75,00 $ Commission des affaires sociales 75,00 $ Commission de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation 25,00 $ Commission de l'aménagement du territoire 100,00 $ Commission de l'Assemblée nationale 5,00 $ Commission de la culture 25,00 $ Commission de l'économie et du travail 100,00 $ Commission de l'éducation 75,00 $ Commission des finances publiques 75,00 $ Commission des institutions 100,00 $ Commission des transports et de l'environnement 100,00 $ Index (une session, Assemblée et commissions) 15,00 $ Achat à l'unité: prix variable selon le nombre de pages. Règlement par chèque à l'ordre du ministre des Finances et adressé comme suit Assemblée nationale du Québec Distribution des documents parlementaires 880, autoroute Dufferin-Montmorency, bureau 195 Québec, Qc C1R5P3 Téléphone: (418)643-2754 Télécopieur (418) 528-0381 Consultation des travaux parlementaires de l'Assemblée ou des commissions parlementaires sur Internet à l'adresse suivante: www.assnat.qc.ca Société canadienne des postes — Envoi de publications canadiennes Numéro de convention: 0592269 Dépôt légal: Bibliothèque nationale du Québec ISSN 082^0102 ‘ Débats de l'Assemblée nationale Le jeudi 15 novembre 2001 Table des matières AITaires du jour 3695 Projet de loi n° 49 — Loi modifiant la Loi sur la Société d’habitation du Québec Adoption du principe 3695 Mme Louise Harel 3695 Mme Fatima Houda-Pepin 3701 Entente de principe sur l'organisation des travaux de l'Assemblée 3708 Souligner les 25 ans de vie parlementaire de certains députés 3709 M. -

Actas Proceedings Atas Actes
ACTAS PROCEEDINGS II ASAMBLEA GENERAL DE LA II GENERAL ASSEMBLY OF THE CONFERENCIA PARLAMENTARIA PARLIAMENTARY CONFERENCE DE LAS AMÉRICAS OF THE AMERICAS Edificar una comunidad de las Building a Fair and Prosperous Américas equitativa y próspera Community of the Americas DEL 19 AL 23 DE JULIO DE 2000 JULY 19-23, 2000 RÍO GRANDE, PUERTO RICO RIO GRANDE, PUERTO RICO ATAS ACTES II ASSEMBLÉIA GERAL DA IIe ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CONFERÊNCIA PARLAMENTAR CONFÉRENCE PARLEMENTAIRE DAS AMÉRICAS DES AMÉRIQUES Construir uma comunidade das Construire une communauté des Américas justa e próspera Amériques équitable et prospère 19-23 DE JULHO DE 2000 19-23 JUILLET 2000 RIO GRANDE, PORTO RICO RÍO GRANDE, PUERTO RICO ACTAS DE LA II ASAMBLEA GENERAL DE LA CONFERENCIA PARLAMENTARIA DE LAS AMÉRICAS ...................................5 Edificar una comunidad de las Américas equitativa y próspera PROCEEDINGS OF THE II GENERAL ASSEMBLY OF THE PARLIAMENTARY CONFERENCE OF THE AMERICAS................................63 Building a Fair and Prosperous Community of the Americas ATAS DA II ASSEMBLÉIA GERAL DA CONFERÊNCIA PARLAMENTAR DAS AMÉRICAS .............................................. 121 Construir uma comunidade das Américas justa e próspera ACTES DE LA IIe ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CONFÉRENCE PARLEMENTAIRE DES AMÉRIQUES................................... 179 Construire une communauté des Amériques équitable et prospère ACTAS II ASAMBLEA GENERAL DE LA CONFERENCIA PARLAMENTARIA DE LAS AMÉRICAS Edificar una comunidad de las Américas equitativa y próspera DEL -

Les Pluies Diluviennes Des 19 Et 20 Juillet 1996 Bilande
LES PLUIES DILUVIENNES DES 19 ET 20 JUILLET 1996 B I L A N D E L A R E C O N S T R U C T I O N QUÉBEC, JUILLET 2000 Dépot Légal – 2000 Bibliothèque nationale du Québec ISBN 2-550-36820-7 TABLE DES MATIÈRES Une leçon de solidarité ........................................................................................... 1 Remerciements....................................................................................................... 3 Avant-propos........................................................................................................... 5 CHAPITRE 1 : LE RAPPEL DES ÉVÉNEMENTS Avertissement de pluie abondante Vendredi, 19 juillet 1996 ......................................................................................... 9 Samedi, 20 juillet 1996............................................................................................10 – Rapport de situation pour l’ensemble du Québec – 20 juillet 1996, 18 h ........19 – Mobilisation de l’Organisation de sécurité civile du Québec ...........................27 Dimanche, 21 juillet 1996........................................................................................28 – État de la situation – Municipalités..................................................................28 – État de la situation – Côte-Nord, Charlevoix...................................................30 – État du réseau routier – Régions ....................................................................31 – Déclaration de M. Lucien Bouchard, premier ministre du Québec..................32