Le Massif Des Dentelles De Montmirail
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Les Dentelles De Montmirail
PROGRAMME Le programme est susceptible d’aménagements en fonction de l’appréciation in situ des difficultés du terrain et des conditions météorologiques. Carte IGN TOP 25 n° 3040 ET. Topo Edisud Ventoux et Dentelles . Vendredi 16 mai Après regroupement à l’arrivée du train à Avignon TGV (09h56), transfert à Beaumes-de-Venise . Organisateur Du bourg qui s’étage sur les premiers contreforts des Michel Durand-Gasselin Dentelles, notre itinéraire part vers l’est à travers les 06 70 24 73 86 vignobles et conduit à la Roque-Alric , petit village calme, campé sur son piton rocheux. Un peu plus loin, Lafare , autre petit village aux ruelles pentues, est notre porte d’entrée au cœur des Dentelles. Le sentier grimpe 08-RC06 en versant sud de la Grande Muraille , ou Lame du Clapis, au long de laquelle il chemine ensuite et conduit, après quelques passages aériens, au Pas de LES DENTELLES DE la Chèvre, puis au col d’Alsau. Et nous voici au pied des Dentelles Sarrasines , ou Lame du Turc. Avec ses 627 m, le Rocher du Turc est le point culminant de cette MONTMIRAIL partie des Dentelles. Y grimper est une petite aventure à la portée du randonneur amateur de curiosités naturelles. Du 16 au 19 mai 2008 11 km, + 760 m, - 260 m, 5 h de marche Niveau M+ / ▲▲ / bivouacs Samedi 17 mai Notre itinéraire continue le long des Dentelles Sarrasines , offrant plus loin une étonnante suite de structures rocheuses qui font la joie des grimpeurs. Il descend sur la ferme de Cassan où l’on retrouve les vignobles, et nous amène au col du Cayron. -

Print Itinerary
+1 888 396 5383 617 776 4441 [email protected] DUVINE.COM Europe / France / Provence Provence 4-Day Bike Tour From the Base of Mont Ventoux to the Heart of the Luberon © 2021 DuVine Adventure + Cycling Co. Browse the weekly market in Vaison-la-Romaine, where local producers offer fragrant soap, wheels of cheese, and intoxicating Provençal lavender Enjoy a Provençal meal at the lovely home of our local friend Become enraptured with breathtaking views from Provençal villages like Gordes and Séguret Wake to view of the Dentelles de Montmirail mountains at our secluded boutique hotel Arrival Details Departure Details Airport City: Airport City: Paris or Marseille, France Paris or Marseille, France Pick-Up Location: Drop-Off Location: Avignon Train Station Avignon Train Station Pick-Up Time: Drop-Off Time: 10:30 am 12:00 pm NOTE: DuVine provides group transfers to and from the tour, within reason and in accordance with the pick-up and drop-off recommendations. In the event your train, flight, or other travel falls outside the recommended departure or arrival time or location, you may be responsible for extra costs incurred in arranging a separate transfer. Emergency Assistance For urgent assistance on your way to tour or while on tour, please always contact your guides first. You may also contact the Boston office during business hours at +1 617 776 4441 or [email protected]. Tour By Day DAY 1 Welcome to Provence Your guides will greet you at the Avignon TGV train station, and the adventure begins! Toast to the trip ahead over a light, fresh lunch at our boutique hotel in the Dentelles de Montmirail mountains, followed by a bike fitting and safety talk. -

A Wine Adventure in Vaucluse 2016 Press Kit
Côtes du Rhône • Châteauneuf-du-Pape • Ventoux • Luberon A wine adventure in Vaucluse 2016 press kit Vaucluse Tourism www.provenceguide.com « A DAY WITHOUT WINE IS A DAY WITHOUT SUNSHINE» as the saying goes and Vaucluse can rely on both! Without any doubt, the history of vineyards, grown here for thousands of years, and the history of Vaucluse are inex- tricably intertwined. Each in their time, Greeks, Romans, the Popes, the Jews - not to mention the mighty Rhône River, have all had a decisive influence on both. Three appellations cover the area here – Côtes du Rhône, AOC Ventoux, and AOC Luberon. The Châteauneuf-du-Pape vintage has attained international fame and more than half of the villages in Vaucluse make their living from wine. Since times past when the traveller took refuge in monasteries, welcomed with a glass of wine, wine has remained a symbol of friendship, of sharing, of human warmth and joie de vivre... In other words, wine is a lifestyle, the Vaucluse lifestyle. www.wine-tourism-provence.co.uk YOUR CONTACTS IN OUR PRESS DEPARTMENT Valérie BISET Head of Press and Communications [email protected] T. +33(0)4 90 80 47 06 Daniela DAMIANI National and international press [email protected] T. +33(0)4 90 80 47 07 Valérie GILLET International Press [email protected] T. +33(0)4 90 80 47 08 Teresa STORM International Press [email protected]. +33(0)4 90 80 47 04 VAUCLUSE TOURISM – Wine Press Kit 2016 - Contact: Valérie BISET – T. 33 (0)4 90 80 47 06 [email protected] - www.wine-tourism-provence.co.uk - http://press.provenceguide.com Page | 3 Table of contents 04 Zoom on.. -

Hosts and Geographic Distribution of Arceuthobium Oxycedri
Table 5 -- Collection sites for Arceuthobium oxycedri in southern France. * Department Location Feature Alpes-de-Haute Augés - between Clément and Praconteau (1) Community Provence Peyruis, below Praconteau (Possibly same as preceding location) (1) Community Versant, north end of Vallée du Béon by Praconteau (Possibly same as Community preceding location) (1) Between Augés and Montfort (Possibly same as preceding location) (1) Community Montford (2) Community Châteaux-Arnoux (3) Community On mountain between Forcalquier and Fontienne (4) Communities Between Pierrerue and Fontienne Praconteau (Possibly same as Communities preceding location) (4) Chateaunuef-Val-Donnat (5) Communities Between St. Auban and Monford (6) Communities Between Sainte-Croix-du-Verdon and Montpezat (7) Communities Montagne de Lure, between Saint-Étienne-les-Orgues et Cruis, Clément Mountain and Praconteau (8) Estoublon (9) Community Gorges du Verdon below Moustier-Sainte-Marie (10) Canyon On plateau bordering road from Montfuron to Bastide-des-Jourdans Plateau Forcalquier (Vaucluse) (11) Along road 907 near Villemus (12) Road Crest of the northeastern end of the Luberon, commune of Volx (13) Mountain Palud-sur-Verdon (14) Community Bras-d'Asse (15) Community Vallée de l'Asse at Entrevennes, road 101 (16) Valley Vançon, near community of Sourribes (17) Riverbed Chapelle Notre-Dame, commune of Entrevennes (18) Community Montjustin (19) Community Valensole, Plateau de Valensole (20) Community Têle, Commune of Bégude-la-Blanche (21) Community Sigonce (22) Community -

Angebot 20150-1
Provence: Sonne und Singletrails rund um den Mont Ventoux Provence: Sonne und Singletrails rund um den Mont Ventoux 8 Reisetage - Individualreise Anreiise + Eiinreiisebestiimmung Für die An- und Abreise bestehen mehrere Möglichkeiten: Die nächsten Flughäfen sind Marseille und Avignon. Reisende mit der Bahn fahren nach Orange, von dort aus ist es möglich, mit einem Taxi zum Ausgangspunkt zu gelangen: Eine einfache Taxifahrt kostet von Montag bis Samstag ca. 60 Euro für eine bis vier Personen und an Sonn- und Feiertagen ca. 90 Euro (Änderungen vorbehalten). Für Anreisende mit dem PKW bestehen kostenlose Parkmöglichkeiten in der Nähe des Ausgangspunktes. Für die Einreise benötigen Sie einen gültigen Personalausweis. Routenführung und Anforderung Sie fahren auf gut befahrbaren Singletrails und auf Feld- und Forstwegen, einzelne Abschnitte der Tour können geschottert sein. Hinunter geht es auf meist gut fahrbaren, flowigen Singletrails (größtenteils S0 bis S1 auf der Singletrail-Skala), aber manche Stellen sind etwas kniffliger mit vereinzelten Blöcken, Stufen oder Wurzeln (maximal S2). Pro Tag legen Sie durchschnittlich ca. 40 Kilometer und ca. 1000 Höhenmeter zurück. Die genauen Kilometer- und Höhenmeterangaben pro Tag können Sie dem Reiseverlauf entnehmen. Begleiitfahrzeug + Guiide Bei dieser Reise handelt es sich um eine Individualreise, bei der Sie ohne Guide oder Begleitfahrzeug unterwegs sind. Ihr Gepäck wird täglich zu den einzelnen Unterkünften transportiert. Sie erhalten zur Orientierung vor Ort detaillierte Reiseunterlagen, Kartenmaterial mit einer markierten Route und GPS-Tracks. Am fünften Reisetag shuttelt Sie ein Kleinbus auf den Mont Ventoux, Sie können auf Wunsch aber auch mit dem Bike hochfahren. Unterkünfte Sie übernachten in ausgewählten Gasthäusern und kleinen Hotels der 2* Landeskategorie. -

Fiche Vélo Au Pied Des Dentelles, Pdf
DRÔME Accueil vélo Ventoux France Plus de 100 professionnels à votre service ! Au pied des Dentelles V ent D974 nt o In the Foothills of the Dentelles de Montmirail o u Ventoux Welcome Cyclists VAUCLUSE M x ALPES-DE- More than 100 professionals at your service! Mont Ventoux HAUTE- Aan de voet van de Dentelles D942 PROVENCE Ventoux Fietsers Welkom D950 Meer dan 100 vaklui tot uw dienst! D1 A9 D938 Loueurs, réparateurs et 11 Le Mas de la Lause Chambres et table d’hôtes accompagnateurs vélo D5 Bicycle renters, repairs and guides +33 (0)4 90 62 33 33 - +33 (0) 6 30 83 05 89 www.provence-gites.com A7 D943 Fietsverhuurders, fietsenmakers en 40 chemin de Geysset - 84 330 Le Barroux GARD D942 gidsen D4 Autour 1 Benoit Igoulen 21 Lou Pasquié*** - Gîte du Ventoux Loueur et accompagnateur +33 (06) 18 01 02 43 Location VTT et VTC [email protected] +33 (0)6 14 11 18 15 Chemin de Beaumes - 84190 La Roque www.igoulen-location-velo.fr 146 chemin de Roquefiguier BOUCHES- 84 190 Beaumes-de-Venise Restaurant DU-RHÔNE www.tracestpi.com 12 2 Office de Tourisme de Côté Vignes Beaumes-de-Venise +335 (0)4 90 6 07 16 Téléchargez le tracé du circuit Location de VTC et VAE 1 515 route de Lafare sur votre smartphone +332 (0)4 90 6 94 39 84 190 Beaumes-de-Venise www.ot-beaumesdevenise.com 13 Download the itinerary on your smartphone Place du Marché - 84 190 Beaumes-de-Venise O’Ptit Creux +335 (0)4 90 6 07 16 Download de routebeschrijving op uw smartphone CoVe : Infographie 3 Cycles Renard Dentelles 78 chemin Sainte Anne Location et vente de VAE 84 190 Beaumes-de-Venise +339 (0)6 14 6 03 95 14 [email protected] Le Four à Chaux Route de La Roque Alric - 84 190 Lafare +332 (0)4 90 6 40 10 www.lefourachaux.com www.destination-ventoux.com 2 253 avenue Charles de Gaulle © C. -

Vineyards of Vaucluse Self-Guided Cycling Trip Notes
Current as of: July 3, 2019 - 15:42 Valid for departures: From January 1, 2018 to December 31, 2019 Vineyards of Vaucluse Self-Guided Cycling Trip Notes Ways to Travel: Self-Guided 9 Days Land only Trip Code: Destinations: Adventure Holidays in France Min age: 8 Leisurely / Moderate Programmes: Cycling C08PV Trip Overview In the heart of Provence, the Vaucluse is steeped in history. Originally Celtic, it was conquered by the Romans and is now rich in well- preserved Roman remains, especially at Orange and Vaison-la-Romaine where the large site is comparable to Pompeii. The skyline is dominated by the majestic silhouette of the Dentelles de Montmirail and dramatic Mont Ventoux. At a Glance 8 Nights, hotel-to-hotel 4 days cycling Headwater wine service Route notes and maps provided High quality bikes provided Optional electric bikes Luggage transfers between hotels Countries visited: Adventure Holidays in France Trip Highlights Easy interest-packed cycling on Provencal plains and foothills Famous Cotes du Rhone vineyards: Gigondas, Beaumes-de-Venise, Vacqueyras Extensive Roman remains at Vaison-la- Romaine and UNESCO Orange Colourful Provencal markets; numerous wine festivals; some of the prettiest villages in France Friendly, family-run hotels, most with private pools; good local cuisine Is This Trip for You? Classification: Self-Guided Average daily distance on move on days: 30.25km (19 miles). No. of days cycling: 4 Terrain: The cycling is mostly on plains or gentle foothills and we have used the quietest possible lanes to link the towns and villages. There are only occasional (unavoidable) short stretches on major roads. -
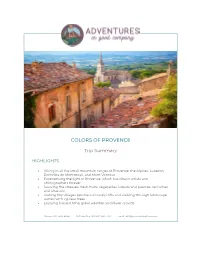
Trip Summary
COLORS OF PROVENCE Trip Summary HIGHLIGHTS • Hiking in all the small mountain ranges of Provence: the Alpilles, Luberon, Dentelles de Montmirail, and Mont Ventoux • Experiencing the light of Provence, which has drawn artists and photographers forever • Savoring the cheeses, fresh fruits, vegetables, breads and pastries, red wines and olive oils • Visiting tiny villages perched on rocky cliffs and walking through landscape dotted with cypress trees • Enjoying harvest time, great weather and fewer crowds. Phone: 877-439-4042 Outside the US: 970-833-3132 Email: [email protected] TRIP AT A GLANCE Location: Avignon, France Activities: Hiking Arrive: At 6:00 p.m. at our hotel in Avignon, France on Day 1 Depart: Any time after breakfast on the last day Trip Overview Provence is surely one of France's most fabled regions. Flanked by the Alps to the north, Italy to the east, and the Mediterranean to the south, Provence is known for the incredible diversity that exists within its borders, its rich human and natural history, and its sights, sounds, tastes, smells, and utter charm. On this trip we will introduce you to all the fascination that Provence has to offer: the ancient settlement of Avignon, the tiny perched villages of the Luberon, the craggy limestone of the Alpilles, and Mont Ventoux, an inspiration for Van Gogh (and us!). We will combine scenic hikes with visits to village markets, stays at French inns, a little culture, and a chance to sample all the fantastic tastes of the south of France. Maximum group size: 12 Rating This trip is designed for women who want to combine hiking off the beaten track in the Provence countryside, with exploring local culture, visits to some of their unique and different villages, and savoring fresh cuisine. -
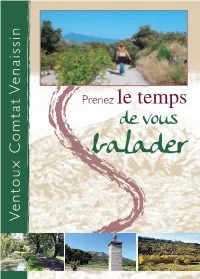
Balader Ventoux Comtat Venaissin Comtat Ventoux Guide Balades 2010.Qxp 9/03/10 15:45 Page 2 Introduction
Guide_balades_2010.qxp 9/03/10 15:41 Page 1 Prenez le temps de vous balader Ventoux Comtat Venaissin Comtat Ventoux Guide_balades_2010.qxp 9/03/10 15:45 Page 2 Introduction e Ventoux-Comtat Venaissin est un petit territoire aux mille et une richesses situé au cœur de la Provence. Chacune de ses entités L paysagères possède son terroir, ses couleurs, ses caractéristiques. Le mont Ventoux : appelé affectueusement « le Géant de Provence », du haut de ses 1 912 m, il domine la plaine comtadine. Chacune de ses facettes est différente : végétation et climat méditerranéen au sud, montagnard au nord. La plaine comtadine: baignée de lumière, elle est jalousement gardée par les monts qui l’entourent. Le réseau hydraulique, combiné à un climat favorable, a fait du territoire « le Jardin de la France ». Les monts de Vaucluse: loin de l’agitation de la plaine, les villages perchés des monts de Vaucluse offrent de superbes panoramas. L’un d’eux, Venasque est classé parmi « Les Plus Beaux Villages de France ». Les Dentelles de Montmirail : au cœur de ce petit massif de 5 000 hectares se nichent des villages aux allures de hameaux. Sa silhouette unique composée de crêtes calcaires et de cultures en terrasse en fait un lieu unique et préservé. Du nord au sud, d'est en ouest, notre territoire vous offre un large choix de balades accessibles à tous et vous invite à de très belles découvertes. CHARTE DU RANDONNEUR : - je m’assure des bonnes conditions météorologiques avant de partir : 08 92 68 02 84 (météo France-Carpentras - service facturé) ; - je m’équipe au mieux: pull, coupe-vent, chaussures de randonnée, chapeau, eau… - je respecte le tracé des chemins afin de ne pas piétiner les zones protégées ; - je suis curieux tout en restant discret pour ne ne pas effrayer les animaux; - je ne laisse aucune trace de mon passage. -

DOMAINE DE COYEUX (France, Rhone, Beaumes-De-Venise)
DOMAINE DE COYEUX (France, Rhone, Beaumes-de-Venise) BACKGROUND: The origin of the Beaumes de Venise’s wine district is very old and the history of its wines can be traced back to 600 years before Christ, when a Greek community moved into the foothills of the Dentelles de Montmirail. Nowadays Beaumes de Venise is an appellation from the eastern central region of the Southern half of the Rhône Valley. Located on the Southern side of the Dentelles de Montmirail, the Domaine de Coyeux is comprised of one continuous area of 110 total hectares (65 under vines and the rest as forest and woods) with its first vines planted in the 1950. The estate was taken over in 2013 by Hugues de Feraudy, whose family was already established in Vaucluse in the tenth century. He’s involved in the agricultural part of the management with a deep focus on the vineyards and the whole vinification process rather than the commercial side of the business. The landscape of Domaine de Coyeux are exceptional with the rocky blades of the Dentelles de Montmirail within sight just a few hundred meters away. Mont Ventoux, snowy during the winter, gives the impression of being at your fingertips beaming the sensation of reigning calm all around the mountains of Coyeux. BEAUMES DE VENISE WINE TRADITION: To cut a long story short the appellation of Beaumes de Venise is famous for its sweet fortified wine of the type “Vin doux naturel” (VDN) under the designation Muscat de Beaumes de Venise. The wines must contain at least 100 gr/lt of residual sugar and feature at least 15% alcohol content. -
Entre Ventoux Et Dentelles Accueil Vélo Ventoux
Accueil vélo Ventoux DRÔME Plus de 100 professionnels à votre service ! France Entre Ventoux et Dentelles Ventoux Welcome Cyclists D974 Between Mont Ventoux V More than 100 professionals at your service! e t n ALPES-DE- and the Dentelles n to o u Ventoux fietsers Welkom VAUCLUSE M x HAUTE- Meer dan 100 vaklui tot uw dienst! Mont Ventoux D942 PROVENCE Tussen Ventoux en Dentelles D950 14 Loueurs et réparateurs La Ferme du Sublon - Gîtes D1 vélo +33 (0)4 90 36 37 02 - +33 (0)6 10 26 05 27 D938 www.lafermedusublon.com A9 Bicycle rental and repair Quartier Les Grandes Fontaines Fietsverhuurders en fietsenmakers 84340 Malaucène 15 1 Cycles Renard Dentelles Le Clos Saint-Michel - Gîtes D5 +33 (0)4 90 65 21 37 - +33 (0)6 14 55 14 65 Location et vente de VAE A7 D943 +33 (0)6 14 69 03 95 www.le-clos-saint-michel.com Quartier Clairier - 84340 Malaucène GARD D942 [email protected] D4 Route de La Roque Alric - 84190 Lafare Autour 16 Le Mas de Cocagne 2 Ventoux Bikes Chambres d’hôtes et gîte du Ventoux Location et vente de vélos de route et VTT +33 (0)4 90 65 27 52 - +33 (0)6 81 43 76 62 +33 (0)4 90 62 58 19 www.masdecocagne.fr www.ventoux-bikes.fr La Malautière - Route de champ long 1 avenue de Verdun - 84340 Malaucène 84340 Malaucène Coordonnées GPS : Long 5°07’.56.4’’ Est 3 Provence Cycling Lat 44°11’29.5’’ Nord BOUCHES- Location et vente de vélos, accompagnateur 17 www.tracestpi.com +33 (0)4 90 41 95 17 Les Mazets du Ventoux**** DU-RHÔNE www.provencecyclingshop.com Résidence de Tourisme 16 place de l’église - 84340 Malaucène +33(0)4 90 67 01 78 www.nemea.fr -
Les Dentelles De Montmirail
Les Dentelles de Montmirail Les Dentelles de Montmirail, un drôle de nom ! Le site du Massif des « Dentelles de Montmirail » est réputé pour ses vins exceptionnels et ses parois abruptes idéales pour les grimpeurs. Le nom de « Dentelles » provient de l'érosion qui a façonné la forme de ces montagnes et taillé la roche lui donnant une forme de dentelle. "Montmirail" : du latin "mons mirabilis" signifiant "mont ou montagne admirable". Les flancs des dentelles ont été ensuite façonnés par l'homme qui a créé des terrasses pour y cultiver en particulier la vigne. Histoire des dentelles Vins et produits agricoles Les dentelles de Montmirail offre un climat ensoleillé propice à la vigne, ainsi qu'une géographie en terrasse qui donne des vins bien spécifiques. On y trouve plusieurs appellations de vins : Vacqueyras, Gigondas, Rasteau, côtes du Rhône village (Sablet et Séguret) et Beaumes-de- Venise. Certaines sont dites AOC (appellation d'origine contrôlée), label donnant un gage de qualité de fabrication du vin. Ce sont essentiellement des vins rouges au goût plutôt prononcé. Le muscat de Beaumes de Venise est un vin liquoreux qui sert davantage en apéritif. On trouve aussi dans les dentelles des productions d'huile d'olive et des truffières. Tourisme et activités sportives Les dentelles de Montmirail offrent de magnifiques paysages et attirent les touristes en recherche de soleil. Les activités principales sont : ● La randonnée, à pied ou à cheval ● Le VTT, la course d'orientation, le raid (mélange par exemple de CO, VTT, course à pied, run and bike, canoë, etc.) ● Et surtout l'escalade : le massif des dentelles a atteint une renommée internationale et attire les grimpeurs confirmés venus du monde entier.