Gérard Et Delphine: La Porte Rouge
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
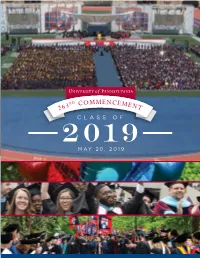
Commencement Program, 2019
263 rd COMMENCEMENT MAY 20, 2019 20, MAY R D COMMENCEME 263 NT CLA S S O F 2 019 M A Y 20, 20 1 9 CLASS OF 2019 KEEPING FRANKLIN’S PROMISE In the words of one elegiac tribute, “Great men have two lives: one which occurs while they work on this earth; a second which begins at the day of their death and continues as long as their ideas and conceptions remain powerful.” These words befit the great Benjamin Franklin, whose inventions, innovations, ideas, writings, and public works continue to shape our thinking and renew the Republic he helped to create and the institutions he founded, including the University of Pennsylvania. Nowhere does Franklin feel more contemporary, more revolutionary, and more alive than at the University of Pennsylvania. His startling vision of a secular, nonsectarian Academy that would foster an “Inclination join’d with an Ability to serve Mankind, one’s Country, Friends and Family” has never ceased to challenge Penn to redefine the scope and mission of the modern American university. When pursued vigorously and simultaneously, the two missions – developing the inclination to do good and the ability to do well – merge to help form a more perfect university that educates more capable citizens for our democracy. Penn has embodied and advanced Franklin’s revolutionary vision for 279 years. Throughout its history, Penn has extended the frontiers of higher learning and research to produce graduates and scholars whose work has enriched the nation and all of humanity. The modern liberal arts curriculum as we know it can trace its roots to Franklin’s innovation to have Penn students study international commerce and foreign languages. -

AVIS Ce Document a Été Numérisé Par La Division De La Gestion Des
Direction des bibliothèques AVIS Ce document a été numérisé par la Division de la gestion des documents et des archives de l’Université de Montréal. L’auteur a autorisé l’Université de Montréal à reproduire et diffuser, en totalité ou en partie, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, et exclusivement à des fins non lucratives d’enseignement et de recherche, des copies de ce mémoire ou de cette thèse. L’auteur et les coauteurs le cas échéant conservent la propriété du droit d’auteur et des droits moraux qui protègent ce document. Ni la thèse ou le mémoire, ni des extraits substantiels de ce document, ne doivent être imprimés ou autrement reproduits sans l’autorisation de l’auteur. Afin de se conformer à la Loi canadienne sur la protection des renseignements personnels, quelques formulaires secondaires, coordonnées ou signatures intégrées au texte ont pu être enlevés de ce document. Bien que cela ait pu affecter la pagination, il n’y a aucun contenu manquant. NOTICE This document was digitized by the Records Management & Archives Division of Université de Montréal. The author of this thesis or dissertation has granted a nonexclusive license allowing Université de Montréal to reproduce and publish the document, in part or in whole, and in any format, solely for noncommercial educational and research purposes. The author and co-authors if applicable retain copyright ownership and moral rights in this document. Neither the whole thesis or dissertation, nor substantial extracts from it, may be printed or otherwise reproduced without the author’s permission. -
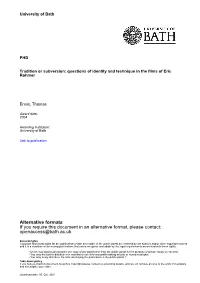
Thesis Rests with Its Author
University of Bath PHD Tradition or subversion: questions of identity and technique in the films of Eric Rohmer Ennis, Thomas Award date: 2004 Awarding institution: University of Bath Link to publication Alternative formats If you require this document in an alternative format, please contact: [email protected] General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 05. Oct. 2021 UNIVERSITY OF BATH LIBRARY AUTHOR: THOMAS ENNIS YEAR: 2004 TITLE: TRADITION OR SUBVERSION: QUESTIONS OF IDENTITY AND TECHNIQUE IN THE FILMS OF ERIC ROHMER Attention is drawn to the fact that copyright of this thesis rests with its author. A copy of this thesis has been supplied on condition that anyone who consults it is understood to recognise that its copyright rests with the author and they must not copy it or use material from it except as permitted by law or with the consent of the author. -

The Cultural Origins of the French Revolution Kindle
THE CULTURAL ORIGINS OF THE FRENCH REVOLUTION PDF, EPUB, EBOOK Roger Chartier | 260 pages | 01 May 1991 | Duke University Press | 9780822309932 | English | North Carolina, United States The Cultural Origins of the French Revolution PDF Book Inspiration for the former derives from such classics of postcolonial thought as C. Sign In or Create an Account. It furthers the University's objective of excellence in research, scholarship, and education by publishing worldwide. This article is also available for rental through DeepDyve. In A Companion to the French Revolution pp. AB - In recent years, a number of works on the cultural environments of different groups in late eighteenth-century France have proposed a wealth of possible answers to the question of what it means for an event to have "cultural origins"?. Link to citation list in Scopus. Read this essay. Advance article alerts. In Stages of Capital, Ritu Birla brings research on nonwestern capitalisms into conversation with postcolonial studies to illuminate the historical roots of Hunt, Exploring the French Revolution Tackett, The Coming of the Terror P. See, for example, Lynn Hunt, Inventing Human Rights: A History New York, , which draws attention to empathetic novel reading in the decades before the Revolution, and Dan Edelstein, The Terror of Natural Right: Republicanism, the Culture of Nature, and the French Revolution Chicago, , which, quite differently, takes seriously enduring literary myths about the Golden Age in reshaping natural rights thinking. Oxford: Pergamon Press, Do you agree with the argument presented here? Read this article and focus on the relationships among the Enlightenment, the French Revolution, democracy, and totalitarian political systems. -

LE MONDE/PAGES<UNE>
LE MONDE DES LIVRES VENDREDI 31 AOÛT 2001 DOSSIER CLAUDE CHANG-RAE LEE LA RENTRÉE CARLO FRANÇOIS Michel Houellebecq, ESTEBAN page V DES ESSAIS GINZBURG FEJTÖ Marc Trillard, François page IV page VI page VII page IX Jonquet, Clotilde Escalle et Stéphane Zagdanski : les tourments sexuels de la rentrée pages II et III a Houellebecq Houellebecq et l’Occident texte qui se lise d’une seule traite. » Même si la polémique Ce qui a été fait. Est-ce cette capacité à révéler ce engagée autour qui dérange qui a incité Michel Houellebecq à s’installer dans une de « Plateforme » s’est toute petite île (200 habitants), au sud-ouest d’une île qui est elle- i vous aimez la littératu- focalisée sur le tourisme même à l’extrême ouest de l’Euro- re, il serait sage de ne pas écouter sexuel, ce n’est en rien pe, autrement dit en Irlande ? Sceux qui disent : « Michel Houelle- « Non, j’ai toujours eu un rêve d’Irlan- becq pense que… » Car Plateforme de, où je suis venu souvent, répond-il, n’est pas un essai sur le tourisme le sujet principal de ce mais je n’avais pas d’argent. Grâce sexuel (lire nos informations dans aux Particules élémentaires, j’en ai Le Monde daté 26-27 août), ni un roman féroce qui, autour eu un peu. J’ai d’abord habité texte de propagande en faveur de Dublin, puis depuis novembre 2000, cette pratique, ni un réquisitoire d’un amour imprévu, je suis ici, à Bere Island. » contre elle. C’est un roman. -

The Armenian Genocide and the Making of Modern Humanitarian Media in the US, 1915-1925
University of Pennsylvania ScholarlyCommons Publicly Accessible Penn Dissertations 2014 "Lest They Perish": The Armenian Genocide and the Making of Modern Humanitarian Media in the U.S., 1915-1925 Jaffa Panken University of Pennsylvania, [email protected] Follow this and additional works at: https://repository.upenn.edu/edissertations Part of the United States History Commons Recommended Citation Panken, Jaffa, ""Lest They Perish": The Armenian Genocide and the Making of Modern Humanitarian Media in the U.S., 1915-1925" (2014). Publicly Accessible Penn Dissertations. 1396. https://repository.upenn.edu/edissertations/1396 This paper is posted at ScholarlyCommons. https://repository.upenn.edu/edissertations/1396 For more information, please contact [email protected]. "Lest They Perish": The Armenian Genocide and the Making of Modern Humanitarian Media in the U.S., 1915-1925 Abstract Between celebrity spokesmen and late night informercials, international humanitarian aid organizations use multiple media strategies to generate public interest in their programs. Though this humanitarian media has seemingly proliferated in the past thirty years, these publicity campaigns are no recent phenomenon but one that emerged from the World War I era. "Lest They Perish" is a case study of the modernization of international humanitarian media in the U.S. during and after the Armenian genocide from 1915 to 1925. This study concerns the Near East Relief, an international humanitarian organization that raised and contributed over $100,000,000 in aid to the Armenians during these years of violence. As war raged throughout Europe and Western Asia, American governmental propagandists kept the public invested in the action overseas. Private philanthropies were using similar techniques aimed at enveloping prospective donors in "whirlwind campaigns" to raise funds. -

Sommaire Du Catalogue 395
SOMMAIRE DU CATALOGUE 395 Généralités Historiques 1 à 13 Amérique du Nord 1318 à 1336 Noblesse - Généalogie - Héraldique 14 à 56 Amérique Centrale et du Sud - Antilles 1337 à 1342 Droit - Institutions 57 à 79 Asie - Océanie 1343 à 1354 Sciences Politiques 80 à 90 Moyen-Orient 1355 à 1363 Économie - Finances 91 à 170 Grèce - Turquie - Balkans 1364 à 1373 Histoire Sociale - Éducation 171 à 189 Pays Germaniques 1374 à 1379 Antiquité 190 à 240 Belgique - Pays Bas - Luxembourg 1380 à 1394 Moyen-Age 241 à 290 Pays Ibériques 1395 à 1407 Seizième siècle 291 à 325 Scandinavie - Pôles 1408 à 1415 Dix-Septième siècle 326 à 364 Iles Britanniques 1416 à 1424 Dix-Huitième siècle 365 à 415 Italie - Malte 1425 à 1436 Révolution Française 416 à 601 Russie 1437 à 1452 Consulat - Empire 602 à 812 Pologne 1453 à 1461 Dix-Neuvième siècle 813 à 951 Suisse 1462 à 1471 Guerre de 1870 - Commune 952 à 967 Régionalisme Généralités 1472 à 1474 Guerre de 1914 968 à 983 Paris 1475 à 1510 Vingtième siècle 984 à 1005 Ile-de-France 1511 à 1552 Militaria 1006 à 1097 Alsace - Lorraine 1553 à 1567 Marine 1098 à 1107 Artois - Flandres - Picardie 1568 à 1598 Philosophie - Ésotérisme 1108 à 1123 Auvergne - Berry - Limousin 1599 à 1625 Religions 1124 à 1147 Bourgogne - Franche-Comté - Nivernais 1626 à 1658 Beaux Arts - Archéologie 1148 à 1184 Bretagne - Vendée 1659 à 1680 Théâtre - Spectacles - Musique 1185 à 1189 Champagne 1681 à 1688 Bibliographie - Histoire du livre 1190 à 1216 Dauphiné - Savoie - Lyonnais 1689 à 1729 Littérature - Critique Littéraire 1217 à 1266 Guyenne - Languedoc - Pyrénées 1730 à 1760 Sciences et Techniques 1267 à 1279 Maine - Anjou 1761 à 1770 Chasse - Gastronomie 1280 à 1285 Normandie 1771 à 1820 Afrique du Nord 1286 à 1307 Orléanais - Touraine - Beauce 1821 à 1837 Afrique Noire- Madagascar 1308 à 1317 Poitou - Aunis - Saintonge 1838 à 1846 Provence - Corse 1847 à 1863 POUR ÉVITER VOTRE ATTENTE, NOUS VOUS REMERCIONS D’APPELER AVANT DE VENIR RETIRER VOTRE COMMANDE © Librairie Historique Fabrice Teissèdre - Mars, 2016. -

Elliot-Elliott, 1625-1976
ELLIOT - ELLIOTT 1625-1976 SRRfl J0Í1G BÊRÍDISH DEDICATED to: THOM ELLIOTT BEAMISH and SUZI (UDELL) BEAMISH CONTENTS FOREWORD JOSEPH ELLIOT of Stonington, Connecticut 1- 14 JOSEPH ELLIOT of Chenango County, New York 15- 19 Adin Elliot 19- 42 Desire Elliot 43 Hopestill Elliot hh Thomas Elliot 1*5- 119 Lemuel Elliot 120 Ledda Elliot 121 Joab Elliot 121- 131 Betsey Elliot 131 Abisha Elliot 132- 136 Ittai Elliot 137-119* FAMILIES RELATED TO ELLIOTTS Di9b BARNES FAMILY 165- 168 BEAMISH - MOULTON FAMILIES 150- 156 BISTODEAU - UDELL FAMILIES 157 BURROWS FAMILY 158- 160 CAROTHERS FAMILY 230 GRIFFITH FAMILY 168- 181 PAGE - BRISTOL FAMILIES 225- 227 RHODES FAMILY 228- 229 SHELDON FAMILY 161- 163 SHELLENBARGER FAMILY 181a- 222 SMALL FAMILY 163- 164 WELLS FAMILY 223- 224 BIBLIOGRAPHY 231- 236 INDEX i-xxxvlii FOREWORD One evening while waiting for Irene Dudley, a friend, at the Detroit Library, I idly picked up a copy of a history of Chenan go County, New York, and saw the name Adin Elliot, the same as my great-grandfather's. I laid the book down and thought nothing of it until the next time I was waiting, Irene suggested I take some notes and see If I could trace the family further. That started my quest for the genealogical record of the Elliotts. Family legends of athletic and hunting prowess, achieve ments, skills (husking corn, making shingles, scaling logs, etc.), the seven brothers who came from Scotland and landed at Halifax, the famous marksman who gave exhibitions, adding a T to the name and other stories told and discussed were part of my heritage as I grew up. -
Le Célèbre Ministre Des Finances De Louis XVI. LS 22/07/1777 À M. De Limay1. I
110-170 € 1 - Jacques Necker: (1732-1804), le célèbre ministre des finances de Louis XVI. L.S. 22/07/1777 à M. de Limay1. Il a choisi M. Desvaux pour remplacer M. Devoglie2, à cause de l’ancienneté de ses services et pour rendre justice à ceux de son correspondant. « J’ai arrêté qu’en attendant qu’il vienne une inspection générale à vaquer, vous serez chargé d’inspecter votre généralité [Tours], celle d’Orléans et celle de Poitiers… » Il le prie de prioriser sa tournée sur les travaux des Ponts et Chaussées et ceux des ports maritimes de son nouveau département. 1p in-folio, bon état. 1Jean Cadet de Limay (1732-1802) deviendra inspecteur général des Ponts et Chaussées en 1780 puis sera chargé sous la Révolution de la direction des canaux d’Orléans et du Loing. 2Jean Baptiste de Voglie (1724-1777), ingénieur des Ponts et Chaussées et ingénieur en chef de la généralité de Tours, est alors fort malade. Il décédera trois mois après ce courrier. Il est à l’origine de l’actuel pont de Saumur et contribua à l’encyclopédie Diderot & d’Alembert sur le sujet des ponts. 230-340 € 2 - Charles Eugène de Lorraine, prince de Lambesc: (1751-1825), colonel propriétaire du Royal-Allemand, tristement célèbre pour la charge qu’il fit aux Tuileries le 12 juillet 1789. Rare P.A.S. De Lorraine Prince de Lambesc en français, Trèves 29/05/1790, en-tête manuscrit de la Cavalerie Etrangère du Royal Allemand. Mémoire pour le comte de La Tour du Pin afin d’obtenir un congé au baron de Speth, major en second de son régiment, 1p in-folio, bon état. -
Louis XVI and the French Revolution, 1789–1792
Louis XVI and the French Revolution, 1789–1792 The experience, and failure, of Louis XVI’s short-lived constitutional monarchy of 1789–1792 deeply influenced the politics and course of the French Revolution. The dramatic breakdown of the political settlement of 1789 steered the French state into the decidedly stormy waters of political terror and warfare on an almost global scale. This book explores how the symbolic and political practices which under- pinned traditional Bourbon kingship ultimately succumbed to the radical challenge posed by the Revolution’s new ‘proto-republican’ culture. While most previous studies have focused on Louis XVI’s real and imagined foreign counter-revolutionary plots, Ambrogio A. Caiani examines the king’s hitherto neglected domestic activities in Paris. Drawing on previously unexplored archival source material, Caiani provides an alternative reading of Louis XVI in this period, arguing that the monarch’s symbolic behaviour and the organisation of his daily activities and personal household were essential factors in the people’s increasing alienation from the newly established consti- tutional monarchy. AMBROGIO A . CAIANI is College and Departmental Lecturer at Lady Margaret Hall and the Faculty of History, University of Oxford. Louis XVI and the French Revolution, 1789–1792 Ambrogio A. Caiani CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo, Delhi, Mexico City Cambridge University Press The Edinburgh Building, Cambridge CB2 8RU, UK Published in the United States of America by Cambridge University Press, New York www.cambridge.org Information on this title: www.cambridge.org/9781107026339 © Ambrogio A. Caiani 2012 This publication is in copyright. -

British Women's Travel Writings in the Era of the French Revolution
BRITISH WOMEN’S TRAVEL WRITINGS IN THE ERA OF THE FRENCH REVOLUTION by TSAI-YEH WANG A thesis submitted to The University of Birmingham for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY Department of History School of Historical Studies The University of Birmingham April 2010 University of Birmingham Research Archive e-theses repository This unpublished thesis/dissertation is copyright of the author and/or third parties. The intellectual property rights of the author or third parties in respect of this work are as defined by The Copyright Designs and Patents Act 1988 or as modified by any successor legislation. Any use made of information contained in this thesis/dissertation must be in accordance with that legislation and must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the permission of the copyright holder. ABSTRACT This thesis intends to investigate how educated British women travellers challenged conventional female roles and how they participated in the political culture in the Revolutionary and Napoleonic era. Part One will discuss those who tried hard to challenge or to correct traditionally-defined femininity and to prove themselves useful in their society. Many of them negotiated with and broadened the traditionally defined femininity in this age. Part Two will take Burke and Wollstonecraft’s debate as the central theme in order to discuss chronologically the British women travellers’ political responses to the Revolution controversy. When the Revolution degenerated into Terror and wars, the Burkean view became the main strand of British women travellers’ political thinking. Under the threat of Revolutionary France and during the Napoleonic Wars, a popular conservatism and patriotism developed in Britain. -

A Brief Moment in the Sun: Francis Cardozo and Reconstruction in South Carolina
A Brief Moment in the Sun: Francis Cardozo and Reconstruction in South Carolina Neil Kinghan Institute of the Americas, University College London This dissertation is submitted for the Degree of Doctor of Philosophy 1 I, Neil Kinghan, confirm that the work presented in this dissertation is my own. Where information has been derived from other sources, I confirm that this has been indicated in the dissertation. Abstract This dissertation examines the life and career of Francis Lewis Cardozo, the first African American to win election to state-wide office in the United States, in April 1868. He served as Secretary of State, then as State Treasurer, for South Carolina from 1868 to 1877. He played a significant role in developing a new state constitution, in promoting land reform and public education and in securing financial stability for South Carolina. Unlike many of his peers, he was an honest and effective office holder, described by a local white newspaper as “the faithful one among the faithless many.” For that reason, the white Democratic government, returning to power after Reconstruction, prosecuted him on a trumped-up charge of fraud. They secured his conviction and, briefly, his imprisonment. Condemning him proclaimed the disgrace of Reconstruction as a whole. Cardozo was also a successful educator, at Saxton School in Charleston, between 1865 and 1868, later as Principal of the M Street High School in Washington, after his pardon and release from prison. In both schools, Cardozo’s purpose was to show that African American children could succeed on the same terms as white if given the opportunity.