Ref.212Ev) Pour
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Lettre D'information Du Programme RHYVIERE
Avril ‐ Mai 2010 Lettre d’information du programme RHYVIERE Le mois de juin Les projets pilotes de réseaux hydroélectriques RHYVIERE Tolongoina Tolongoina Sahasinaka/Fenomby/ Ampasimbe Onibe Sabotsy Namatoana ► Sélection du délégataire finalisée ► Promotion de l’Appel d’Offres Mahabako ► Mission pour valider une nouvelle ► Mission de jaugeage du débit ► Convention de financement signée dans la presse ► Finalisation de l’APS position pour la centrale avec l’ADER et un missionnaire ► Début de l’APD cambodgien du GRET Cambodge ► Réunion de lancement du nouvel ► Mission de restitution de l’APS à ► Finalisation des études techni‐ AO (une trentaine de BE pré‐ ques et socio‐économiques de Sahasinaka Fenomby Mahabako Sahasinaka en présence des 3 Les autres projets sents) et AO pendant 6 semaines communes l’APS (avec l’extension à Foule‐ ► Finalisation de l’étude avec extension (Andoharanomaintso, Sahatona) ► Analyse des offres et présélec‐ pointe) à Fenomby et Mahabako ► Création de l’OPCI tion d’un délégataire « électrification » par les trois ► Suivi de la pluviométrie et de ► Dépôt du dossier à l’ORE et l’Ader 2010. Ambohimahasina ► Mission de l’IRD sur les PSE communes ciblées l’hydrologie par la population avril ► Recensement de la population Ampasimbe Onibe / Ambatofotsy 28 le ► Ambatofotsy ► Restitution de la reconnaissance Suite de la rédaction des APS CITE ► Finalisation de l’étude d’APS ► Formation de l’équipe communa‐ au le au projet, lancement de l’APS Ambohimahasina ► Mission de terrain de l’équipe techni‐ que et socio économique -

Rep 2 out Public 2010 S Tlet Sur of Ma Urvey Rvey Adagas Repor Scar Rt
Evidence for Malaria Medicines Policy Outlet Survey Republic of Madagascar 2010 Survey Report MINSTERE DE LA SANTE PUBLIQUE www. ACTwatch.info Copyright © 2010 Population Services International (PSI). All rights reserved. Acknowledgements ACTwatch is funded by the Bill and Melinda Gates Foundation. This study was implemented by Population Services International (PSI). ACTwatch’s Advisory Committee: Mr. Suprotik Basu Advisor to the UN Secretary General's Special Envoy for Malaria Mr. Rik Bosman Supply Chain Expert, Former Senior Vice President, Unilever Ms. Renia Coghlan Global Access Associate Director, Medicines for Malaria Venture (MMV) Dr. Thom Eisele Assistant Professor, Tulane University Mr. Louis Da Gama Malaria Advocacy & Communications Director, Global Health Advocates Dr. Paul Lavani Executive Director, RaPID Pharmacovigilance Program Dr. Ramanan Senior Fellow, Resources for the Future Dr. Matthew Lynch Project Director, VOICES, Johns Hopkins University Centre for Dr. Bernard Nahlen Deputy Coordinator, President's Malaria Initiative (PMI) Dr. Jayesh M. Pandit Head, Pharmacovigilance Department, Pharmacy and Poisons Board‐Kenya Dr. Melanie Renshaw Advisor to the UN Secretary General's Special Envoy for Malaria Mr. Oliver Sabot Vice‐President, Vaccines Clinton Foundation Ms. Rima Shretta Senior Program Associate, Strengthening Pharmaceutical Systems Dr. Rick Steketee Science Director, Malaria Control and Evaluation Partnership in Africa Dr. Warren Stevens Health Economist Dr. Gladys Tetteh CDC Resident Advisor, President’s Malaria -
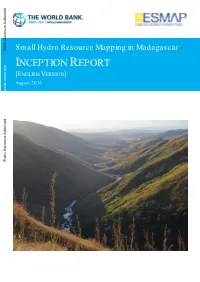
Small Hydro Resource Mapping in Madagascar
Public Disclosure Authorized Small Hydro Resource Mapping in Madagascar INCEPTION REPORT [ENGLISH VERSION] August 2014 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized This report was prepared by SHER Ingénieurs-Conseils s.a. in association with Mhylab, under contract to The World Bank. It is one of several outputs from the small hydro Renewable Energy Resource Mapping and Geospatial Planning [Project ID: P145350]. This activity is funded and supported by the Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP), a multi-donor trust fund administered by The World Bank, under a global initiative on Renewable Energy Resource Mapping. Further details on the initiative can be obtained from the ESMAP website. This document is an interim output from the above-mentioned project. Users are strongly advised to exercise caution when utilizing the information and data contained, as this has not been subject to full peer review. The final, validated, peer reviewed output from this project will be a Madagascar Small Hydro Atlas, which will be published once the project is completed. Copyright © 2014 International Bank for Reconstruction and Development / THE WORLD BANK Washington DC 20433 Telephone: +1-202-473-1000 Internet: www.worldbank.org This work is a product of the consultants listed, and not of World Bank staff. The findings, interpretations, and conclusions expressed in this work do not necessarily reflect the views of The World Bank, its Board of Executive Directors, or the governments they represent. The World Bank does not guarantee the accuracy of the data included in this work and accept no responsibility for any consequence of their use. -

1 COAG No. 72068718CA00001
COAG No. 72068718CA00001 1 TABLE OF CONTENT I- EXECUTIVE SUMMARY .................................................................................................................................................. 6 II- INTRODUCTION ....................................................................................................................................................... 10 III- MAIN ACHIEVEMENTS DURING QUARTER 1 ........................................................................................................... 10 III.1. IR 1: Enhanced coordination among the public, nonprofit, and commercial sectors for reliable supply and distribution of quality health products ........................................................................................................................... 10 III.2. IR2: Strengthened capacity of the GOM to sustainably provide quality health products to the Malagasy people 15 III.3. IR 3: Expanded engagement of the commercial health sector to serve new health product markets, according to health needs and consumer demand ........................................................................................................ 36 III.4. IR 4: Improved sustainability of social marketing to deliver affordable, accessible health products to the Malagasy people ............................................................................................................................................................. 48 III.5. IR5: Increased demand for and use of health products among the Malagasy people -

Liste Des Communes Beneficiaires Au Financement Papsp-Fdl
LISTE DES COMMUNES BENEFICIAIRES AU FINANCEMENT PAPSP-FDL DATE Ordre de CATEG APPORT MONTANT TYPE RÉGION DISTRICT COMMUNE SOUS-PROJET MONTANT FDL MODE D'EXECUTION TYPE DE TRAVAUX SECTEUR Virement FDL vers ORIE COMMUNE TOTAL INFRASTRUCTURE TRESORS ALAOTRA MANGORO AMBATONDRAZAKA AMBANDRIKA CR 2 FANORENANA BIRAOM-POKOTANY AO AMBANIALA 15 000 000 480 15 000 480 TACHERON CONSTRUCTION GOUVERNANCE BUREAU FOKONTANY 26/04/2018 ALAOTRA MANGORO ANOSIBE AN'ALA AMBATOHARANANA CR 2 FANARENANA CEG AO AMBATOHARANANA 9 249 000 9 249 000 TACHERON REHABILITATION EDUCATION CEG 13/04/2018 ALAOTRA MANGORO ANOSIBE AN'ALA AMBATOHARANANA CR 2 FANARENANA LALANA 5 KM MAMPITOHY 5 751 000 5 751 000 HIMO/TACHERON REHABILITATION PISTE RURALE PISTE 13/04/2018 ALAOTRA MANGORO AMPARAFARAVOLA AMBATOMAINTY CR 2 FANITARANA SY FANARENANA BIRAON'NY KAOMININA 15 000 000 7 049 500 22 049 500 TACHERON REHABILITATION GOUVERNANCE BUREAU COMMUNE 13/04/2018 ALAOTRA MANGORO AMBATONDRAZAKA AMBATONDRAZAKA CU FANARENANA TRANO FIVORIAN'NY KAOMININA 15 000 000 15 000 000 TACHERON REHABILITATION GOUVERNANCE SALLE DE REUNION 28/03/2018 ALAOTRA MANGORO AMBATONDRAZAKA AMBATONDRAZAKA SUBURBAINE CR 1 FANARENANA TETEZANA TELO 15 000 000 2 TACHERON REHABILITATION PISTE RURALE PONT 13/04/2018 ALAOTRA MANGORO AMBATONDRAZAKA AMBATOSORATRA CR 2 FANORENANA LYCEE AO AMBATOSORATRA 15 000 000 15 730 900 30 730 900 TACHERON CONSTRUCTION EDUCATION LYCEE 13/04/2018 ALAOTRA MANGORO MORAMANGA AMBATOVOLA CR 2 FANARENANA CSB II AO AMBATOVOLA 15 000 000 13 018 15 013 018 TACHERON REHABILITATION SANTE CSB II 13/04/2018 -

Universite D'antananarivo
UNIVERSITE D’ANTANANARIVO FACULTE DES SCIENCES DEPARTEMENT DE PHYSIQUE MEMOIRE Pour l’obtention du diplôme de MAITRISE DES SCIENCES ET TECHNIQUES EN GEOPHYSIQUE APPLIQUEE Option : Mines et Environnement Intitulé ETUDE DES ZONES FAVORABLES EN MINERALISATION AURIFERE ET EN EMERAUDE DANS LA COMMUNE RURALE D’ANDRORANGAVOLA, DISTRICT D’IFANADIANA, REGION VATOVAVY FITOVINANY Présenté par RANTOSOA Andriharizafy Devant la commission d’examen composée de : Président : RANDRIAMANANTANY Zely Arivelo Professeur Titulaire Rapporteur : RASOLOMANANA Eddy Professeur Examinateurs: RANDRIANJA Roger Professeur RAZAFINDRAKOTO Boni Gauthier Docteur Le 29 Décembre 2008 UNIVERSITE D’ANTANANARIVO FACULTE DES SCIENCES DEPARTEMENT DE PHYSIQUE MEMOIRE Pour l’obtention du diplôme de MAITRISE DES SCIENCES ET TECHNIQUES EN GEOPHYSIQUE APPLIQUEE Option : Mines et Environnement Intitulé ETUDE DES ZONES FAVORABLES EN MINERALISATION AURIFERE ET EN EMERAUDE DANS LA COMMUNE RURALE D’ANDRORANGAVOLA, DISTRICT D’IFANADIANA, REGION VATOVAVY FITOVINANY Présenté par RANTOSOA Andriharizafy Devant la commission d’examen composée de : Président : RANDRIAMANANTANY Zely Arivelo Professeur Titulaire Rapporteur : RASOLOMANANA Eddy Professeur Examinateurs: RANDRIANJA Roger Professeur RAZAFINDRAKOTO Boni Gauthier Docteur Le 29 Décembre 2008 REMERCIEMENTS En préambule de ce mémoire, je souhaite adresser ici mes vifs remerciements à toutes personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à l'élaboration de ce mémoire tout particulièrement les personnes citées ci après : Madame RANDRIAMANANTANY Zely Arivelo , Professeur Titulaire, Chef du Département de Physique, qui a bien voulu présidé le membre de jury. Monsieur le Professeur RANAIVO Nomenjanahary Flavien , Directeur de l’ Institut et Observatoire de Géophysique d’Antananarivo (IOGA), Responsable Pédagogique de la formation en Maîtrise des Science et Technique en Géophysique Appliqué (MSTGA), et qui m’a accepté d’être parmi ses étudiants au sein dudit établissement. -

Le Developpement Economique De La Region Vatovavy Fitovinany
UNIVERSITE D’ANTANANARIVO Année Universitaire : 2006-2007 Faculté de Droit, d’Economie, de Second Cycle – Promotion Sortante Gestion et de Sociologie Option : DEVELOPPEMENT DEPARTEMENT ECONOMIE « Promotion ANDRAINA » Mémoire de fin de Cycle LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA REGION VATOVAVY FITOVINANY Encadré par : Monsieur Gédéon RAJAONSON Présenté par : MANIRISOA RAZAFIMARINTSARA Firmin Date de soutenance : 14 Décembre 2007 REMERCIEMENTS Pour commencer, je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à ma formation et à la réalisation de ce Grand Mémoire de fin d’études en Economie. J’adresse donc tout particulièrement mes vifs remerciement à : • DIEU TOUT PUISSANT • Mon encadreur Monsieur Gédéon RAJAONSON ; • Tous les enseignants et les Personnels administratifs du Département Economie de la Faculté DEGS de l’Université d’Antananarivo ; • Monsieur Le Chef de Région de Vatovavy Fitovinany et ses équipes • Monsieur le Directeur Régional des Travaux Publics de Vatovavy Fitovinany • Ma famille pour leurs soutiens permanents. Veuillez accepter le témoignage de ma profonde gratitude. LISTE DES ABREVIATIONS ANGAP : Agence Nationale de la Gestion des Aires Protégés CEG : Collège d’Enseignement Général CHD 1 : Centre Hospitalier de District Niveau 1 CHD 2 : Centre Hospitalier de District Niveau 2 CISCO : Circonscription Scolaire CSB 1 : Centre de Santé de Base Niveau 1 CSB 2 : Centre de Santé de Base Niveau 2 DRDR : Direction Régionale du Développement Rural EPP : Ecole Primaire Public FCE : Fianarantsoa Côte Est FER : Fonds d’Entretien Routier FTM : Foibe Toantsritanin’i Madagasikara GU : Guichet Unique HIMO : Haute Intensité de Main d’œuvre INSTAT : Institut National de la Statistique M.A.E.P. -

Evolution De La Couverture De Forets Naturelles a Madagascar
EVOLUTION DE LA COUVERTURE DE FORETS NATURELLES A MADAGASCAR 1990-2000-2005 mars 2009 La publication de ce document a été rendue possible grâce à un support financier du Peuple Americain à travers l’USAID (United States Agency for International Development). L’analyse de la déforestation pour les années 1990 et 2000 a été fournie par Conservation International. MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DES FORETS ET DU TOURISME Le présent document est un rapport du Ministère de l’Environnement, des Forêts et du Tourisme (MEFT) sur l’état de de l’évolution de la couverture forestière naturelle à Madagascar entre 1990, 2000, et 2005. Ce rapport a été préparé par Conservation International. Par ailleurs, les personnes suivantes (par ordre alphabétique) ont apporté leur aimable contribution pour sa rédaction: Andrew Keck, James MacKinnon, Norotiana Mananjean, Sahondra Rajoelina, Pierrot Rakotoniaina, Solofo Ralaimihoatra, Bruno Ramamonjisoa, Balisama Ramaroson, Andoniaina Rambeloson, Rija Ranaivosoa, Pierre Randriamantsoa, Andriambolantsoa Rasolohery, Minoniaina L. Razafindramanga et Marc Steininger. Le traitement des imageries satellitaires a été réalisé par Balisama Ramaroson, Minoniaina L. Razafindramanga, Pierre Randriamantsoa et Rija Ranaivosoa et les cartes ont été réalisées par Andriambolantsoa Rasolohery. La réalisation de ce travail a été rendu possible grâce a une aide financière de l’United States Agency for International Development (USAID) et mobilisé à travers le projet JariAla. En effet, ce projet géré par International Resources Group (IRG) fournit des appuis stratégiques et techniques au MEFT dans la gestion du secteur forestier. Ce rapport devra être cité comme : MEFT, USAID et CI, 2009. Evolution de la couverture de forêts naturelles à Madagascar, 1990- 2000-2005. -

Crustal Assembly of the Antananarivo and Masora Domains, Central
Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, Volume 110, page 111–125, 2015 Crustal assembly of the Antananarivo and Masora domains, central–eastern Madagascar: constraints from U–Pb zircon geochronology and whole–rock geochemistry of meta–granitoids Takashi ICHIKI*, Masahiro ISHIKAWA*, Jun–Ichi KIMURA**, Ryoko SENDA** and Raymond RAKOTONDRAZAFY*** *Graduate School of Environment and Information Sciences, Yokohama National University, 79–7 Tokiwadai, Hodogaya–ku Yokohama 240–8501, Japan **Department of Solid Earth Geochemistry (D–SEG), Japan Agency for Marine–Earth Science and Technology (JAMSTEC), 2–15 Natsushima–cho, Yokosuka 237–0061, Japan ***Department of Earth Sciences, Faculty of Science, University of Antananarivo, PB 906 Antananarivo 101, Madagascar In reconstructions of the Gondwana supercontinent, correlations of Archean domains between Madagascar and India remain debated. In this paper, we aim to establish correlations among these Archean domains using whole–rock geochemistry and U–Pb zircon geochronology of meta–granitoids from the Masora and the Anta- nanarivo domains, central–eastern Madagascar. A meta–granitoid from the central part of Masora domain is dated at 3277 Ma and shows a typical Archean tonalite–trondhjemite–granodiorite composition, whereas a tonalitic gneiss from the southeastern part of the Antananarivo domain gives an age of 2744 Ma. The geo- chemical signature of this tonalitic gneiss differs from that of the ~ 2500 Ma granitoids of the northwestern part of Antananarivo domain. In addition, the geochemical composition of the ~ 760 Ma granitic gneisses is con- sistent with a volcanic–arc origin for the protolith. Based on the geochemical and geochronological results, along with existing data, we identified three episodes of granitic magmatism in central–eastern Madagascar at ~ 3300, 2700, and 2500 Ma. -
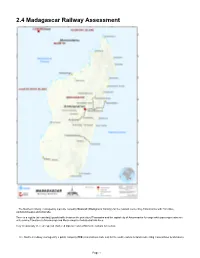
2.4 Madagascar Railway Assessment
2.4 Madagascar Railway Assessment - The Northern railway, managed by a private company Madarail (Madagascar Railway) for the network connecting Antananarivo with Tamatave, Ambatondrazaka and Antsirabe. There is a regular (at least daily) goods traffic between the port city of Toamasina and the capital city of Antananarivo for cargo while passenger trains are only serving Tamatave to Moramanga and Moramanga to Ambatrodrazaka lines. Very occasionally there are special chartered trips on restored Micheline railcars for tourists. - The Southern railway, managed by a public company FCE (Fianarantsoa Cote Est) for the south eastern network connecting Fianarantsoa to Manakara. Page 1 The southern line has regular passenger and cargo trains, which provides a slow but picturesque alternative to the recently rehabilitated road in the region. For more information on railway company contact details, please see the following link: Madagascar Railway Assessment Railway Companies and Consortia 4.2.7 Madagascar Railway Company Contact List Northern railway*: *During our study, Madarail was in the midst of restructuring, therefore, they did not want to share information, statistics or even contacts. All the information gathered and shared in this document comes exclusively from third parties or from data found on the internet. Madarail, was founded on October 10, 2002 following the decision of the Malagasy State to privatize the Malagasy National Railway Network1 (RNCFM). A concession agreement for the management of the North network is then established between the new private operator and the State. Madarail began operating the Northern railway network in Madagascar on 1 July 2003. In 2008, the Belgian operator Vecturis, already active in eight other African countries, became the majority shareholder of the company and the new railway operator. -

Article Lucien
RAMIANDRISOA Lucien – Article 2016 Les chefs coutumiers ont-ils un rôle dans la gestion foncière ? L’exemple des sociétés Antemoro et Antañala, District de Manakara, Région de Vatovavy-Fitovinany, MADAGASCAR Par Lucien RAMIANDRISOA Doctorant en Géographie, Laboratoire Espaces et Sociétés École Doctorale Sciences Humaines et Sociales E-mail : [email protected] Université d’Antananarivo, MADAGASCAR Et En co-diretion de thèse avec le Laboratoire PACTE – Territoires, UMR 5194 CNRS – IEPG – UJF – UPMF Université Grenoble Alpes, FRANCE Résumé Abstract Les deux formalisations de droit de propriété à The two formulations of Malagasy property right Madagascar consistent dans l’immatriculation consist of land registration and land certification foncière et la certification foncière (selon la (according to the land reform of 2005). These two réforme foncière de 2005). Ces deux pratiques official and formal practices were put in place by officielles et formelles ont été instaurées par the Malagasy government since its independence l’État malgache depuis l’indépendance de 1960. 1960. Land management as a basis of “territorial La gestion foncière en tant que base de development” involves different decision makers “développement territorial” implique and will give a major opportunity for all l’intervention de diverses instances de décisions Malagasy farmers in formulation of property et va donner une grande opportunité pour tous les right. In Sub-Saharan African countries and even paysans malgaches dans le cadre de la in Madagascar, traditional leaders involve in the formalisation du droit de propriété. Dans les pays land management in which their decision-making de l’Afrique subsaharienne et même dans tout powers are limited by government. -

3505 Nosy Varika
dfggfdgfdgsdfsdfdsfdsfsdfsdfdsfsdfdsfdmmm REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana ----------------- HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE RESULTATS DEFINITIFS DU SECOND TOUR DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE DU 19 DECEMBRE 2018 dfggfdgffhCode BV: 350501010101 dfggfdgffhBureau de vote: EPP AMBAHY dfggfdgffhCommune: AMBAHY dfggfdgffhDistrict: NOSY VARIKA dfggfdgffhRegion: VATOVAVY-FITOVINANY dfggfdgffhProvince: FIANARANTSOA Inscrits : 668 Votants: 292 Blancs et Nuls: 12 Soit: 4,11% Suffrages exprimes: 280 Soit: 95,89% Taux de participation: 43,71% N° d'ordre Logo Photo Nom et Prenoms Candidat Voix obtenues Pourcentage 13 RAJOELINA Andry Nirina 240 85,71% 25 RAVALOMANANA Marc 40 14,29% Total voix: 280 100,00% Copyright @ HCC 2019 dfggfdgfdgsdfsdfdsfdsfsdfsdfdsfsdfdsfdmmm REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana ----------------- HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE RESULTATS DEFINITIFS DU SECOND TOUR DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE DU 19 DECEMBRE 2018 dfggfdgffhCode BV: 350501020101 dfggfdgffhBureau de vote: EPP AMBATOHARANANA dfggfdgffhCommune: AMBAHY dfggfdgffhDistrict: NOSY VARIKA dfggfdgffhRegion: VATOVAVY-FITOVINANY dfggfdgffhProvince: FIANARANTSOA Inscrits : 374 Votants: 108 Blancs et Nuls: 4 Soit: 3,70% Suffrages exprimes: 104 Soit: 96,30% Taux de participation: 28,88% N° d'ordre Logo Photo Nom et Prenoms Candidat Voix obtenues Pourcentage 13 RAJOELINA Andry Nirina 79 75,96% 25 RAVALOMANANA Marc 25 24,04% Total voix: 104 100,00% Copyright @ HCC 2019 dfggfdgfdgsdfsdfdsfdsfsdfsdfdsfsdfdsfdmmm REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA