Les Primates De Park Avenue
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

St. Martin's Griffin December 2018
ST. MARTIN'S GRIFFIN DECEMBER 2018 Beasts of Extraordinary Circumstance A Novel Ruth Emmie Lang "This exquisite and adventurous book will remind you of classic fantasies that you read as a child." —Bustle Finding magic in the ordinary... The day that Weylyn is born is the largest snowstorm the South has ever seen. As he grows older, so does the legends of Weylyn Grey, his horned-pig Merlin and their magical abilities. But the true magic is in the way that he transforms FICTION / FANTASY / the lives of those around him. As anyone who's met Weylyn will tell you, once CONTEMPORARY he wanders into your life, you'll wish he'd never leave. St. Martin's Griffin | 12/4/2018 9781250306661 | $16.99 / $22.50 Can. Told from the perspectives of the people who knew him, loved him, and even a Trade Paperback | 368 pages | Carton Qty: 24 8.3 in H | 5.4 in W few who thought he was just plain weird. Although he doesn’t stay in any of their lives for long, he leaves each of them with a story to tell. Stories about a Subrights: UK Rights: Andrea Somberg, Harvey boy who lives with wolves, great storms that evaporate into thin air, fireflies that Klinger, Inc. Translation Rights: Andrea Somberg, Harvey make phosphorescent honey, and a house filled with spider webs and the strange Klinger, Inc. man who inhabits it. Other Available Formats: Hardcover ISBN: 9781250112040 There is one story, however, that Weylyn wishes he could change: his own. But Ebook ISBN: 9781250112057 first he has to muster enough courage to knock on Mary’s front door. -
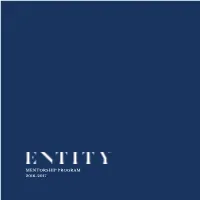
Entity Academy Mentorship Program 2016-2017
ENTITY ACADEMY MENTORSHIP PROGRAM 2016-2017 ENTITY ACADEMY CLASS OF ’16 AND ’17 ADRIANA ADRIENNE ALICIA ALYSSA AMY AMANDA SERRATO SIGETI HOLLIDAY ANDERSON GROSSINGER WAGERNSHEIM AN ANGELICA ANNABEL ANTHEA ARIANNA ASHLEY NGUYEN PRONTO SCHULZ TAEUBER SIMONET ALEXANDER ENTITY’s mentorship program is a 6-week immersive experience bringing together a collective of young women from across the country. These young women are afforded a unique opportunity to explore their career and life ambitions; gain invaluable experience within the digital media CASEY CAITLIN CAMELLE CANDICE CARMEN CHRISSIE CROMWELL DEVEREAUX SISON HORDE CAMPBELL CHENG space; as well as build long lasting relationships with extraordinary female mentors and fellow mentees. ENTITY Academy’s curated mentorship program trains women to be successful communicators in today’s globalized world. FIFTY WOMEN, CORINNE ELIZA ELENA ELLENA EMMA ERIN ZWARTER BRITT ENDER KILGALLON DIMAGGIO HARPUR SIX WEEKS. 2 3 ENTITY ACADEMY CLASS OF ’16 AND ’17 FRANCES FRANKIE FRIDA GABRIELLE GIULLIANA HANNAH KYLIE MADILYN MICAIAH MADDIE MIXIE MONICA SENIGRAM WILLIAMS GUREWITZ WAXTEIN DE LA ROSA NIEMIER CHERIN SMITH BRADLEY CASO MECHLEY REYNOSO HAORAN HARMONY HILLARY HILLARY IMAN ISABELLA NATALIE NATALIE NICOLE NGOC OLIVIA PATRICK ZHANG BIRCH LITHERLAND OJEDA BIBI AUSTIN CAHILL SANCIMINO SAZEGAR ANH HA SZYMANSKI COYLE RACHEL J. KENDALL JAYDA JOHANIE JASMYNE JOSEPHINE JUSTINE RACHEL RUORAN SAELI SAMANTHA SARAH SHERMAN ALLEN PATTERSON COOLS PECK-BAILEY DJUHANA MORALES WANGERSHEIM WANG ESHELMAN LIMA SHERMAN -
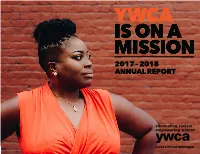
2017 - 2018 Annual Report
2017 - 2018 ANNUAL REPORT west central michigan We need to believe. 2017-18 BOARD OF DIRECTORS Believe survivors. Believe domestic abuse and sexual assault happen. Doug Wilterdink, President Believe the uncomfortable truth that people we know are capable of Lonna Wiersma, Vice President violence. Believe there are structures in place that protect offenders. Believe we can be part of the problem, but also part of the solution. Believe that Peggy Bishop, Treasurer domestic and sexual violence are not inevitable – they are preventable. India Manns, Secretary Believe the world can be different. Janean Couch Karen Ender Believing is an act of hope. And it’s what supporters like you do – recognizing Barbara Griffin that you can help, that you can change things. Julia Guevara Your support of the YWCA makes an impact for the 4,000+ served here each Meg Hackett year, and also for our community and beyond. You change lives, you change Bryan Houck laws, you change attitudes. The numbers and stories in this report show just Rhonda Huismann how transformative that can be. Kathy Koch Thanks to you, we can support survivors with quality comprehensive Sherwin Robinson services, and make bold change through prevention and empowerment Cindy Rogowski programming. You act in the belief that change is possible – and it makes all Precious Threats the difference.Thank you. Michelle VanTorre-Tellier Jan Winters Eliminating Racism Charisse Mitchell, CEO Empowering Women and Girls Promoting Peace, Justice, Freedom, and Dignity for All Charisse Mitchell Doug Wilterdink -

A NEW DIRECTION for CHICK LIT by Rachel
ABSTRACT CONSCIOUSNESS-RAISING: A NEW DIRECTION FOR CHICK LIT by Rachel R. Rode Schaefer Focusing on novels published outside of the popular market, this thesis seeks to draw attention to work being published under the label of chick lit that subverts standard chick lit genre conventions. While much work has been and is being done that concentrates on popular market chick lit, such as Helen Fielding’s Bridget Jones’s Diary (1996) and Candace Bushnell’s Sex and the City (1996), only cursory attention is being given to transnational, minority, and religious chick lit. This thesis considers chick lit within the larger history of women’s writing in order to contextualize the genre. Since chick lit has been connected to both feminism and post-feminism in its origins, consideration of this genre as a feminist genre focuses attention on how chick lit functions as a consciousness-raising genre. CONSCIOUSNESS-RAISING: A NEW DIRECTION FOR CHICK LIT A Thesis Submitted to the Faculty of Miami University In partial fulfillment of Master of Arts Department of English by Rachel R. Rode Schaefer Miami University Oxford, Ohio 2015 Advisor_________________________________ Dr. Madelyn Detloff Reader__________________________________ Dr. Mary Jean Corbett Reader__________________________________ Dr. Theresa Kulbaga © Rachel R. Rode Schaefer 2015 Table of Contents Introduction: Reading Chick Lit as Consciousness-Raising Novel ................................................ 1 Project Summary ........................................................................................................................ -

Stephen Gaynor School Gazette Summer 2011
www.stephengaynor.org PRSRT STD U.S. Postage PAID Permit No. 751 148 West 90th Street Sioux Falls, SD New York, NY 10024 www.stephengaynor.org SUMMER 2011 2011 –2012 SGS Calendar of Events 2011 Sept 7 Wednesday All Parents Meet Teachers – 9:00 a.m. Sept 7–9 Wednesday–Friday ECC Family Visits (by appointment) Sept 8 Thursday Opening Day of School (except for ECC) Sept 12 Monday Opening Day of School – ECC Students Sept 29 & 30 Thursday & Friday Rosh Hashanah Oct 10 Monday Columbus Day – School closed Oct 11 Tuesday Parent Teacher Conferences – No students Nov 11 Friday Veterans Day/Professional Development – No students Nov 24 & 25 Thursday & Friday Thanksgiving Recess – School closed Dec 17– Jan 2 Saturday–Monday Winter Recess – School closed 2012 Jan 3 Tuesday School session resumes Jan 16 Monday Martin L. King’s birthday – School closed Jan 17 Tuesday Administrative Day – No Students Feb 9 Thursday Parent Teacher Conferences – No students Feb 20 & 21 Monday & Tuesday Presidents’ Day – School closed Mar 17–Apr 1 Saturday–Sunday Spring Recess – School closed Gordon Gaynor Reflects Apr 2 Monday School session resumes Apr 6 Friday Good Friday – School closed on 25 Years of Service May 2 Wednesday Parent Teacher Conferences – No students May 25 Friday Administrative Day – No students 2011 Gaynor Gala May 28 Monday Memorial Day – School closed Jun 13 Wednesday Last day of School End of the Year Wrap Up Jun 14 Thursday Graduation Ceremony 148 West 90th Street, New York, NY 10024 • TEL: 212.787.7070 • FAX: 212.787.3312 • www.stephengaynor.org Thank you Gordon REASONS for 25 years of 11 TO GIVE TO THE GAYNOR FUND service and dedication to the • • • • • •9898 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Stephen Gaynor School • • • Hailey • Jack • Isabella • Alexandra • Oliver • Lily • David • Ryan • Sander • Rachel • Ben Liam • Finn • Justin • Cillian • Ryan • Samuel • Andrew • Abe • Jay • Tyler • Samuel Kylie • Joshua • Stephen • P.J. -

GIRLFRIENDS Why YOU Need Them! THANKSGIVING CRAFTS Your Stepkids Will LOVE
!"#$%&$'()*+*( CONQUERING the BIGGEST HOLIDAY STEPHASSLES The 4 Lies We Tell Stepmoms She’s Giving Thanks for Her Stepmom One Woman’s Beautiful Story Encountering Exes During the Holidays! How to Handle it Gracefully GIRLFRIENDS Why YOU Need Them! THANKSGIVING CRAFTS Your Stepkids will LOVE STYLISH STEPMOM shares her HOLIDAY MONEY-SAVING TIPS Letter from the Publisher 3 Gratitude and the Season of Giving 4 – 5 Four Big Lies We Tell Women with Stepchildren 6 – 8 Becoming a Smart Stepmom Webinar 9 Conquering Holiday Hassles 10 – 12 Stylish Stepmom 13 Giving Thanks 14 – 15 My Journal 16 Being a Stepmom is… 17 Encountering Exes During the Holidays 18 – 19 Legal Matters 20 – 21 Thanks and Misgivings 22 – 23 Crafts with Your Stepkids 24 – 25 Grief, Passion and the Holidays 26 – 28 Managing Expectations: How to Keep Thanksgiving from Being A Total Turkey 29 A Stepmom’s Best Friend 30 – 31 “You Again” Movie Review 32 – 33 Recognizing Your Stressors 34 – 35 Give Yourself the Gift of Peace 36 – 37 Recipes 38 – 40 Words of Wisdom 41 2 © 2010 StepMom Magazine Brenda’s Corner Stepmoms are often told they should manage or lower their expectations to avoid certain disappointment. I’ve always had a problem with this concept. In my mind, I equated lowering my expectations with settling for something less. Accepting mediocrity. Giving up, in a sense. During this time of the year, you will read a lot of articles that address stepholidays and all that comes with them. Writers will advise you to anticipate unexpected schedule changes, prepare for inevitable encounters with exes and to know in advance that most family gatherings never live up to the perfect scenes depicted in those Norman Rockwell paintings. -

A Librarian's Guide to Great Gift Books
FOR THE FAMILY’S BEST GIFT GIVER: A LIBRARIAN’S GUIDE TO GREAT GIFT BOOKS FOR THE FOR FOR THE DISCRI- ANGLOPHILES LITERARY- FOR MINATING FOR FANS WHO TAKE MINDED THRILL- GRAPHIC OF THE THEIR TEA FOODIE SEEKERS NOVEL FAN MARTIAN BLACK Kitchens of the Great Midwest The Hand that Feeds You by A.J. Rich The Sandman: Overture Seveneves by Neal Stephenson Crooked Heart by Lissa Evans by J. Ryan Stradal This riveting, sexy novel of psychological by Neil Gaiman Readers eager for more characters This irresistibly wry dark comedy set This sweet and savory debut novel—parts suspense is about an accomplished Legendary scribe Gaiman makes his that “science the hell” out of life and in World War II England chronicles an of which are set in Evanston—is the woman involved with a man who proves long-awaited return to the characters death will be absorbed by this story unlikely alliance between a frazzled coming-of-age tale of a young woman to be an imposter. A.J. Rich is actually and medium that made him famous. of annihilation and survival spanning con artist and a young orphan who who becomes one of the country’s most a pseudonym for celebrated literary 5,000 years. schools her in the art of the steal. famous chefs. authors Amy Hempel and Jill Ciment. FOR FOR THOSE SOMEONE WHO WISH FOR THE WITH A FOR THE THEY WERE FOR READER TASTE SHORT PART OF DRAMA WITH A TIME FOR THE STORY THE LOST KINGS AND TRAVEL UNUSUAL LOVER GENERATION QUEENS TO-DO LIST Delicious Foods Honeydew by Edith Pearlman Villa America by Liza Klaussmann The Penguin Arthur Miller: Time -

Inkwell Management London 2019
InkWell Management London 2019 TABLE OF CONTENTS Fiction Anne Brinsden ................................................ Wearing Paper Dresses .............................................................. 9 Susanna Calkins ............................................. Murder Knocks Twice ............................................................... 10 Blake Crouch .................................................. Recursion ................................................................................... 11 Suzanne Daniel ............................................... A Girl in Three Parts ................................................................. 12 Rene Denfeld .................................................. The Butterfly Girl ...................................................................... 13 James Grady.................................................... Condor: The Short Takes ........................................................... 14 Rose Hartley ................................................... Maggie’s Going Nowhere .......................................................... 15 Elin Hilderbrand ............................................ Summer of ‘69 ............................................................................ 16 Elin Hilderbrand ............................................ What Happens in Paradise ........................................................ 17 Eloisa James .................................................... Say No to the Duke ................................................................... -

Primates of Park Avenue Download
Primates of park avenue download LINK TO DOWNLOAD Move over Primates of Park Avenue, and say hello to a more evolved female archetype. Meet Mina Baron and Jill Stone. These domestic doyennes bring humility back to 'Real Housewives' - reminding society that women can be resolutely adventurous, defiantly gritty, endlessly relevant, undeniably talented and indomitably resilient. ♥ Book Title: Primates of Park Avenue ♣ Name Author: Wednesday Martin ∞ Launching: Info ISBN Link: ⊗ Detail ISBN code: ⊕ Number Pages: Total sheet ♮ News id: y6c5DAAAQBAJ Download File Start Reading ☯ Full Synopsis: ""Like an urban Dian Fossey, Wednesday Martin decodes the primate social behaviors of Upper East Side mothers in a. · Primates of Park Avenue is a smart, funny, and original dissection of the tribal rites of rich and striving New Yorkers.” — Steven Gaines, author of Philistines at the Hedgerow “This book in which primatology leads to a deeper understanding of the human hearts that beat beneath their designer-clad exteriors [is] a tour de force” — Robert Martin, PhD, author of How We Do It4,7/5(1). Title: Primates of Park Avenue Author: Wednesday Martin Publisher: Simon & Schuster, Format: PDF Size: MB Pages: Like an urban Dian Fossey, Wednesday Martin decodes the primate social behaviors of Upper East Side mothers in a brilliantly original and witty memoir about her adventures assimilating into that most secretive and elite renuzap.podarokideal.ru Edition: Simon & Schuster. An instant #1New York Timesbestseller,Primates of Park Avenueis an “amusing, perceptive and deliciously evil” (The New York Times Book Review) memoir of the most secretive and elite tribe—Manhattan’s Upper East Side mothers. -

This Reading Group Guide for Primates of Park Avenue Includes An
This reading group guide for Primates of Park Avenue includes an introduction, discussion questions, ideas for enhancing your book club, and a Q&A with Wednesday Martin. The suggested questions are intended to help your reading group find new and interesting angles and topics for your discussion. We hope that these ideas will enrich your conversation and increase your enjoyment of the book. Introduction Wednesday Martin’s new memoir, Primates of Park Avenue, is an inside look at the unexpectedly stressful and anxious lives of Manhattan’s most elite set: Upper East Side mommies. The book follows Wednesday on her journey to join the “it” crew in Manhattan, and no detail—no matter how trivial or painful—is left out. We read about the feelings of exclusion and unhappiness Wednesday experiences as she learns to navigate the sometimes-cruel streets and female “friendships” west of Lexington Avenue. We hear about her epic quest to own an Hermès Birkin bag and about the cutthroat nature of preschool applications on the Upper East Side. Through it all, Wednesday straddles the line between subjective insider desperate to find a place for herself and her son and academically detached outsider using her background in anthropology and primatology to help make sense of her world, one she realizes might seem silly and unsympathetic from the outside. Wednesday is both participant in and observer of the rituals of motherhood in Manhattan’s richest neighborhood. Discussion Questions 1. In her introduction, author Wednesday Martin asks herself “who were they really, these glamorous, stylishly turned out women with sophisticated babies?” (2). -

January 2017
In This Issue: January Events | AuthorSpeak | Book Discussions | Business Workshops Children's Programs | Concerts | Healthy Minds/Healthy Bodies | Weekly Programs January 2017 Greetings! It's 2017, and I just want to say one word to you, just one word. Are you listening? AUDIOBOOKS If your New Year's resolutions include more (exercise, reading) or less (road rage, sleeplessness), put AUDIOBOOKS at the top of that list. You won't feel like you're on a treadmill when you are engrossed in a mystery. Being stuck in traffic isn't so bad when you are catching up on your reading. When you can't sleep, stop thinking about whatever it is that's keeping you awake. Close your eyes, plug in your earphones and put the AUDIOBOOK on sleep timer. You don't have to pay, not even overdue fines, or even come into the library. You just have to have a Norwalk library card. If you don't have one, but live, work or go to school in Norwalk, Go online and get one! (Actually, that should be New Year's resolution #1). We have three databases from which you can choose your first audiobook, and that is not a free trial; they are always free. Be sure to download the books through their apps so you can listen wherever you are. Hoopla Enter your email; scroll down to Norwalk Public Library (CT); enter your library card number; download the app. Hoopla titles are all available all the time. One Click Digital Register with your library card #; set up a user name and password; give your email; download the app. -
I'll Have What She's Having!
Seasoned StepmomsI’ll Have What She’s Having! by WEDNESDAY MARTIN, Ph.D. WHAT IS THE SECRET TO HAPPINESS? - Stepmonster 12 © 2012 STEPMOM MAGAZINE The educated woman with ELF!CARE PRACTICE. stepkids might not like some of S the situations she finds herself in, but at least she understands them. “Psychoeducation”— LEARNING WHAT IS NORMAL IN STEPFAMILY LIFE OR REMARRIAGE WITH CHILDREN DUCATED OUTLOOK. —can make the di!erence E - between thriving and throwing in the towel. IR TIGHT PARTNERSHIP. A - 13 © 2012 STEPMOM MAGAZINE TRONG NETWORK. The happy and seasoned S - stepmothers I spoke to were not - hand-wringers. THEY DIDN’T REVISIT THEIR MISTAKES, OR QUESTION THEMSELVES ENDLESSLY, or crumble in the face of disapproval. NLY FIGHTS FAIR. O - - O GUILT. N - 14 © 2012 STEPMOM MAGAZINE MPATHY AND COMPASSION FOR HER PARTNER. Getting into his head, E understanding where he’s coming from and LETTING HIM KNOW YOU UNDERSTAND HIS - FEELINGS—even when he is driving you insane ... is OES NOT LET RUMINATION RULE HER MIND OR HER LIFE. the key to staying D connected. - - - O WEDNESDAY MARTIN, Ph.D., is a social researcher and the author of Stepmonster: A New Look at Why Real Stepmothers Think, Feel, and Act the Way We Do (2009). She is a regular contributor to Psychology Today (www.psychology today.com/blog/stepmonster) and blogs for the Hu!ngton Post and on her own website (www.wednesdaymartin.com). She has appeared as a stepparenting expert on NPR, the BBC Newshour, Fox News and NBC Weekend Today and was a regular contributor to the New York Post’s parenting page.