Débat Public De L'interconnexion Sud Note De Synthèse
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Des Réserves Importantes De Capacité À Long Terme Dans Les Principales Lignes Ferroviaires À Grande Vitesse Et Les Grands Aéroports Parisiens
VOYAGEURS DES RÉSERVES IMPORTANTES DE CAPACITÉ À LONG TERME DANS LES PRINCIPALES LIGNES FERROVIAIRES À GRANDE VITESSE ET LES GRANDS AÉROPORTS PARISIENS Alain SAUVANT Les principales lignes ferroviaires à grande vitesse (LGV) et les aéroports parisiens présentent encore d’importantes réserves de capacité, à con- dition d’utiliser du matériel de plus grande capacité (TGV à deux niveaux, en unité multiple, avions de grande capacité), en recourant des systèmes de “ contrôle commande ” performants et en utilisant davantage l’infras- tructure, notamment aux heures creuses. Ces gains maximaux de capa- cité à long terme (2020 à 2030) sans infrastructures nouvelles sont de plus de quatre fois les flux actuels pour la LGV Sud-Est, pourtant la plus saturée, et de plus de quatre fois également pour les aéroports de Paris (hors contraintes réglementaires entraînant un plafonnement du nombre de mouvements). Les comparaisons internationales montrent qu’un tel niveau d’utilisation des capacités peut être atteint en pratique, que ce soit pour les LGV ou pour les aéroports. Ces gains sont possibles à réglemen- tation inchangée pour les TGV. Cette mobilisation de la capacité disponible passe également, surtout pour le mode ferroviaire, par un recours accru à des modulations tarifai- res pour une meilleure utilisation des capacités. La capacité La question de la capacité des principales lignes ferroviaires à grande vitesse et est au cœur des grands aéroports se situe au cœur des choix de politique des transports en de la politique matière de transport de voyageurs à longue distance. des transports En effet, rien ne sert de développer des nouvelles lignes ferroviaires à grande vitesse (par exemple Lyon-Turin) si elles induisent un supplément de trafic qui ne peut s’écouler sur les lignes les plus chargées (Paris-Lyon dans ce même exemple). -

SYSTRA RA 2018 Int VOK HD.Indd
SIGNATURES RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 SOMMAIRE AMBITIONS MESSAGE DE LA DIRECTION P.02 CHIFFRES CLÉS 2018 P.04 RÉFÉRENCES P.06 REPORTAGES Mobilité de demain AU QUÉBEC, LE TRANSPORT PUBLIC DEVIENT UN MOTEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE P.08 Métro, des infrastructures aux systèmes LE MÉTRO DU GRAND PARIS DESSINE LA MÉTROPOLE DU XXIe SIÈCLE P.14 Ferroviaire & fret LE FRET TRANSPORTE L’INDE VERS SON AVENIR P.20 Grande vitesse UNE PREMIÈRE LIGNE À GRANDE VITESSE POUR LE CONTINENT AFRICAIN P.26 Ponts & grands ouvrages UN NOUVEAU PONT ÉMERGE DE LA BAIE DE KOWEÏT P.32 Tramways & téléphériques urbains AUX PORTES DU SAHARA ALGÉRIEN, UN TRAMWAY DÉFIE LE DÉSERT P.38 Aménagement du territoire & aviation L’ÉTAT DE SÃO PAULO INVESTIT DANS LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE P.42 GOUVERNANCE LE CONSEIL DE SURVEILLANCE P.46 LE COMITÉ EXÉCUTIF P.47 DONNÉES FINANCIÈRES P.48 04 PROFIL Chez SYSTRA, travailler sur le tracé d’une ligne, c’est ouvrir la voie à des milliers de passagers, livrer un pont d’une grande technicité, c’est faire rayonner un territoire, concevoir le réseau de métro automatique d’une métropole, c’est orchestrer la collaboration de tous les acteurs clés d’un projet, mettre en place des signalisations ferroviaires de dernière génération, c’est contribuer à un transport plus sûr, inclure l’écoconception au cœur de nos projets, c’est faire émerger une mobilité plus durable. Toutes ces performances techniques et technologiques sont développées par des femmes et des hommes qui partagent les mêmes valeurs : une exigence permanente pour l’excellence, la richesse du travail en équipe et la singularité par l’audace. -

Een Invulling Van Een Netwerkvisie Voor De Hogesnelheidstrein Van, Naar En in Nederland
Een invulling van een netwerkvisie voor de hogesnelheidstrein van, naar en in Nederland John Baggen Technische Universiteit Delft [email protected] Jaap Vleugel Technische Universiteit Delft [email protected] Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 25 en 26 november 2010, Roermond 1 Samenvatting Een invulling van een netwerkvisie voor de hogesnelheidstrein van, naar en in Nederland In de afgelopen twee edities van het CVS werd aandacht geschonken aan een aanzet tot en de ontwikkeling van een netwerkvisie voor de hogesnelheidstrein van, naar en in Ne- derland. Die lijn wordt in deze bijdrage voortgezet en afgesloten met een verdere invulling. In deze bijdrage worden achtereenvolgens ingevuld een realistisch netwerk voor hogesnel- heidstreinen van, naar en in Nederland in 2020 op basis van actuele ontwikkelingen en een ideaal netwerk met een verder weg gelegen tijdhorizon van 2030. Het ontwerp van een realistisch netwerk is ingegeven door de verwachting dat het niet voor de hand ligt dat er binnen afzienbare tijd nog aanvullende investeringen in de infra- structuur specifiek t.b.v. hogesnelheidstreinen zullen worden gedaan. In dit netwerk wordt uitgegaan van het geplande Fyra-netwerk. Daarnaast is er, bij wijze van vingeroefening, een realistische voorbeelddienstregeling ontworpen voor de andere hogesnelheidstreinen op de corridors richting Frankrijk en Duitsland, d.w.z. uitgaande van de bestaande dienstregeling met zo weinig mogelijk aanpassingen daaraan. Het resultaat is op beide genoemde assen een regelmatig uurpatroon met een variatie aan bestemmingen. In de verdere toekomst zal er meer nadruk moeten worden gelegd op infrastructuur en wel in het bijzonder op de ontwikkeling van een HSL-Oost/Deltalijn. -

High Speed Lines in the World 2017
HIGH SPEED LINES IN THE WORLD Updated 1st April 2017 1 Lines or sections of lines in which operation V > 250 km/h 1:There are some exceptions. EUROPE AUSTRIA In operation: Section Max.Speed Year Distance (km/h) (km) Vienna - St Pölten 230 2012 48 Total km = 48 Under construction: Section Max.Speed Year Distance (km/h) (km) Ybbs - Amstetten 230 2015 17 Gloggnitz - Mürzzuschlag (Sermmering-Basistunnel) 2024 27 Graz - Klagenfurt (Koralmtunnel) 2024 110 Brennerachse 64 Total km = 218 Total Austria km = 266 BELGIUM In operation: Section Max.Speed Year Distance (km/h) (km) Brussels - French Border (L1) 300 1997 72 Leuven - Liège (L2) 300 2002 65 Liège - German Border (L3) 260 2009 36 Antwerp - Dutch border (L4) 300 2009 36 Total km = 209 Total Belgium km = 209 High Speed lines in the World – UIC Passenger Department Updated 1st April 2017 Page 1/21 CZECH REPUBLIC Long-term planning: Section Max.Speed Year Distance (km/h) (km) Vranovice Breclav (border A to Wien, border SK to Bratislava) 200 - 350 2020 40 Brno Prov 200 2020 70 Praha Lovosice 350 2030 55 Brno Vranovice 200 - 350 2030 30 Lovosice border D (to Dresden) 200 - 350 >2040 40 Praha Brno 350 >2040 205 Prerov Ostrava 350 >2040 80 Prerov Ostrava 350 >2040 80 Ostrava border P (to Katowice) 300 2050 10 Praha Plzen 250 - 350 2050 75 Plzen border D (to Nurnberg) 350 2050 55 Praha border P (to Wroclaw) 350 2050 150 Total km = 890 Total Czech Republic km = 890 DENMARK Under construction: Section Max.Speed Year Distance (km/h) (km) Copenhagen - Ringsted 250 2018 56 Total km = 56 Total Denmark -
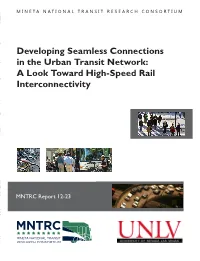
A Look Toward High-Speed Rail Interconnectivity MNTRC 12-23 Report
MNTRC MINETA NATIONAL TRANSIT RESEARCH CONSORTIUM Developing Seamless Connections: A Look Toward HSR Interconnectivity SeamlessDeveloping Connections: A Look Toward Funded by U.S. Department of Developing Seamless Connections Transportation in the Urban Transit Network: A Look Toward High-Speed Rail Interconnectivity MNTRC Report 12-23 MNTRC MNTRC Report 12-23 July 2014 July MNTRC MINETA NATIONAL TRANSIT RESEARCH CONSORTIUM MINETA TRANSPORTATION INSTITUTE MTI FOUNDER LEAD UNIVERSITY OF MNTRC Hon. Norman Y. Mineta The Norman Y. Mineta International Institute for Surface Transportation Policy Studies was established by Congress in the MTI/MNTRC BOARD OF TRUSTEES Intermodal Surface Transportation Efficiency Act of 1991 (ISTEA). The Institute’s Board of Trustees revised the name to Mineta Transportation Institute (MTI) in 1996. Reauthorized in 1998, MTI was selected by the U.S. Department of Transportation Founder, Honorable Norman Thomas Barron (TE 2015) Nuria Fernandez (TE 2014) Dr. David Steele (Ex-Officio) through a competitive process in 2002 as a national “Center of Excellence.” The Institute is funded by Congress through the Mineta (Ex-Officio) Executive Vice President General Manager/CEO Dean, College of Business United States Department of Transportation’s Research and Innovative Technology Administration, the California Legislature Secretary (ret.), US Department of Strategic Initiatives Valley Transportation San José State University Transportation Parsons Group Authority through the Department of Transportation (Caltrans), and by private grants and donations. Vice Chair Michael Townes* (TE 2014) Hill & Knowlton, Inc. Joseph Boardman (Ex-Officio) Rose Guilbault (TE 2014) Senior Vice President Chief Executive Officer Vice President (ret.) National Transit Services Leader The Institute receives oversight from an internationally respected Board of Trustees whose members represent all major surface Honorary Chair, Honorable Bill Amtrak American Automobile Association CDM Smith transportation modes. -
A Look Toward High-Speed Rail Interconnectivity
UNLV Theses, Dissertations, Professional Papers, and Capstones 12-1-2014 Developing Seamless Connections in the Urban Transit Network: A Look toward High-Speed Rail Interconnectivity Tingting Yu University of Nevada, Las Vegas Follow this and additional works at: https://digitalscholarship.unlv.edu/thesesdissertations Part of the Transportation Commons, Urban, Community and Regional Planning Commons, Urban Studies Commons, and the Urban Studies and Planning Commons Repository Citation Yu, Tingting, "Developing Seamless Connections in the Urban Transit Network: A Look toward High-Speed Rail Interconnectivity" (2014). UNLV Theses, Dissertations, Professional Papers, and Capstones. 2318. http://dx.doi.org/10.34917/7048637 This Thesis is protected by copyright and/or related rights. It has been brought to you by Digital Scholarship@UNLV with permission from the rights-holder(s). You are free to use this Thesis in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s) directly, unless additional rights are indicated by a Creative Commons license in the record and/ or on the work itself. This Thesis has been accepted for inclusion in UNLV Theses, Dissertations, Professional Papers, and Capstones by an authorized administrator of Digital Scholarship@UNLV. For more information, please contact [email protected]. DEVELOPING SEAMLESS CONNECTIONS IN THE URBAN TRANSIT NETWORK: A LOOK TOWARD HIGH-SPEED RAIL INTERCONNECTIVITY By Tingting Yu Bachelor of Science in Economics Wuhan University 2011 A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the Master of Science in Engineering Civil and Environmental Engineering and Construction Howard R. -
Planification Des Grands Projets D'infrastructures Ferroviaires (1981- 2009)
Planification des grands projets d'Infrastructures ferroviaires (1981- 2009) Répertoire numérique détaillé du versement 20160085/1-20160085/136 Caroline Lebreton Première édition électronique Archives nationales (France) Pierrefitte-sur-Seine 2016 1 Mention de note éventuelle https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_054879 Cet instrument de recherche a été rédigé avec un logiciel de traitement de texte. Ce document est écrit en ilestenfrançais.. Conforme à la norme ISAD(G) et aux règles d'application de la DTD EAD (version 2002) aux Archives nationales, il a reçu le visa du Service interministériel des Archives de France le ..... 2 Archives nationales (France) INTRODUCTION Référence 20160085/1-20160085/136 Niveau de description groupe de documents Intitulé Planification des grands projets d'infrastructures ferroviaires Date(s) extrême(s) 1981-2009 Nom du producteur • FRAN_NP_006700 - Sous-direction des transports ferroviaires Importance matérielle et support 16,19 ml (48 dimabs et 5 registres) Localisation physique Pierrefitte-sur-Seine Conditions d'accès La consultation des documents s'effectue conformément au code du Patrimoine, art. 213-1 à 3 Conditions d'utilisation Conformément au règlement de la salle de lecture DESCRIPTION Type de classement Le plan de classement des archives est construit par les producteurs des archives et les archivistes. Afin de rendre compte des actions réalisées dans le cadre des politiques publiques portées par l'administration, il est organisé par fonction et activité. Aussi, le classement actuel respecte le(s) plan(s) de classement adopté(s) lors du versement aux archives du ministère de l'Écologie. Langue des documents • Français Institution responsable de l'accès intellectuel Archives nationales HISTORIQUE DU PRODUCTEUR La sous-direction du développement et de la gestion des réseaux ferroviaires et fluviaux de la direction des Infrastructures de transport est rattachée depuis 2008 à la direction générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer. -

Avril 2021 À L’Adresse : [email protected]
www.cfcim.org 59e année Numéro 1035 15 avril - 15 mai 2021 Dispensé de timbrage autorisation n° 956956 L’INVITÉ DE CONJONCTURE CHRISTIAN HARBULOT Politique de gestion de l’eau au Maroc Une équation complexe Rencontre digitale Visite de Jean-Pascal 31e cérémonie de remise L’actualité vue par le autour de la Journée Darriet, Président de la des diplômes de l’ESA Service économique de Économique d’Essaouira CFCIM, à Agadir Casablanca15 septembre - 15 octobre 2020l’Ambassade - Conjoncture N° de 1028 France - 1 2 - Conjoncture N° 1035 - 15 avril - 15 mai 2021 Editorial Politique de gestion de l’eau au Maroc : une équation complexe Un défi impérieux à relever pour les Jean-Pascal DARRIET Président générations futures L’eau est un enjeu universel qui impacte, à des degrés divers, l’ensemble des pays. La situation est de plus en plus critique à mesure que le changement climatique s’accélère et que les activités humaines se développent. Régulièrement touché par la sécheresse, le Maroc se situe dans l’une des zones où la ressource est la plus rare dans le monde : la région MENA. Le Royaume a depuis longtemps pris conscience de cette problématique et a entrepris au cours des dernières décennies une politique ambitieuse en matière de barrages. Les investissements réalisés, qui ont permis jusqu’à présent de répondre à la majorité des besoins en eau potable et en irrigation, semblent atteindre bientôt leur limite. C’est pourquoi le pays a récemment lancé un nouveau plan national de l’eau 2020-2050 qui met notamment l’accent sur la mobilisation des ressources en eau non conventionnelles telles que le dessalement d’eau de mer, une technologie qui off re un réel espoir pour les zones côtières les plus arides. -

Luque-Ferrocarriles En Europa
Transportes Ferroviarios en Europa Lautaro Luque PDF generado usando el kit de herramientas de fuente abierta mwlib. Ver http://code.pediapress.com/ para mayor información. PDF generated at: Wed, 27 Jul 2011 22:47:13 UTC Contenidos Artículos Railteam 1 Infraestructuras de la Unión Europea 2 Eurotúnel 6 Autopista ferroviaria Perpiñán-Luxemburgo 9 Alta Velocidad Española 10 Train à Grande Vitesse 25 InterCityExpress 41 Eurostar Italia 45 Impacto ambiental de vías terrestres 46 Referencias Fuentes y contribuyentes del artículo 49 Fuentes de imagen, Licencias y contribuyentes 50 Licencias de artículos Licencia 52 Railteam 1 Railteam Railteam es una alianza de siete operadores ferroviarios de alta velocidad fundada en el año 2007. El objetivo del grupo es ofrecer servicios ferroviarios integrados de alta velocidad entre las principales ciudades europeas y competir con las compañías aéreas en puntualidad, protección del medio ambiente, precio y velocidad. Los miembros de Railteam planean lanzar un sistema integrado de venta de pasajes un un web site único en 2009.[1] [2] El 3 de febrero de 2009 del web site de ABTN (Air & Business Travel News) indicaba que existían serios rumores en la industria de que el proyecto había sido cancelado. Ante esto Eurostar anunció que el proyecto continuaba con vida aunque reconoció que ha habido serios problemas con la creación de una plataforma común de reservas. Por ello la implementación de la plataforma común de reservas ha sido aplazada y se ha transformado en una "ambición a largo plazo". En su lugar un sistema basado en internet se pondrá en marcha lo más rápido posible. -

LGV Nord Aus Wikipedia, Der Freien Enzyklopädie
LGV Nord aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie Wechseln zu: Navigation, Suche LGV Nord: Paris–Calais Eurostar auf dem Viaduc de la Haute-Colme Kursbuchstrecke (SNCF): 222 und 250 216 000 (Fretin–Fréthun) Streckennummer (RFF): 226 000 (Gonesse–Lille-Frontière) Streckenlänge: 333 km Spurweite: 1435 mm (Normalspur) Stromsystem: 25 kV 50 Hz ~ Höchstgeschwindigkeit: 300[1] km/h Legende 0,0Paris Gare du Nord Villiers-le-Bel 15,41 Ausfädelung aus der Strecke Paris−Amiens 0,0 Viaduc du Crould (545 m) -12,81Verzweigungsdreieck zur LGV Interconnexion Est Viaduc de Verberie (Oise; 1527 m) Strecke Paris−Compiègne Viaduc de Longueil-Sainte-Marie (A 1) Strecke Amiens−Laon 110,81TGV Haute-Picardie 147,81Verzweigung der Anschlussstrecke nach Arras Strecke Arras−Douai Strecke Lens−Douai Strecke Douai−Lille 197,83 Verzweigung der HSL 1 nach Belgien 0,0 Strecke Lille−Valenciennes Einmündung der HSL 1 aus Richtung Belgien Strecke Lille−Gent 15,97Lille-Europe Strecke Lille−Calais 61,97Ausfädelung zur Strecke nach Dünkirchen Strecke Hazebrouck−Dünkirchen Viaduc de la Haute-Colme (Aa und Canal de la Haute-Colme; 1827 m) Strecke Lille−Calais Ausfädelung zur Strecke Boulogne-sur-Mer−Calais 115,97Calais-Fréthun Einfädelung von der Strecke Boulogne-sur-Mer−Calais Eurotunnel zum CTRL Die LGV Nord, kurz für Ligne à grande vitesse Nord, ist eine Eisenbahn-Schnellfahrstrecke in Frankreich. Sie ist 333 km lang und verbindet Paris mit der belgischen Grenze sowie mit dem Eurotunnel. Die 1993 eröffnete Strecke ist die dritte in Frankreich eröffnete Hochgeschwindigkeitsstrecke.[2] Die betriebliche Höchstgeschwindigkeit auf der für 320 km/h trassierten Strecke liegt bei 300 km/h. -

What Is High Speed Rail? 5 Costs and Financing 5 Why France Built HSR 6 Talk of HSR in the US 8 California’S HSR Project 10
A Culture of High Speeds and Accumulating Debt A CASE STUDY OF FRENCH HIGH SPEED RAIL FINANCING PRACTICES Adeline Collot GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | CITY AND REGIONAL PLANNING 245 4TH STREET NW, SUITE 204 ATLANTA, GA 30332-0155 Table of Contents Table of Figures 3 Abstract 4 Introduction 4 Literature Review 5 What is High Speed Rail? 5 Costs and Financing 5 Why France Built HSR 6 Talk of HSR in the US 8 California’s HSR Project 10 History 11 The Players 11 Rail Reforms 12 Debt 14 Discussion of debt pre-reform 18 French HSR Financing Models 21 Public debt financing 21 Debt & subsidy combination 21 Public-private partnership (P3): design-finance-build-run-maintain 22 Discussion 23 French HSR as a Model? 24 Conclusion 25 References 27 2 Table of Figures FIGURE 1: SNCF AND RFF DEBT 1990-2013 (IN BILLIONS OF EUROS) 13 FIGURE 2: "TRAIN TRIANGLE" MONETARY EXCHANGES 15 FIGURE 3: 2011 INFRASTRUCTURE AND SERVICE COST DISTRIBUTION 16 FIGURE 4: ANNUAL RFF DEFICIT EXCLUDING EXPANSION COSTS 2004-2013 17 FIGURE 5: INDEX OF TRAVEL PRICES FROM 1998-2013 IN FRANCE 17 FIGURE 6: 2008-2013 CHANGE IN KILOMETERS TRAVELED BY MODE 19 FIGURE 7: HISTORIC TREND OF 10 YEAR BORROWING RATE FOR FRANCE & USA 20 FIGURE 8: FINANCING HSR PROJECTS UNTIL 1997 21 3 Abstract This paper set out to studY the methods used to finance High Speed Rail (HSR) in France. It began bY introducing the concept of high speed rail and the historY of rail development in France to provide context for the state of rail in France today. -

Tesina Completa
TESINA D’ESPECIALITAT Títol IMPACTE DE L’ALTA VELOCITAT EN LA MODERNITZACIÓ O CONSTRUCCIÓ D’ESTACIONS 722 – TES – CA – 5070 Autor/a Garcia Q. del Campo, Albert Tutor/a López Pita, Andrés Departament Infraestructura del Transport i Territori Intensificació Transports Data 18-02-2011 Impacte de l’alta velocitat en la modernització o construcció d’estacions Agraïments La realització d’aquesta tesina no hauria estat possible si no fos per totes les persones que m’han acompanyat i recolzat durant aquesta etapa universitària que estic a punt de finalitzar. És per això que voldria aprofitar aquesta pàgina per agrair-los el suport que m’han donat. En primer lloc vull començar pels meus pares, la Bhing i l’Antonio. Ells em van inculcar des de petit la importància de prioritzar la meva formació acadèmica per tal d’aconseguir un ventall més ampli d’oportunitats en el meu futur professional. Sense la seva estima, la seva dedicació i el seu esforç jo no hauria pogut arribar fins aquí. Seguidament vull agrair a la Marta, per ajudar a superar-me en les dificultats i per tenir sempre un somriure per a mi. I sobretot, per la seva fidelitat i amor cap a mi. Des de fa gairebé tres anys s’ha convertit en el centre de la meva vida, a ella li dec bona part de la meva felicitat. No voldria oblidar-me de tots els companys que m’han acompanyat en aquest camí, des d’aquell llunyà primer dia en què vaig aterrar al món universitari. Gràcies per compartir tantes experiències, tant a les classes, com a l’acadèmia, a la biblioteca, a les pràctiques, al viatge d’estudis, als interminables treballs al Centre de Càlcul, i com no, als sopars i a les festes dels dijous.