Santé Intérieur
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Commercial Release Sheet (PDF)
GCD P32103 Poissance d’amours New release information February 2008 Graindelavoix “Le grain, c’est le corps dans la voix qui chante, dans la main qui écrit, dans le membre qui exécute...” (Roland Barthes) NOTES (ENG) NOTES (FRA) Little attention has been given on record so far La discographie avait jusqu’à présent négligé to the music and writings emanating from the la musique et les écrits extraordinaires dus à flourishing economic and cultural environs of la floraison économique et culturelle du Brabant 13th-century Brabant but it is from the au XIIIe ; et c’est à cette source prodigieuse remarkable outpouring associated with this ayant surgi dans ce duché médiéval que Björn medieval duchy – covering the areas of Brussels, Schmelzer et Graindelavoix ont puisé pour créer Antwerp and the present day Belgian provinces leur troisième volume chez Glossa. Au cours of Vlaams and Walloon Brabant as well as des deux précédents, Caput (GCD P32101) et Noord-Brabant in The Netherlands – that Björn Joye (GCD P32102), Schmelzer et son ensemble Schmelzer and Graindelavoix have created their résident à Anvers ont exploré, dans la musique third recording for Glossa. In Caput (GCD médiévale tardive de Johannes Ockeghem et P32101) and Joye (GCD P32102) Schmelzer de Gilles Binchois, des courants et des tendances and his Antwerp-based ensemble explored in qui illuminent notre temps. Graindelavoix, en the late medieval music of Johannes Ockeghem effet, s’intéresse principalement, dans le cadre Poissance d’amours and Gilles Binchois undercurrents that illuminate de la musique ancienne, à la relation entre la Mystics, monks and minstrels our own times. -

Bibliographie Des Chansonniers Franã§Ais Des Xiiie Et Xive Siãšcles
BIBLIOGRAPHIE CHANSONNIEH RANÇAI LE PU "t'. - 1~1PHBl1:HJ E MA HG!ŒSSOU FILS BIBLIOGRAPHIE DES CHANSONNIERS FRANCAIS. .. DES XIIIe ET XIVe SIÈCLES COMPRENANT LA DESCRIPTION DE TOUS LES MANUSCRITS LA TABLE DES CHANSONS CLASSÉES PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE DE RIMES ET LA LISTE DES TROUVÈRES PAR GASTON RA YN A UD TOME PREMIER DESCRIPTION DES MANUSCRITS PARIS F. VIEWEG, LIBRAIRE- ÉDI TEUR 67, RUE RlCHELlllU. 67 1884 INTRODUCTION Les travaux préliminalres de l'édition des œuvres de Tiébaut de Champagne, que je prépare depuis plusieurs années et qui verra bientôt le jour, m'ont conduit à étu dier de près tous les manuscrits de chansons françaises du moyen âge; j'ai dû, à cette occasion, parcourir ces manuscrits, les dépouiller complètement et dresser pour mon usage une table générale, d'où je pusse extraire, dans son intégrité, la bibliographie des chansons du Roi de Navarre, qui trop souvent, dans certains manuscrits, sont anonymes ou ont de fausses attributions. C'est ce travail, complété et augmenté, que je présente aujour d'hui au public; il sera, je l'espère, utile, et évitera aux travailleurs bien des recherches et des tâtonnements, en leur permettant de prendre connaissance, à l'aide du premier vers d'une chanson, des manuscrits qui la con tiennent et des éditeurs qui l'ont publiée, et, d'autre part, de retrouver, sous le nom de chaque trouvère, les pièces qui lui sont attribuées, à tort ou à raison. L'idée, du reste, n'est pas absolument nouvelle: déjà, J:\ITnODUC'j au XVIIie siècle, La Borde, dans son Essai sur la musique (t. -
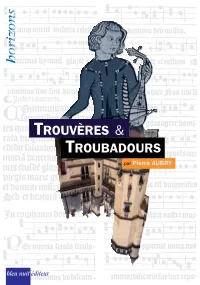
Trouvères & Troubadours
TROUVÈRES & TROUBADOURS par Pierre AUBRY bleu nuit éditeur Trouvères & Troubadours dans la même collection: 1. Alexandre BORODINE par André Lischké 32. César FRANCK par Eric Lebrun 2. Le Clavecin des Lumières par Jean-Patrice Brosse 33. Giuseppe VERDI par Patrick Favre-Tissot-Bonvoisin 3. Leos JANACEK par Patrice Royer 34. Charles-Valentin ALKAN par B. François-Sappey & F. Luguenot 4. Jean SIBELIUS par Pierre Vidal 35. Francis POULENC par Isabelle Werck 5. Etienne Nicolas MÉHUL par Adélaïde de Place 36. Edvard GRIEG par Isabelle Werck 6. Gaston LITAIZE par Sébastien Durand 37. Wolgang Amadeus MOZART par Yves Jaffrès 7. Dietrich BUXTEHUDE par Eric Lebrun 38. Camille SAINT-SAËNS par Jean-Luc Caron & Gérard Denizeau 8. Guillaume LEKEU par Gilles Thieblot 39. Antonio SALIERI par Marc Vignal 9. Jan Dismas ZELENKA par Stéphan Perreau 40. Anton BRUCKNER par Jean Gallois 10. Maurice EMMANUEL par Christophe Corbier 41. Jean-Philippe RAMEAU par Jean Malignon & J.-Philippe Biojout 11. André JOLIVET par Jean-Claire Vançon 42. Christoph Willibald GLUCK par Julien Tiersot 12. Richard STRAUSS par Christian Goubault 43. Carl NIELSEN par Jean-Luc Caron 13. Alexandre P. F.BOËLY par B. François-Sappey & E. Lebrun 44. Ludwig van BEETHOVEN par Patrick Favre-Tissot-Bonvoisin 14. Gaetano DONIZETTI par Gilles de Van 45. Charles GOUNOD par Yves Bruley 15. Gioachino ROSSINI par Gérard Denizeau 46. Manuel de FALLA par Gilles Thieblot 16. Antonio VIVALDI par Adélaïde de Place & Fabio Biondi 47. Charles-Marie WIDOR par Anne-Isabelle de Parcevaux 17. Edouard LALO par Gilles Thieblot 48. Ralph VAUGHAN WILLIAMS par Marc Vignal 18. -

Troubadours NEW GROVE
Troubadours, trouvères. Lyric poets or poet-musicians of France in the 12th and 13th centuries. It is customary to describe as troubadours those poets who worked in the south of France and wrote in Provençal, the langue d’oc , whereas the trouvères worked in the north of France and wrote in French, the langue d’oil . I. Troubadour poetry 1. Introduction. The troubadours were the earliest and most significant exponents of the arts of music and poetry in medieval Western vernacular culture. Their influence spread throughout the Middle Ages and beyond into French (the trouvères, see §II below), German, Italian, Spanish, English and other European languages. The first centre of troubadour song seems to have been Poitiers, but the main area extended from the Atlantic coast south of Bordeaux in the west, to the Alps bordering on Italy in the east. There were also ‘schools’ of troubadours in northern Italy itself and in Catalonia. Their influence, of course, spread much more widely. Pillet and Carstens (1933) named 460 troubadours; about 2600 of their poems survive, with melodies for roughly one in ten. The principal troubadours include AIMERIC DE PEGUILHAN ( c1190–c1221), ARNAUT DANIEL ( fl c1180–95), ARNAUT DE MAREUIL ( fl c1195), BERNART DE VENTADORN ( fl c1147–70), BERTRAN DE BORN ( fl c1159–95; d 1215), Cerveri de Girona ( fl c1259–85), FOLQUET DE MARSEILLE ( fl c1178–95; d 1231), GAUCELM FAIDIT ( fl c1172–1203), GUILLAUME IX , Duke of Aquitaine (1071–1126), GIRAUT DE BORNELH ( fl c1162–99), GUIRAUT RIQUIER ( fl c1254–92), JAUFRE RUDEL ( fl c1125–48), MARCABRU ( fl c1130–49), PEIRE D ’ALVERNHE ( fl c1149–68; d 1215), PEIRE CARDENAL ( fl c1205–72), PEIRE VIDAL ( fl c1183–c1204), PEIROL ( c1188–c1222), RAIMBAUT D ’AURENGA ( c1147–73), RAIMBAUT DE VAQEIRAS ( fl c1180–1205), RAIMON DE MIRAVAL ( fl c1191–c1229) and Sordello ( fl c1220–69; d 1269). -

Authors and Other Persons Connected with the Songs Symbols: * Not Listed in SR L Lai , Mentioned in the Poem R Rondeau 7 Aseription by a Modern Seholar S
74 Authors and Other Persons Connected with the Songs Symbols: * not listed in SR L lai , mentioned in the poem r rondeau 7 aseription by a modern seholar s. see (7)questionable aseription A * Abbé de Vieoigne 1021 ' * Abélard, Pierre L 1 Adam de Givenei 62(7),62',541,625,665,815,959,11 08--L2-1,3 * Adam de la Bassée 317-2,423-3,554-3, 669-3,960-2,1169-3,1206-6 L29-2,35-3--R35 Adam de la Halle 36,87-1 /2,89--147,66,93,96--207,50,85,86,90--354,366,384 410,20,42' ,95--520' ,27,62,95,99--615,19,32,72,75,700--704,21,79 812,15,22,26--916,23,60-1,71 ,87,89--1 018,33,44,51--1124,52,53,62 1219 * Adam de St.Vietor L92 * Adam de Wailli 26' * Adam Esturion Belemote 26' * Ade de Persan(Perçain) L38' * Adeline de Nanteuil L38' Adenarde, darne d'--s. Oudenarde, darne d' Aélis--s. also Alix * Aélis 742',786' * Aélis, eomtesse de Chartres 1079' ,1134'7 * Aélis, eomtesse de Clermont L38' * Aélis de Gallardon (Garlandon) L38' * Aélis de Moneeaux L38' * Aélis de Montmoreney et Montfort L38' * Aélis de Roleis(Reuilly) L38' * Aélis de Trie L38' * Agnès de Cresonsart L38' * Agnès de Trieot(Trieeoe) L38' * Agnes play 203-5 Alart de C(h)ans 220-1,298-1,394-1 * Albert(et) de Sestarto(Sisteron) 457,L4-3 * Alens de Challon, li 943-1 * Alix, eomtesse de Chartres 1079' * Alix, dame de Couti, wife of Raoull, seigneur de Couei L38' * Alix de Champagne, rO'ine 1 054-1' Alos, comte d'-s. -

Lo Non Intendo Ad Altro Che a Intavulare« 1 Ta
1 ·lo non intendo ad altro che a intavulare« 1 Avec ce titre ·INTAVULARE", qui évoque l'activité intense des humanistes et singulièrement d'Angelo Colocci, particulièrement important pour nous - nous avons voulu suggérer que nous suivons aujourd'hui la voie qu'ils ont si utilement ouverte, mus par une égale curiosité et par une passion identique pour les chansonniers de la première lyrique romane et, nous l'espérons, fidèles à leurs enseignements. Mais il ne s'agit pas seulement d'un souvenir exemplaire : concrètement, ce qui nous a incités à entreprendre la présente recherche, ce fut d'avoir étudié leurs précieuses tables, établies avec une sorte de frénésie et le plus souvent séparées de leur contexte, pour tenter de débrouiller l'écheveau de leurs rapports avec les manuscrits eux-mêmes, écheveau qui s'apparente souvent à une énigme policière, parfois résolue, comme dans le cas de la ta vola colocciana ·A utori portughesi,2 ou la table humaniste du chansonnier provençal A3. Plus immédiatement évident encore est l'autre souvenir, celui des Tables anciennes, qui accompagnent, mais trop rarement, les chansonniers, et ne coïncident pas toujours avec eux dans l'enregistrement des pièces. Par rapport aux unes et aux autres (Tables anciennes et Tables humanistes), nos tables (que nous désignerons du terme plus rapide et plus 'moderne' d'Index) ont une autre fin : non plus •tables-mémoire· comme le sont d'habitude celles des humanistes, privées de toute référence à la localisation des textes dans les manuscrits, et pas davantage (ou du moins -

Repertorio Delle Attribuzioni Discordanti Nella Lirica Trovierica
Studi e Ricerche Studi umanistici – Philologica Repertorio delle attribuzioni discordanti nella lirica trovierica Luca Gatti Prefazione di Luciano Formisano University Press Collana Studi e Ricerche 79 Studi umanistici Serie Philologica Repertorio delle attribuzioni discordanti nella lirica trovierica Luca Gatti Prefazione di Luciano Formisano 2019 Studi umanistici Serie Philologica Repertorio delle attribuzioni discordanti nella lirica trovierica Luca Gatti Prefazione di Luciano Formisano 2019 Il volume è pubblicato con il contributo di Sapienza Università di Roma (Fondi di Avvio alla Ricerca 2015). Copyright © 2019 Sapienza Università Editrice Piazzale Aldo Moro 5 – 00185 Roma www.editricesapienza.it [email protected] Iscrizione Registro Operatori Comunicazione n. 11420 ISBN 978-88-9377-113-9 DOI 10.13133/9788893771139 Pubblicato ad agosto 2019 Quest’opera è distribuita con licenza Creative Commons 3.0 diffusa in modalitàopen access. In copertina: opera di Benedetta Moracchioli. Ai miei nonni Indice Prefazione ix 1. Introduzione 1 1.1. Le bibliografie della lirica trovierica 1 1.2. Ragioni di un Repertorio delle attribuzioni discordanti 5 nella lirica trovierica 1.3. Esami statistici 9 1.4. Discordanza fra testo e rubrica 13 1.4.1. Esempi di tradizione passiva 13 1.4.2. Esempi di tradizione attiva 18 1.4.3. Difformità attributive nei jeux-partis 22 1.5. I confini delle attribuzioni 24 1.6. Ragioni delle discordanze 26 1.6.1. Ragioni codicologiche 29 1.6.2. Ragioni analogiche 35 2. Descrizione dei codici 43 3. Corpus degli autori privi di scheda Linker 87 IL REPERTORIO Il Repertorio: istruzioni per l’uso 95 4. Repertorio per manoscritti 105 5. -

907317 Spanish For
HMU 907317 LOS MILAGROS DE NUESTRA SEÑORA Poemas de alabanza a la Virgen escritos por Gauier de Coincy (1177-1236) y adaptados a canciones populares medievales “Había instrumentos de todas clases, y los músicos cantaban con voces potentes. Y sabían como interpretar bien todo tipo de canciones populares. Y con técnicas vocales excelentes, cantaban motetes y conductus.” – “Panthere d’Amors,” Nicole de Margival, siglo XIII 1 “¿Por qué debería el diablo tener toda la mejor música?” – Canción popular, Larry Norman, 1977 2 ientras los trovadores sembraban el viento del sur de Francia, por el año 1200 los troveros, sus primos del norte, cosechaban el torbellino. La nobleza altisonante de la lírica provenzal y M la sofisticación académica de los poetas de educación universitaria desciende a niveles más realistas gracias a la traviesa malicia de los coristas de la catedral y la notable decadencia de los estudiantes parisinos, por la energía vigorosa de los músicos de la clase obrera y los excesos paganos de celebraciones campesinas. La Obra de Daniel, hoy considerada uno de los más altos logros dentro del drama musical medieval, se escribió no para estimular la algarabía festiva, sino para controlar y limitar la tradicional parranda. Subdiáconos de la catedral de Beauvais utilizaron como pretexto la fiesta del Día de los Inocentes para permitir—dentro de la misma iglesia—la monta de burro, carcajadas, ruido y correteos, dar palmas, bailar y tocar instrumentos, salvaje tañer de las campanas de la catedral; fiesta, juegos de dados y adivinación de la fortuna en el altar, violencia y falta de respeto abierta hacia la jerarquía religiosa. -

A Bibliography of Old French Lyrics
ROMANCE MONOGRAPHS, INC. Number 31 A BIBLIOGRAPHY OF OLD FRENCH LYRICS BY ROBERT WHITE LINKER UNIVERSITY, MISSISSIPPI ROMANCE MONOGRAPHS, INC. 1 9 7 9 CoPYRIGHT © I979 BY RoMANCE MoNOGRAPHs, INc. P.O. BOX 7553 UNIVERSITY, MISSISSIPPI 38677 IMPRESO EN ESPANA PRINTED IN SPAIN I.S.B.N. 84-499-2809-5 DEPOSITO LEGAL: V. 1.532- I979 To Dorothy Insley Linker ARTES GRAFICAS SOLER, S. A. - JAVEA, 28 - VALENCIA (8) - I979 Dorothy Linker Sander Thomas Polk Linker Professor Linker submitted the present work for publication three months before his death, November 13, 1976. Library of Congress Cataloging in Publication Data Linker, Robert White. A bibliography of old French lyrics. (Romance monographs; no. 3I) Bibliography: p. Includes index. 1. French poetry- To 1500-Bibliography. I. Title. [PQI5I] 79-11948 TABLE OF CONTENTS Page INTRODUCTION . .. 9 TABLE OF ABBREVIATIONS ..... ..... ...... I2 LINKER NUMBERS . • . I9 PART I A. BIBLIOGRAPHIES OF MANUSCRIPTS . .. 23 B. MANUSCRIPTS, FACSIMILES, EDITIONS 25 I. Major Manuscripts . .. 25 2. Lesser Manuscripts . .. 41 3· Longer Works Containing Lyrics .. 63 4· Provenc;:al MSS Containing French Poems 68 C . GENERAL PuBLICATIONS ........ ... ... .. 70 D. EDITIONS BY TYPES . .. E. EDITIONS BY REGIONS . .. F. METRICS AND MUSIC ... ....... •... .. .... ... ( G. INDEX OF ABBREVIATIONS OF TROUVERES' NAMES PART II A. OLD FRENCH LYRICS 93 1. By Author . .. 93 2. Anonymous . 253 B. CROSS-INDEX OF RAYNAUD AND LINKER NUMBERS . 386 INTRODUCTION The standard bibliography of Old French lyrics has, since 1884, been Raynaud's Bibliographie des chansonniers franfais. In Volume 11 Raynaud listed each lyric alphabetically according to rhyme word, with an index giving the number of each poem assigned to authors. -

Lajos Cimnegyed Cimnegyed2.Qxd 2/15/2016 1:28 PM Page 1
Lajos cimnegyed_cimnegyed2.qxd 2/15/2016 1:28 PM Page 1 Jean de Joinville SZENT LAJOS ÉLETE ÉS BÖLCS MONDÁSAI Lajos cimnegyed_cimnegyed2.qxd 2/15/2016 1:28 PM Page 2 A KÖZÉPKORI FRANCIA TÖRTÉNETI IRODALOM REMEKEI II. Sorozatszerkesztõ CSERNUS SÁNDOR KÉSZÜLT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK KÖZÉPKORI EGYETEMES TÖRTÉNETI TANSZÉKÉN Lajos cimnegyed_cimnegyed2.qxd 2/15/2016 1:28 PM Page 3 Jean de Joinville SZENT LAJOS ÉLETE ÉS BÖLCS MONDÁSAI Közreadja CSERNUS SÁNDOR JACQUES LE GOFF könyvrészletével CSERNUS SÁNDOR ZIMONYI ISTVÁN tanulmányaival BALASSI KIADÓ · BUDAPEST Lajos cimnegyed_cimnegyed2.qxd 2/15/2016 1:28 PM Page 4 A kötet megjelenését támogatta SZTE Bölcsészettudományi Kara Lendület „Magyarország a Középkori Európában” MTA–DE Kutatócsoport / LP2014-13/2014 A jegyzeteket írta és a segédleteket összeállította CSERNUS SÁNDOR Fordította CSERNUS SÁNDOR CS. TÓTH ANNAMÁRIA A térképeket rajzolta SZÁNTÓ RICHÁRD A borítón Damietta elfoglalása. Miniatúra Jean de Joinville mûvének 14. századi másolatában. Párizs, Bibliothèque nationale de France, Département des Manuscrits, Français 13568, f. 83 Köszönetnyilvánítás / Remerciements Gallimard Kiadó, Párizs / les Éditions Gallimard, Paris Jacques Le Goff örökösei / les héritiers de Jacques Le Goff Joinville város Polgármestere és Polgármesteri Hivatala / le Maire et la Mairie de Joinville Joinville, Miasszonyunk-templom / l’Église Notre-Dame de Joinville Blécourt Polgármestere és Polgármesteri Hivatala / le Maire et la Mairie de Blécourt Hungarian translation © Csernus Sándor, Cs. Tóth Annamária, 2015 © Csernus Sándor, Zimonyi István (tanulmányok), 2015 © Éditions Gallimard, Paris, 1996 (Jacques Le Goff) ISBN 978-963-506-963-7 A kiadásért felel a Balassi Kiadó igazgatója Felelõs szerkesztõ Tamás Zsuzsanna Sorozatterv Szák András Mûszaki szerkesztõ Harcsár Magda Nyomás és kötés az OOK Press Kft.-ben készült Felelõs vezetõ Szathmáry Attila Lajos cimnegyed_cimnegyed2.qxd 2/15/2016 1:28 PM Page 5 TARTALOM SZENT LAJOS ÉLETE ÉS BÖLCS MONDÁSAI / 9 (Fordította Csernus Sándor és Cs. -

Actas Del IX Congreso Internacional De La Asociación Hispánica De Literatura Medieval
www.ahlm.es Actas del IX Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (A Coruna, 18-22 de septiembre de 2001) III 2005 www.ahlm.es Actas del IX Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, 2005. © Carmen Parrilla © Mercedes Pampín © Toxosoutos, S.L. Primera edición, septiembre 2005 © Toxosoutos, S.L. Chan de Marofias, 2 Obre - 15217 Noia (A Coruña) Tfno.: 981 823855 Fax.: 981 821690 Correo electrónico: [email protected] Local en la red: wvvTv.toxosoutos.com I.S.B.N. obra conjunta: 84-96259-72-2 I.S.B.N. volumen: 84-96259-75-7 Depósito legal: C-2072-2005 Impreso por Gráficas Sementeira, S.A. - Noia Reservados todos los derechos www.ahlm.es Sur une chanson à acrostiche d'un trouvère appelé Gilet Edith de la Marnière Pour Orland Grapi Collègue, ami et témoin L'usage de l'acrostiche est fort ancien. Tout au long de l'histoire littéraire, cet artifice s'est vu utilisé pour souligner certains termes ou signaler le nom d'un auteur, d'une œuvre ou encore celui du personnage auquel le texte est envoyé. Pour ce qui est de la littérature médiévale en langue d'oïl,^ les exemples les plus clairs sont visibles dans la narrative en vers. Ainsi, Jakemon Sakesep, auteur du Roman du Châtelain de Coud, nous révèle son nom à travers un habile acrostiche.^ Adans li Roi, dans son roman Cléomades, annonce pour sa part que "deux dames qu'il ne veut nommer que couvertement car il mourrait plutôt que de faire ou dire quelque chose qui ne leur fut agréable, lui commandèrent d'écouter l'histoire de Cléomades".^ Or ces noms ne se trouvent nulle part dans le corps du texte. -
Cahiers De Recherches Médiévales Et Humanistes, 26
Cahiers de recherches médiévales et humanistes Journal of medieval and humanistic studies 26 | 2013 Musique et littérature au Moyen Âge John Haines (dir.) Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/crm/13382 DOI : 10.4000/crm.13382 ISSN : 2273-0893 Éditeur Classiques Garnier Édition imprimée Date de publication : 30 décembre 2013 ISBN : 978-2-8124-2933-0 ISSN : 2115-6360 Référence électronique John Haines (dir.), Cahiers de recherches médiévales et humanistes, 26 | 2013, « Musique et littérature au Moyen Âge » [En ligne], mis en ligne le 30 décembre 2016, consulté le 13 octobre 2020. URL : http:// journals.openedition.org/crm/13382 ; DOI : https://doi.org/10.4000/crm.13382 Ce document a été généré automatiquement le 13 octobre 2020. © Cahiers de recherches médiévales et humanistes 1 SOMMAIRE Musique et littérature au Moyen Âge : héritage et témoignage des travaux de Pierre Aubry et Jean Beck Introduction. Musique et littérature au Moyen Âge : héritage et témoignage des travaux de Pierre Aubry et Jean Beck John Haines À l’ombre d’Orphée : variations médiévales sur le mythe d’Amphion Jean-Marie Fritz L’organum, un art de cathédrale ? Musiques autour de saint Guillaume Guillaume Gross « Faire gaia chanso » : la tradition des troubadours, un art de faire entre musique et littérature Christelle Chaillou-Amadieu À la défense des mélodies « marginales » chez les trouvères : le cas de Thibaut IV de Champagne Christopher Callahan La sapience secrète et le rêve révélateur dans le traité Desiderio tuo, fili karissime John Haines On connaît la chanson : la contrafacture des mélodies des trouvères dans le Ludus super Anticlaudianum d’Adam de la Bassée Daniel E.